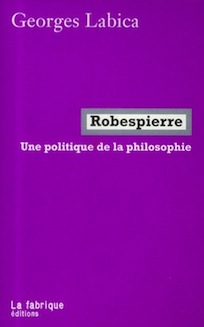
A lire : préface de « Robespierre » (de Georges Labica)
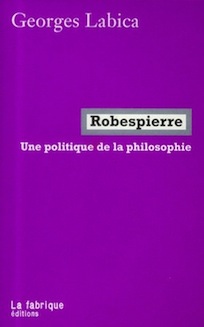
G. Labica, Robespierre. Une politique de la philosophie, Paris, éd. La Fabrique, 2013, 209 pages.
Robespierre dans une trajectoire intellectuelle
La parution de Robespierre : une politique de la philosophie en 1991 associe étroitement intervention dans une conjoncture et trajectoire d’une œuvre. Commençons par ce deuxième versant, plus méconnu. Georges Labica (1930-2009) est généralement, et justement, connu comme philosophe marxiste, communiste et comme militant anti-impérialiste indéfectible. De cette cohérence-là, on peut être sûr. Cependant, s’il a eu, tout au long de son existence, nombre de collaborateurs et d’interlocuteurs, sa contribution n’est pas, du moins pour l’instant, et à de rares exceptions près1, l’objet de discussions ou d’analyses approfondies d’une œuvre en tant que telle, avec ses continuités de gestes, de figures et de problèmes.
Il y au moins deux raisons principales à cela. Georges Labica a consacré la majeure partie de son travail intellectuel (seul ou collectivement) à diriger l’attention vers la rencontre de textes et d’auteurs, dont il s’est agi avant tout d’inviter à la lecture, de donner à connaître, et ce, jusqu’à une certaine forme d’effacement. Le Dictionnaire critique du marxisme, comme grande entreprise collective nécessitant plusieurs années de travail et de coordination, relève aussi de ce type de préoccupation, bien entendu. Mais cette démarche, dans des formes différentes, et inaugurée avec le travail de présentation d’Ibn Khaldun, est distinctement celle d’ouvrages tels que Karl Marx : Les Thèses sur Feuerbach (1987) ou de l’édition, élaborée avec Bernard Lafite, du Cahier bleu (Le marxisme quant à l’État) (1977) de Lénine. Dans de tels cas, le souci quasi-obsessif de la lettre de textes – qui, en l’occurrence, ne sont que des fragments ou des ébauches – tient plus de celui de l’éditeur-historien, ou du chercheur en génétique textuelle que du commentaire philosophique et de l’extrapolation personnelle. Labica est, dans une large mesure, sur ce terrain de la production écrite, un praticien de la lecture intensive à des fins de pédagogie d’un marxisme pleinement politique. S’il n’était certes pas hostile à l’inventivité interprétative et à son caractère centrifuge, on trouve chez lui une discipline de lecture et d’attention méticuleuse qui tend à interdire toute rapidité en besogne quant à l’outillage théorique jugé d’une importance primordiale dès lors qu’il s’agit de penser le problème central : la question révolutionnaire (sa conjoncture, ses forces historiques, ses diverses élaborations conceptuelles). Et c’est d’ailleurs à ce titre révolutionnaire (et on ne saurait trop y insister ici) que Marx et Lénine forment l’axe de l’engagement militant de G. Labica dans sa constance même, que les temps et les lieux de cet engagement soient ceux de la pédagogie ou ceux de l’intervention politique. Par conséquent, en termes de trajectoire, le Robespierre relève du même registre stable de pratiques pédagogiques textuelles, politiques et conceptuelles. Ajoutons que c’est ce même attachement à la lettre que l’on retrouve dans un goût marqué pour l’écriture elle-même, une singularité d’expression qui, en plus d’une occasion, croise les voies de la sophistication stylistique, de l’écriture poétique, de la provocation et de l’humeur, éruptive parfois. Mais on observe là encore qu’en dépit du nombre considérable de contributions à quantités de revues, et de la satisfaction personnelle éprouvée lors de la parution de chaque livre, G.?Labica n’a quasiment jamais cherché à entretenir une actualité éditoriale particulière qui aurait pu consister en des publications de recueils de ces textes disséminés. Reprendre, mettre à jour, augmenter… ? On soupçonnera sans risque qu’en ce qui le concernait, il n’y voyait pas d’intérêt (Démocratie et Révolution, paru en 2003, est le seul exemple de ce type de regroupement. Il faudra au moins brièvement y revenir).
Avec cet enjeu de la lecture intensive comme méthode récurrente, il faut relever un autre facteur de relatif auto-effacement de G. Labica comme auteur (qui pour ainsi dire, fait autorité en tant qu’il contribue à faire connaître, établir l’autorité de son objet – fragments, ébauches –ainsi rendu utilisable et mobilisable). Cet autre facteur tient au choix des auteurs et des problèmes eux-mêmes.
Du côté des auteurs, de manière répétée, G.?Labica s’est consacré à faire connaître des figures, dans certains cas, oubliées ou négligées : Ibn Khaldun et Ibn Tufayl dans l’Algérie des années 1960, Antonio Labriola, dans les années 1980, par exemple ; dans d’autres cas, irrécupérables : Lénine (que l’on pense au Cahier bleu ou à la réédition du L’Impérialisme en 2001, entre autres) puis, dans le contexte très hostile du bicentenaire, Robespierre. Du côté des objets, et en lien avec ces auteurs, comme il va de soi, les priorités se situaient du côté de la question révolutionnaire, du communisme, de l’impérialisme, mais aussi, aux rapports entre politique (marxiste, stratégique, à visée émancipatrice) et religion, et ce, bien avant le récent regain d’intérêt pour ce sujet. Il suffit d’observer la stabilité de cet enjeu qui court depuis le premier livre, Politique et Religion chez Ibn Khaldun : essai sur l’idéologie musulmane (Alger, 1968) jusqu’au troisième et dernier chapitre du Robespierre : « Philosophie et religion », et à l’ouvrage codirigé avec Jean Robelin en 1994, Politique et Religion, via les entrées « Religion », « Agnosticisme » et « Millénarisme » du Dictionnaire critique. Une remarque à ce propos : l’attention insistante accordée à la question de la religion n’a rien de surprenant si l’on tient compte de ce que, premièrement, elle recoupe d’emblée celle de « l’idéologie », si souvent pensée avec le vocabulaire du religieux chez Marx, des « visions du monde », de « l’aliénation » et de la « réification », toutes choses éminemment marxiennes auxquelles G. Labica consacre beaucoup de travail (que ce soit dans le Dictionnaire ou dans Le Paradigme du Grand-Hornu : essai sur l’idéologie, 1987, et ailleurs encore) ; et en ce que, deuxièmement, la préparation de l’événement révolutionnaire et la diffusion du projet à échelle de masse ne peut poser l’athéisme radical comme préalable. Autrement dit, se rencontrent dans le marxisme de G. Labica, à la fois, un déploiement possible du programme contenu dans la formule de Marx utilisée en exergue à Ibn Khaldun, «?la critique de la religion est la condition de toute critique », et le prolongement des visions politiques marquées par un certain anti-élitisme qui furent celles d’un Robespierre ou, dans de toutes autres circonstances, d’un Lénine, lequel n’hésitait pas écrire (exemple parmi bien d’autres) en 1905 :
« Ni les livres ni la propagande n’éclaireront le prolétariat s’il n’est pas éclairé par la lutte qu’il soutient lui-même contre les forces ténébreuses du capitalisme. L’unité de cette lutte réellement révolutionnaire pour se créer un paradis sur terre nous importe plus que l’unité d’opinion des prolétaires sur le paradis du ciel. Voilà pourquoi, dans notre programme, nous ne proclamons pas et nous ne devons pas proclamer notre athéisme ; voilà pourquoi nous n’interdisons pas et ne devons pas interdire aux prolétaires, qui ont conservé tels ou tels restes de leurs anciens préjugés, de se rapprocher de notre Parti. Nous préconisons toujours la conception scientifique du monde ; il est indispensable que nous luttions contre l’inconséquence de certains « chrétiens », mais cela ne veut pas du tout dire qu’il faille mettre la question religieuse au premier plan, place qui ne lui appartient pas ; qu’il faille laisser diviser les forces engagées dans la lutte politique et économique véritablement révolutionnaire au nom d’opinions de troisième ordre ou de chimère […]2. »
Pour ce qui est des irrécupérables, les choses ne s’arrêtent pas là, loin s’en faut. Outre le fait de la défense du projet communiste révolutionnaire en temps de reflux massif après les grands moments d’espérance des années 1960 et 1970 dans les métropoles de l’impérialisme et dans le tiers-monde, G.?Labica consacre une grande partie de son activité militante à la question palestinienne et en outre, dans les années 2000, à la campagne contre les conditions d’incarcération faites aux détenus d’Action Directe, notamment à travers les visites qu’il rendit régulièrement à Joëlle Aubron à la prison de Bapaume et à travers la correspondance qu’il entretint avec elle. Or, ce qui est posé à travers ces deux situations aux enjeux et aux proportions profondément hétérogènes, c’est l’absolutisation d’un ennemi dont peuvent alors s’autoriser des États (se revendiquant « de droit ») pour pratiquer des perforations de plus en plus massives de leur propre droit au nom d’une nécessité « exceptionnelle » (la « guerre au terrorisme ») ; régime exceptionnaliste dans le droit international pour la politique d’occupation israélienne, régime d’exception fabriqué dans le droit national français permettant de juger et rejuger des détenus jusqu’à ce que, littéralement, mort s’ensuive. Deux figures emblématiques de la production exceptionnaliste d’illégalismes par le haut, donc, et que prolongent, confirment, diffusent, normalisent, Abou Ghraïb, Guantanamo, les transferts secrets de prisonniers [extraordinary renditions] promis à des méthodes de torture « propre » ou « sans trace » [stealth torture]. Tout indique bien aujourd’hui que l’horreur terroriste politiquement et médiatiquement mise en scène depuis le 11 septembre 2011 était déjà porteuse du projet à peine codé de l’enfer impérialiste de dernière génération programmé pour des populations entières. Le tableau de ces trous dans le droit serait sans fin, de l’évasion fiscale massive comme institution au traitement des étrangers illégalisés et à la confusion stratégique jetée dans le droit du travail.
G.?Labica, dans les mois qui précédèrent sa disparition, avait accumulé un ample répertoire de récents cas de justice à deux vitesses en France. Une simple et bonne raison à cela est que tout militant de la cause des dominés a vocation à documenter empiriquement et au jour le jour les contorsions de la justice de classe contre ce que le droit peut avoir enregistré d’avancées antérieures dans des périodes de conquêtes sociales et juridiques. Mais au-delà, il s’agit aussi de documenter la production d’illégalismes inhérente à la violence des rapports de forces sociaux.
La rébellion violente et permanente des dominants, en phase de restauration néolibérale du pouvoir de classe depuis trente ans, s’en prend au droit avec d’autant plus, maintenant, d’entrain que se manifeste, à travers ces coups de forces multiples, ce qui peut être, à l’occasion, présenté comme un viril exercice du pouvoir. À tel point que, par exemple, des universitaires spécialisés en histoire du droit en sont venus à juger utile de poser une « hypothèse du néoféodalisme » à travers laquelle il s’agit d’identifier, avec toute la rigueur savante nécessaire, les tendances à la « fragmentation » ou à la « décomposition » du système juridique national en particularismes de la production de normes et de règles3. Le personnel politique de Dick Cheney, dans un rapport minoritaire de 1987 rédigé sous son autorité sur l’Iran-Contra4, ne proposait-il pas déjà qu’au nom de la sécurité nationale états-unienne, «?le chef de l’exécutif sentira, dans certains cas, qu’il est de son devoir d’affirmer des principes de prérogative monarchique [notions of monarchichal prerogative] qui lui permettront d’outrepasser le droit [exceed the law] » ? Ainsi, saisi à échelle individuelle/nationale ou collective/internationale, ces productions d’illégalismes au gré des rapports de forces contemporains, forment un tableau immédiatement cohérent avec la question des illégalismes soulevée dans le Robespierre. En l’occurrence, les illégalismes se produisent et s’affrontent et ont vocation à le faire dès lors que le champ du droit se conçoit comme lieu d’enregistrement des rapports de forces dont les formes juridiques temporaires ne sont alors que le produit de cette trame illégaliste.
En contrepoint aux normalisations contemporaines de l’état d’exception indispensable au régime néolibéral de domination de classe (comme rébellion permanente et violente contre les gains historiques du mouvement ouvrier et des peuples), en contrepoint donc,l’illégalité appartient à la logique interne du procès révolutionnaire. Pour Robespierre elle lui appartient deux fois. La première, parce que toute révolution est suspensive de la loi. Elle l’est par définition : la révolution abolit l’ordre antérieur. Elle est l’intervalle entre deux légalités […] Elle est, en second lieu, le produit d’une raison coextensive à la nature, d’une raison qui rétablit la nature dans ses droits, lesquels sont, Robespierre l’affirme à suffisance, imprescriptibles.
Problème du droit naturel chez Robespierre, problème de la dictature du prolétariat comme bris et dépérissement de l’État chez Lénine, indissociables, dans un cas comme dans l’autre, de la question de la démocratie, de « l’inadmissible de la démocratie dans la démocratie bourgeoise1 ». On va avoir l’occasion d’y revenir mais soyons d’ores et déjà tout à fait certains que les généralisations de la fantasmagorie cauchemardesque antitotalitaire n’ont pas tant à voir avec la liquidation des droits démocratiques, l’intimidation et la peur instituées en régime général de l’insécurité sociale, la négation de l’individu, la torture, ou le monopartisme : tout ceci, l’ordre dominant s’en charge avec un savoir-faire et un sens administratif exemplaires. C’est bien du côté de cet « inadmissible » qu’il faut chercher, et que sans grande peine, d’ailleurs, on trouve (entre élections volées, souci Trilatéral de corriger « l’excès de démocratie », exclusions multiples du droit de vote, etc. Même dans ses formes domestiquées, de démocratie, il semble qu’il y en ait un peu toujours trop). Quoi qu’il en soit, entre illégalismes par en haut et illégalismes par en bas, entre Robespierre ici, Lénine là, les Territoires occupés là-bas, Joelle Aubron ici, se noue une logique serrée de figures, de contradictions et d’interventions placées sous le sceau de « l’inadmissible » qu’il faut donc apprendre à anticiper comme tel.
Récapitulons. G.?Labica comme figure intellectuelle se constitue à la fois à travers un mode pédagogique de l’auto-effacement, mais aussi tout au long d’une série de problèmes et de figures au mieux, de la marginalité, au pire, de l’irrécupérable. En d’autres termes, si le prisme des divers axes problématiques est la question révolutionnaire, pour être conséquent, une certaine pratique de l’inconciliation par « l’inadmissible », du dissensus radical, doit primer. La chose paraît d’autant plus impérative en temps de « consensus », de dépassement des clivages droite-gauche, de « nouvel ordre mondial », entre autres expressions de fin de guerre froide au moment de la chute du mur, mais plus profondément peut-être, entre autres symptômes du nouveau statut idéologique de l’économie-expertise, « ni de droite ni de gauche », puisque relevant du seul et même « consensus » hégémonique, à savoir, « de Washington », en l’occurrence.
Reste alors le pire. Compte tenu de la trajectoire et de la pratique de Georges Labica, et au regard de la conjoncture idéologique du tournant des années 1990, une question vient constituer le point d’exacerbation de toutes les autres, la question de la violence.
Si on l’a vu réapparaître de manière plus saillante dans les débats intellectuels à gauche depuis quelques années, il demeure que la violence en tant qu’ensemble de problèmes occupe, de longue date et explicitement, une place centrale dans le travail de G. Labica. Son dernier livre, Théorie de la violence, correspond à la tentative de faire aboutir de manière pleinement articulée cette récurrence ancienne disséminée au fil de ses travaux. L’une des thèses principales en est d’ailleurs déjà donnée dans la présentation du Cahier bleu, au milieu des années 1970 : « Quel marxiste […] prétendra jamais que la violence est un concept5 ? ». On la retrouve en bonne place dans Démocratie et Révolution, en présentation de l’édition séparée du chapitre sur « L’expropriation originelle6 », et avant cela, dans les pages du Robespierre. Il y a nécessairement beaucoup à dire sur le sujet dès lors que par ignorance, par paresse, par simple habitude ou par mauvaise foi, on soupçonnera ou reprochera longtemps à Labica d’avoir été complaisant, d’avoir voulu légitimer, et qui sait, d’avoir voulu glorifier la violence. À l’heure d’une horloge apparemment arrêtée où la participation à nombre de débats reste conditionnée par la « condamnation » préalable « des violences » quelles qu’elles soient, la chose semble malheureusement prévisible. On peut alors au moins se contenter de dire que la réflexion de long terme de Labica sur ce sujet consiste d’abord en une invitation insistante à refuser les esquives du problème à peu de frais.
En ce qui le concerne, en tant que militant anticolonialiste en Algérie, ou dans divers épisodes de sa vie personnelle, la violence, assurément, ne l’a pas esquivé. Comme elle n’a pas esquivé – formulation qui devient franchement absurde à ce stade – l’ensemble du tiers-monde engagé dans les luttes de décolonisation de la Malaisie insurgée jusqu’à l’Amérique latine en passant par l’Algérie. En tant qu’intellectuel marxiste lui-même partie prenante de cette histoire, n’était-il pas la moindre des choses que d’entreprendre d’intégrer pleinement cette part décisive des luttes de libération (en l’occurrence) anticoloniales aux ressaisies conceptuelles et théoriques ultérieures ? Et n’est-il d’ailleurs pas tout à fait extraordinaire que la gauche, son « militantisme », ses « fronts » (uniques, populaires, de gauche), ses « stratégies », ses « rapports de forces », ses « mobilisations » (etc.) accepte que tout son propre vocabulaire militaro-politique historique ait pris un tour entièrement métaphorique depuis les années 1980 sans quasiment jamais se poser la question de savoir ce que pouvait signifier (pour sa légitimité à échelle de masse, pour ses projets de transformation sociale) le décrochage et la prise de distance historique de fait vis-à-vis de cette dimension pourtant cruciale de ses pratiques historiques comme de son héritage théorique ? De Saint-Just et Theobald Wolfe Tone jusqu’à Amirouche, en passant par les communards, les combattants de la guerre d’Espagne, la résistance, toute une partie du canon théorique marxiste toutes tendances ou presque confondues (de Hô Chi Minh à Trotski en passant par Lénine, Gramsci, Zhou Enlai, le Che, et par « le général » Engels lui-même, féru de questions militaires), les moments de séparation entre théorie, politique, et stratégie militaire comme violence organisée, ressemblent autrement plus à l’exception qu’à la règle. N’y a-t-il pas d’ailleurs quelque raison de regretter qu’Allende n’ait pas été chef militaire ? Et n’est-t-il pas quelque peu prévisible que les débats et autres forums sur les « alternatives » à gauche paraissent former une ronde de désolation lorsque la dimension historiquement centrale de la recherche de concrétisation des « alternatives » a disparu sans même que l’on se demande comment ? Sans même que l’on périodise cette disparition dont la trace aujourd’hui reste enregistrée dans la métaphorisation déjà évoquée ? S’il ne veut rien dire de regretter certaines phases passées de militarisation de la politique des dominés, on ne peut pas non plus faire comme si cette expérience historique massive et omniprésente n’avait pas eu lieu et que sa dissipation dans des conditions nouvelles dispensait de comprendre et de mesurer ce qu’il en coûte aujourd’hui en termes de capacités à projeter un avenir libéré des rapports capitalistes. Mais au-delà de l’histoire des expériences passées, il faut bien se poser aussi la question du besoin insurrectionnel, ne serait-ce que pour être en mesure de reconnaître les modalités organisationnelles de ses prises en charge (effectives ou tentées) là où elles apparaissent aujourd’hui. Enfin, on ne peut pas non plus sous-estimer indéfiniment le fait que les quarante années environ de démilitarisation de la critique radicale dans un très grand nombre de régions du monde ont aussi correspondu à une poursuite de l’armement tous azimuts et de la sophistication des moyens coercitifs aux mains des classes dirigeantes de l’impérialisme néolibéral.
En l’absence d’un ensemble de considérations de ce type, le discours de la non-violence, de la « condamnation » préalable « des violences », pourrait n’être plus grand-chose d’autre qu’une modalité supplémentaire d’intériorisation des défaites, qui ne veut pas dire son nom. Par conséquent, laisser la violence impensée, c’est non seulement passer à côté de la réalité des rapports de forces les plus exacerbés jusqu’aux plus ordinaires, dans le grain fin de la vie du travail (de son organisation même) et des rapports de genres, mais en cela même, c’est aussi s’accommoder de l’assujettissement porté par l’injonction de « condamner les violences », sans distinctions élémentaires pourtant de rigueur pour toute démarche critique digne d’estime et dûment héritière d’une histoire pas si lointaine. Plus de dominants, plus de dominés et seuls demeurent les renvois « dos à dos » en attendant que s’engage la prochaine « spirale », le prochain « engrenage » sur fond de politicide structurel tout employé, depuis de longues années, à pathologiser et à culturaliser, dans un regain manifeste de l’orientalisme instrumental le plus agressif, une violence « islamiste » jetant tranquillement ensemble dans un même sac Al-Qaïda, le Hamas, le Hezbollah, les Frères musulmans égyptiens. Autant s’en tenir, à ce stade, aux types de formulations proposées par Georges Labica lui-même qui, avant d’en venir au fait que « la violence n’est pas un choix », rappelle cette proposition que je ne me lasse pas de répéter?: la violence n’est pas un concept. Le terme renvoie à une multitude de formes, des sanglantes aux paisibles, de la bombe à la discipline d’usine, du meurtre d’un forcené à l’existence du système, savoir, les rapports capitalistes de production. Partant, il n’est d’autre violence qu’en situation. Deux corollaires s’ensuivent. Opposer violence à non-violence, fût-ce en stipulant qu’il s’agit d’actions de masses, c’est soit nager en pleine métaphysique, soit ériger sa candeur en argument, soit dissimuler son impuissance, sa démission, son acquiescement à l’ordre établi ou toute autre arrière-pensée. La violence ne peut se passer d’une qualification quelle qu’elle soit. La définir par la « force » (Littré) ne fait que déplacer le problème. La plupart des dictionnaires et même des livres qui prétendent la prendre comme objet exprès se dispensent de la définir et se bornent à des énumérations descriptives selon différents domaines, dont le structurel (le système) est en général exclu. La belle âme n’a pas de mains, c’est bien connu7.
La question de la violence révolutionnaire occupe toute la place à laquelle on peut s’attendre dans le Robespierre. On peut observer, néanmoins, qu’elle n’apparaît pas en tant que telle dans les titres de chapitres ou de sous-chapitres. La Terreur elle-même n’est pas plus annoncée comme objet de traitement séparé dans le sommaire. C’est qu’il s’agit de saisir le sens « en situation » révolutionnaire de suspension du droit de l’ordre ancien, de tentative d’incarnation politique des catégories du droit naturel. Il y a donc ici un refus, de fait, de dissocier la Terreur du processus d’ensemble, comme entreprennent de le faire au même moment diverses révisions historiographiques de la Révolution française qui, dans leur version « modérée » tocquevilienne, s’attachent à séparer démocratie et révolution afin de congédier cette dernière vers la tradition intemporelle du mal totalitaire et criminel, en cours d’importation (on va y revenir).
Loin d’être une étude isolée et limitée à une intervention dans la conjoncture idéologique du bicentennaire, Robespierre : une politique de la philosophie poursuit donc le travail entrepris de longue date, travail singularisé par des pratiques de lecture et de pédagogie, des figures de la marges ou de l’inadmissible et une résilience parti-culière de visées politiques. À travers ces choix, Labica s’est démarqué assez nettement de ce qui a pu constituer la trame centrale des préoccupations philosophiques et critiques d’une période dans laquelle les choses de la théorie s’étaient en bonne partie déplacées vers Habermas, Rawls ou un hégémonisme « linguiciste » (du signe, du discours, de la construction discursive) succédant à un paradigme affaibli de l’économie politique marxienne. Chacun pourra librement juger les distances qui séparent les « adieux à la classe ouvrière » et les ruptures postmodernes avec la critique radicale de la « barbarie » capitaliste des uns, le grand-théorisme proto-utopique de l’agir communicationnel et de la justice des autres, et enfin la réactivation du nécessaire dissensus propre à l’appel au « devoir de haine ». Dans un ouvrage collectif contre la guerre de l’Otan au Kosovo, G.?Labica précisait ainsi, en conclusion de sa contribution :
« Enfin, reste la haine, ce « devoir de haine », que j’ai mis en avant. J’ai pris délibérément, en plaçant mon propos anti-impérialiste sous cet intitulé, le risque de le voir invalidé a priori. Hitler/Clinton opposé à Hitler/Milosevic (ou Saddam) : les satanisations réciproques ne sont-elles pas vouées à se heurter aux mêmes limites ? Il se peut bien. Mais ce risque, en large part dû à la conjoncture française dont la sérénité n’est pas le trait le plus marquant, est celui d’une provocation visant à tordre le bâton dans l’autre sens, autrement dit à briser avec tous les consensus, qu’ils soient résignés ou militants, à déranger les certitudes apprivoisées et à prendre le contre-pied des matraquages complaisants, alors que nos moyens d’expression sont d’une modestie scandaleuse en regard de ceux dont dispose la partie adverse. Est-il si évident, d’autre part, même pour les consciences religieuses, que la haine, sentiment ou attitude, soit aussi négative qu’on le prétend ? Sans convoquer les autorités d’un Descartes, d’un Spinoza ou, plus près de nous, d’un Nizan ou d’un Sartre, que l’on me permette de remémorer la « haine des tyrans », qui animait jadis les révolutionnaires de 89 et la « haine de classe » dont naguère les travailleurs ne faisaient pas fi. Je n’irai pas, par contre, jusqu’à annexer Bourdaloue en appelant à la « haine du péché » ! Devoir de haine, oui, n’ayons pas honte. Aujourd’hui l’aversion résolue envers l’impérialisme, « américain » prioritairement et jusqu’à nouvel ordre, représente pour toutes les victimes de la domination la propédeutique d’une détermination lucide et d’un engagement de solidarité active8. »
Deux choses devraient, espère-t-on, apparaître clairement : le Robespierre s’inscrit dans une trajectoire d’ensemble et cette trajectoire, par la nature de sa composition même, situe Georges Labica à bonne distance d’un « air du temps » (humanitaro-mémorialiste, discursiviste, culturaliste, globalement et agressivement anti-marxiste, postimpérialiste, et post-ci et post-ça), « air du temps » irrespirable et auquel il s’agissait de « résister9 » par tous les moyens de clarification encore disponibles. La situation de Labica qu’il ne faut pas craindre de décrire comme activement mineure est à lier à cette in-actualité revendiquée, inactualité qui est le propre du projet révolutionnaire dont la vocation est de rendre tout à fait et durablement inactuel l’ordre des choses actuellement existant, et de le faire à partir de ce qui ne relève déjà plus du connu, de l’éteint, du déjà. Depuis quelques années cependant, il apparaît que les positions défendues en période d’eaux basses sont sorties de leur moment de reflux. La redécouverte de l’impérialisme, de la souffrance au travail (comme version, il est vrai, encore souvent assez médicalisée de l’exploitation capitaliste), la succession d’effondrements économiques et sociaux de l’Argentine à l’Asie du Sud-Est puis maintenant en Europe, la persécution froide, rationnellement irrationnelle et sans fin apparente du peuple grec par ses amis européens « qui lui veulent du bien », les émeutes de la faim, les révoltes de la jeunesse, étudiante ou pas, et enfin la « crise » financière érigée en institution mondiale… Voilà de quoi redonner à bien du monde une puissante nostalgie du futur et, incidemment, tout ceci valait bien une inflexibilité bien comprise.
Dans cette reconfiguration de la conjoncture idéologique, on peut noter le signal que constitue la circulation diffuse (certes, sur un registre savant) des problématiques de « l’événement » comme nom possible de ruptures radicales dans l’ordre du temps, du présent sans fin de la domination, de l’existant. Ce Robespierre lu par Georges Labica est d’abord le nom d’une confrontation avec le nouveau, « l’inédit » sur lequel les équipements philosophiques, mentaux, viennent buter. Toute la « dignité philosophique » de Robespierre tient ici dans cet étonnement d’où doit sortir une philosophie-à-même-la-conjoncture, saisie par elle et dans l’urgence de ses temps courts, de ses retournements ; philosophie qui ne vaut qu’en tant qu’elle se porte hors d’elle-même dans et par l’injonction d’une invention au jour le jour d’une politique de la révolution. « L’événement » peut constituer un mode d’hébergement conceptuel de la possibilité révolutionnaire historique. Mais jusqu’où, ou jusqu’à quand, si ne convergent pas sur lui les questions de ses forces, de leur organisation et de leurs visées stratégiques, notamment quant à la question du pouvoir ? Tout ceci peut ne pas avoir sa place dans les usages d’un événement toujours réductible à une radicalité de l’inconditionné et pour ainsi dire sans objet. Le Robespierre, maintenant à deux décennies des eaux sales de la guerre froide, a alors aussi vocation à contribuer à une pensée de l’invention proprement politique dans des conditions de nouveauté irréductible et pour une visée : la démocratie comme promesse faite, et jusqu’ici non tenue, ou simplement reniée parce qu’elle aussi, en vérité, irrécupérable car inadmissible pour le monde tel qu’il va.
Outre la diffusion savante de la radicalité de l’événement aujourd’hui, le livre sur Robespierre a vocation à participer de l’autre actualité de la Révolution française, invaincue par les révisions historiographiques installées avec le bicentenaire. Les travaux de Florence Gauthier, de Sophie Wahnich, de l’Institut d’histoire de la Révolution française, de la Société des études robespierristes, documentent ce glissement de conjoncture qu’ils ont eux-mêmes contribué à opérer. La reparution du présent livre chez l’éditeur qui s’est chargé de la réédition des discours de Robespierre (2000), de la publication du livre de Sophie Wahnich La Liberté ou la Mort. Essai sur la Terreur et le terrorisme (2003), de la réédition de Mathiez sur La Réaction thermidorienne (2010), et maintenant d’Une histoire de la Révolution française (2012), ne peut que participer de cette heureuse et nécessaire entreprise collective de recaptation des courants chauds circulant dans l’histoire, d’historiothermie, donc. Cette véritable lutte nous vaut qu’en France on ne soit pas encore parvenu à faire subir à la Révolution française le sort qui depuis bien longtemps a été réservé à la Révolution anglaise, sort contre lequel l’immense historien qu’était Christopher Hill a consacré une vie entière et des dizaines d’ouvrages admirables.
Robespierre, 1990. Du droit à recommencer
Ce qui incite à revenir sur ce livre, non pas, en référence à notre environnement immédiat, mais plutôt à celui des années 1980 et du début des années 1990. Au regard de la production de l’auteur dans cette séquence, l’ensemble problématique évoqué jusqu’ici au titre de sa trajectoire, prend une consistance particulière. Elle se résume bien à la manière dont se disposent quatre ouvrages successifs et dont, en 1990, le Robespierre forme le quatrième moment d’aboutissement et de charnière. Les trois autres livres, eux aussi relativement courts, sont Le Marxisme-léninisme : éléments pour une critique (1984), Le Paradigme du Grand-Hornu. Essai sur l’idéologie (1987) et la même année, Karl Marx. Les Thèses sur Feuerbach. On observe minimalement la chose suivante : deux de ces ouvrages portent sur la production de l’idéologie comme « ciment » visant à se constituer en « structure intégrée » et en « totalité sans extérieur1 » : dans un cas (Le Paradigme du Grand-Hornu), ciment des rapports sociaux capitalistes, dans l’autre (Le Marxisme-léninisme), le « ciment » est « une philosophie d’État, une philosophie pour l’État, une étatisation de la philosophie. Le marxisme-léninisme n’est rien d’autre que la raison d’État10 ». Si les deux ne se ressemblent guère, la métaphore du ciment et du bâti vaut bien pour l’un et l’autre en tant qu’il y est affaire de stases, de productions de staticités des rapports de domination capitaliste ou de l’État stalinien (staticités au sens où il est à la fois question de tentatives d’arrestation du temps et de production de formes étatiques). En revanche, et dans une sorte de contrepoint, Karl Marx. Les Thèses sur Feuerbach et le Robespierre abordent les possibilités de sortie et de départ, tout juste ébauchées, l’une et l’autre limitées dans l’élaboration comme dans le temps (brièveté des notes de Marx comme de l’expérience robespierriste). Dans les deux cas est posée, théoriquement et pratiquement, la question de la philosophie à même l’ordre des choses, dépossédée de tout privilège de l’extériorité.
D’où les quelques observations suivantes. On retrouve donc une fois encore cette possibilité de la mise hors de soi politique de la philosophie, le mouvement vers la sortie, l’Ausgang déjà au centre du livre sur « le statut marxiste de la philosophie ». D’où cette « dignité philosophique » de Robespierre comme nom d’une puissance d’invention à même les conditions du Novum, de l’inouï révolutionnaire qui la produit. Deuxièmement, d’un point de vue rétrospectif, comme on l’a déjà observé, le lien est transparent avec les préoccupations du premier livre sur Ibn Khaldun quant à la question de la religion, qu’il s’agisse de la critique faite par Marx de la critique de la religion trouvée chez Feuerbach, ou des questions religieuses chez Robespierre : liberté des cultes, culte de l’Être suprême, « ce culte contre les cultes, cette religion sans religion ».
Ensuite, dans le champ du marxisme, le Robespierre contribue à rompre avec le paradigme historiographique des « révolutions bourgeoises » dont l’Incorruptible n’aurait été qu’un simple instrument petit bourgeois. On sait que cette affaire a été au cœur de quelques belles polémiques internes à la tradition marxiste, que ce soit entre historiens (E.P. Thompson contre Perry Anderson et Tom Nairn) ou entre philosophes (Ernst Bloch contre Max Horkheimer11 pour ne prendre que ces deux exemples). Quoi qu’il en soit, pour G. Labica, Robespierre ne peut être rapatrié vers les seuls ordres des classes et de la détermination, le tout porté dans une seule et même temporalité historique nécessaire. Au prisme de la catégorie canonique de révolution bourgeoise, c’est toute cette nouveauté et cette temporalité propre qui se perdent de vue et avec elles, la sophistication marxiste même de la pensée des temps (périodes, moments, conjonctures – vocabulaire que Daniel Bensaïd n’a cessé de cultiver et d’enrichir), de la polyrythmie de la totalité.
Enfin, et l’essentiel est certainement là : avec le livre sur Robespierre s’énonce la revendication d’un droit imprescriptible, à savoir, le droit à recommencer. Dans l’environnement des années 1989-1991, il va de soi qu’il s’agit là aussi d’une position rendue pour le moins contre-intuitive : chute du mur, puis démantèlement de l’Union soviétique et fin du « siècle court ». Ajoutons à cela les reculs, parfois désastreux, des grandes expériences anticoloniales et anti-impérialistes vécues trente ans plus tôt et dont l’auteur avait été lui-même partie prenante (en Algérie, mais aussi, dans une moindre mesure, à Cuba où le quotidien algérien El Moudjahid l’avait délégué en janvier 1963 pour établir un rapport sur les politiques d’alphabétisation). À divers titres, Robespierre est un lieu et un moment où se croisent des trajectoires à la fois théoriques, militantes et personnelles. Ce livre porte donc sur l’impératif des réinventions, des recommencements nécessaires et nécessairement à même les choses, pour tout deuil de « l’existant », tombé avec le mur et pour ne pas interminablement finir sous ses décombres.
Reste une chose, peut-être. En écrivant ce livre, l’auteur n’ignorait pas les débats et révisions historiographiques en cours à l’époque. Il va d’ailleurs de soi que le fait de consacrer cet ouvrage à Robespierre constituait un commentaire et une réponse de fait dans cette conjoncture idéologique. Il demeure qu’il n’en a rien dit de façon explicite, ni ici ni ailleurs. La première raison en était probablement que le débat était d’abord un débat entre historiens dans lequel une certaine rigueur savante pouvait interdire au philosophe d’intervenir. Mais il y a sans doute plus simple que cela. Le narcissisme national qu’a induit le bicentenaire de la Révolution française (certes, comme événement de portée historico-mondiale) a pu engendrer l’illusion selon laquelle le débat historiographique national était le centre du monde, lui-même de portée historico–mondiale, en quelque sorte. Dans ce scénario, il revenait à une courageuse avant-garde intellectuelle de dévoiler enfin la pathologie criminelle propre à toute expérience révolutionnaire passée quelle qu’elle fût et au-delà, de tout projet émancipateur qui, présupposant une rupture événementielle du temps historique et une anticipation du nouveau, trahirait alors invariablement un rapport « utopique » perverti aux « réalités » de l’existant. L’observation, ou l’anticipation de possibilités autres dont se nourrissent la critique et la lutte politique pouvaient maintenant relever génériquement de l’utopie, de l’utopie-abstraction jugée fondamentalement porteuse d’une violence maladive, totalitaire et liquidatrice dans l’âme.
Nul besoin d’entrer dans la grammaire de cette entreprise d’abolition de l’idée même de possibilité et du futur, abolition et, dans le même geste, consignation des diverses expériences et conjonctures historiques à une seule et même fosse commune du passé où peuvent s’expédier tout un panthéon du mal, de Joachim de Flore et Thomas Münzer jusqu’à Robespierre et Lénine, les uns et les autres opportunément mêlés aux représen-tants des tyrannies fascistes dont le capital s’est pourtant toujours si bien accommodé. On en connaît bien maintenant un des principaux acquis : la version « révisée » de la démocratie comme pa-trimoine culturel ethnicisé dont la gestion relève plus de l’industrie du tourisme et du ministère de l’Intérieur, et à l’occasion, de la Défense lorsqu’elle devient produit à l’exportation, que de tout projet d’invention et d’extension de droits nouveaux.
Ce moment et ce succès de la critique anti-totalitaire, en l’occurrence, dans sa veine historiographique de fin de guerre froide, est à bien des égards révolu1. Certes, son héritage persiste dans le processus culturel grand public12. Il vaut peut-être simplement la peine d’indiquer ou de rappeler que son moment français dans les années 1980 jusqu’au bicentenaire, en dépit de sa coloration nationale évidente, n’était guère autre chose qu’une version locale et assez secondaire d’une stratégie idéologique globale et inclusive, elle-même prolongeant une tradition conservatrice déjà vieille comme la Révolution française.
Sur le terrain de la tradition philosophique en général et de la propagande de guerre froide, on trouve chez Zeev Sternhell un panorama dans lequel, pour l’après-guerre, les figures de Jacob Talmon et plus encore d’Isaiah Berlin apparaissent comme centrales dans la « campagne contre le communisme, par les Lumières françaises interposées13 ». Jean-Jacques Rousseau, au tout premier chef, pouvait alors devenir pour I. Berlin, « un des plus monstrueux et des plus sinistres ennemis de la liberté dans toute l’histoire de la pensée moderne » et en tant que tel, faire figure de père spirituel de Robespierre, d’Hitler, des communistes14. Jean-Michel Besnier a montré dès 1983 comment cette entreprise « philosophique » a été acclimatée aux conditions françaises par le biais de la figure de Robespierre lui-même, lorsqu’il s’est agi de penser la Révolution contre la démocratie15. En outre, on ne peut que rappeler que cette offensive idéologique de la guerre froide n’aurait pu être menée avec cette ampleur sans le genre d’assistance logistique massive dont Frances Stonor Saunders a fait l’histoire dans Qui mène la danse ? La CIA et la guerre froide culturelle16 et sans le relai de clubs aussi puissants que la Commission trilatérale à partir du milieu des années 1970. Le rapport sur la « crise de la démocratie » rédigé pour la Trilatérale envisageait, sous la plume de l’homme du « choc des civilisations », S.P. Huntington, rien moins qu’une correction de « l’excès de démocratie » suite aux politisations de masse survenues au cours des années soixante17. Aussi a-t-on les meilleures raisons d’entendre dans l’affrontement Tocqueville-Robespierre le bruit pas si distant de manœuvres stratégiques impérialistes (que l’on s’égarerait gravement à vouloir réduire à l’ordre d’une vulgaire « conspiration » pour alimenter le contrepoint plus sophistiqué d’une critique anti-systémique vidée de toute intentionnalité stratégique de classe).
Georges Labica, ni dans le présent livre ni ailleurs, n’a voulu s’intéresser à ces « débats » là largement aux mains d’un réactionnariat militant d’intellectuels « haute-fidélité » (pour reprendre une expression fréquente de l’auteur). Toutefois, l’exigence de correction interdit de reproduire ici le genre de termes avec lesquels il put, à l’occasion, formuler sa caractérisation de l’adversaire impérialiste besogneux. Le recueil Démocratie et Révolution, paru au Temps des Cerises en 2003, de par son titre même (mais aussi de par la diversité des formes de son contenu, participant d’une histoire chaude plutôt que cadavérique) apporte dans tous les cas une réponse de fait à la désarticulation des deux mots et des deux projets entreprise sur les terrains philosophiques et historiographiques depuis alors plus de vingt ans en France.
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Raison d’autant plus grande alors de saluer la publication, sous la direction d’Omar Lardjane, de Georges Labica. Une philosophe en colère, actes du colloque consacré à G. Labica, un an après sa disparition, les 15 et 16 février 2010 à Alger. Editions du CNRPAH, 2012. Pour une évocation de cet hommage collectif, cf. l’article d’Ahmed Ancer, journaliste à El Moudjahid puis à El Watan, http://langues.superforum.fr/t582-georges-labica-le-philosophe-revolutionnaire. |
|---|---|
| ⇧2 | Lénine, « Socialisme et religion », décembre 1905, Œuvres, t.?10, nov. 1905-juin 1906, Éditions sociales, Paris et Éditions du progrès, Moscou, 1967. |
| ⇧3 | L’hypothèse du néoféodalisme. Le droit à une nouvelle croisée des chemins, dir. José Lefebvre, Puf, 2006. |
| ⇧4 | Affaire du financement de la contre-révolution au Nicaragua sous les gouvernements R. Reagan et G. Bush Sr, par des ventes d’armes à l’Iran et des trafics de drogue (crack, répandu de manière souvent décrite comme épidémique dans la ville de Los Angeles dans les années 1980), affaire révélée par le journaliste Gary Webb, mort de deux balles dans la tête en 2004. L’enquête conclut au « suicide » du journaliste d’investigation. |
| ⇧5 | Le Cahier bleu, Éditions Complexe, 1976, p.15. |
| ⇧6 | Le Cahier bleu, p.?14. |
| ⇧7 | Georges Labica, « Un traité de la violence », présentation de Karl Marx, L’expropriation originelle, trad. J.P. Lefebvre, Les Nuits rouges, 2001. |
| ⇧8 | « La violence ? Quelle violence ? » http://www.lahaine.org/labica/b2-img/labica_violence.pdf |
| ⇧9 | « Le devoir de haine », dans Maîtres du monde, ou les dessous de la guerre des Balkans, collectif, Le Temps des Cerises, 1999, p. 248. |
| ⇧10 | Pour faire aussi allusion à sa participation régulière aux réunions du SPRAT (Société pour résister à l’air du temps), lancé par Daniel Bensaïd au début des années 1990. |
| ⇧11 | Le Paradigme du Grand-Hornu, p.?19. |
| ⇧12 | Le Marxisme-léninisme, Éditions Bruno Huysman, 1984, p. 58. |
| ⇧13 | Cf. E.P. Thompson, « The Peculiarities of the English », dans The poverty of Theory, Merlin, 1978, et Ernst Bloch, Droit Naturel et dignité humaine, trad. D Authier et J Lacoste, Payot, 2002. On ne saurait néanmoins tout à fait ignorer l’arrière-plan aussi très personnel de l’une et l’autre de ces confrontations. |
| ⇧14 | S’il devait encore préserver un intérêt aujourd’hui, ce serait plutôt au titre de l’allégorie qu’il fournit du monde du capital intégral dans lequel, en effet, l’utopie de l’entrepreneur et d’un monde social fait d’individus moralisés et fortifiés par la concurrence enfin libérée, la rationalité évaluative, et les marchés financiers comme instance abstraite porteuse de jugements et de sanctions contre les mauvaises conduites, la triade, donc, utopie-rationalité-abstraction en version néolibérale s’avère bel et bien universellement oppressive, meurtrière et froidement liquidatrice (on n’a certes pas encore tout vu). À titre d’allégorie involontaire ou d’accusation en miroir qui s’ignore, le cauchemar antitotalitaire, à sa manière insalubre, ne manque pas de pertinence critique. Cf., par exemple, le documentaire diffusé sur France 3 (le 7 mars 2012), « Robespierre, bourreau de la Vendée ». Pour un commentaire et une réponse critique, cf. «?“Robespierre, bourreau de la Vendée??” : une splendide leçon d’antiméthode historique » par Marc Belissa, Université Paris Ouest Nanterre-La Défense et Yannick Bosc, Université de Rouen : http://revolution-francaise.net/2012/03/15/476-robespierre-bourreau-de-la-vendee-une-splendide-lecon-danti-methode-historique. |
| ⇧15 | Zeev Sternhell, Les anti-Lumières du xviiie?siècle à la guerre froide, Fayard, 2006, p.?495. |
| ⇧16 | Jean-Michel Besnier, « La Révolution contre la démocratie ? Les analyses de la Terreur et leurs implications, ou, Que faire de Robespierre ? », Revue de l’Institut catholique de Paris, n°?13, Janvier-Mars 1985 (reprenant une conférence de 1983). |
| ⇧17 | M.?Crozier, S.P. Huntington, J. Watanuki, The Crisis of Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, 1975 (p.?113, pour «?l’excès?»). |





![Marx face au problème de l’État [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Marx-graffiti-150x150.jpg)



