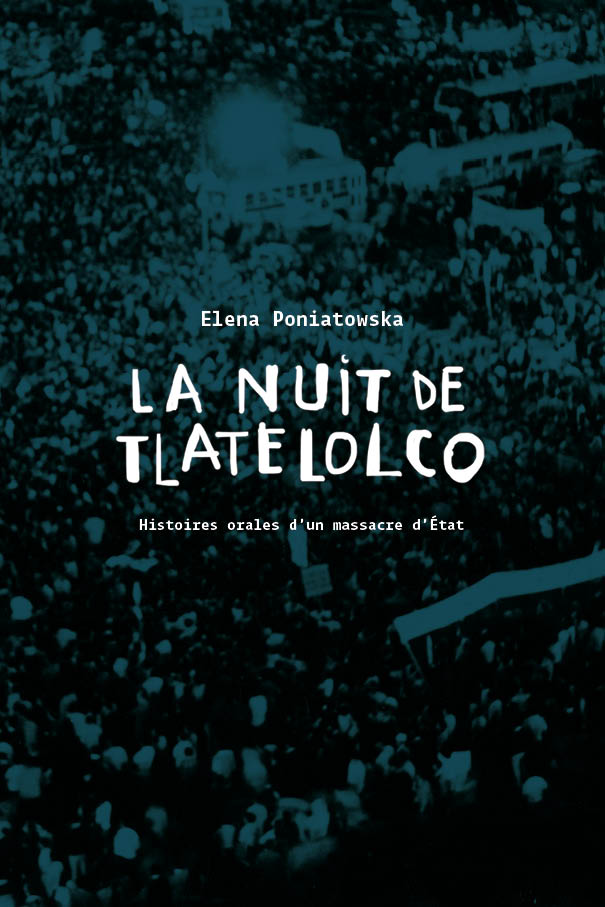
À lire : un extrait de « La nuit de Tlatelolco » d’Elena Poniatowska
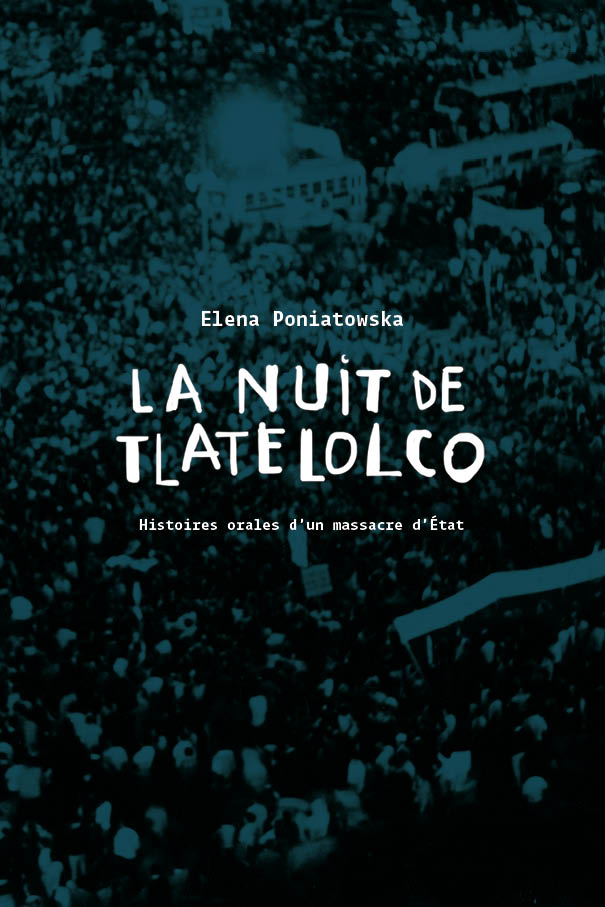
Elena Poniatowska, « La Nuit de Tlatelolco. Histoire orale d’un massacre d’Etat« , avec cahiers photos et reproductions de gravures et d’affiches du mouvement étudiant. Traduit par Marion Gary et Joani Hocquenghem, Toulouse, Éditions CMDE, 2014.
En ce jeudi 2 octobre 2014, des dizaines de milliers de personnes commémoraient, comme tous les 2 octobre depuis 46 ans, le massacre des étudiants sur la Place des Trois Cultures. L’Etat mexicain avait alors écrasé dans le sang la contestation sociale qui faisait rage dans les rues de Mexico en cet été 1968. Les étudiants et étudiantes de l’époque avaient osé braver l’autoritarisme du parti d’Etat, le PRI, en affichant à la fois une solide détermination dans leurs revendications et un bel aplomb dans leurs moqueries du pourtant très répressif président de l’époque, Gustavo Díaz Ordaz. À 10 jours des J.O de Mexico, sous les yeux de la presse internationale, l’armée assassina des centaines d’étudiants et d’habitants du quartier de Tlatelolco, venus apporter leur soutien aux jeunes.
Face au black-out médiatique et animée d’une nécessité pressante de rétablir la vérité historique, la journaliste et romancière Elena Poniatowska se lança, dès le lendemain des faits, dans une vaste collecte de témoignages d’acteurs du mouvement, de paroles d’habitants, d’ouvriers, de simples passants. Deux ans durant, elle se rendit inlassablement dans la prison de Lecumberri et s’entretint avec les prisonniers politiques. De ces récits troublants, naîtra le livre « La Nuit de Tlatelolco. Histoire orale d’un massacre d’Etat », édité pour la première fois au Mexique en 1971 et traduit aujourd’hui en français, aux éditions CMDE (http://editionscmde.org/).
Elena Poniatowska y construit un tissage subtil de témoignages, qu’elle a entrecoupé de paroles de pouvoir et d’extraits de presse afin de mieux faire ressortir les contradictions et pointer du doigt les vrais responsables du massacre, qui n’ont jamais été jugés, ni inquiétés, de quelque manière que ce soit.
Ce climat de tensions sociales et de répression des mouvements étudiants n’a jamais cessé dans les décennies suivantes : la stratégie étatique de « guerre sale » des années 1970 s’est prolongée aujourd’hui dans le processus de militarisation du pays à travers lequel l’Etat mexicain, sous couvert de lutte contre le narcotrafic, mène une guerre sociale contre la population et ceux et celles qui tentent de s’organiser. Le récent massacre des étudiants du Guerrero, dans le sud du Mexique, le montre tristement : des dizaines de jeunes issus de l’université rurale de formation des maitres Ayotzinapa, alors qu’ils rentraient chez eux après une manifestation, ont été attaqués par la police locale, liée au crime organisé. Bilan : 6 morts et plus de 40 disparus, alors que la découverte de fosses communes laisse entrevoir le pire.
La manifestation massive du 2 octobre dernier à Mexico a rappelé, avec force et courage, que sous le slogan « Tlatelolco, le 2 octobre ne s’oublie pas ! », ce sont toutes les résistances, à commencer par les très combatives universités rurales du pays, qui s’ancrent dans la mémoire collective du Mexique et renforcent nos luttes, ici comme là bas.
Extraits de « La Nuit de Tlatelolco. Histoire orale d’un massacre d’Etat ».
« Pour la plupart, ces témoignages ont été recueillis en octobre et novembre 1968. Les étudiants emprisonnés ont livré les leurs au cours des deux années suivantes. Ce récit leur appartient. Il est fait de leurs mots, de leurs luttes, de leurs erreurs, de leur douleur et de leur étonnement. Il laisse voir aussi leurs « emballements », leur ingénuité, leur confiance. Je remercie surtout les mères, les gens qui ont perdu un fils, un frère, d’avoir accepté de parler. La douleur est un acte absolument solitaire. En parler s’avère presque intolérable ; enquêter, creuser, a quelque chose d’insolent. Ce récit évoque le souvenir d’une mère qui était restée calme des jours durant, durcie sous le coup, et qui soudain, comme un animal blessé – un animal à qui on arrache les entrailles – laissa sortir du centre de sa vie, de la vie même qu’elle avait donnée, un cri rauque, déchiré. Un cri qui faisait peur, peur à cause du mal absolu qui peut être fait à un être humain ; ce cri difforme qui brise tout, le aïe de la blessure définitive, celle qui ne pourra jamais cicatriser, celle de la mort du fils. Voici l’écho du cri de ceux qui sont morts et le cri de ceux qui sont restés. Voici leur indignation et leur protestation. C’est le cri muet qui est resté coincé dans des milliers de gorges, dans des milliers d’yeux exorbités d’effroi le 2 octobre 1968, la nuit de Tlatelolco. » Elena Poniatowska
« Les unités de l’armée se sont déployées autour de la foule comme des tenailles et en quelques minutes toutes les issues ont été bloquées. Du troisième étage de l’immeuble Chihuahua, l’endroit où avait été installée la tribune, on ne pouvait pas voir ces manœuvres et la panique nous semblait inexplicable : les deux hélicoptères qui survolaient la place presque depuis le début du meeting avaient adopté une attitude hostile et provocatrice, volant à très basse altitude, en cercles de plus en plus serrés, puis ils avaient lancé les feux de Bengale, un vert et l’autre rouge. Quand le deuxième est tombé, la panique a commencé, et nous, les membres du Conseil, on a tenté de l’arrêter : aucun d’entre nous ne voyait que l’armée avançait en dessous de la tribune. La foule a freiné d’un seul coup quand elle s’est trouvée face aux baïonnettes et a aussitôt reculé : on aurait dit une vague qui avançait vers l’autre bout de la place, mais l’armée était aussi là-bas, d’en haut on voyait comment la vague humaine poussait vers un autre côté. Ce fut tout : le troisième étage avait déjà été pris par le bataillon Olimpia. Tandis que nous, les derniers à être restés près du micro, on ne comprenait pas pourquoi cette foule incontrôlable courait et soudain reculait, on est soudain tombés nez à nez sur les canons des mitraillettes. Le bataillon Olimpia avait envahi le balcon et ils nous ont mis les mains en l’air, face au mur. Il nous était strictement interdit de nous retourner vers la place ; au moindre mouvement, on recevait un coup de crosse à la tête ou dans les côtes. Le piège s’était refermé, l’assassinat collectif avait commencé. » Gilberto Guevara Niebla, du CNH (Conseil national de grève)
« Nous avons perdu de vue Reyes et j’ai entendu un cri de mon frère : » Ne me lâche pas ! » Nous nous sommes pris fortement par la main. Je suis allé vers la droite, pour essayer d’arriver au jardin où étaient les ruines. Beaucoup de gens étaient là et essayaient de se cacher de la terrible fusillade qui venait de toutes les directions. L’impact des projectiles prédominait sur les autres sons et une pluie de fragments, produits par l’impact des balles sur les pierres des ruines, s’abattait sur nos têtes. Je serrais toujours fermement la main de mon frère bien que des gens se soient interposés entre nous et j’essayais de le tirer jusqu’à moi. Des étudiants parmi nous étaient tombés, les uns morts, d’autres blessés […] » Diana Salmerón de Contreras
« Entre les granaderos et nous, c’était un combat aztèque, à coups de pierre. La question des armes à feu ne se posait pas car ils n’avaient que des matraques et des choses comme ça. À Zacatenco, par exemple, ils avaient déjà essayé bien des fois d’entrer seuls mais n’avaient pas réussi… Il fallait que l’armée vienne. C’est pour ça qu’à partir du 23 septembre, ils ont été armés de fusils M-1. » Raúl Alvarez Garín, du CNH (Conseil national de grève)
« Notre propagande, c’étaient les rambardes où on peignait des slogans ; le lendemain elles étaient repeintes en gris, la peinture qu’utilisait la police pour les effacer, mais nous, on repassait une couche de peinture et de nouveau les slogans : « À bas Cueto » ou « Liberté des prisonniers politiques » ; les inscriptions sur les bus urbains, sur les tramways, jusque sur le toit des bus (là ils mettaient plus de temps à les enlever parce qu’ils ne les voyaient pas de suite), sur les côtés des trolleybus, sur n’importe quel mur de n’importe quel coin de la ville. Et même quand les services de la ville effaçaient les inscriptions, il restait de grosses tâches, et celles-ci – d’une certaine façon – continuaient à protester. Les murs peints, les tracts ronéotés et nos poumons, c’était notre presse. » Ernesto Hernández Pichardo, de l’École d’Économie de l’UNAM (Université nationale autonome de Mexico)
« Alors c’est comme ça qu’on dialogue au Mexique ? À coups de feu ? Visiblement, Pancho Villa fait encore des siennes ! » Andrew Fulton, commerçant, visiteur américain aux XIX? Jeux Olympiques
« Le gouvernement, sensible aux pressions de 25 000 businessmen et techniciens américains présents au Mexique, a décidé de réagir en employant la manière forte. Il n’a pas pensé qu’en remplissant les prisons, il courait le risque de vider le stade. » Albert Paul Lentin, Le Nouvel Observateur, lundi 7 octobre 1968
« S’ils tuent des étudiants pour qu’il y ait des Jeux Olympiques, il vaudrait mieux que ces derniers n’aient pas lieu, car aucun J.O., même en les réunissant tous, ne valent pas la vie d’un étudiant. » Un athlète italien, membre de la délégation italienne aux XIX? Jeux Olympiques, Ovaciones, 3 octobre 1968
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.








