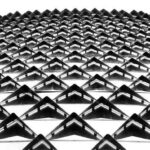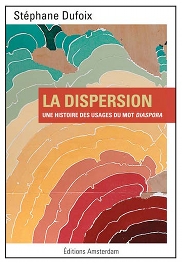
Bonnes feuilles et recension : La Dispersion. Une histoire des usages du mot diaspora, de Stéphane Dufoix
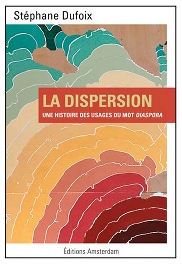
Stéphane Dufoix, La Dispersion. Une histoire des usages du mot diaspora, Paris, Éditions Amsterdam, 2012, p. 385-387.
À la fin des années 1980 et au tout début des années 1990, on peut repérer deux séries conceptuelles différentes liées à diaspora dans le paysage académique mondial. La première série s’appuie sur l’exemple archétypal de la diaspora juive dans ses versions tant politique – la recherche d’un État – que centro-périphérique – le lien entre cet État une fois constitué et l’ensemble de ceux qui vivent à l’étranger et qui reconnaissent partager avec lui un lien spécial, symbolique, affectif, ethnique, religieux, etc. La seconde – qui s’est volontairement et explicitement construite en opposition à la première –, bien qu’également fondée historiquement sur l’histoire du peuple juif, s’en sépare pour englober sous diaspora la possibilité d’une communauté culturelle a-centrée, traversée par des réélaborations constantes, parfois concurrentes, voire antagonistes.
À de rares exceptions près, jusqu’en 1993, les deux séries demeurent parfaitement parallèles, indépendantes l’une de l’autre. C’est à cette date qu’elles se rencontrent, alors que se manifeste, à l’échelle internationale, un intérêt accru pour la question des diasporas, dans un contexte académique de prise de conscience des transformations croissantes du rapport à la distance en raison des progrès des nouvelles technologies de l’information et de la communication. La naissance de nouvelles revues, dans le champ de l’anthropologie, de la science politique, de la sociologie, va de pair avec la recherche de nouveaux concepts susceptibles de décrire de manière adéquate les relations à l’espace des communautés dispersées dans un monde progressivement désigné comme « global » ou en voie de « globalisation ». C’est dans ce contexte que diaspora prend son essor conceptuel et que les diaspora studies sont construites comme un champ académique à part entière, traversé d’oppositions et de contradictions.
En peu d’années, diaspora s’impose, non seulement dans le vocabulaire académique, mais aussi dans les lexiques du journalisme, de l’action publique gouvernementale et des organisations internationales en charge des questions de développement, ainsi que progressivement dans la langue courante des migrants et de tous ceux qui sont amenés à s’interroger sur la communauté à laquelle ils appartiennent. Le terme dépasse même le champ pourtant large des thématiques liées aux migrations, aux liens entre groupes distants, aux identités dont la logique ne peut être enfermée dans le cadre national. Il s’invite au-delà de la dispersion géographique pour devenir un mot à la mode, un mot dont on vante même la beauté et qui, selon les opinions des uns ou des autres, est associé à des valeurs contradictoires – positives ou négatives –, à des historicités différentes – il est pré-moderne, moderne ou postmoderne – ainsi qu’à des prises de position antagonistes. Pour les uns, il est dépassé, incapable de prendre en compte le monde contemporain. Pour d’autres, il est au contraire parfaitement adapté à la mondialisation et au mode de vie transnational ; il en est tout à la fois le symbole et le désignant, la « diaspora » devenant le mode de vie spécifique de l’humanité passée à la condition postmoderne, et le terme diaspora acquérant la capacité à embrasser l’époque globale. Si ses usages ou ses significations font l’objet de critiques importantes depuis le milieu des années 1990 (trop large, trop réduit, trop connoté, trop courant, incompréhensible) dans le monde académique ou dans celui des organisations communautaires, diaspora ne cesse de prendre de l’importance, notamment parce qu’il est officiellement entré depuis la fin des années 1990 dans le lexique des organisations internationales participant à la prise en charge de l’aide aux pays non industrialisés (Banque mondiale, Fonds monétaire international, Organisation internationale des migrations, etc.) comme l’alternative la plus crédible à la « fuite des cerveaux ». Fondée sur les travaux des chercheurs en sciences sociales spécialistes des « diasporas », véhiculée par d’autres chercheurs (économistes, sociologues, experts en nouvelles technologies) présentant la particularité de se trouver à l’intersection du monde de la recherche et de l’expertise internationale, cette terminologie, l’« option diaspora », s’intègre dans la lingua franca des politiques du développement et devient un élément incontournable du discours international relatif aux États et à ceux que l’on identifie comme leurs « expatriés », qu’ils soient nationaux ou seulement d’origine nationale.
Cette identification des « diasporas » liées aux États n’est pas seulement le résultat d’un regard d’experts ou de consultants. Elle s’inscrit également dans un processus de longue durée : la valeur accordée par l’État à ses ressortissants a progressivement changé. Longtemps considérés comme exclus de l’espace national par l’expatriation, les migrants voient progressivement, essentiellement depuis les années 1970, leur existence à l’étranger interprétée comme un atout à partir du moment où le lien avec le pays ne se rompt pas. La « diaspora » vaut alors ici comme lien et comme construction d’une communauté nationale par-delà la distance, rendue possible par la quasi-simultanéité des échanges à distance, par la potentielle « présence » des expatriés en dépit de leur éloignement géographique. Le terme acquiert alors, au travers de cet usage croissant par les autorités étatiques, repris voire initié par les représentants des communautés nationales à l’étranger, une dimension politique fondamentale qui s’appuie sur les acquis antérieurs – conceptualisation académique, institutionnalisation politico-administrative dans les instances internationales, popularisation croissante – pour proposer de nouveaux rapports entre les États et leurs expatriés. De fait, ces derniers ne le sont plus tout à fait puisqu’ils sont invités à rejoindre, par divers mécanismes institutionnels (vote à distance, double nationalité, représentation parlementaire), l’espace même de la nation, contribuant ainsi à transformer ce dernier en l’étendant au-delà des frontières de l’État.
Savoirs en dispersion : la diaspora de « diaspora »
À propos de Dufoix S. La dispersion. Histoire des usages du mot diaspora
1) Le mot et la chose
Retracer une histoire des usages du mot diaspora, histoire longue de plus de deux mille ans (« depuis la traduction en grec du texte sacré des Hébreux au cours du IIIe siècle avant l’ère chrétienne » (p. 35) jusqu’à sa prolifération dans les univers académique et politique depuis la fin des années 1980 où diaspora devient le « nom du global », en passant par l’émergence de la diaspora noire/africaine) c’est à cette tâche colossale que s’est livré Stéphane Dufoix durant ces dix dernières années. Ce livre est, de l’aveu même de son auteur, l’« achèvement provisoire » d’un travail irrémédiablement voué à demeurer « incomplet » (p. 567). « Incomplétude » toute relative cependant puisque le livre de Dufoix est si foisonnant, si riche d’interprétations qu’une modeste recension ne saurait aucunement lui rendre justice. Ce n’est néanmoins pas le moindre mérite de ce livre que d’ouvrir d’innombrables pistes d’investigation comme si l’histoire (une histoire) du mot diaspora, que l’auteur n’a pas voulu « raconter de manière linéaire », préférant « l’organiser selon la logique du déploiement des usages du terme » (p. 34) devenait elle-même l’objet de potentielles circulations, le lieu de trajectoires multiples.
Qu’est-ce qu’une histoire de mots ? À cette question, Dufoix répond dans son introduction qu’il inscrit sa recherche dans la lignée des travaux de l’École des Annales (Lucien Febvre), de l’École de Cambridge (Skinner, Pocock) ou encore de la Begriffsgeschichte (Koselleck). L’histoire de mots, nous dit-il, ne doit pas être confondue avec l’« histoire conceptuelle » dans la mesure où celle-ci ne se soucie guère d’interroger les « conditions de possibilité » de la formation et de l’usage des mots-concepts (p. 20) et se révèle ainsi par trop étrangère au contexte des textes (p. 21) pourtant capital si l’on désire en expliciter le sens. Si l’histoire conceptuelle relève d’une sémasiologie, de l’« étude d’une idée et de la manière dont elle a été traduite par des mots différents », l’histoire de mots relève quant à elle d’une onomasiologie, de l’« étude d’un seul mot et de ses usages, au travers des différentes idées ou choses qu’il a pu exprimer » (p. 20). Plus encore qu’à une contextualisation des usages, il s’agit de procéder à leur historicisation, ce qui implique de les étudier au niveau diachronique, sur la durée, sur le temps long (p. 23).
Par ailleurs, l’histoire de mots pratiquée par Dufoix « s’éloigne d’une simple entreprise de sémantique » dans la mesure où il s’agit pour lui de démontrer, à la suite « de toute une tradition philosophique et sociologique », que l’usage du langage contribue à la « production de la réalité sociale » (p. 27), autrement dit de prendre en compte ce qu’il appelle la formativité (plutôt que la performativité1) des mots : « l’usage du terme crée ou contribue à créer un groupe ou une entité », opération prolongée « par l’objectivation linguistique, politique ou juridique, par la reconnaissance médiatique ou académique, ainsi que par la progressive évidence que prend l’existence de l’entité ainsi produite » (p. 29). C’est en ce sens que l’auteur parle de socio-sémantique historique, celle-ci devant se refuser à toute quête d’une origine une (qui « laisse souvent entendre que cette origine dissimule l’essence, la vérité du phénomène étudié ») pour questionner « de manière plus complexe la question de la provenance en y décelant également les traces des luttes constitutives de la naissance », en d’autres termes pour thématiser et départager, dans la mesure du possible, « les vraies et les fausses origines » (p. 44), fausses origines qui font de diaspora une pure et simple traduction du mot hébreu galouth ou enracinent à tort le terme dans le lexique grec de la colonisation (p. 45).
Ce refus de l’origine, l’auteur l’hérite de Foucault, lui-même interprète de la généalogie nietzschéenne. Or, l’on peut se demander si la figure de Nietzsche n’est pas essentielle, quoique souterraine, dans l’ouvrage de Dufoix qu’il est ainsi loisible de lire comme une longe méditation sur le langage, ses pouvoirs et les illusions qu’il suscite. N’est-il pas révélateur que l’auteur ait placé en exergue de son introduction une citation du philosophe allemand : « « nous ne nous servons pas seulement [des mots et des idées] pour désigner les choses, nous croyons originairement que par eux nous en saisissons l’essence« »2 (p. 15) ? N’est-il pas plus généralement significatif que plusieurs chapitres de l’ouvrage débutent par des citations-considérations relevant d’une théorie du langage, ou mieux d’une théorie des mots, des « mots-vagabonds », sans demeure fixe, selon les mots de Locke (p. 159) ? Certes, ce n’est pas là l’objet à proprement parler de la recherche menée par Dufoix, mais ces questions ne cessent néanmoins d’affleurer à la surface de son texte, et semble-t-il d’en être une essentielle source d’inspiration… mais aussi d’inquiétude.
Faisons un pas de plus. L’effort auquel se livre l’auteur n’est-il pas d’une certaine manière comparable à une épochè (phénoménologique) ? Ne relève-t-il pas de la suspension de tout jugement sur ce qu’est la « chose diaspora » : « Tout au long de ces années, à chacune ou presque de mes interventions dans des conférences, des séminaires ou des ateliers, en France comme à l’étranger, on me posait une question, presque toujours la même : pour vous, qu’est-ce qu’une diaspora ? À chaque fois, je répondais que ce n’était pas mon objet d’étude ou tout simplement que je l’ignorais » (p. 566). Cet effort, Dufoix le sait « paradoxal », « marqué […] par le doute » et peut-être même livré à une « cinglante ironie », à une « mise en abyme toute borgésienne » dans la mesure où il pourrait en dernière instance participer de « la confirmation, et de la consécration même de l’existence de la – ou des – chose(s) que [le mot diaspora] a pu décrire au cours des vingt-trois derniers siècles » (p. 569), là où il s’agissait pour ainsi dire de démontrer, pour citer Saussure, que « bien loin que l’objet précède le point de vue, on dirait que c’est le point de vue qui créé l’objet »3. Ce à quoi en appelle Dufoix (proche de ce point vue, nous dit-il, d’autres chercheurs tels Rogers Brubaker ou Christine Chivallon), c’est à une indispensable « ‘désubstantialisation’ de diaspora dans le monde académique pour en faire une ‘catégorie de la pratique’ » (p. 458). Cependant et quoiqu’il ne le dise pas explicitement, témoigner des pouvoirs formatifs du mot, ce n’est pas pour l’auteur dénier toute réalité à la chose ou faire de celle-ci un pur artefact langagier ; c’est refuser de l’ériger en substance dont l’existence serait indépendante de tout discours. C’est pour lui, nous semble-t-il, concevoir cette existence en tant que processus lui-même intimement lié au devenir de la définition de diaspora, définition dont il montre qu’elle constitue depuis quelques décennies un véritable champ de bataille4.
Écrire une histoire de mots, ce n’est donc pas simplement recenser des occurrences, dresser un inventaire des usages ; c’est bien plutôt se livrer au fourmillement des mots, traquer leur surgissement et leur évanescence, observer leurs ancrages et leurs déplacements, expliciter leurs relations (leur identification ou leur opposition) à d’autres mots, en quoi l’on pourrait également parler d’une biographie de mots avec toutes les incertitudes, les zones d’ombre que ne peut manquer de comporter celle-ci. Or, rédiger une telle biographie suppose de mettre en question la prévalence du concept qui est déjà une première limitation du mouvement des mots. Car l’émergence du concept n’est plus en rien une origine, elle n’est qu’un moment, certes capital, de l’histoire du mot. Il n’en reste pas moins que l’ouvrage de Dufoix pourrait également nourrir une théorie du concept. Car penser l’en deçà du concept de diaspora, sa pré-histoire, c’est aussi problématiser le devenir concept du mot, « l’installation du concept » (p. 302), ou encore ce que l’on pourrait appeler la concurrence du mot et du concept5. En conclusion de son chapitre sur « L’émergence de la diaspora noire/africaine », Dufoix écrit ainsi : « diaspora n’est plus seulement un « nom à soi », mais un véritable concept à partir duquel peut être pensé l’articulation de l’unité et de la dispersion » (p. 320).
2) Décentrement : une géographie du mot diaspora
Au-delà des multiples définitions de diaspora, Dufoix montre que son champ sémantique est, du moins depuis la fin des années 1980, traversé par une tension qui, pour le dire sommairement, oppose une conception centrée qui met l’accent sur le rapport à une terre d’origine6, et une conception décentrée qui privilégie une pure dispersion dénue d’origine, de racine – à celle-ci se substituant l’image du rhizome. Cédant probablement au zeitgeist, nous ne nous intéresserons ici qu’à la seconde de ces conceptions, celle-ci puisant ses « racines » dans ce que Dufoix nomme la « matrice poststructuraliste » (p. 325-344). Ce que développent Foucault, Derrida, Lyotard ou encore Deleuze, c’est une philosophie du décentrement (de la dispersion ou de la dissémination, de la marge ou de la limite) en lutte incessante contre toute nostalgie de l’origine-centre. Et comme l’écrit très justement Dufoix : « le décentrement ne consiste pas à valoriser la marge, la périphérie, la limite, mais à intégrer la fabrication, la production de ces marges comme un élément à part entière de la construction historique de la modernité et non comme son envers » (p. 338). L’auteur souligne l’influence exercée à cet égard par la figure de Nietzsche : « Cette nouvelle lecture voit en Nietzsche un précurseur de la pensée décentrée, dans laquelle s’effacent les certitudes – de la vérité, de l’origine, du sens, du retour, de la stabilité, de l’unité – au profit d’une quête plus joyeuse de la multiplicité et de l’incertitude » (p. 341). Nietzsche devient en somme l’épigone d’une « nouvelle conception de la philosophie, qui n’est pas sédentaire et fixée mais au contraire nomade et mobile » (p. 343) et qui fait « l’apologie du déplacement entendu ici non seulement comme déplacement dans l’espace mais aussi comme […] comme déplacement du sens » (p. 344).
Mais, à nouveau, il ne saurait s’agir d’instituer cette matrice en origine unique, Dufoix préférant parler avec précaution de « première étape » (p. 325). C’est ainsi que cette philosophie du déplacement fait elle-même l’objet de déplacements, participe à « l’émergence ou [à] la consolidation de nouveaux courants de pensée dans les sciences humaines et sociales – cultural studies, postcolonial studies, subaltern studies, postmodern studies, gay and lesbian studies… – dont la plupart jouent un rôle important pour la diffusion d’une nouvelle forme d’utilisation de diaspora » (p. 345). Ne citons ici qu’Appadurai qui affirme que toute « diaspora met en danger le centre originel » et qui entend révéler « le potentiel dynamique, créatif, mobile et transformateur de la dispersion » (p. 406). De même, si à côté des textes de Glissant, les écrits poststructuralistes fournissent « un appui théorique » à la conceptualisation de diaspora par les membres du Center for Contemporary Cultural Studies (CCCS) de Birmingham (p. 358), ce n’est que graduellement et non pas tant selon une logique de l’influence ni même du « branchement » immédiat que par « affinité élective » (p. 350). Ainsi Stuart Hall pense « l’expérience diasporique » comme « expérience de l’exil et de la perte » interdisant tout retour : « « On ne peut ‘revenir chez soi’« » (p. 362). Pour Hall, « la ‘diaspora moderne’ [dont le prototype est la diaspora caribéenne] est fondée sur l’impureté, sur l’hybridité, sur la réappropriation permanente » (p. 367). Autre figure centrale du CCCS, Paul Gilroy, qui en appelle à rompe avec toute « « idée selon laquelle notre culture doit être centrée« » (p. 372) et à problématiser le « changement qu’a opéré sur [les produits artistiques ou les codes esthétiques] leur « déplacement, délocalisation et dissémination par l’intermédiaire des échanges culturels et de vastes réseaux de communication« » (p. 370-371). Gilroy s’inscrit dans un mouvement de pensée, demeuré trop largement méconnu en France, qui s’attache à thématiser ce qu’Adrienne Rich a appelé les politiques du lieu (politics of location7). C’est le cas également, aux États-Unis à présent, de l’anthropologue James Clifford, auteur d’une célèbre communication sur les cultures voyageuses (« travelling cultures ») dans laquelle « il se propose de saisir, à partir de la notion de ‘voyage’ ce qui se déplace, ce qui se translate, ce qui se modifie mais aussi ce qui demeure quand les cultures, quelles qu’elles soient, voyagent avec les hommes et les femmes qui les portent » (p. 411). Dans la diaspora « s’entrechoquent le voyage et la résidence, le local et le global, la fixité et le mouvement » (p. 411). Mentionnons enfin et de manière elliptique Avtar Brah qui s’attache quant à elle à thématiser « « la positionnalité de la dispersion« », le double mouvement de « transformation de la diaspora en chez-soi (homing of diaspora) et de diasporisation du chez-soi (diasporizing of home) » (p. 415).
Certes, nous n’en sommes déjà plus ici « à une vision totalement décentrée où disparaîtrait le travail même sur l’origine » (p. 412) dans la mesure où il s’agit de penser à la fois, pour Gilroy, les « déplacements » et les « recompositions identitaires, le changing same » (p. 413) ; pour Clifford, les « enracinements » (roots) et les cheminements (routes) (p. 323) ; pour Brah, la localisation et la dislocation (location/dislocation) (p. 415) – et l’on ne s’étonnera donc guère que le concept de frontière ait été amené à jouer un rôle de premier plan dans ces recherches. Il n’en reste pas moins que la question première qui anime celles-ci demeure celle du déplacement, de la dispersion « originelle ». Ne songeons ici qu’à l’image du navire « voguant entre l’Europe, l’Amérique, l’Afrique et les Caraïbes » que Gilroy mobilise comme symbole de l’entreprise intellectuelle menée dans son livre L’Atlantique noir (p. 373) car cette image, que Nietzsche avait déployé et dont Foucault avait fait le symbole de l’hétérotopie (p. 344), « attire immédiatement notre attention sur le « Passage du Milieu« , sur les divers projets de retour rédempteur à la patrie africaine, et sur la circulation d’idées, de militants et d’artefacts culturels et politiques essentiels, qu’il s’agisse de pamphlets, de livres, de disques ou de chœurs »8.
Nous aimerions à présent montrer que ce schème du décentrement et de la dispersion est dans l’ouvrage de Dufoix bien plus qu’un objet d’investigation parmi d’autres, bien plus qu’un moment de l’histoire du mot diaspora. En exergue de son introduction, et à la suite de la citation de Nietzsche mentionnée précédemment, Dufoix reproduit les mots suivants de Henry Goldschmidt : « « Le concept de ‘diaspora’ a récemment été adopté par les chercheurs dans tellement de disciplines – et brandi par des activistes dans tellement de communautés – que le terme lui-même est devenu quelque peu diasporique« » (p. 15). Qu’est-ce à dire sinon que la prolifération des usages de diaspora au cours des dernières décennies relève elle-même d’une véritable dispersion, ce qu’indique du reste assez explicitement le titre même du livre : La dispersion. Une histoire des usages du mot diaspora – quoique au premier abord, le lecteur puisse penser que le mot dispersion n’est ici qu’un substitut « neutre », non connoté, du mot qu’il s’agit en quelque sorte de « déconstruire » en en retraçant l’histoire. Dufoix l’écrit également dans le corps de l’ouvrage: « Le sens de diaspora est désormais lui-même très dispersé » (p. 473) ce que l’on peut encore lire en quatrième de couverture : « Les usages de diaspora, aujourd’hui dispersés tant géographiquement que sémantiquement, ont très peu été questionnés ». Commentant enfin un article de Rogers Brubaker au titre éloquent « The ‘Diaspora’ Diaspora », Dufoix parle d’une « dispersion des significations du terme au sein de l’espace sémantique, conceptuel et disciplinaire » (p. 457).
Cette dernière citation ne devrait-elle pas pourtant nous mettre en garde car l’idée d’une dispersion du mot diaspora signifie-t-elle autre chose ici que la simple multiplication de ses significations, l’inflation du terme ? La dispersion a-t-elle un autre sens que métaphorique ? Peut-être pas, mais connaissant le rôle qu’a pu jouer la métaphore (dont on rappellera qu’elle est elle-même déplacement, transfert de signification d’une entité à une autre) dans la prolifération des usages du mot diaspora, l’on pourrait se demander si Dufoix lui-même ne contribue pas, sinon à la dispersion du mot diaspora, du moins à celle du discours du déplacement et de la dispersion qui le porte. Ainsi, en conclusion de ses remerciements, il écrit déjà : « Tout le monde étant sur le pont, le voyage peut commencer » (p. 10) – tout comme avant lui Gilroy, dans la préface de L’Atlantique noir, avait invité ses lecteurs à « [embarquer] pour le voyage auquel, je l’espère, ce livre s’apparente »9. Ne lit-on pas par ailleurs en quatrième de couverture que ce à quoi nous convie Dufoix, c’est à « un voyage de plus de deux millénaires sur les traces de ce mot » ? N’évoque-t-il pas dans les dernières pages du livre « le vertige de la dispersion » qui l’emporte « à l’heure de conclure » ajoutant que « le terrain ferme manque à chaque pas » (p. 568) et qu’il ne s’agit donc là que du « terme provisoire du voyage » (p. 570). Et si cette dispersion « spatiale » du mot n’est pas interrogée en tant que telle dans l’ouvrage, c’est bien néanmoins sur une problématisation cartographique de la « dispersion de diaspora » (qui semble même prendre un instant le pas sur sa problématisation historique) qu’ouvre sa conclusion, quoique l’auteur fasse encore un usage systématique des guillemets comme si un doute subsistait, comme s’il redoutait la menace d’être lui-même pris dans les mots, captif du langage de la dispersion. S’appuyant sur un essai d’August-Wilhelm von Schlegel sur l’étymologie, Dufoix en appelle ainsi à « retracer les « migrations » [que les mots] accomplissent ». Car à travers sa « métaphore migratoire », Schlegel « fait une magnifique description de ces « voyages » dont j’ai tenté de tracer grossièrement la carte » (p. 570). Le livre se clôt sur ces mots du poète et philologue allemand : « « Les mots voyagent, ils s’établissent comme des colons loin de leur patrie, et il n’est pas rare de les voir faire le tour du globe« » (p. 570).
Ce que ne cesse de dévoiler le livre de Dufoix, c’est que l’histoire récente du mot diaspora est aussi l’histoire d’incessants déplacements, circulations, voyages d’hommes et d’idées : voyages par exemple « de nombreux écrivains noirs-américains après la Première guerre mondiale », voyages qui seront essentiels pour l’émergence des mouvements noirs francophones (en particulier pour la naissance de la négritude) et seront en outre inséparables d’une véritable « migration des idées » (p. 274) ; voyage outre-Atlantique également de ce qui allait devenir la French Theory dont la formation fut étroitement liée à la « migration » des intellectuels des ex-colonies dans les universités américaines et au développement des postcolonial studies – que l’on ne pense qu’à Gayatri Chakravorty Spivak, auteur du célèbre essai « Les subalternes peuvent-elles parler ? », mais aussi de la traduction anglaise de La Grammatologie de Derrida. À propos de ce voyage, Dufoix parle du reste d’« importations de la dispersion et de diaspora » (p. 345), ce qui ne peut manquer de faire écho à la notion bourdieusienne d’« import-export intellectuel »10 largement reprise et retravaillée dans « la littérature sociologique et historique sur la circulation des idées » (p. 354). À cette littérature, qui interroge les « passages, transferts, luttes, conflits frontaliers, concernant aussi bien les individus et les institutions que les idées, les œuvres et les disciplines »11, Dufoix ne manque pas de se référer et, semble-t-il, de s’inspirer lorsqu’il emploie la notion de trajectoire des usages du mot diaspora (p. 33). Cependant, tandis que cette littérature reste le plus souvent confinée à l’Europe ou bien à une bipartition Europe continentale versus États-Unis/Grande Bretagne (liée à la question « que faire des cultural studies ? »12), le voyage que retrace Dufoix opère une salutaire distension de l’espace des discours et des savoirs, le concept de trajectoire acquérant par là même une dimension plus spécifiquement géographique. Il est à cet égard significatif que l’auteur ait baptisé l’un des sous-chapitres de la partie consacrée à la diaspora noire : « socio-géographie des premiers usages », quoique l’on puisse regretter qu’il ne soit pas réellement attaché à problématiser cette notion.
Selon Appadurai, la « diaspora » était aussi celle « de certains mots occidentaux tels que droits, liberté, souveraineté, représentation ou démocratie », cette mobilité ayant « contribué à diminuer « la cohérence interne qui maintenait la cohésion entre ces mots et ces images au sein d’un récit d’ensemble euro-américain« » (p. 406). Or, ne faudrait-il pas à présent ajouter à cette liste, qui évidemment ne se veut pas exhaustive, le mot diaspora lui-même. Sa dispersion sémantique n’est-elle pas dépendante de sa dispersion géographique autour du globe ? Pour employer une idée un peu usée, ne serait-on pas en présence d’une singulière « identité du sujet et de l’objet » dans la mesure où seraient désormais inextricablement mêlés l’objet de connaissance et les modalités de production de cet objet, l’espace de la diaspora et l’espace du mot diaspora, sans qu’il soit possible de trouver un ancrage, de se donner un point fixe à partir duquel pourraient être contemplés ces mouvements enchevêtrés ? Pour le dire autrement, ce qu’il s’agit d’attester, c’est la constitution diasporique de diaspora, du fait que le domaine des diaspora studies s’est lui-même constitué en diaspora. Au-delà, ou plutôt en complément de l’historicisation de l’usage des mots, il serait ainsi nécessaire de problématiser leurs mouvements, leurs déplacements, d’œuvre à leur « géographisation ». L’enjeu serait ainsi de promouvoir une géographie de mots qui ne serait pas seulement une partie, un « chapitre » de leur histoire, mais soulèverait des questions originales.
Conclusion : « théories en diaspora »
Si retracer l’histoire de diaspora s’avérait être une tâche essentielle, c’est donc aussi en raison du pouvoir heuristique du mot lui-même qui, peut-être plus que tout autre mot, rend possible une échappée hors d’une histoire des idées profondément eurocentrée, une histoire conçue par Arthur O. Lovejoy comme « une quête, une recherche des idées par lesquelles la civilisation occidentale s’est affirmée dans son rôle et son destin »13 ; hors donc de ce qu’on peut appeler une histoire occidentale des idées. C’est que diaspora est devenu l’indice d’une mutation opérée non seulement dans nos manières de penser les cultures, les communautés, l’identité, etc. mais aussi dans les modes mêmes de production de la connaissance, une connaissance qui, en contexte postcolonial, est vouée à la dispersion – ce qui n’empêche aucunement, au contraire, que se manifestent ce que l’on pourrait appeler des « revendications cognitives territoriales », que s’affirment ou se réaffirment des frontières géo-épistémiques. C’est pourquoi la « circulation internationale des idées » n’est pas seulement porteuse d’enjeux historiques et sociologiques ; elle l’est aussi d’enjeux proprement épistémologiques qui sont également ceux soulevés par le projet d’une décolonisation des savoirs. Pour Foucault, affirme Paul Veyne, « l’histoire des idées commence vraiment quand on historicise l’idée philosophique de vérité »14. Or, s’il faut toujours saluer cette mise en perspective historique, ne nous faudrait-il pas néanmoins aujourd’hui contester les limites géographiques de cette histoire, mettre en question la fixité des territoires de la connaissance, des « aires intellectuelles » ? À la question « qu’est-ce que la vérité ? » ne se substituerait plus alors seulement celle de sa production historique, mais aussi celle de sa localisation : « où est la vérité ? ».
L’on pourrait alors en appeler à l’émergence d’une nouvelle sémasiologie reposant elle-même sur une géographie de la connaissance ; une sémasiologie qui, attentive aux processus de délocalisation et de relocalisation des idées, soucieuse des lieux de la connaissance, pourrait échapper à l’écueil de la décontextualisation qui menace l’histoire conceptuelle. Bourdieu, s’appuyant sur une réflexion de Marx dans Le manifeste du parti communiste, soulignait que le plus souvent « les textes circulent sans leur contexte », ceci s’avérant source de bien des « malentendus »15. Il faudrait cependant ajouter que ces changements de contexte, ces appropriations, sont également source de variations, d’altérations, de traduction du texte lui-même, autrement dit qu’ils sont susceptibles d’avoir de puissants « effets théoriques » qui demandent eux aussi à être élucidés. Or, cela pourrait être fait en réinvestissant le concept de théorie voyageuse introduit par Said16, repris et retravaillé notamment par Clifford17 et auquel Dufoix ne manque pas de faire référence (p. 370, 411). Que l’on ne songe ici qu’aux trajectoires de la ladite dialectique hégélienne du maître et de l’esclave (qui nous intéresse d’autant plus que les études postcoloniales/subalternes sont marqués par un profond antihégélianisme), objet d’innombrables déplacements, d’« usages dispersifs » (ne citons que les reprises de Simone de Beauvoir ou de Frantz Fanon) qui furent aussi de profondes reconfigurations et pour tout dire des revigorations théoriques au service de projets émancipatoires originaux. La question soulevée est par conséquent celle des transformations qui affectent l’« identité » des théories (et en particulier des théories nées sur le sol européen) en situation de dispersion. Ce qu’il s’agit de conceptualiser, c’est ce qu’on pourrait désigner comme des théories en diaspora… au risque de contribuer une fois encore à la dispersion sémantique du terme.
En conclusion, si cette recension débute par un exposé qui se veut fidèle au projet théorique de Stéphane Dufoix, elle se conclut par une série d’hypothèses de travail, de pistes de recherche que l’auteur de La dispersion désavouerait peut-être toutes et qui pourront sembler bien fragiles et téméraires comparées à l’immense travail et à la solidité des idées défendues dans ce livre. Mais dussent-ils mener à une impasse, ces cheminements n’en témoigneront de la grande productivité de cet ouvrage qui ouvre d’innombrables horizons et nous enjoint donc à aller au-delà de lui ; un ouvrage qui, tout simplement et c’est là l’essentiel, nous donne à penser.
Matthieu Renault est docteur en philosophie politique, chercheur associé au Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques (CSPRP, Université Paris VII Denis Diderot) et ingénieur de recherche à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme. Il est l’auteur notamment de : Frantz Fanon. De l’anticolonialisme à la critique postcoloniale, Paris : Amsterdam, 2011.
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Selon Dufoix, l’usage pour le moins diffus de la notion de performativité dans le champ académique est (linguistiquement) impropre. Si la performativité (acte illocutoire chez Austin) désigne le fait de « faire des choses avec les mots », la formativité elle seule (acte perlocutoire) désigne le fait que « des paroles produisent des effets » (p. 29). L’on pourra néanmoins se demander si le concept même de performativité ne devrait pas à son tour être historicisé, ce qui obligerait à faire le constat d’une progressive disparition de la différence illocutoire/perlocutoire que ce soit par exemple chez Bourdieu que Dufoix évoque ou encore dans les théories du genre et notamment chez Judith Butler ; de telle manière qu’il faudrait renoncer à en revenir à un quelconque « sens originel » de la performativité. La question, avouons-le quelque peu aporique, que l’on peut ainsi soulever est celle de la possibilité pour une histoire de mots d’historiciser jusqu’à ces instruments théoriques et méthodologiques eux-mêmes. |
|---|---|
| ⇧2 | Ici comme dans la suite du texte, les « » renvoient aux citations introduites par Dufoix dans son texte. |
| ⇧3 | de Saussure, F. Cours de linguistique générale, Paris : Payot, 1972, p. 23, cité par Boschetti, A. « Pour un comparatisme réflexif » in Boschetti, A. (dir.), L’espace culturel transnational, Paris : Nouveau Monde éditions, 2010, p. 12. |
| ⇧4 | Ce dont témoigne la volonté affirmée par toute une série de chercheurs d’établir une liste stricte de critères de ce qu’est une diaspora : « définitions catégoriques » néanmoins concurrencées par des « définitions ouvertes […] proposant une vision lâche et non discriminée de l’objet étudié et laissant la porte ouverture à un nombre indéterminé a priori de cas » ainsi que par des « définitions oxymoriques […] ne proposant aucune réelle définition du concept, mais une conception de l’identité culturelle en dispersion travaillée par la dispersion et le changement » (p. 441). |
| ⇧5 | Nous pensons ici aux pages que Dufoix consacre à Édouard Glissant. Ainsi rend-il compte de ce qui est bel et bien un usage conceptuel dediaspora lorsqu’il souligne que « Glissant fait de diaspora une notion peu pertinente pour étudier la question des Africains transportés hors d’Afrique » (Glissant écrit : « « C’est ce qui différencie, outre la persécution d’une part et l’esclavage de l’autre, la Diaspora juive de la Traite des nègres » »). Mais l’« examen des usages » de diaspora par Glissant « montre une réalité plus contrastée », « [témoignant] plutôt de son acceptation » (p. 352). Faut-il alors donner le primat au concept sur le mot (plus fluctuant, moins soumis à l’emprise de l’auteur) ou au mot sur le concept comme semble le faire ici Dufoix ? Ou ne serait-ce pas cette contradiction interne même qui primerait et qu’il faudrait ainsi élucider ? |
| ⇧6 | Conception qu’il ne faut pas assimiler sans précaution à l’archétype de la diaspora juive, ainsi qu’en témoigne un auteur tel que Simon Doubnov, « personnage central de la réflexion juive sur le déplacement » (p. 377) qui a « pensé la dispersion en dehors de toute perspective de retour à la terre natale » (p. 381). |
| ⇧7 | Rich, A. « Notes Toward a Politics of Location » in Rich, A. (ed.) Blood, Bread, and Poetry: Selected Prose 1979-1985, Londres : Virago, 1987. |
| ⇧8 | Gilroy, P. L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, Paris : Amsterdam, 2010, p. 19. |
| ⇧9 | Gilroy, P. L’Atlantique noir. Modernité et double conscience, op. cit., p. 12. |
| ⇧10 | Bourdieu, P. « Les conditions sociales de la circulation internationale de la circulation internationale des idées », Actes de la recherche en sciences sociales, 2002/5 n° 145, p. 3-8. |
| ⇧11 | Boschetti, A. « Pour un comparatisme réflexif », op. cit., p. 11. |
| ⇧12 | Cf. notamment « Miroirs transatlantiques. Circulation des savoirs et malentendus féconds entre les États-Unis et l’Europe, y compris la France », L’Homme, n° 187-188, juillet-décembre 2008. |
| ⇧13 | Rosaye J.-P., « L’institutionnalisation de l’histoire des idées : un conflit de méthodes et de statuts », Revue LISA/LISA e-journal, vol. VII, n°3, 2009, http://lisa.revues.org/117, dernière consultation le 20 décembre 2011. |
| ⇧14 | Veyne, P. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?, Paris : Seuil, 1992, p. 39. |
| ⇧15 | Bourdieu, P. « Les conditions sociales de la circulation internationale de la circulation internationale des idées », p. 4. |
| ⇧16 | Said, E.W. « Travelling Theory » in The World, the Text, and the Critic. Cambridge : Harvard University Press, 1983 ; Said, E. W. « Retour sur la théorie voyageuse » in Réflexions sur l’exil et autres essais, Arles : Actes Sud, 2008. |
| ⇧17 | Clifford, J. « Notes on Theory and Travel » in Clifford, J. et Dhareshwar, V. (eds), Traveling Theories, Traveling Theorists, Inscriptions 5, Santa Cruz : University of California, 1989, http://www2.ucsc.edu/culturalstudies/PUBS/Inscriptions/vol_5/clifford.html, dernière consultation le 7 février 2012. |