
Le rôle de l’État dans la genèse du capitalisme en Europe. À propos d’un ouvrage d’A. Bihr
À propos de l’ouvrage d’Alain Bihr : Le Premier Âge du capitalisme (1415-1763). Tome 2 : La Marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme, Lausanne/Paris, Éditions Page 2/Syllepse, 2019, 805 pages.
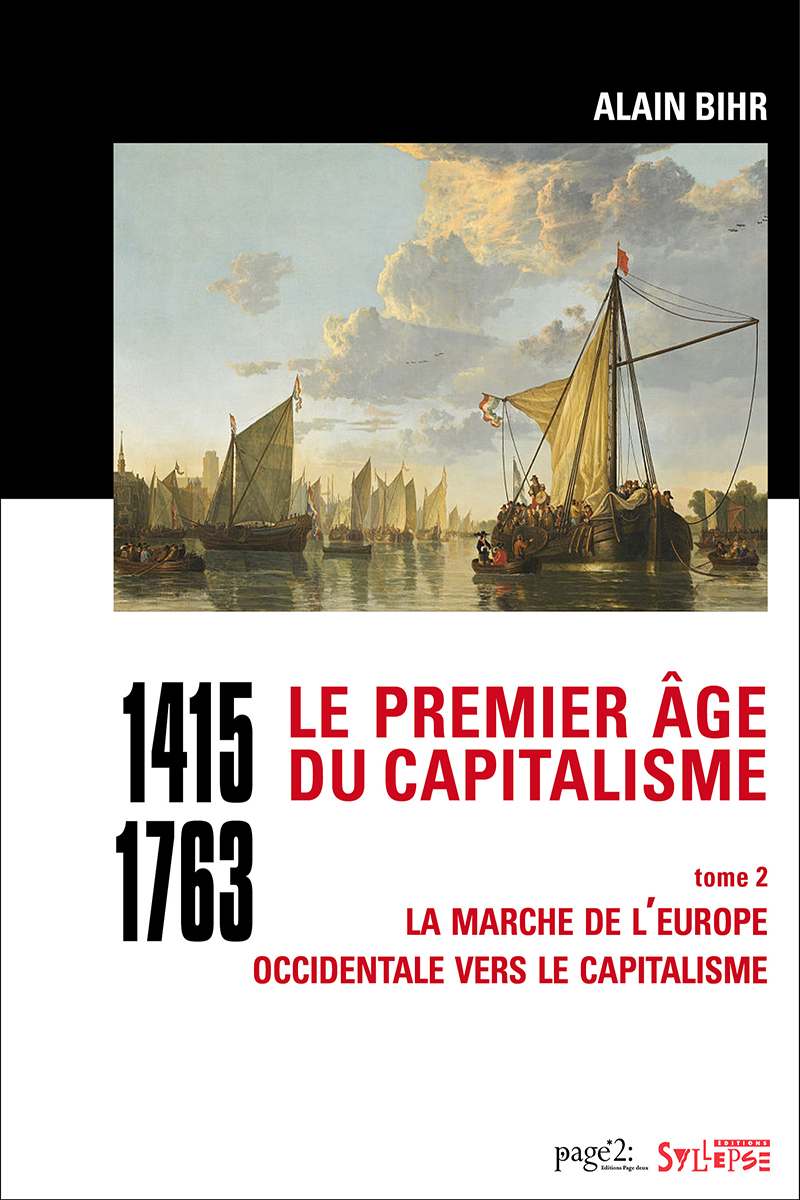
Ce tome 2 poursuit le récit par Alain Bihr de la genèse du capitalisme, en étudiant cette fois-ci non plus les racines coloniales de cette genèse[1] mais la manière dont elle s’incarne dans les bouleversements que connaît l’Europe occidentale à cette époque. Pour ordonner son propos, Alain Bihr assume une méthodologie marxiste rétrospective. Il prend en effet pour point de départ le schéma du cycle complet du capital industriel dessiné par Marx dans le Livre II du Capital ainsi que la description des rapports de classe dressés dans le Manifeste du parti communiste.
C’est en tâchant d’identifier, dans la masse des phénomènes offerts au chercheur, les premières manifestations de ces réalités capitalistes – dont on peut considérer que Marx les décrit à l’état pur – qu’A. Bihr déroule l’histoire de ce protocapitalisme européen, formation sociale de transition puisqu’elle comprend à la fois les prodromes en question mais également des structures féodales en déclin avec lesquelles ils entrent en conflit : « Partout, à tous les niveaux, c’est le règne du double, de l’ambivalence, de l’ambiguïté, de l’ancien qui n’en finit pas de mourir et du nouveau qui peine à naître » (p. 800-801).
L’ouvrage s’ordonne donc autour de quatre parties, dont la première – « Le Parachèvement des rapports capitalistes de production » – porte plus spécifiquement sur la genèse du cycle capitaliste tandis que les trois suivantes – « Protocapitalisme et guerre », « La formation de l’État capitaliste » et « L’Invention de la modernité » – sont plus directement sur les transformations politiques et sociales impliquées par le remplacement progressif des rapports féodaux par les rapports capitalistes.
Comme dans le tome précédent, l’ouvrage alterne des phases proprement narratives, orientées selon une progression purement chronologique, et un découpage thématique qui permet de dissocier clairement les composantes de ce protocapitalisme. Cette alternance produit des effets parfois surprenants : ainsi, les guerres et les révolutions de la période sont par exemple étudiées avant qu’il ne soit question de la formation de l’État capitaliste. Mais sauf à choisir entre un récit purement chronologique et une étude purement analytique, il s’agit là d’un expédient inévitable et cohérent avec la démarche d’A. Bihr, tout en conférant à l’ouvrage une unité plus contraignante que celle du tome 1. Difficile, ici, de sélectionner un ou plusieurs chapitres indépendamment du reste de l’ouvrage.
La première partie, la plus directement économique, raconte l’apparition, encore fragile, des différentes conditions et composantes du cycle capitaliste tel que décrit par Marx : l’accumulation de capital-argent, qui fonctionne ici comme capital commercial et capital financier, l’existence d’un prolétariat, un processus – timide – d’industrialisation[2] du travail et la formation de marchés capitalistes.
Pour chacune de ces réalités, A. Bihr montre comment éléments féodaux et capitalistes produisent des réalités hybrides qui font toute la spécificité de ce proto-capitalisme : les compagnies commerciales, principal acteur capitaliste de l’époque, sont ainsi à la fois très « avancées » du point de vue de leur forme, constituant de véritables sociétés par action, tout en étant intrinsèquement liées à une forme politique de plus en plus marginalisée au fur et à mesure que va se développer l’État bourgeois, l’empire[3]. De même, le système monétaire demeure soumis à l’arbitraire étatique malgré les tentatives des marchands de constituer un système fonctionnant d’une manière plus objective, etc.
Le principal enseignement qu’A. Bihr tire de sa description – ou plutôt celui qu’il choisit de mettre en avant – est l’importance de l’État dans les dynamiques économiques de la période. Il est en effet présent et agissant d’un bout à l’autre des cycles capitalistes partiels que connaît la période. On le retrouve derrière les compagnies commerciales, les premières manufactures, les transformations du système monétaire et du système de crédit, la formation – via l’expropriation des paysans – d’une classe de prolétaires, etc. Ce faisant, de même que dans le premier tome de son ouvrage, A. Bihr insiste sur la dimension politique de cette genèse du capitalisme, contre l’idée que les fétiches capitalistes – marchandise, monnaie et capital – auraient produit mécaniquement la réalité capitaliste et continueraient à le faire jusqu’à aujourd’hui.
Ce sont également les politiques mercantilistes, auxquelles A. Bihr assigne une dimension structurante pour le capitalisme naissant, qui témoignent de cette importance de l’État et elles permettent ainsi à A. Bihr d’effectuer une transition entre la dimension proprement économique de la première partie et celle, plus directement politique, de la seconde. Cette dernière est en effet consacrée aux différents conflits engendrés par la montée en puissance des rapports sociaux capitalistes, qu’il s’agisse des conflits interétatiques – les guerres, qui tendent à devenir à l’époque des guerres entre États – ou des conflits inhérents aux États qu’accompagne le passage d’une société d’ordre à une société de classe.
Dans les deux cas, ce récit des conflits sert avant tout de réponse à la question des origines de l’État, vu principalement ici comme le sujet politique intrinsèquement lié au capitalisme puisqu’il est issu de ses conflits, qu’il organise et régule. État et capitalisme sont donc pris dans un processus de conditionnement réciproque, le développement de l’un se nourrissant de l’autre et inversement. Là encore, l’histoire des différents conflits se trouve réinscrite dans un cadre susceptible de lui donner sens, la constitution progressive des rapports sociaux capitaliste.
La troisième partie de l’ouvrage cherche à étudier l’État naissant non plus simplement à travers l’étude des fonctions qu’il remplit pour le capitalisme mais dans la forme spécifique qu’il prend à l’époque, celle de l’État capitaliste. A. Bihr approfondit, pour ce faire, les rapports entre État de droit et capitalisme, poursuivant semble-t-il la discussion avec Max Weber[4] ainsi qu’avec d’autres théoriciens marxistes, E. Pašukanis[5] notamment.
Dans la mesure où l’ordre capitaliste suppose une certaine objectivation des rapports humains, le droit (et notamment le droit de la propriété) participe du mouvement de capitalisation des sociétés puisqu’il fait naître un ordre rationnel et « calculable » (le terme se trouve notamment chez Weber) permettant le développement des rapports marchands et la mise en œuvre d’un espace d’échange large et non menacé par l’arbitraire des pouvoirs personnels. C’est d’ailleurs dans ce cadre qu’on comprend la dépersonnalisation et la bureaucratisation – encore très partielles – de l’État, qui s’accompagne de pratiques administratives codifiées peu à peu et entrant elles aussi dans des cadres légaux.
L’État, du fait de son poids croissant, va devenir un sujet économique à part entière, centre de prélèvement de ressources (notamment par l’impôt) et de dépenses (la guerre, principalement), ce qui va donner lieu aux bricolages institutionnels et économiques les plus curieux (vente des offices, endettement public auprès des riches marchands), sans doute les meilleurs exemples de cet état hybride et transitionnel des réalités sociales de cette époque.
La dernière partie – « L’invention de la modernité » – porte enfin sur la sphère la plus « superstructurelle » du monde social, c’est-à-dire la culture, entendue ici en un sens large. Elle s’articule en trois chapitres, qui reprennent des moments et des thèmes considérés habituellement comme constitutifs de la modernité occidentale : la Réforme, la Renaissance et les Lumières (étudiées ici comme une seule dynamique) et l’émergence de ce que A. Bihr appelle « individualité asservie » (qui touche notamment à ce qu’on appelle communément l’individualisme). Outre une discussion des thèses de Weber, appuyée manifestement sur une solide bibliographie, on trouvera dans cette partie une description de la manière dont ces révolutions culturelles ont arraché petit à petit la vie des individus aux institutions qui façonnaient l’espace féodal, l’Église en premier lieu.
C’est également la partie dans laquelle A. Bihr se prête à l’exercice difficile de l’inventaire de la culture bourgeoise, progressiste par certains aspects et néfaste par d’autres. Le chapitre sur les Lumières est symptomatique ici : tout en rappelant les errements – racistes, inégalitaires, etc. – de certaines Lumières (ce qui fait d’ailleurs s’interroger sur la consistance du terme), A. Bihr conclut son propos sur le rappel du fait que c’est l’héritage des Lumières, abandonné par la bourgeoisie, qui a servi de base à la formation d’une culture progressiste au sein du mouvement ouvrier.
En offrant une synthèse actualisée de l’histoire du capitalisme écrite d’un point de vue – et selon une méthode rigoureusement – marxiste, A. Bihr nous permet donc de réinscrire des événements connus de notre histoire dans un cadre qui leur donne une intelligibilité et un sens indéniables. En cela, il s’agit d’un ouvrage important susceptible de servir de base à la construction d’un autre récit que celui, hagiographique, bâti par les idéologues du capitalisme souriant et massivement diffusé aujourd’hui encore. Peut-être faudra-t-il en fournir, pour ce faire, une version abrégée (les trois volumes devraient avoisiner les 2000 pages).
D’autre part, l’ouvrage pêche par ses mérites : en insérant tous les événements significatifs dans la longue histoire de la formation du capitalisme, il ne répond pas à des questions plus théoriques sur les rapports « logiques » entre les réalités sociales qu’il met historiquement en lien. L’importance historique, indéniable, de l’État de droit pour le capitalisme permet-elle de conclure qu’il constitue la forme « normale » de l’État capitaliste ? De même, qu’y a-t-il d’intrinsèquement bourgeois – et de fonctionnel au capitalisme – dans la logique d’individualisation des rapports sociaux ?
C’est peut-être sur ces questions, qui se posent de manière brûlante aujourd’hui puisqu’elles mettent en jeu la question des alternatives cohérentes au capitalisme, que l’histoire et la logique ne se recouvrent pas totalement et qu’il faut trancher en faveur de l’une ou de l’autre. Mais il demeure évident que l’ouvrage d’A. Bihr, de par l’ampleur de ses perspectives et des données qu’il rassemble, sera indispensable pour poursuivre ces réflexions.
Notes
[1]Voir le compte-rendu du 1er tome.
[2]Le terme est ici à entendre en un sens non directement technique puisqu’il dénote surtout le caractère de plus en plus hétéronomique du processus de travail, c’est-à-dire la disparition tendancielle, là encore timide, de l’artisanat.
[3]Il n’est pas ici question ici d’impérialisme au sens économique du terme, qui sera au contraire – du moins pour les théoriciens marxistes du premier vingtième siècle – une manifestation, au contraire, d’un âge avancé du capitalisme.
[4]On pense notamment à la section d’Économie et société (mal) traduite en français sous le titre Sociologie du droit.
[5]E. Pašukanis, La Théorie générale du droit et le marxisme [1924], Toulouse, Éditions de l’Asymétrie, 2018. On a repris ici la graphie du nom de l’auteur proposée par l’éditeur, assez curieuse (prononcer « Pachoukanis »).
[6]Tout comme dans le premier volume, on ne trouvera pas ici de bibliographie explicite.









