
Conquérir une démocratie réelle. Un extrait du livre de Samuel Hayat
Samuel Hayat, Démocratie, Paris, Anamosa, 2020.
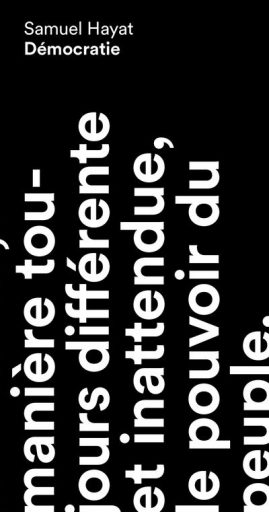
Refuser collectivement d’être gouvernés
La question est de savoir ce que peut signifier une société démocratique, donc ce que peut vouloir dire démocratiser des relations de pouvoir qui nous traversent, nous constituent même comme sujets particuliers, avec nos identités de genre, de race, de classe. La question est en réalité double : il s’agit à la fois de savoir quel est l’objectif de la démocratie comme forme de société, et par quels moyens il est possible de l’atteindre. À la première question, la réponse est simplement l’égalité, la fin de la domination. De la même manière que, dans la sphère de l’État, la démocratie consiste à donner un pouvoir égal à n’importe qui, lorsqu’on passe aux relations sociales, il s’agit de donner à chacun un pouvoir égal, c’est-à-dire de faire en sorte que personne ne soit soumis à personne, sur aucun plan. Observant la société américaine du XIXe siècle, et y voyant les prémisses d’un mouvement amené à transformer le monde entier, Tocqueville définit la démocratie par « l’égalité des conditions », c’est-à-dire la suspension de l’évidence de la différence sociale entre le serviteur et le maître. Loin d’être un démocrate, Tocqueville voit dans ce mouvement d’égalisation, selon lui impossible à empêcher, un danger pour la stabilité des sociétés. Ce faisant, il s’inscrit dans une longue tradition de critique de la démocratie comme régime créant une égalité sociale indue, car donnant, comme l’écrivait Platon, « une sorte d’égalité aussi bien à ce qui est inégal qu’à ce qui est égal ». Alors que pour Platon, la société est censée être organisée par des distinctions, où chaque personne est à la place spécifique qui lui est assignée, il reproche à la démocratie de mettre partout l’égalité. La démocratie, selon lui, égalise toutes les positions, tant en matière politique qu’en matière sociale, et même psychologique, puisque « l’homme démocratique » se trouve incapable d’établir des distinctions, ce qui l’amène à établir « une espèce d’égalité entre les plaisirs, livrant le commandement de son âme à celui qui se présente, comme offert par le sort, jusqu’à ce qu’il en soit rassasié, et ensuite à un autre ; il n’en méprise aucun, mais les traite sur un pied d’égalité ». Pour Platon, la logique du sort, qui dans le gouverne- ment démocratique donne le pouvoir à n’importe qui à travers le tirage au sort, amène dans le domaine social les individus à désirer n’importe quoi.
Il faut prendre au sérieux cette critique de la démocratie, sans cesse reprise depuis Platon jusqu’aux républicains d’aujourd’hui qui, de Marcel Gauchet à Dominique Schnapper, mettent en avant le danger que la démocratie, comme mouvement d’égalisation sans limite, de mise en question de tous les pouvoirs, de destruction de toutes les valeurs, est censée faire peser sur les sociétés. Il y a bien quelque chose de proprement anarchique dans la démocratie, entendue comme demande d’égalité dans tous les domaines. Car si l’on considère que la société est traversée de rapports sociaux fondamentalement inégalitaires, alors vouloir réaliser l’égalité ne peut pas passer uniquement par l’attribution à chacun d’un poids électoral identique. Si la démocratie n’est pas seulement affaire de pouvoir au sens étatique, mais aussi d’égalité dans les rap- ports sociaux, elle doit inclure la possibilité de les mettre en question. Prise en ce sens, la logique démocratique consiste en une extension indéfinie de la capacité de décision de n’importe qui à l’ensemble des relations de pouvoir dans lesquelles il est pris, c’est-à-dire à n’importe quoi. Un des aspects cruciaux de la démocratie se trouve alors dans la possibilité de refuser d’être gouverné, dans quelque aspect de sa vie que ce soit. Et il faut immédiatement ajouter : la démocratie, c’est refuser d’être gouverné, mais à plusieurs. Car l’expérience du gouvernement, même si elle est vécue de manière singulière, nous lie aux autres sujets qui partagent cette expérience. Les rapports de pouvoir séparent et distinguent, mais par là ils constituent des sujets collectifs, qui peuvent se découvrir pareillement soumis aux mêmes dispositifs, et peuvent choisir, ensemble, de les refuser. La démocratie, en ce sens à la fois politique et social, est le pouvoir des gouvernés qui se découvrent collectivement gouvernés, et qui dans cette découverte refusent ensemble l’assujettissement.
Les modalités de ce refus d’être gouvernés peuvent prendre de multiples formes, selon les rapports de pouvoir dont il est question, les espaces et les moments où il saisit les groupes. Il peut passer par des insoumissions collectives mais silencieuses, par des résistances secrètes ou au contraire étalées au grand jour, par des défections, des rébellions, des soulèvements. Dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit de populations subalternes, la résistance doit se faire infra-politique, se réfugier dans les cultures populaires, pour ne pas être lisible par les dominants. Au contraire, lorsque ce refus du gouvernement peut s’exprimer au grand jour, dans les situations révolutionnaires, par exemple, il peut nourrir, dans les groupes sociaux dominés, des projets de scission. Le retrait des plébéiens sur l’Aventin, dans la République romaine du Ve siècle av. J.-C., constitue l’événement inaugural, pour Rancière, de ce qu’il appelle la politique : les patriciens leur refusant d’avoir part à la discussion politique, les plébéiens s’en séparent pour constituer leur propre espace de parole, montrant par là leur capacité, à égalité avec les patriciens, à délibérer. L’histoire des luttes est pleine d’exemples de ces moments où les dominés menacent, rêvent ou effectuent cette séparation d’avec les groupes qui les exploitent et les dominent. L’anarchiste Pierre-Joseph Proudhon défend cette option pour les travailleurs dans son dernier ouvrage, La Capacité politique des classes ouvrières, publié de manière posthume en 1865 comme une réponse au Manifeste des Soixante sur les candidatures ouvrières. De ce manifeste, il approuve le principe : l’affirmation de la « Démocratie ouvrière » comme une force politique propre, autonome, reposant non sur une unité d’opinions, mais sur une unité de classe. Cependant, alors que les Soixante veulent s’organiser en vue de la participation aux élections, Proudhon avance que la Démocratie ouvrière doit rompre avec le système, refuser de faire partie des mêmes institutions que la classe bourgeoise, s’en « séparer radicalement ». Cet impératif se retrouve dans l’anarcho-syndicalisme, reposant sur l’idée que les syndicats constituent à la fois un moyen de lutte contre la bourgeoisie et les bases de la société future, une fois que le capitalisme et l’État auront été renversés. Dans un tout autre contexte, Frantz Fanon analyse la décolonisation comme un mouvement de séparation radicale, marqué pour le colonisé par « l’affirmation échevelée d’une originalité posée comme absolue ». Prise en ce sens d’un refus collectif d’être gouverné, la démocratie peut mener à ce que d’aucuns appellent aujourd’hui la destitution : se séparer, ici et maintenant, d’avec les institutions pour construire autre chose. À l’extrême, cette séparation peut prendre la forme d’une déclaration de guerre, comme celle que l’Armée zapatiste de libération nationale adresse à l’armée fédérale mexicaine le 1er janvier 1994, inaugurant dans plusieurs régions du Chiapas une expérience d’organisation autonome inédite par son ampleur et sa durée, fondée notamment sur les droits des peuples indigènes. Lorsqu’elle est le fait de groupes sociaux dominés, la destitution n’est jamais une simple sécession. Elle dessine en creux la possibilité d’une organisation sociale fondée sur l’égalité, à la fois dans le gouvernement et en matière sociale. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a démocratie que lorsque la plèbe se retire sur l’Aventin ; mais l’horizon d’une séparation est toujours là pour mettre en échec les tentatives des dominants de ne pas tenir compte des dominés. La possibilité, pour ceux-ci, d’arrêter de jouer le jeu et de renverser les rapports de dépendance qui les maintiennent en situation d’infériorité, s’avère alors un outil fondamental de lutte contre la domination.
Pour une démocratie réelle, reprendre parti
La démocratie est le pouvoir du peuple – mais le sens des mots pouvoir et peuple ne cesse de se dédoubler et de s’entremêler. La démocratie réelle, telle qu’elle est exigée dans les soulèvements de la dernière décennie, est irréductiblement plurielle, et cet ouvrage n’a fait que proposer quelques pistes pour en saisir les contours. Comme régime, la démocratie repose sur le pouvoir du peuple entier, de l’universalité des citoyens, exerçant sa souveraineté par le vote direct de la loi, c’est-à-dire par référendum. Cette condition pourtant minimale n’est aujourd’hui réalisée presque nulle part, et pour cause : les régimes actuellement qualifiés de démocraties, les gouvernements représentatifs, se sont construits contre la démocratie, et la plupart des gouvernants d’hier et d’aujourd’hui craignent l’expression directe de la volonté du peuple. Cependant, la démocratie réelle ne saurait se limiter au référendum. Elle requiert aussi une participation des citoyens à toutes les étapes de la prise de décision politique, depuis sa préparation dans l’espace public, qui doit être ouvert à toutes les voix pour permettre une délibération véritable, jusqu’à son application par les administrations, la justice, la police. Or ces corps, y compris dans les démocraties libérales, ne sont généralement pas responsables devant les citoyens et agissent hors de tout contrôle populaire. La répression des soulèvements récents montre, s’il en était besoin, à quel point les États, démocratiques ou non, n’ont aucune peine à utiliser tous les moyens à leur disposition pour faire taire leur propre population.
N’y a-t-il alors aucun sens à parler de démocratie pour qualifier certains régimes existants ? Au sens d’une démocratie réelle, probablement pas. Mais il y a bien quelque chose de démocratique dans les régimes que l’on qualifie actuellement de démocraties libérales : le pouvoir n’y est pas absolu, mais encadré par la loi, et il est l’objet d’une compétition électorale entre élites politiques. Ces deux éléments ne sont pas sans lien : un pouvoir reposant sur si peu de chose, une courte majorité dans les urnes, peut difficilement s’exercer de manière absolue.
Les gouvernants ne doivent leur position qu’au choix du peuple, c’est-à-dire de n’importe qui : ils n’ont d’autre titre à gouverner que celui que leur confèrent les gouvernés, ceux justement qui n’ont aucun titre. Les lignes mêmes par lesquelles les partis s’opposent et entrent en compétition sont mouvantes. Cette indétermination fondamentale des démocraties libérales n’élimine en rien leur caractère oligarchique – c’est toujours une élite qui gouverne –, mais elle donne un rôle réel à l’opinion des citoyens. Elle pousse les gouvernants à chercher à convaincre les masses, et elle amène les citoyens, pour peser, à prendre parti. C’est ici que la démocratie en un sens social, comme pouvoir de la plèbe, des pauvres, entre en jeu. Les partis ne sont pas seulement un outil de pouvoir pour les élites politiques, mais aussi un moyen, pour les dominés, de se rassembler, de se faire reconnaître et d’imposer leur présence. Cette entrée des groupes sociaux dominés en politique modifie la définition même de ces groupes, qui voient leur identité transformée par cette politisation, permettant à d’autres lignes de division d’émerger et à d’autres formes de domination de devenir l’objet de conflits.
Tout l’enjeu d’une démocratie réelle, fondée sur la souveraineté et le gouvernement du peuple, serait de garder des partis leur capacité à donner de la visibilité et du pouvoir aux dominés, tout en en éliminant le caractère oligarchique, leur soumission aux élites politiques. Pour saisir ce que pourrait vouloir dire prendre parti dans une démocratie réelle, il faut alors se tourner vers les autres manières qu’ont eues les dominés de s’organiser, dans le syndicalisme, le mouvement féministe, les diverses luttes des minorités raciales ou sexuelles. Leur pratique de la démocratie relève non de la conquête du pouvoir politique, mais plutôt du combat pour l’égalité et contre la domination sociale. À l’intersection de ses significations politique et sociale, la démocratie prend alors la forme d’un refus collectif des dominés d’être gouvernés. Prendre parti, en ce sens, n’est peut-être pas tant l’ultime conséquence d’une démocratie réelle que la condition première de son instauration : un mouvement de destitution, de sécession avec les dominants et leur monde, pour créer quelque chose d’autre, en un mot une révolution.
La démocratie, comme refus collectif d’être gouverné, met en péril tous les pouvoirs. Si elle sort de l’espace étroit que lui laisse l’oligarchie, c’est toute la société qui se trouve mise en question. Les soulèvements populaires, qui n’en finissent pas de contester les élites politiques et les réformes néolibérales qu’elles mènent, jouent un rôle crucial dans le mouvement vers une démocratie réelle. Ils révèlent – et sans doute accélèrent – tout un travail de mise en lien entre des gens qui se découvrent une communauté d’expérience et qui s’appuient dessus pour se doter collectivement d’un pouvoir. Le parti, le syndicat, le mouvement, l’organisation, le groupe affinitaire, l’association, aucune forme n’est prémunie de la captation oligarchique, mais aucune n’y est non plus condamnée. La démocratie est le pouvoir d’un peuple qui ne cesse de se reconstruire dans l’expérience collective d’un refus d’être gouverné. Ce refus préfigure un temps nouveau, celui du gouvernement du peuple et de la fin de la domination sociale. Adhérer à la démocratie au sens fort suppose de l’effectuer, c’est-à-dire de prendre parti, sans garantie de victoire. Là est le sujet collectif que cette compréhension de la démocratie construit : un nous partisan, fondé sur un commun attachement à la démocratie réelle, cette forme de gouvernement et de société qui repose sur la capacité de n’importe qui à prendre parti, pour mettre en échec collectivement les relations de pouvoir qui nous enserrent. Là est le pari de la démocratie, la condition pour que s’effectue, de manière toujours différente et inattendue, le pouvoir du peuple.









