
Lumières et anti-Lumières. L’histoire des idées de Zeev Sternhell
L’historien israélien Zeev Sternhell vient de mourir. Auteur d’une œuvre considérable, il avait en particulier contribué à démolir ce que Michel Dobry avait nommé le « mythe de l’allergie française au fascisme » : non seulement la France n’a pas été « immunisée » contre le fascisme, mais c’est en France que l’idéologie fasciste serait née, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle à la faveur d’une alliance – ou plutôt d’une synthèse intellectuelle – entre une « droite révolutionnaire » (cherchant à capter la colère des masses populaires) et une « gauche révisionniste » (ayant rompu avec le marxisme).
Dans cet article publié en 2014 par la Revue des livres, Enzo Traverso revient sur cette thèse qui a donné lieu à d’intenses controverses, la majorité des historiens français dominants ayant attaqué violemment Sternhell. Il analyse les limites de sa méthode (une histoire des idées dans laquelle ces dernières sont dotées d’une force intrinsèque, indépendamment des grandes forces sociales et des dynamiques historiques), mais pointe également les contradictions de Sternhell lorsque celui-ci fut amené à étudier le projet sioniste et le nationalisme israélien.
***
La place de Zeev Sternhell dans le paysage intellectuel contemporain est assez paradoxale. Son œuvre a renouvelé l’historiographie du fascisme et, plus en général, l’histoire intellectuelle, tout en revendiquant avec force son ancrage à une tradition ancienne. Méthodologiquement, ce professeur de science politique de l’université de Jérusalem est un conservateur déclaré. Les courants historiographiques apparus au cours des cinquante dernières années ne présentent à ses yeux le moindre intérêt, sinon celui d’engendrer des régressions dangereuses exigeant la critique la plus ferme. L’histoire sociale a le défaut d’ignorer l’autonomie des idées. Quentin Skinner et J.G.A. Pocock, les fondateurs de l’école de Cambridge, soucieux de contextualiser sur le plan textuel la philosophie politique, tombent dans les pièges du particularisme et du relativisme. Le linguistic turn postmoderniste n’est qu’une forme d’irrationalisme, la version contemporaine d’un obscurantisme ancien opposé aux Lumières. Contre ces tendances dangereuses, Sternhell oppose des références un peu datées : Ernst Cassirer, Raymond Aron et Arthur Lovejoy. Les deux premiers étaient des historiens et des philosophes de combat, engagés dans une bataille intellectuelle inspirée par un libéralisme éclairé. Le dernier a codifié une conception de l’histoire des idées comme dialogue entre des catégories intemporelles de la pensée (unit-ideas) susceptibles de traverser les époques, les langues et les cultures, qui ne trouve guère de défenseurs aujourd’hui[1]. Pour Sternhell, en revanche, il s’agit d’un « instrument sans pareil » offrant la clef pour interpréter l’expérience des sociétés humaines[2]. À ses yeux, démocratie, libéralisme, nationalisme, communisme, fascisme sont avant tout des idées. Leur histoire matérielle, sociale, culturelle, politique n’est que dérivée, secondaire. Les idées, pourrait-on dire avec une formule qui n’appartient pas à son langage, sont « performatives ». Cette méthode a toujours inspiré son œuvre. Comme j’essayerai de montrer dans ces pages, elle est mise au service d’un projet critique — dénoncer le soubassement idéologique des formes de domination du monde moderne — et ses résultats sont souvent fructueux, en dépit de ses limites évidentes. Voilà le paradoxe incarné par Sternhell : on peut renouveler la pensée critique avec un outillage très archaïque.
Pendant plus de trois décennies, Sternhell a exploré l’histoire du nationalisme français. Lorsqu’il prépare sa thèse de doctorat à l’Institut d’Études Politiques (IEP) de Paris, au milieu des années 1960, Vichy demeure un tabou. L’historiographie politique de la France contemporaine est alors dominée par René Rémond, un des piliers de l’IEP, dont la thèse sur les « trois droites » est une sorte de un canon. Selon Rémond, depuis 1789, l’hexagone aurait connu une droite légitimiste, une bonapartiste et une orléaniste, mais pas une droite fasciste[3]. La première est née avec la contre-révolution et s’étale sur un siècle, de Joseph de Maistre à Charles Maurras ; elle est réactionnaire, nostalgique de l’Ancien Régime et empreinte de catholicisme. La deuxième est autoritaire : entre Napoléon Ier et le général de Gaulle, en passant par Napoléon III et le maréchal Pétain, elle traverse toutes les sensibilités du conservatisme, en s’affichant comme la gardienne de la nation. La troisième est technocratique, favorable à une modernisation respectueuse de l’ordre et des hiérarchies sociales. Elle est apparue en 1830 avec la monarchie de Louis Philippe et s’est manifestée au sein de tous les régimes politiques français, jusqu’à la Ve République post-gaullienne. Dans ce tableau, pas de fascisme. En France, le fascisme n’aurait jamais été qu’un produit d’importation, sans racines et sans avenir, la mouvance de quelques enragés apparus sous l’occupation allemande, pendant une période éphémère, mais restés marginaux et isolés. Selon Rémond, Pétain est bien davantage un mélange singulier de ces trois droites qu’un fasciste. Bref, c’est la thèse, alors consensuelle, d’une France « immunisée » contre le fascisme[4].
Ce mythe, Sternhell a été le premier à le dénoncer, à le soumettre à une critique systématique et, finalement, à le renverser. Dès 1972, il publie un portrait de Maurice Barrès (tiré de sa thèse) dans lequel il présente l’écrivain nationaliste comme un idéologue proto-fasciste[5]. C’est Barrès qui, pendant l’affaire Dreyfus, abandonne le cosmopolitisme et le socialisme de sa jeunesse pour incarner un tournant nationaliste radical et subversif. Il passe outre la dénonciation de la « décadence » — l’obsession du « pessimisme culturel » fin-de-siècle — et s’oriente vers une synthèse nouvelle entre la tradition conservatrice — un certain romantisme, le rejet du progrès, l’autoritarisme, le respect des hiérarchies, un anticapitalisme aristocratique — et la modernité. Son culte du chef et de la jeunesse, son mythe du sang et du sol, sa haine des valeurs bourgeoises, son antisémitisme racial dessinent un irrationalisme de type nouveau qui tend à créer une sorte de modernité alternative. Il ne regarde pas vers le passé mais se projette vers l’avenir. S’il rejette la démocratie c’est pour la dépasser vers un ordre autoritaire, non pas pour restaurer l’Ancien Régime. Son éloge de la virilité, de la force primitive, de la vitalité du peuple le rapproche davantage d’Ernst Jünger que de Joseph de Maistre ou Louis de Bonald. Il n’adhère pas à l’Action française, la principale mouvance antirépublicaine et antidreyfusarde, car son nationalisme populiste transcende la contrerévolution. Son antisémitisme va au-delà de l’antijudaïsme économique et religieux de Drumont, son racisme a déjà assimilé les codes du darwinisme social.
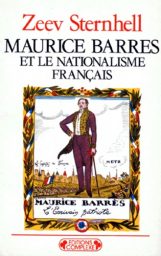
Quelques années plus tard, Sternhell systématise son interprétation dans La droite révolutionnaire (1978), un ouvrage où la France de la fin du xixe siècle apparaît comme le véritable berceau du fascisme européen, résultat de la synthèse entre une droite qui abandonne son conservatisme aristocratique pour devenir populiste et une gauche qui cesse d’être marxiste et républicaine pour devenir nationaliste[6]. Le nationalisme constitue le magma dans lequel se mêlent ces différents courants, de l’antisémitisme de l’Action française et Drumont à l’eugénisme de Georges Vacher de Lapouge et Gustave Le Bon, du populisme du Cercle Proudhon à l’irrationalisme antirépublicain et antidémocratique de Georges Sorel. Le modèle est ainsi fixé. Au cours des années suivantes, Sternhell consacre plusieurs ouvrages à l’étude de la révision idéologique qui conduit plusieurs courants de gauche vers le socialisme national et enfin vers le fascisme : « Le socialisme national, sans lequel il n’y a pas de fascisme, émerge dès la fin des années 1880, et la tradition se perpétue de manière continue jusqu’à la Seconde Guerre mondiale[7]. » L’éclosion du fascisme, poursuit-il, « s’accomplit ainsi avant la Grande Guerre et sans aucun rapport avec elle[8] ». C’est l’affaire Dreyfus avec son mélange de militarisme, anti-républicanisme, antilibéralisme et antisémitisme qui le rend possible. Ce processus aboutit à une « imprégnation fasciste » quasi générale du nationalisme français pendant les années 1930. Entre les émeutes de février 1934 et l’avènement du régime de Vichy, le fascisme ne se réduit pas, selon Sternhell, à quelques mouvements subversifs tels le Parti Populaire Français de Jacques Doriot, les « chemises vertes » d’Henri Dorgères ou le « néo-socialisme » de Marcel Déat, ni non plus à quelques écrivains enragés tels Louis Ferdinand Céline, Robert Brasillach, Lucien Rebatet ou Pierre Drieu la Rochelle. Il inclut aussi le planisme d’Henri De Man et la sociologie politique de Roberto Michels pour qui, incapables de s’auto-diriger, les classes populaires seraient toujours dominées par une élite, en prouvant ainsi l’impossibilité de la démocratie. Mais le chaudron fasciste est encore plus vaste, car Sternhell ne manque pas d’y ajouter le socialisme populiste de Georges Valois, l’irrationalisme d’Édouard Berth et Georges Sorel et le spiritualisme de Thierry Maulnier et Emmanuel Mounier.

Pendant deux décennies, l’historien de Jérusalem a été au centre d’un vaste débat international, une véritable Sternhell Controversy qui a été un moment majeur du renouveau des interprétations du fascisme[9]. Bien que rarement approuvées, tout au moins dans leur intégralité, ses thèses ont graduellement acquis droit de cité : personne n’avait reconstitué la généalogie intellectuelle du nationalisme français dans une vision d’ensemble aussi profonde et complète. Nombreux sont les historiens qui lui ont reproché une interprétation téléologique faisant découler le fascisme, de façon linéaire et quasi inéluctable, de la crise de la démocratie libérale et de la réaction contre les Lumières de la fin du xixe siècle. D’autres ont émis des doutes sur une interprétation qui, en renversant radicalement la thèse « immunitaire » traditionnelle, fait de la France le paradigme-même du fascisme. Peut-on généraliser un tel modèle interprétatif ? La vision du fascisme comme produit de la rencontre entre une gauche révisionniste et une droite révolutionnaire trouve certaines correspondances dans la genèse du fascisme italien, comme l’ont montré plusieurs disciples de Sternhell. La fusion qui s’opère à la fin de la Grande Guerre entre le socialisme national de Mussolini, le syndicalisme révolutionnaire de Sergio Panunzio, le nationalisme radical d’Enrico Corradini et Alfredo Rocco, l’irrédentisme de Gabriele D’Annunzio, le lspiritualisme de Giovanni Gentile et le futurisme de Filippo-Tommaso Marinetti, semble en effet une répétition, avec quelques variantes et dans un contexte plus chaotique, du cocktail idéologique expérimenté en France lors de l’affaire Dreyfus[10]. Le rôle joué par Sorel dans les débats qui précèdent la naissance du fascisme italien éclaire un mécanisme analogue de surgissement idéologique. Mais ce modèle ne trouve guère d’équivalent dans d’autres pays affectés par la fascisation de l’Europe pendant les années 1930. Certes pas en Espagne, où le fascisme prend finalement la forme du national-catholicisme franquiste en abandonnant le modernisme de la première Phalange, ni au Portugal, où il serait bien difficile de trouver une matrice de gauche au salazarisme. Ni dans le clérico-fascisme autrichien, de souche social-chrétienne mais pas socialiste, ni non plus dans les nationalismes fascisants d’Europe centrale, particulièrement vivaces en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, où ils seront la base des fascismes d’occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, il ne trouve pas d’équivalent dans le nazisme, dont les origines résident dans l’idéologie völkisch, le racisme biologique et le modernisme réactionnaire, aux antipodes de toute forme de syndicalisme ou de révisionnisme marxiste[11]. Le modèle sternhellien résulte ainsi problématique. Peut-on considérer comme paradigmatique un fascisme qui n’a pas été exporté et n’a jamais exercé aucune influence majeure sur la politique européenne ? Peut-on, surtout, considérer comme paradigmatique un fascisme qui, à la différence de ses homologues européens, a toujours été minoritaire et n’est arrivé au pouvoir que pendant une courte période, entre 1940 et 1944, dans les circonstances de l’occupation allemande ? Sternhell lui-même a parfois reconnu les limites de son approche : afin de défendre l’idée d’une origine française du fascisme, il s’est vu obligé d’en exclure le nazisme, sous prétexte de son idéologie entièrement axée sur le déterminisme biologique[12]. Son modèle fait aussi abstraction de la différence, désormais canonique, entre les idéologies, les mouvements et les régimes[13]. L’idéologie fasciste n’est pas toujours incarnée par des mouvements de masse et ces derniers ne sont pas toujours parvenus à conquérir le pouvoir, ni à se transformer en régimes. Si le fascisme occupe une place si importante dans l’histoire du xxe siècle, ce n’est pas à cause de la synthèse idéologique opérée par Maurice Barrès et Jules Soury dans la France des années 1890, mais à cause des bouleversements sociaux et politiques introduits à l’échelle du continent par l’arrivée au pouvoir de Mussolini, Hitler et Franco. Le refus par Sternhell de prendre en considération l’impact de la guerre sur la pensée européenne le prive ainsi d’un critère décisif pour comprendre l’essor du fascisme, sa diffusion et ses métamorphoses liés à sa pénétration au sein de contextes culturels et nationaux fort différents. Seul un adepte de l’histoire des idées la plus traditionnelle — les idées comme distillations chimiquement pures de la pensée, dotées d’une vie propre et imperméable aux cataclysmes du monde — pouvait s’atteler à la définition d’une idée purement « platonicienne » du fascisme.
La ténacité, l’ampleur et la profondeur de son enquête ont cependant donné des résultats fructueux. Sa démonstration de l’existence d’un fascisme français a remis en cause des clichés anciens et favorisé une révision féconde. Petit à petit, le modèle des « trois droites » a été abandonné et le constat de l’existence d’un fascisme français est devenu consensuel. Dans un contexte intellectuel marqué d’abord par l’essor de la mémoire juive de la déportation puis par la montée du Front National, la « controverse Sternhell » est devenue un moment essentiel du « syndrome de Vichy » : une mutation de la mémoire collective et une transformation de la conscience historique[14]. Si aujourd’hui la « révolution nationale » du maréchal Pétain n’est plus vue comme un accident de parcours mais comme le débouché — cohérent bien que non inéluctable — d’une longue trajectoire du nationalisme français, cela est dû, dans une large mesure, à Sternhell (et à d’autres historiens qui, comme Robert Paxton, ont commencé à décloisonner la parenthèse de Vichy[15]). C’est donc l’histoire des idées la plus traditionnelle qui a renouvelé l’historiographie du fascisme en France. Son impact a été énorme du point de vue de l’usage public de l’histoire.
Une fois apaisées les polémiques sur le fascisme, Sternhell a élargi l’horizon de sa recherche en étudiant l’histoire de la pensée conservatrice en Europe depuis la Révolution française jusqu’à la fin du xxe siècle. La modernité — dont il saisit la matrice dans les Lumières — est un processus contradictoire marqué par une opposition irréductible, permanente, entre le rationalisme et ses ennemis. Autrement dit, l’histoire de la modernité est indissociable de celle des anti-Lumières, sa pars destruens. Le concept d’anti-Lumières (Gegenaufklärung) remonte à Nietzsche et son usage est devenu courant en Allemagne dès la fin du xixe siècle, bien avant d’être systématisé par Isaiah Berlin dans ses études sur le Counter-Enlightenment[16]. Comme il avait déjà fait pour la notion de fascisme, Sternhell en propose une définition large, susceptible d’inclure de nombreuses variantes. À la différence de Berlin, pour qui le père spirituel des anti-Lumières serait l’apocalyptique et mystique Johann Georg Hamann, le « Mage du Nord »[17], Sternhell attribue un rôle fondateur à Vico, l’auteur de La Scienza nuova (1725), pourfendeur du cartésianisme et partisan d’une vision cyclique de l’histoire. Les anti-Lumières deviennent une idéologie politique à la fin du xviiie siècle, grâce à la prose enflammée d’Edmund Burke et de Joseph de Maistre, les deux grands ennemis de la Révolution française. Le premier rejette les droits de l’Homme au nom des droits ancestraux de l’aristocratie britannique dont il oppose le caractère historique et concret à celui, abstrait, d’une humanité « universelle ». Le second les repousse au nom d’un pouvoir sacré, intemporel et indiscutable, incarné par le roi et le bourreau. C’est Herder qui, à cette époque de transition, essaie de trouver une synthèse cohérente entre l’antirationalisme, le relativisme, le communautarisme nationaliste et l’historisme. Ce philosophe allemand récuse l’idée d’un monde gouverné par la raison et oppose la singularité des cultures à l’universalisme, ainsi qu’une conception mystique des langues et des communautés nationales aux droits des individus ; il oppose enfin l’historisme — au sens d’une conception providentielle de l’histoire — au constructivisme d’une société d’individus libres et maîtres de leur destin. Selon Sternhell, Herder constitue « le premier maillon d’une chaîne qui conduit à la dislocation du monde européen[18] ».
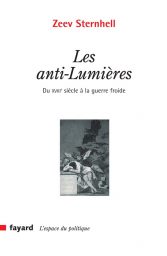
Une seconde vague, certes moins apocalyptique dans ses tons mais tout aussi ferme dans ses principes antirationalistes et anti-universalistes, se déploie au milieu du xixe siècle. C’est alors que des savants comme Thomas Carlyle, Hyppolite Taine, Ernest Renan et les « pessimistes culturels » allemands (Paul de Lagarde, Julius Langbehn et Arthur Moeller van den Bruck) commencent à greffer le poison du darwinisme social, du racisme et de l’antisémitisme sur le tronc du conservatisme. La troisième vague apparaît vers la fin du siècle, d’abord annoncée par Nietzsche puis approfondie d’abord en France par les antidreyfusards puis en Allemagne par les « révolutionnaires conservateurs[19] ». Grand ennemi de la modernité, Nietzsche demeure un « aristocrate de la pensée qui ne descend pas dans la rue[20] ». Ses successeurs, en revanche, retrouvent les accents militants des origines. Leur diagnostic du déclin de l’Occident indique une alternative dans la révolte nationaliste et leur rejet du cosmopolitisme se nourrit de l’exaltation des racines, du mythe du sang et du sol. Si la proximité avec le fascisme de cette troisième vague est évidente, Sternhell y inclut aussi des conservateurs plus modérés comme Benedetto Croce et Friedrich Meinecke, qui feront preuve d’un antifascisme passif et timoré pendant les années 1930 et 1940.
Dans l’après-guerre, les anti-Lumières connaissent une dernière métamorphose, en s’abritant derrière le bouclier de l’anticommunisme. Leur principal représentant, selon Sternhell, est Isaiah Berlin, une des vedettes de l’émigration blanche au Royaume Uni, libéral conservateur qui ne cachait pas son admiration pour Vico et Herder et détestait violemment les Lumières françaises, tout particulièrement Rousseau, dans lequel il voyait le berceau des totalitarismes du xxe siècle. La distinction célèbre établie par Berlin (dans le sillage de Benjamin Constant) entre, d’une part, les libertés « négatives » des modernes visant à protéger la propriété et les prérogatives individuelles et, de l’autre, les libertés « positives » des anciens, orientées vers l’action publique et la défense du bien commun, ne fait que reformuler un des postulats des anti-Lumières : le rejet du principe d’égalité au nom du relativisme anti-universaliste[21]. À côté de Berlin, Sternhell place les porte-paroles du néo-conservatisme américain, notamment Irving Kristol et Gertrude Himmelfard, auteure d’un violent pamphlet contre les Lumières françaises[22], ainsi que deux historiens anticommunistes comme Ernst Nolte et François Furet.
Cette mise en perspective historique du conservatisme est un tour de force admirable qui séduit par son souffle mais laisse nombre de questions sans réponse. Les anti-Lumières sont un phénomène réactif, comme leur nom l’indique ; elles supposent les Lumières qui, cependant, ne sont jamais clairement définies par Sternhell. Dans son livre, elles sont à la fois omniprésentes et insaisissables. Nous sommes informés de leur matrice « franco-kantienne »[23], ainsi que de leurs branches anglaises et écossaises, de John Locke à Adam Ferguson et David Hume, c’est tout. On a l’impression, en le lisant, qu’elles s’arrêtent en 1783 avec un célèbre essai de Kant (Was ist Aufklärung ?). Il ne resterait ensuite qu’à les défendre. Certains passages semblent indiquer qu’il s’agit d’un courant de pensée essentiellement libéral, allant en droite ligne de Locke et Montesquieu à Raymond Aron et Leo Strauss (oui, Leo Strauss)[24]. Comme le fascisme n’avait pas attendu la Grande Guerre pour apparaître sur la scène de l’histoire, ainsi les anti-Lumières n’ont pas eu besoin de la Révolution française pour assumer un profil intellectuel et politique cohérent, en dépit de ce que suggèrent de nombreux historiens[25]. Interprétés dans cette perspective téléologique, les totalitarismes contemporains seraient déjà contenus, in nuce, dans les anti-Lumières des origines, notamment chez Herder, « le premier à battre en brèche la confiance en elle-même de la civilisation occidentale, phénomène qui devait avoir, au XXe siècle, des résultats désastreux[26] ».
Selon Sternhell, les Lumières et les anti-Lumières s’opposent comme des blocs de béton, aucune nuance de gris ne surgit entre ces deux courants qui façonnent une histoire de la pensée politique en noir et blanc. Un tel schématisme laisse le lecteur sceptique. D’une part, cette vision semble ignorer délibérément tout ce qui, dans l’histoire des Lumières, ne rentre pas dans la généalogie de la démocratie libérale. Elle n’accorde aucune attention aux « Lumières radicales »[27], surgies en Hollande, avec Spinoza, un demi-siècle avant le Traité du gouvernement civil de Locke (1690). Leur projet ne consistait pas à naturaliser la propriété et l’État, ni à justifier une alliance entre la foi et la raison dans le cadre des monarchies existantes. Pour les tenants du spinozisme, les Lumières prenaient une coloration tendanciellement athée, républicaine et collectiviste, avec une remise en cause de la grande propriété foncière au nom de la souveraineté du bien commun, dans laquelle s’inscrivait leur reconnaissance de la liberté individuelle. Outre le républicanisme, la reconstitution de Sternhell ignore aussi le marxisme, la principale tentative de renouveler les Lumières à partir du milieu du xixe siècle. Et pourtant, son ouvrage fait irrésistiblement penser à La destruction de la raison (1954), la somme dans laquelle Georg Lukács a formulé en termes marxistes une téléologie analogue (et tout aussi unilatérale) de l’irrationalisme occidental[28]. Dans quelques passages de son livre, Sternhell définit l’anticommunisme comme une des formes privilégiées des anti-Lumières à l’époque de la guerre froide, mais ne développe pas cette hypothèse fort intéressante.
D’autre part, Sternhell fait preuve d’un aveuglement quasi total sur les contradictions qui traversent l’histoire des Lumières elles-mêmes. Dans sa vision apologétique, la « dialectique de la raison » est un mythe ou une nouvelle forme de relativisme dangereux[29]. La transformation du rationalisme occidental en dispositif de domination coupé de toute visée émancipatrice — un questionnement qui traverse l’œuvre d’une large partie de la pensée contemporaine, de Max Weber à l’école de Francfort, de Günther Anders à Zygmunt Bauman — ne semble guère l’effleurer. Nous pouvons bien considérer le fascisme comme « une forme exacerbée de la tradition anti-Lumières » et le nazisme comme « une attaque totale contre le genre humain[30] », mais nous ne pouvons pas oublier le lien qui unit la tradition des Lumières au stalinisme, qui s’en réclamait explicitement, ou le rapport du colonialisme et de la bombe atomique avec la démocratie libérale, ou encore les conséquences écologiques d’une « maîtrise » de la nature par la raison devenue rationalité technologique. Nous n’avons plus le droit, au xxie siècle, de lire Condorcet avec l’innocence de ses contemporains. Sternhell évite de poser la question, ou l’évacue en affirmant simplement que de telles dérives seraient étrangères aussi bien à « l’esprit des Lumières franco-kantiennes qu’à celui des Lumières anglaises et écossaises[31] ». On appelle cela l’esquive.
Il était inévitable que l’historien des nationalismes en Europe finisse, tôt ou tard, par se confronter au sionisme. À la différence de ses parents, Sternhell a survécu à la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah — il a passé les années de guerre dans sa Pologne natale, caché par une famille catholique — et s’est installé en Israël à l’âge de seize ans, en 1951, après un séjour de six ans en France[32]. Engagé dans la gauche sioniste et favorable au démantèlement des colonies juives dans les territoires palestiniens, il est un acteur de la vie politique israélienne : l’histoire du sionisme l’interpelle comme citoyen avant de l’intéresser comme chercheur. Il ne le cache d’ailleurs pas : « Pour moi, Israël n’est pas une question politique. C’est quelque chose de beaucoup plus profond, élémentaire. C’est un retour à l’humanité. […] Je ne suis pas seulement sioniste. Je suis super sioniste[33]. » Dans ce domaine, l’intellectuel engagé interfère souvent avec l’historien, en dépit de ses efforts de distanciation critique. Appliquant à l’histoire du sionisme les mêmes critères analytiques déjà adoptés pour interpréter les nationalismes européens, il constate lucidement sa matrice « herderienne » et « tribale »[34]. Un mouvement né en Europe centrale à la fin du xixe siècle comme réponse à la crise du libéralisme et au blocage du processus d’Émancipation, ne pouvait pas échapper aux contraintes culturelles de son temps. Le socialisme des pères fondateurs (Berl Katznelson, Aron David Gordon et David Ben Gourion) était une couche extérieure, superficielle, qui sous-tendait un nationalisme vigoureux et combatif. Certains idéologues sionistes comme Haïm Arlosoroff et Nachman Syrkin s’inspiraient ouvertement du nationalisme allemand d’Oswald Spengler et Moeller van den Bruck, tandis que Martin Buber se livrait, en 1911, à une idéalisation mystique du « sang » juif. Cela suffirait largement, sur la base de l’herméneutique mise en œuvre dans les ouvrages antérieurs de Sternhell, à placer ces intellectuels à côté de Barrès, Maurras et Spengler, dans le champ des anti-Lumières, sinon du fascisme. Sauf que, dans ce cas, notre historien ne récuse pas les vertus de la contextualisation, en saisissant une différence fondamentale entre ces deux courants : le nationalisme allemand prônait une politique de conquête impériale, alors que le sionisme recherchait une solution politique aux problèmes d’un peuple menacé[35]. Autrement dit, le sionisme est bien né comme une variante du nationalisme tribal, mais il s’agissait du nationalisme tribal d’un peuple opprimé. Dans un essai plus récent, Sternhell présente Theodor Herzl comme un « juif libéral assimilé » dont le nationalisme cachait en réalité « une intuition de génie » : il avait compris « le danger qui menaçait les juifs d’Europe dès que l’ordre libéral commencerait à vaciller » car, à ses yeux, « l’antisémitisme n’était qu’un aspect de la grande bataille contre les Lumières » qui allait dominer le xxe siècle[36]. Aux antipodes de Herder, Herzl devient ici une sorte de combattant des Lumières en lutte contre l’antisémitisme. Voici donc Sternhell soudainement réconcilié avec le providentialisme sioniste sur la base d’une argumentation rationaliste « franco-kantienne » qui, en principe, s’accorde mal avec une idéologie nationaliste dont la source ultime de légitimation réside dans la Bible (comme il reconnaît lui-même sans difficulté[37]).

Au-delà de sa téléologie rétrospective hautement discutable (lorsque Herzl publie L’État des juifs, en 1897, personne n’est en mesure de prévoir l’Holocauste), cette reconstitution historique ne manque pas de soulever de nouvelles questions. Si le projet du sionisme travailliste consiste à bâtir une société nationale juive sans Arabes, ses sources ne résident peut-être pas dans le racisme hiérarchique des anti-Lumières, mais certes pas non plus dans une conception républicaine de la nation comme communauté politique ouverte, non délimitée par des frontières ethniques ou religieuses. Or, il ne fait pas de doute qu’Israël, en tant qu’« État juif », est bien plus « herderien » que « franco-kantien ». Sternhell reconnaît que la guerre de 1967 a « créé une situation de type colonial »[38], mais il refuse d’admettre que les contradictions qui traversent aujourd’hui la société israélienne étaient déjà inscrites dans l’État qui a vu le jour en 1948. Il faut maintenant espérer que ce grand historien du nationalisme, du fascisme et des anti-Lumières, accepte enfin de retourner ses armes critiques contre la tradition des Lumières elle-même. Non pas pour la rejeter, loin de là, mais pour en saisir les contradictions, les ambiguïtés et aussi les usages, qui n’ont parfois rien à envier aux pratiques de la réaction. C’est la seule manière fructueuse de les défendre et de les sauver.
Illustration : Nuit d’émeute fasciste le 6 février 1934.
Notes
[1] Arthur Lovejoy, « The Historiography of Ideas », Essays in the History of Ideas, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1948, pp. 1-13.
[2] Zeev Sternhell, Les anti-Lumières. Du xviiie siècle à la guerre froide, Fayard, Paris, 2006, p. 34.
[3] René Rémond, Les Droites en France, Aubier, Paris, 1982 (éd. or. 1954).
[4] Cf. Michel Dobry (dir.), Le mythe de l’allergie française au fascisme, Albin Michel, Paris, 2003.
[5] Zeev Sternhell, Maurice Barrès et le nationalisme français, Complexe, Bruxelles, 1985 (éd. or. 1972).
[6] Zeev Sternhell, La droite révolutionnaire 1885-1914. Les origines françaises du fascisme, Gallimard, Paris, 1997 (éd. or. 1978).
[7] Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche. L’idéologie fasciste en France, Seuil, Paris, 1983, p. 34.
[8] Ibid., p. 35.
[9] Cf. Robert Wohl, « French Fascism. Both Right and Left : Reflections on the Sternhell Controversy », Journal of Modern History, 1991, n° 63, pp. 91-98 ; António Costa Pinto, « Fascist Ideology Revisited : Zeev Sternhell and his Critics », European History Quarterly, 1986, XVI, pp. 465-483 ; Robert Soucy, The French Fascism. The Second Wave 1933-1939, Yale University Press, New Haven, 1995, pp. 8-12.
[10] Zeev Sternhell, Mario Sznajder, Maia Ashéri, Naissance de l’idéologie fasciste, Gallimard, Paris, 1989. Pour une critique argumentée de cette thèse, cf. Francesco Germinario, « Fascisme et idéologie fasciste. Problèmes historiographiques et méthodologiques dans le modèle de Sternhell », Revue française des idées politiques, 1995, n° 1, pp. 39-78.
[11] Philippe Burrin, « Le fascisme », in Jean-François Sirinelli (dir.), Histoire des droites en France, I. Politique, Gallimard, Paris, 1990, pp. 613-617.
[12] Zeev Sternhell, « Le concept de fascisme », Naissance de l’idéologie fasciste, op. cit., p. 20.
[13] Cf. Renzo De Felice, Le interpretazioni del fascismo, Laterza, Bari-Roma, 1986 ; Emilio Gentile, Fascismo. Storia e interpretazione, Laterza, Bari-Roma, 2002, ch. I.
[14] Cf. Henry Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Seuil, Paris, 1990.
[15] Robert O. Paxton, La France de Vichy 1940-1944, Seuil, Paris, 1973 (éd. or. 1972).
[16] Isaiah Berlin, « Les Contre-Lumières », À contre-courant. Essais sur l’histoire des idées, Albin Michel, Paris, 1988, pp. 59-86.
[17] Isaiah Berlin, Le Mage du Nord critique des Lumières. J.G. Hamann 1730-1788, Presses universitaires de France, Paris, 1997.
[18] Zeev Sternhell, Les anti-Lumières, op. cit., p. 24.
[19] Les études de Sternhell constituent, de ce point de vue, l’équivalent français des travaux sur l’Allemagne de Fritz Stern, Politique et désespoir. Les ressentiments contre la modernité dans l’Allemagne pré-hitlérienne, Armand Colin, Paris, 1990, et de Jeffrey Herf, Reactionary Modernism : Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich, Cambridge University Press, New York, 1984.
[20] Ibid., p. 457.
[21] Ibid., p. 523. Voir Isaiah Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford University Press, New York, 1990 (éd. or. 1966).
[22] Gertrude Himmelfard, The Roads to Modernity : the British, French, and American Enlightenments, Vintage, New York, 2005.
[23] Zeev Sternhell, Les anti-Lumières, op. cit., p. 27.
[24] Ibid., p. 19.
[25] Voir par exemple Roger Chartier, Les origines culturelles de la Révolution française, Seuil, Paris, 1990.
[26] Ibid., p. 414.
[27] Cf. Jonathan I. Israel, Les Lumières radicales. La philosophie, Spinoza et la naissance de la modernité (1650-1750), Éditions Amsterdam, Paris, 2005.
[28] Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft, Luchterhand, Neuwied, 1988, 3 vol. (éd. or. 1954).
[29] Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, La dialectique de la raison, Gallimard, Paris, 1974 (éd. or. 1947).
[30] Zeev Sternhell, Les anti-Lumières, op. cit., p. 578.
[31] Ibid., p. 40.
[32] Cf. Ari Shavit, « Entretien avec Zeev Sternhell », Ha’aretz du 7 mars 2008 (http://www.lapaixmaintenant.org/Entretien-avec-Ze-ev-Sternhell). Il a abordé indirectement son passé in Zeev Sternhell, « La guerre aux Lumières et aux juifs », in Gilbert Michlin, Aucun intérêt au point de vue national. La grande illusion d’une famille juive en France, Albin Michel, Paris, 2001, pp. 129-176.
[33] Ari Sharit, « Entretien avec Zeev Sternhell », op. cit.
[34] Zeev Sternhell, Aux origines d’Israël. Entre nationalisme et sionisme, Fayard, Paris, 1996, p. 26.
[35] Ibid., p. 47.
[36] Zeev Sternhell, « In Defence of Liberal Zionism », New Left Review, 2010/62, p. 107.
[37] Zeev Sternhell, Aux origines d’Israël, op. cit., p. 111.
[38] Zeev Sternhell, « In Defence of Liberal Zionism », op. cit., p. 114.
![Fascisme : vieux démons et nouveaux monstres [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/734662-150x150.jpeg)

![Le projet sioniste, la colonisation de la Palestine et l’extrême droite israélienne [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Palestinian_refugees_1948-150x150.jpg)
![Que veulent Modi et les ultranationalistes hindous ? [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Path_Sanchalan_Bhopal-1-150x150.jpg)
![Trajectoires du fascisme en Turquie [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/turquie-erdohan-mhp-bahceli-150x150.jpg)
![Rebelles réactionnaires et extrémisation des droites [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/President_Trump_Delivers_Remarks_at_CPAC_49608880598-150x150.jpg)
![L’islamophobie : racisme institutionnel et locomotive du néofascisme [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/408_-_img_9831-modifier-150x150.jpg)


