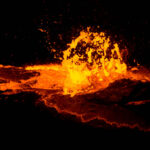Le Mexique en armes. Entretien avec Laura Castellanos
Dans Le Mexique en armes : guérilla et contre-insurrection (1943-1981), Laura Castellanos retrace l’histoire de la montée de la lutte armée à partir des années 60 et de sa répression.
Le livre qui vient de paraître en français aux éditions Lux retrace cette histoire largement méconnue à partir d’un travail d’enquête auprès des acteurs et de témoins de ces ‘événements. Journaliste mexicaine ayant travaillé entre autres pour La Jornada, El Universal ou encore Reforma et la revue Gatopardo, Laura Castellanos s’est lancée dans ce projet après le choc du soulèvement du Chiapas à partir de 1994, et après la parution du livre au Mexique, elle a publié une série d’entretiens avec le sous-commandant Marcos, sous le titre Corte de caja, en 2008.
Pourquoi l’histoire des mouvements guérilleros est-elle un passage obligé pour comprendre l’histoire des mouvements sociaux au Mexique ? Quelle importance ces mouvements ont-ils pris pour les idées « socialistes » au Mexique jusqu’à nos jours ?
Un retour sur cette histoire est nécessaire, et d’une certaine façon incontournable parce que l’histoire de la guérilla au Mexique fait partie de l’histoire du pays, une histoire négligée et méconnue, bien qu’elle traverse une bonne partie du siècle dernier et que le phénomène guérillero existe en continu depuis 1965.
Une quarantaine d’organisations armées ont agi dans le pays, les premiers « focos » (foyers)[1] de guérilla sont apparus dans les campagnes dans les années 60, et dans les villes dans les années 70. La guérilla urbaine, dans sa lutte sociale, revendiquait également une continuité avec les mouvements sociaux précédents, qui avaient été défaits. C’était donc l’émergence d’une nouvelle génération après la répression de grands mouvements sociaux mexicains, tels ceux des cheminots, des syndicalistes en général, des enseignants ou des médecins qui, à un moment donné, ont eu des liens étroits avec le parti communiste (PCM). Le contexte historique plaçait les militants dans une société très fermée, où la possibilité d’un changement politique par la voie légale et électorale était très limitée – de plus, la gauche se voyait refuser l’inscription au registre électoral[2] – ce qui a permis la radicalisation d’une génération.
Nous parlons ici d’une génération qui a été littéralement « poussée vers les armes » et d’une période parfois désignée sous le nom de « guerre sale »[3], tout au long des années 70 et jusqu’au milieu des années 80. Il est donc impossible de comprendre la situation actuelle des organisations de la gauche mexicaine et le rôle joué par les classes dominantes, si l’on méconnait ce chapitre de l’histoire, longtemps resté dans l’ombre.
Qu’est-ce qui a le plus entraîné une génération fermement convaincue de changer le système, dans la lutte armée ou plus exactement dans la guérilla ?
Le contexte social et politique de l’époque était particulier, non seulement sur le plan régional ou national mais aussi sur le plan international. Il s’agit tout de même d’une époque où un groupe de jeunes militants avait fait la révolution à Cuba et instauré un gouvernement socialiste, dans le contexte de la Guerre froide. En même temps, les mouvements sociaux sont réprimés dans le pays, mais il y a aussi un effet de génération dans tout l’occident, avec une vague de rébellion à travers différentes manifestations. Le Mexique n’est pas resté en dehors de tous ces phénomènes, vécus par ailleurs de façon très particulière en Amérique latine, où la guérilla est apparue dans une série de pays qui ont connu des coups d’État ou le retour de dictatures au cours de cette période.
Ce contexte historique et social et le fait que la gauche se voyait refuser l’enregistrement électoral montraient clairement l’impossibilité d’un changement par la voie électorale. Cette génération est aussi celle des massacres de 68 et de 71[4], la paupérisation de la classe moyenne ainsi que l’influence de la Théologie de la Libération ; bref, toutes les circonstances contribuent à la radicalisation d’une partie de cette génération, qui décide de prendre les armes comme seul moyen de renverser l’État.
Vous parlez de « radicalisation ». On peut dire que, comparée aux autres formes de lutte, la lutte armée est en elle-même « radicale ». Mais dans les mouvements politiques et sociaux, le débat sur la « radicalité » tactique est toujours présent. Quelle forme prenait-il dans les années 60 et 70 ? Autrement dit, pouvait-il y avoir un débat sur la « radicalité » de développer la lutte syndicale, par exemple, en limitant l’emploi des armes à l’autodéfense plutôt que la révolution armée immédiate ?
Dans les années 60, les « foyers » guérilleros étaient principalement influencés par le manuel La guerre de guérilla de Che Guevara ; en revanche, dans les années 70 cette discussion existe. Elle apparaît sous cette forme dans les universités, traversées par différents réseaux militants de la jeunesse : Jeunesses communistes (JC), les fédérations d’étudiants socialistes et les jeunes chrétiens radicaux. Ces réseaux, à un moment déterminé et dans des circonstances différentes, parfois même avec quelques années de décalage, voient leurs mobilisations universitaires réprimées. Environ une dizaine d’universités ont été impliquées dans ces mouvements : l’Université de Morelia, de Chihuahua, de Monterrey, de Guadalajara, de Puebla, du Yucatán, de Oaxaca et de la ville de Mexico.
Une grande partie des jeunes mobilisés, entre la fin des années 60 et le milieu des années 70, sont liés aux JC et après le massacre de 68 (Tlatelolco), ils font face à la direction du PCM, en disant qu’ils se trouvent face à une révolution, et qu’ils sont prêts à prendre les armes. La réponse de la direction du PC est négative, ce qui suscite la rupture entre une partie de ces jeunes, avec Raúl Ramos Zavala à leur tête, et le PC.
Ainsi se forme un petit noyau indépendant qui se rend dans différentes universités, où un processus de radicalisation est en cours dans les mouvements étudiants. Et un débat beaucoup plus large commence à avoir lieu, qui dépasse les revendications à caractère universitaire : au début des années 70, on débat partout – et même à l’UNAM[5] – de « l’ouverture démocratique » proposée par le président Luis Echeverría. Considéré comme responsable du massacre de 68[6], il cherche alors à établir des liens avec certains secteurs de la gauche, en cooptant quelques intellectuels, ou avec la jeunesse, en libérant certains jeunes qui étaient en prison suite aux événements de 68, ou par une réforme qui abaisse l’âge minimum pour être candidat aux élections. Le débat à l’UNAM dure plusieurs jours, et le secteur le plus radical parmi les jeunes lance une phrase qui a connu un certain succès en son temps : « nous ne voulons pas l’ouverture, nous voulons la révolution ». Le mouvement universitaire se scinde alors en deux, ceux qui continuent dans la voie légale, et les autres, le petit noyau qui commence à se déplacer et à prendre contact avec les différents comités des JC dans le pays. Ce noyau croise le chemin d’un groupe de jeunes chrétiens radicalisés, et leur leader, Ignacio Salas Obregón, se lie à Raúl Ramos Zavala pour former la plus grande organisation de guérilla urbaine du Mexique de l’époque : la Ligue communiste du 23 septembre. A partir du principe de ne pas se limiter aux revendications universitaires, ils reprennent le discours marxiste-léniniste de la lutte des classes ; mais ces jeunes militants considèrent que les classiques sont dépassés par les circonstances et ils créent leur propre théorie, qui explique que le milieu étudiant, et non le prolétariat ou la paysannerie, constitue la nouvelle avant-garde révolutionnaire.
Vous mentionnez à un moment de votre livre, que certains de ces jeunes se rendent en Corée du Nord pour recevoir un entraînement militaire. Quel a donc été le rôle des pays du bloc communiste dans l’initiation de ces jeunes à la lutte armée ?
Il s’agissait d’un autre groupe de jeunes qui à la fin des années 60 se rend en Russie pour poursuivre des études, grâce à des plans d’échange culturel mis en place par les gouvernements des deux pays. Pour ces jeunes communistes, l’État soviétique était, d’une certaine façon, la matrice de la direction politique du Parti. Ils apprennent le massacre de 68 et ils décident de préparer une révolution afin de renverser l’État en place au Mexique. Ils décident alors de créer une guérilla, et dans ce but ils demandent de l’aide à un pays du bloc communiste. Ils frappent aux portes des ambassades du Vietnam, d’Algérie, de Chine et de Cuba et la seule qui les reçoit est celle de la Corée du Nord, presque 60 jeunes sont ainsi recrutés et transférés dans une base militaire nord-coréenne. De retour au Mexique, et profitant des réseaux des JC et d’autres contacts parmi la jeunesse révolutionnaire, ils commencent à agir. Quelques mois après l’arrivée d’Echeverría à la présidence (fin 1970), ces jeunes constituent la première organisation de guérilla urbaine : le mouvement d’action révolutionnaire (MAR), en mars 1971. L’une de ces cellules se fait démanteler et c’est la première fois que la population apprend, par les journaux, l’existence de guérilleros au Mexique. A la Une du journal El Universal, par exemple, on pouvait lire le gros titre « Guérilleros » et des articles accompagnés des photos des détenus. Cette situation produit une crise diplomatique avec la Russie, car on la croyait responsable de l’entraînement de ces jeunes. On peut tout de même s’étonner de l’attitude très ingénue de ces jeunes, qui sollicitent une formation militaire auprès des ambassades du bloc communiste…
Le contexte international de la décennie 60-70 était marqué par la dimension de « rupture » avec la gauche traditionnelle et en même temps vous signalez dans votre livre une certaine « continuité » de la guérilla avec des formes de lutte proprement « mexicaines ». Dans l’histoire de la lutte armée au Mexique, y avait-il des contradictions entre des courants plus proches de l’histoire mexicaine et d’autres d’inspiration plutôt internationale ?
Dans la zone rurale – et je pense particulièrement au cas de Lucio Cabañas qui tout en étant un militant des JC, a mené une action plutôt insurrectionnelle, spontanéiste et influencée par le maoïsme – la mémoire régionale restait particulièrement liée au déroulement des soulèvements antérieurs. Lui-même raconte que quand il se rendait dans les villages pour recruter des guérilleros, les plus vieux lui disaient : « alors, quand est-ce que le général va passer pour nous donner les armes, comme à l’époque de la Révolution ? », pour eux le soulèvement allait être immédiat, ils ne comprenaient pas sa stratégie.
L’expérience de la guérilla urbaine était différente et influencée particulièrement par les théoriciens européens de l’époque et surtout par le Manuel du guérillero urbain du Brésilien Carlos Marighella, pour qui le milieu étudiant et enseignant constituait la nouvelle avant-garde révolutionnaire. L’expérience de la Révolution cubaine était, d’une certaine façon, méprisée parce que son avant-garde était la paysannerie, et en même temps le manuel de la Guerre de guérilla du Che restait pour eux un exemple pour les questions tactiques. Certes, les guérilleros urbains avaient étudié sérieusement les principes marxistes, léninistes, etc. mais, à un moment donné, ils se sont rendu compte que ce n’était pas suffisant et, « en bons Mexicains » en quelque sorte, ils ont décidé de faire leur propre théorie révolutionnaire.
Le chapitre 4 de votre livre est intitulé : « Guérilla urbaine : ce qui n’était pas dans les journaux », quel a été alors le rôle joué par les médias quand ces groupes guérilleros émergeaient ? Et face à la répression ?
Les médias critiques ont également subi des accusations et des poursuites. Mais les articles se multipliaient dans la presse au fur et à mesure que les actes guérilleros se succédaient. Les médias employaient des termes particuliers pour nommer les actions de la guérilla : « assaut », « expropriation » ou « séquestration », et les articles reflétaient en général la stupéfaction produite par ces actes révolutionnaires : « Les communistes sont arrivés au Mexique ! » était plus ou moins le message transmis par les médias. Tout cela représentait un vrai scandale pour le Mexicain moyen, il ne faut pas oublier que le Mexique est un pays très catholique, sous un régime de monopartisme à l’époque et que tout cela arrivait dans le contexte de la Guerre froide, où la gauche était stigmatisée.
La répression devient encore plus brutale et l’action de la guérilla aussi, en réaction. Les jeunes gens poursuivis décident alors d’exécuter des agents de police, ce qui représentait pour eux une action révolutionnaire et en même temps les condamnations deviennent de plus en plus sévères. Au fur et à mesure que la répression devient plus brutale, les informations intègrent la rubrique des crimes et faits divers.
D’un autre côté, à la fin des années 70, quand les premières voix journalistiques osent parler des détentions, de la torture et de l’existence des prisons clandestines, on essaye de faire taire la presse. Les dénonciations se font plus virulentes et plusieurs journaux sont censurés. L’histoire que nous avons écrite est celle qui n’est pas parue dans les journaux, où il était seulement resté la version policière des faits.
L’écriture de votre livre est par des moments « romancée ». Pourquoi ce choix ? L’histoire de la lutte armée ou de la guérilla implique-t-elle de s’arrêter sur certains aspects de la vie intime de ses protagonistes ?
C’est surtout pour que la lecture soit aussi facile et aussi peu ennuyeuse que possible, car il y a énormément de données et de noms. Et puis, parce que je ne suis pas universitaire mais journaliste et pour moi le rôle des journalistes consiste précisément à rendre l’information accessible, y compris par le style du récit. Je pense principalement à ces lecteurs qui plongent pour la première fois dans cette histoire, sans avoir de lien particulier avec le Mexique. Il s’agit finalement d’une histoire de l’Amérique latine et de l’occident, restée dans l’ombre, mais qui est utile pour comprendre ce qui se passe à l’époque dans le pays, les dizaines de groupes de guérilleros en activité et la façon dont le cycle historique militantisme-radicalisation-répression se répète constamment. Une partie du livre est consacrée, par exemple, à l’histoire des différents massacres restés impunis, comme ceux d’Atenco ou d’Oaxaca, qui sont les plus récents mais pas les seuls ni les premiers. Si on se penche sur l’histoire du Mexique on comprend comment une histoire régie par des « caciquats »[7] et un régime répressif, on observe la répétition de ces massacres, dans des moments et des endroits différents, contre les militants de gauche.
On entend souvent parler des questions de l’« unité » et de la « dispersion » géographique et politique, dans l’histoire du Mexique du XXème siècle. Quelles similitudes et quelles différences peut-on remarquer entre les différentes régions ? La question de l’unité ou de la création de réseaux entre plusieurs régions se posait-elle ?
Dans le cas de la guérilla rurale, il s’agit de foyers concentrés qui intervenaient dans un territoire déterminé et qui pouvaient facilement être localisés, encerclés, divisés, réprimés etc. Dans le cas de la guérilla urbaine, les guérilleros agissent différemment, pas nécessairement par des réseaux mais par des cellules. Alors, en cas de dénonciations et d’arrestations, qui désarticulaient une cellule, il y avait en général un membre du groupe qui était en contact avec la direction qui à son tour était en contact avec un coordinateur régional. Le gouvernement a commencé à agir au fur et à mesure des différentes actions de guérilla ; les cellules sont en principe mobiles, mais si le gouvernement atteignait quelqu’un de la coordination régionale ou du Bureau, alors il pouvait frapper à plusieurs endroits… mais en tout cas il était impossible d’agir comme avec la guérilla rurale.
Quel était le rôle des femmes dans la lutte armée lors des années 70 ? Et plus tard en défense des droits de l’homme ?
Les femmes travaillaient plutôt à des tâches de « base » et ont rarement eu accès à des responsabilités de direction, sauf dans des cas exceptionnels, comme celui de Paquita Calvo dans le Front urbain zapatiste ou de Marta Maldonado à l’ONAR (organisation nationale révolutionnaire). Le bureau politique de la Ligue communiste était exclusivement composé d’hommes, et les femmes ont seulement accédé à des responsabilités militantes vers la fin des années 70 au sein de la coordination régionale de la capitale, au moment où la répression était la plus forte et où les leaders hommes tombaient les uns après les autres. Il s’agissait pour la plupart de femmes très jeunes, d’environ 18 ans, souvent étudiantes en formation pour devenir enseignantes, et elles se consacraient en particulier aux activités liées à l’action directe : surveillance, messages ou même actions à main armée ; parfois elles étaient ce qu’on appelait des « murs », ce qui consistait à surveiller les entrées et sorties des militants dans un lieu déterminé. Il y a eu environ 30% de femmes au sein des organisations de lutte armée.
En ce qui concerne la lutte pour le sort des disparus ou assassinés, souvent menée par des femmes de leur famille, qui ne savaient souvent rien de la lutte révolutionnaire ni du marxisme, la mémoire et la justice, il s’agit d’un phénomène à l’échelle latino-américaine. Ce sont surtout les mères qui ont osé descendre dans les rues pour dénoncer les prisons clandestines et exiger la réapparition des disparus ; la figure la plus emblématique au Mexique est sans doute Rosario Ibarra. Après les massacres de 68 et 71, ces femmes arrivent à faire converger des divers blocs de la gauche face à la répression ; pour la première fois communistes, féministes, syndicalistes et paysans convergent en un front de lutte de gauche et organisent une marche devenue historique en 1978, pour exiger la réapparition des disparus politiques. Ce fut le grand antécédent de la lutte pour les droits de l’homme au Mexique.
Après autant de changements, la lutte pour les droits de l’homme, des changements politiques et économiques au Mexique ainsi qu’en politique internationale, comment se fait-il que la continuité entre les luttes soit possible jusqu’au mouvement zapatiste d’aujourd’hui ?
Les changements sont relatifs, car la classe dominante est toujours restée la même. Mais c’est une question intéressante, je posais précisément la même question récemment à un spécialiste des mouvements armées latino-américains, l’Argentin Jorge Lofredo, animateur du Centre de documentation sur les mouvements armés[8], dans une conversation sur les causes de l’existence permanente de la guérilla au Mexique depuis 40 ans. Il ne s’agit pas d’un phénomène propre au Mexique mais qu’il concerne plusieurs pays de l’Amérique latine. C’est un continent qui a connu des gouvernements de droite, des coups d’État, des gouvernements social-démocrates, d’autres que l’on considère comme socialistes, etc. mais le seul phénomène qui a survécu est celui de la guérilla. Selon lui, cela est dû au fait que la guérilla, en tout cas au Mexique, ne luttent pas simplement contre tel ou tel gouvernement mais contre le système néolibéral, car la pauvreté, l’exclusion et les inégalités restent toujours les mêmes.
Dans son livre, La Utopia Desarmada, Jorge Castañeda[9] présente l’ensemble phénomène guérillero comme une utopie, qui selon lui n’existe plus de nos jours. Il oublie pourtant qu’un secteur du pays persiste dans l’idée que les armes sont la seule voie possible pour combattre un État, la voie électorale étant complètement brouillée : il suffit d’évoquer ici les fraudes électorales de 1988 et de 2006, les seuls moments de l’histoire du Mexique où la gauche aurait pu arriver (est arrivée ?) à la présidence.
Peut-on établir des différences entre les luttes armées de différents pays de l’Amérique latine ?
Je ne suis pas spécialiste de la guérilla en Amérique latine. La guérilla colombienne, les FARCs par exemple, fait l’objet de fortes polémiques et la question de ses liens avec le trafic de drogue n’est pas clairement réglée. En ce qui concerne la guérilla mexicaine, la ligne de séparation entre son action et celle du trafic de drogue a toujours été claire. Ces deux dernières années, malheureusement, le trafic a considérablement augmenté dans tout le pays, traversant même des zones, comme Guerrero ou Oaxaca, qui connaissent une guérilla active, ce dont a profité l’État afin de s’attaquer à des communautés où la guérilla était présente mais repliée.
L’unité existante entre la lutte armée, comme au Chiapas ou à Oaxaca, et la lutte indigène est assez évidente dans le contexte actuel. Mais quelles sont les tensions qui existent ou ont existé entre ces luttes ?
C’est l’EZLN[10] qui fait émerger pour la première fois la condition indigène comme un objet de lutte révolutionnaire. Il bouleverse également le discours guérillero, puisque le discours zapatiste inclut la question du genre et de la diversité sexuelle. Le discours des autres guérillas mexicaines, qui appartiennent plutôt aux traditions marxistes-léninistes et qui dérivent des courants des années 70, ne s’est pas autant ouvert sur les questions de genre ni sur la condition indigène. Ce discours connaît pourtant une certaine influence du discours zapatiste, sans que celui-ci devienne leur étendard car la priorité reste toujours pour eux la lutte de classe.
D’où vous est venue l’idée de faire cette enquête, qui a pris dix ans, et d’écrire un livre sur les organisations de la lutte armée ?
Il s’agit d’une histoire qui n’avait pas été écrite et on manquait de livres de référence, les livres qui circulaient sur ce sujet portaient principalement sur l’expérience de Lucio Cabañas ou sur les figures emblématiques de la guérilla (et on rencontrait des travaux très brefs et dispersés sur la guérilla urbaine).
Reconstituer cette histoire, en prenant contact avec ses protagonistes, a été un travail complètement artisanal. Je n’ai pas consulté les archives gouvernementales, je n’ai pas voulu entrer dans le labyrinthe de toutes les dépositions, dont une bonne partie ont été arrachées sous la torture, et les documents des archives policières ne me semblaient pas dignes de foi. J’en cite seulement un, une photographie prise sous la torture, car la personne qui l’a mise entre mes mains à été l’épouse du fondateur de la Ligue communiste, Ignacio Salas Obregón. Il est photographié à l’Hôpital militaire, avant d’être porté disparu et sa femme a réussi à récupérer cette pièce dans les archives, une preuve historique du fait qu’il a été à l’Hôpital militaire avant sa disparition, et elle me l’a confiée.
Réunir autant de protagonistes, autant d’entretiens et trouver une structure narrative à cette histoire a représenté un processus épuisant et complètement indépendant, auquel ont participé quatre chercheurs qui ont travaillé sur les sources de presse.
J’ai dédié ce livre aux générations postérieures à 68, car pour tous ceux qui n’ont pas vécu cette période, la lecture de ce livre est une façon d’approcher l’histoire du pays, à partir des voix de ses protagonistes. C’est aussi une histoire très douloureuse, car c’est celle d’une génération vaincue, et rejetée par tous, y compris la gauche institutionnelle.
Ma plus grande satisfaction est de savoir que cet ouvrage est utilisé comme source de référence historique dans les universités, et que les étudiants et les enseignants se le sont approprié, car je l’ai écrit avec l’idée qu’il serait principalement lu par les jeunes générations.
Propos recueillis par Bettina Ghio et Mathieu Bonzom.
[1] Sur la base de la révolution cubaine mais aussi de la stratégie du Vietnam contre l’attaque des États-Unis, Che Guevara théorise la création de « focos » ou foyers de guérilla rurale, dans le but de faire émerger « deux, trois… de nombreux Vietnam ». Le « foquisme » est à l’origine de nombreux groupes de guérilleros, en Amérique latine en particulier.
[2] L’enregistrement permet une pleine participation aux élections et l’accès à un système de financement public.
[3] Cette expression désigne les formes de répression exceptionnelles (en particulier de nombreux enlèvements et assassinats, et un usage fréquent de la torture) employées par les dictatures et régimes autoritaires d’Amérique latine contre l’opposition, en particulier de gauche et d’extrême-gauche, dans les années 60 à 80 (les périodes et les événements varient selon les pays).
[4] Le mouvement étudiant de l’été 1968 au Mexique subit une violente répression qui culmine lors du massacre de plusieurs centaines de personnes par un groupe paramilitaire en civil et l’armée, dans un rassemblement sur la Place des Trois Cultures (ou Place de Tlatelolco), à Mexico, le 2 octobre. Le gouvernement minimise le nombre de victimes (20) mais finit par assumer la responsabilité de l’intervention en 1969. Les étudiants attendent le 10 juin 1971 pour oser lancer une nouvelle manifestation dans la capitale, qui se solde par un autre massacre perpétré par un groupe de militaires en civil, los Halcones. Le gouvernement Echeverría nie quant à lui toute implication.
[5] L’université nationale autonome du Mexique, fondée à Mexico au XVIe siècle, est l’une des plus grandes et des plus réputées du pays, du continent et du monde hispanophone. Elle devient un haut lieu des mouvements étudiants, en particulier en 1968 et jusqu’à aujourd’hui.
[6] Avant de succéder à Gustavo Díaz Ordaz à la présidence, Echeverría est son Ministre de l’Intérieur (1964-1970), et dirige donc la répression du mouvement étudiant de 1968.
[7] « Cacique » est un terme d’origine antillaise introduit au Mexique par les Espagnols et désignant les chefs ou notables indigènes ; pris par la suite en mauvaise part pour « notable local au pouvoir incontesté » . Le régime dirigé par un cacique est appelé un caciquat. [Note du livre, p. 16]
[8] Centre de documentation et de recherche à but non-lucratif fondé en Espagne (http://www.cedema.org).
[9] Intellectuel mexicain issu du PCM et actif dans la campagne présidentielle Cárdenas pour le PRD en 1988, Castañeda ne cesse de se revendiquer de la gauche mais rejoint la campagne Fox (PAN, conservateur) en 2000 et obtient après son élection le poste de Ministre des Affaires Étrangères.
[10] Abréviation de Ejército Zapatista de Liberación Nacional, « armée zapatiste de libération nationale », organisation révolutionnaire armée à l’origine du soulèvement indigène et populaire de l’État du Chiapas depuis 1994.

![Récits de militantes : Annick Coupé, de mai 68 au mouvement altermondialiste [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/annick-coupe-150x150.jpg)