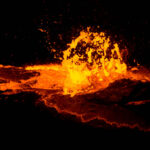La morale des soulèvements ? Classes moyennes, économie morale et révoltes populaires
L’onde de choc des soulèvements qui ont éclaté au cours de l’automne 2019 ne s’est pas épuisée. Ces révoltes appellent un renouvellement des analyses. C’est ce que propose ici Frédéric Thomas, chargé d’étude au CETRI – Centre tricontinental, à partir des cas chilien, équatorien et haïtien, en croisant les concepts d’économie morale et de classe moyenne, et en émettant quelques hypothèses.
*
« Je n’aime pas parler de « classe moyenne », car elle est pour moi inexistante en Haïti. Il n’y a pas les conditions économiques ici d’une classe moyenne. » (Vélina Élysée Charlier, l’une des figures de Nou pap dòmi en Haïti.)
La surprise, la radicalité et la simultanéité des soulèvements au cours de l’automne 2019, du Liban au Chili, en passant par Haïti et l’Algérie, ont frappé les esprits. Nombre d’articles ont tenté d’en éclairer les causes et les enjeux, les correspondances et les détonateurs locaux. Si une des caractéristiques communes de ces mouvements fut leur mixité en termes générationnel et de classes sociales, force est aussi de constater le rôle important joué par la jeunesse urbaine de « classe moyenne »1. C’est cette place que nous voudrions discuter ici, en nous centrant sur les révoltes qui ont éclaté en Amérique latine.
Classes moyennes, classes fantômes ?
Le concept de « classes moyennes » s’avère méthodologiquement compliqué à manier, du fait de son hétérogénéité. Il se définit d’abord négativement, par ce qu’il n’est pas : ni riche, ni pauvre, dans cet entre-deux. Il détient par ailleurs une charge idéologique considérable, particulièrement à l’œuvre dans le discours dominant. Mais qu’en est-il de sa réalité en Amérique latine ?
La Banque mondiale notait, en 2013, que le continent était en train de se convertir en une « région de classe moyenne »2. Six ans plus tard, sur base des derniers chiffres (2017), la Commission économique pour l’Amérique latine (Cepal, agence des Nations unies) estime que la classe moyenne – soit le large spectre de personnes dont les revenus se situent entre 1,8 et 10 fois le seuil de pauvreté – représente 41 % de la population. Dont plus de la moitié occupe la tranche basse. Et la Cepal de reconnaître que cette classe forme « une sorte de ‘zone grise’ de la structure sociale d’Amérique latine ».
Au-delà des questionnements méthodologiques, plusieurs remarques peuvent déjà être faites. En 2017, un peu plus de 30 % de la population du continent était sous le niveau de pauvreté, et près de 26 % disposait de bas revenus (moins de 1,8 fois le seuil de pauvreté). La frontière entre cette majorité (56 %) de la population et la tranche basse de la classe moyenne (21 % de la population) est poreuse3. Et ce d’autant plus qu’il y a fort à parier que les conditions sociales de cette dernière catégorie sont davantage comparables avec la population à bas revenus qu’avec le « haut » de la classe moyenne.
Un prix et une conquête
Dans son édition 2019 du Panorama social de l’Amérique latine, la Cepal affirme : « une classe moyenne forte et prospère est cruciale pour l’efficacité de l’économie et la cohésion de la société ». L’émergence et le développement de cette classe marquaient dès lors une double réussite : la sortie de millions de personnes de la pauvreté, et l’assurance d’un avenir prospère. Ainsi, comme l’écrivent Güemes et Paramio, « l’idée de classe moyenne opérait comme un prix et une conquête »4. Prix et conquête qui sont d’abord ceux du cycle post-néolibéral qui a marqué le continent, depuis l’arrivée au pouvoir d’Hugo Chavez au Venezuela, en 1999, jusqu’à la destitution de Dilma Roussef, en 2016, au Brésil, pour prendre deux dates clés.
Le curseur mis sur la classe moyenne permet d’esquiver la question de la classe dominante du continent le plus inégalitaire du monde. Le développement de la classe moyenne serait à la fois le marqueur et le vecteur de l’atténuation des conflits sociaux et de la diminution des inégalités. D’où sa mise en avant stratégique. Mais ce récit s’avère aussi instrumentalisé que problématique. La réduction des inégalités est probablement surestimée, du fait de l’évasion fiscale, de toute façon centrée, sinon cantonnée aux revenus – et pas à la propriété de la terre et aux capitaux –, et passée. Depuis 2017, les inégalités ont augmenté au Brésil, au Chili, en Équateur, en Colombie, en République dominicaine, en Uruguay, au Salvador et au Honduras. Dans le même temps, la pauvreté est repartie à la hausse et, selon la Cepal, devrait continuer à augmenter.
De plus, cette nouvelle classe moyenne est avant tout le fruit d’un développement basé sur l’extractivisme – exploitation de ressources naturelles (soja, minerais, pétrole, etc.), peu ou pas transformées, et prioritairement destinées aux exportations –, et catalysé par la croissance chinoise. Or, la durabilité de ce modèle a été mise en question. À court terme, la baisse des prix des matières premières depuis 2015, l’absence d’une refonte de la politique fiscale, la faiblesse des systèmes de protection sociale, et le poids de l’économie informelle fragilisent les bases de cette classe. Celle-ci n’a donc pas la stabilité qu’on lui attribue et ne constitue pas (ou bien faiblement) le facteur de stabilisation de la société que d’aucuns veulent y voir. Pour preuve, selon la Cepal, les couches à faible revenu et les strates basses de la classe moyenne, soit 46 % de la population, « présentent de hauts risques de tomber en situation de pauvreté »5.
Un mythe performatif
En 2011, 70 % des citoyens latino-américains se reconnaissaient comme appartenant à la classe moyenne, soit le double de ceux reconnus en fonction de critères objectifs ; signe de la puissance performative du récit signalée par Cecilia Güemes et Ludolfo Paramio. Le statut était mobilisé comme un critère de distinction, une manière d’anticiper, de justifier ou de consacrer les attentes correspondant à cette ascension sociale. Mais, un double déclassement subjectif et objectif s’est imposé. Au fur et à mesure que se creusaient les frustrations et la désillusion d’une classe moyenne sans moyens, l’étiquette a perdu de son attractivité. À quoi bon si, de toute façon, la distinction opère de moins en moins, et cache de plus en plus mal l’écart entre les attentes propres à la classe moyenne et leur réalisation ?
Les personnes de la nouvelle classe moyenne pensaient s’être élevées au-dessus de la pauvreté et accéder à un ensemble de biens et services, qui semblaient leur être dus. Sans s’être véritablement affranchies de la misère économique, poursuivies par le spectre du déclassement, elles découvrent maintenant leur misère morale. D’où un processus de désaffiliation, de désertion, voire de sabotage. Cela se vérifie au détour de la lecture qui est faite de son implication dans les récents changements sociaux en Amérique latine.
Au Brésil, la classe moyenne fut accusée d’ingratitude ; elle tournait le dos au Parti des Travailleurs (PT), qui lui avait permis de se développer, pour se jeter dans les bras populistes de Jaïr Bolsonaro. Au Chili, en Équateur et en Haïti, sa participation aux révoltes sanctionnait l’ère du soupçon. N’était-ce pas le signe, en fin de compte, du caractère superficiellement radical et populaire de ces soulèvements ? Ce n’est jamais les bonnes raisons ni le bon moment, et, en fin compte, jamais le « bon » peuple, qui se révolte. L’axe central de cette lecture de disqualification réside dans l’assignation faite à la classe moyenne d’incarner le « juste milieu » de la démocratie de marché. Ce qui précisément volait en éclats.
Une partie de la classe moyenne refuse de continuer à jouer le jeu, en se faisant la vitrine du régime. À la trahison de ses expectatives en termes d’accès au logement, à la santé, à l’emploi et, au-delà, aux valeurs de respect et d’honnêteté, de sécurité et de dignité, elle répond en démoralisant les attendus correspondant à sa classe et au libéralisme démocratique, en faisant de l’écart entre les annonces du statut et la précarité du quotidien la formule de l’explosion. Nulle part cet écart n’est peut-être plus visible qu’au niveau de l’éducation. De plus en plus de jeunes de ladite classe moyenne accèdent à une éducation supérieure, en décalage avec les possibilités offertes par les marchés du travail locaux (l’économie informelle s’élève à plus de 40 % au Chili ; 59 % en Équateur ; bien davantage encore en Haïti. De même, 27 % des jeunes Arabes sont au chômage). Le chômage, l’emploi informel et l’émigration sont autant de signes des promesses non tenues de cette éducation, qui constitue l’un des premiers prix de l’accès à la classe moyenne.
Mais cet écart est également sensible au niveau de l’accès au transport. Aussi différents soient les contextes haïtien, équatorien et chilien, l’explosion sociale qui a secoué ces pays a pour origine une augmentation du coût du transport (l’augmentation du prix de l’essence en Haïti et en Équateur ; du ticket de métro au Chili). Repoussés vers les périphéries, où s’opère, en Haïti, une hybridation des communautés rurales et urbaines, ainsi qu’une informalisation croissante des pratiques quotidiennes, les citadin-e-s doivent consacrer plus de temps et d’argent pour se déplacer dans des villes exponentielles, en voie rapide de néolibéralisation6. Alors que la mobilité est devenue un véritable enjeu, les mesures annoncées dans les trois pays démontraient les limites ou l’absence d’une politique de transport public un tant soit peu cohérente et durable, et, en affectant d’abord et davantage les classes précaires, de l’existence d’une politique fiscale injuste.
Économie morale du soulèvement
Outre le contexte latino-américain, la précarité et la désillusion de la classe moyenne éclairent à la fois sa révolte et ses ambivalences. Sa surexposition dans le discours de légitimation du système peut expliquer en retour sa radicalité et la fixation de la lutte sur des critères moraux de rejet de la corruption. Au-delà des détournements de fonds, c’est le pacte implicite, faisant système, qui est corrompu ; un pacte où se nouent classe moyenne, progrès économique, juste milieu social et démocratie représentative libérale.
Le recours au concept « d’économie morale » de l’historien E. P. Thompson se prête à l’analyse de ces explosions sociales. Samuel Hayat, qui l’a appliquée au mouvement des « gilets jaunes » en France, rappelle en effet qu’il s’agit d’un appel à ce que devrait être un bon fonctionnement, au sens moral, de l’économie, étant entendu que « l’économie réelle doit être fondée sur des principes moraux »7.
L’économie morale s’appuie sur l’idée de « pactes et d’attentes tacites », définissant les limites de l’acceptable, les contours du juste et de l’injuste. À l’origine, elle traduit plutôt des « formes d’arrangement moral » entre dominants et dominés, qu’un renversement du rapport de domination. D’où son ambivalence ; ambivalence qui se décline aux niveaux de la cible, des prémisses et de la solution de cette morale. Le capitalisme est justement le système qui prétend dés-encastrer l’économie du reste de la société, libérer les forces du marché de toutes ses entraves, dont au premier chef, les questions éthiques. L’attaquer au nom de la morale risque dès lors d’emprunter le chemin superficiel d’une moralisation de la vie publique, qui peut vite prendre le tour de la technocratie (le gouvernement d’experts) ou du bon sens populaire contre la politique. C’est passer à côté de la logique même du fonctionnement du libre-échange, et ne pas voir que le néolibéralisme favorise une technocratie qui tend à se débarrasser du politique, et à faire du marché le seul bon sens populaire.
De plus, comme le souligne Hayat, l’économie morale renvoie à un ordre, fixé par le rappel à des normes intemporelles et l’inscription dans une communauté. Et les drapeaux nationaux ont, de fait, fleuri au sein des insurrections du Sud, qui se voulaient nationalistes (voire l’expression d’une nouvelle indépendance comme en Algérie)8. Réaffirmation d’un espace public et d’une communauté nationale, qui peut glisser vers une forme réactionnaire. Ne peut-on d’ailleurs aussi lire la montée en puissance des droites militantes, au Brésil entre autres, comme le retour d’une partie de cette classe moyenne à un Ordre moral, la réaction face au déclassement et le repli sur « la communauté primordiale d’appartenance » menacée ? Bref, le versant conservateur de cette économie morale ?
Le risque de ce glissement est bien réel. Mais jusqu’à présent, les révoltes de l’automne 2019 n’y ont pas cédé. Au contraire même, elles se sont caractérisées par une convergence d’acteurs et un décloisonnement des places et des rôles. Leur chance – leur chance et leur radicalité – tient aussi à l’accumulation de forces, suite aux luttes indigènes et féministes. Nombreux sont les commentateurs qui ont souligné la plus grande visibilité des femmes au sein de ces révoltes. Non seulement celles-ci sont plus nombreuses et plus visibles, mais elles portent des revendications féministes, appliquées au changement du système. Quant aux organisations indigènes, elles ont joué un rôle de premier plan en Équateur9, tandis que les luttes mapuches et, plus généralement, socio-environnementales, irriguent la conflictualité sociale au Chili.
Les féministes et les indigènes ne sont pas moins nationalistes, mais ils et elles le sont à partir de ce « en-dehors » de l’essentialisme communautaire, obligeant à faire de la nation un montage de visages, d’histoires et de dynamiques pluriels. De même déclinent-ils le genre et les couleurs de cette classe moyenne. En outre, forts de leurs expériences, ils dénoncent la mystification d’une économie « désentravée » des rapports sociaux, et entendent donner à la morale le sens concret des conditions matérielles et spirituelles d’une vie digne. Enfin, pour les plus radicaux, il ne s’agit pas seulement de retourner le mythe dont la classe moyenne est l’étendard, mais bien de le renverser, en montrant que la corruption du système tient d’abord à sa soumission à une économie sans morale.
à voir aussi
références
| ⇧1 | Renaud Lambert évoque ainsi, dans Le Monde diplomatique de mars 2020 (« La droite latino-américaine dans l’impasse »), « la plus forte contestation de l’histoire récente de l’Amérique latine, d’autant plus remarquable qu’elle mobilise de larges fractions des classes moyennes ». |
|---|---|
| ⇧2 | Ferreira Francisco H. G., Julian Messina, Jamele Rigolini, Luis-Felipe López-Calva, Maria Ana Lugo, et Renos Vakis, 2013, La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina, Washington DC, Banque mondiale. |
| ⇧3 | Cepal, Panorama Social de América Latina 2019, Santiago, 2019. Sauf mentions contraires, les chiffres proviennent de ce document. |
| ⇧4 | Cecilia Güemes, Ludolfo Paramio, « El porvenir de una ilusión: clases medias en América Latina », Nueva Sociedad, n° 285, janvier-février 2020. De manière générale, sur la question des classes moyennes en Amérique latine, je renvoie à cet excellent numéro de la revue Nueva Sociedad. |
| ⇧5 | C. Güemes et L. Paramio estiment pour leur part qu’autour de 90% de ces classes moyennes sont « vulnérables ». |
| ⇧6 | Lire à ce propos les travaux de David Harvey, et l’application qu’en fait Asef Hayat par rapport aux révolutions arabes : Revolution without revolutionnaries. Making sense of the Arab spring, Stanford UP, 2017. |
| ⇧7 | Samuel Hayat, « Les Gilets Jaunes, l’économie morale et le pouvoir », 5 décembre 2018. Pour une discussion de l’usage de ce concept dans le contexte africain, lire Johanna Siméant, « ‘Économie morale’ et protestation – détours africains », Genèses, n° 81, 2010. |
| ⇧8 | Pour rappel, l’augmentation du prix de l’essence en équateur et en Haïti découlait des conditions de prêts du Fonds monétaire international (FMI), nourrissant en retour le sentiment national. |
| ⇧9 | « La manifestation du 9 octobre [2019], conduite par la Conaie [Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur] fut la plus importante protestation sociale du XXIème siècle ». Et Franklin Ramírez Gallegos de préciser que la Conaie s’était faite « les tribunes de la plèbe exploitée et aggravée par la violence néolibérale débordante » : « Las masas en octubre : Ecuador y las colisiones de clase », 21 janvier 2020. |