
À lire : « Figures de la révolte. Rébellions latino-américaines : 16e-20e s. » (coord. N. Pinet)
Nicolas Pinet (coord.), Figures de la révolte. Rébellions latino-américaines : 16e-20e siècles, Paris, Syllepse, 2016, 320 p., 16€.
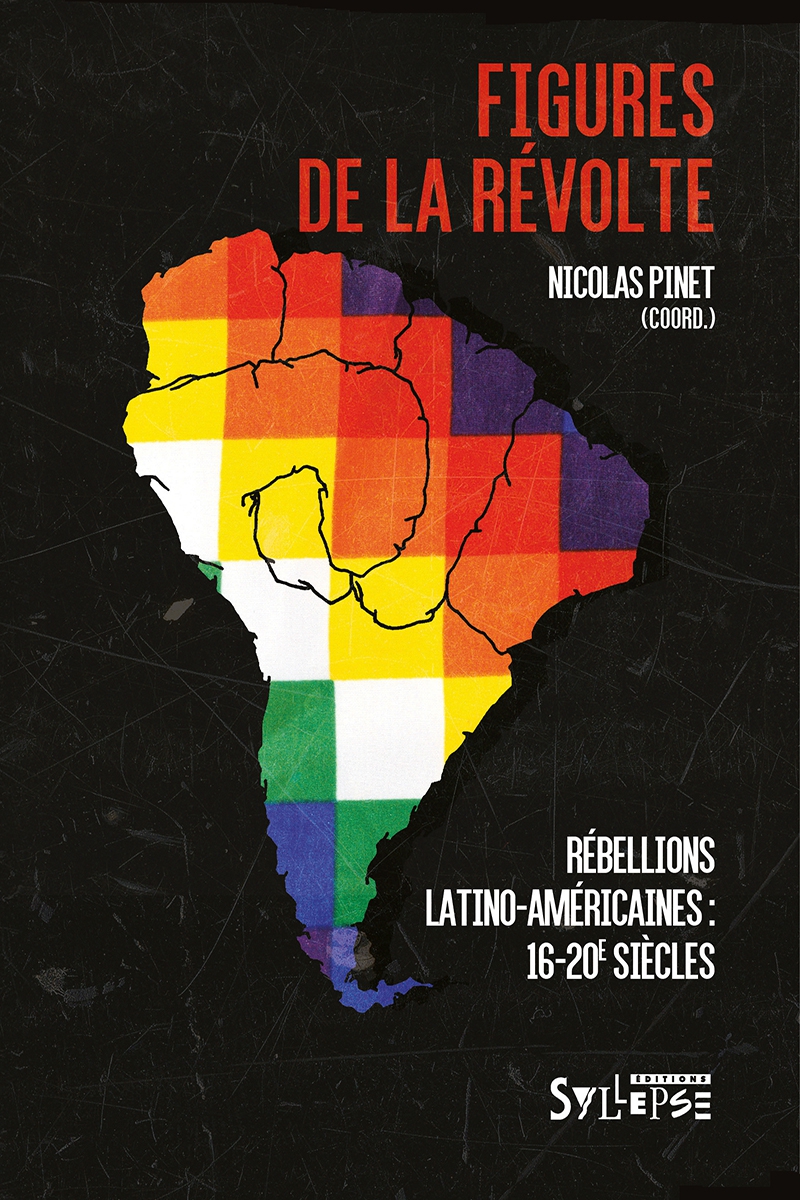
Introduction : « Amériques latines. Éléments pour une grammaire de la révolte » (p. 7-29)
L’Amérique latine occupe une place particulière dans l’imaginaire français et, en particulier, dans l’imaginaire de gauche. Ce n’est pas un hasard si c’est aussi une destination privilégiée de voyage, notamment chez les jeunes adultes dont les périples latino-américains ont souvent une dimension initiatique. Si l’on demandait aux gens d’énumérer les images qu’ils associent à la région, on retrouverait sans doute en bonne place des pratiques culturelles, comme la salsa, des destinations vantées par l’industrie du tourisme – les plages du Brésil… –, ainsi qu’une série de lieux et de figures emblématiques, liés à différents moments de l’histoire de la région : la révolution cubaine de la fin des années 1950 (La Havane, Fidel Castro, Che Guevara), la voie chilienne vers le socialisme au début des années 1970 (Santiago, Salvador Allende), la révolution sandiniste de la fin des années 1970 (Managua, Manuel Ortega et les sandinistes), le soulèvement du 1er janvier 1994 au Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, le sous-commandant Marcos), la révolution bolivarienne initiée au Venezuela à la fin des années 1990 (Caracas, Hugo Chávez). Ce panthéon des luttes va de pair avec un antipanthéon des « dictateurs » : Fulgencio Batista, Augusto Pinochet, Anastasio Somoza, le néolibéralisme, l’oligarchie, pour ne citer que les doubles négatifs des exemples donnés précédemment.
Le travail éditorial de la revue Dial (Diffusion de l’information sur l’Amérique latine) s’inscrit dans ce contexte : s’il y a un intérêt certain pour la région, il n’est pas facile de trouver, en français, des informations relativement substantielles sur des sujets ne faisant pas les grands titres de la presse. Et même sur les sujets abordés, les informations diffusées par les médias sont souvent lacunaires, voire inexactes. Dial s’efforce ainsi de rendre accessible, en les traduisant en français, des textes donnant accès aux multiples facettes d’un continent complexe.
De même, au-delà d’une vision du passé latino-américain ne retenant que les grands faits et dates d’une histoire présentée comme linéaire et sans aspérités – une « histoire des vainqueurs » –, Figures de la révolte propose de faire retour sur les moments d’achoppement et de vacillation des pouvoirs en place, sur les révoltes qui en ont fait trembler les fondations, de l’époque coloniale à nos jours. Les dix textes que l’on va lire ont été rédigés par des historiens, à l’exception des deux derniers, écrits respectivement par deux anthropologues et une politiste. Chacun présente une description précise et documentée des événements et propose des éléments d’analyse. Ces textes, inédits en français, ont été traduits de l’espagnol ou de l’anglais par Dial [1]. Cet ouvrage est donc le fruit du travail collectif réalisé au sein de la revue par les différents membres de l’équipe – traducteurs et traductrices, relecteurs et relectrices, éditeurs et éditrices – sans qui il n’aurait pu exister. Que la publication de cet ouvrage soit l’occasion de les remercier tous et toutes.
Quels mots pour dire la révolte ?
Il est peut-être utile d’évoquer brièvement deux aspects de ce travail éditorial. Le premier concerne la traduction : si le passage d’une langue à l’autre est toujours un défi, le choix d’équivalents français pour des mots espagnols ou anglais du champ sémantique de la révolte a souvent été un casse-tête. Comment traduire par exemple « estallidos », ou « protestas » ? Il n’y a pas d’équivalent exact facilement utilisable dans les différentes acceptions des mots. Pour le premier, nous avons opté pour « soulèvements populaires urbains » dans les contextes généraux et conservé « estallidos », avec une note, dans d’autres cas plus spécifiques où la transposition conduisait à une perte de sens trop grande. Le deuxième a été rendu parfois par « mobilisations », d’autres fois par « protestation » (sociale), « mouvements de protestation », ou « manifestations », selon les contextes. Pour d’autres mots, comme « riot » ou « looting », la traduction par « émeute » et « pillage » s’imposait et c’est elle qui a été adoptée, sans que les connotations associées, au moins au premier des deux mots, ne nous satisfassent pleinement.
En effet, la majorité du vocabulaire que nous utilisons pour désigner les mobilisations, les mouvements de protestation ou de revendication populaires n’a pas été forgée par les acteurs et actrices de ce type de mobilisation mais plutôt par les lettrés, et, plus récemment, par les médias et les hommes et femmes politiques, c’est-à-dire par celles et ceux ayant accès à la parole publique. Ceux-ci, du fait de cette position privilégiée, contribuent à forger les discours publics et les représentations qui leur sont associées. Du fait de la distance sociale les séparant des classes populaires sur lesquelles ils sont amenés à s’exprimer, c’est vraiment d’un Autre qu’ils parlent et il n’est pas rare que leurs propos soient perçus comme insultants voire humiliants par les personnes concernées. L’historien Gérard Noiriel [2] rappelle ainsi comment les ouvriers de la Monarchie de Juillet avaient protesté publiquement contre l’utilisation, notamment par Victor Hugo, du mot « populace » pour les désigner. Plus récemment, l’utilisation par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’intérieur, du mot « racaille » (octobre 2005) pour désigner les jeunes de quartiers populaires avait aussi entraîné de nombreuses réactions critiques. Dans le texte consacré au Caracazo, Fernando Coronil et Julie Skurski rapportent les propos de Gonzalo Barrios, président et fondateur d’Action démocratique, parti alors au pouvoir, qui compare les pilleurs à une « tribu primitive », l’option du gouvernement de recourir massivement à la violence pour réprimer les troubles étant présentée, elle, comme participant de la mission civilisatrice de l’État.
Les parties en conflit ont tout intérêt à discréditer l’adversaire et, dans les différentes révoltes présentées dans ce livre, les classes supérieures et les pouvoirs en place font un usage plein de leur quasi-monopole sur la parole publique pour délégitimer les luttes des groupes qui leur font face. Lors de la révolte de Túpac Amaru, l’État colonial utilise par exemple l’incendie d’une église lors de la bataille de Sangarará pour présenter le leader de la rébellion comme un « traître sacrilège », à la tête de milliers d’Indiens sanguinaires cherchant à exterminer les non-Indiens, privant ainsi Túpac Amaru du soutien des Créoles. On retrouve dans les différents cas présentés dans cet ouvrage, et au-delà, le même genre de représentations disqualifiantes : les révoltés sont barbares, primitifs, irrationnels, violents, voire, dans le cas des habitants de Canudos, de dangereux illuminés. Ils constituent une menace à la civilisation et à l’ordre contre laquelle le recours à la répression est donc « légitime ».
Même au-delà des parties impliquées directement, les travaux de certains historiens sur les émeutes, révoltes et révolutions ne diffèrent parfois pas radicalement dans leur approche des représentations évoquées. L’historien britannique George Rudé (1910-1993), dans l’introduction de son ouvrage La Foule dans l’histoire [3], dresse ainsi un inventaire de la multitude de qualificatifs négatifs utilisés pour désigner les classes populaires chez les historiens conservateurs. Pour Hippolyte Taine (1828-1893), d’abord libéral mais échaudé par la Commune de Paris, les révolutionnaires de 1789 sont des « bandits », des « sauvages », des « voleurs », la « lie de la société ». Si, comme il le fait remarquer, les historiens postérieurs n’utilisent plus ce genre de qualificatifs, ils mobilisent cependant volontiers le concept de « foule », instrument passif d’agents manipulateurs, masse aux instincts imprédictibles et tendanciellement criminels. Edward Palmer Thompson, autre historien britannique, s’insurge de même contre la vision spasmodique de l’histoire populaire qui se cache souvent derrière le mot « émeute » :
Selon cette vision, les gens du commun ne peuvent guère être considérés comme des agents historiques avant la Révolution française. Avant cette période, ils s’immiscent de manière occasionnelle et spasmodique dans le canevas de l’histoire, dans les périodes de troubles sociaux soudains. Ces immixtions sont de type compulsif plutôt que conscientes d’elles-mêmes et autonomes : ce sont de simples réponses à des stimuli économiques. Il suffit de mentionner une mauvaise récolte ou une baisse des revenus du commerce, pour remplir toutes les conditions requises de l’explication historique [4].
Les auteurs rendent tous compte, chacun à sa manière, du contexte et des logiques collectives et individuelles à l’œuvre lors des révoltes décrites, contribuant ainsi, dans la mesure de ce que leurs sources leur permettent, à rendre à ces événements leur intelligibilité, malgré la distance temporelle, culturelle et spatiale qui nous en sépare. Une des difficultés de l’entreprise est que si, au moment des faits, coexistent plusieurs récits et interprétations des événements, de la part d’acteurs et d’observateurs, l’accès différentiel à la parole publique a pour conséquence que les différentes versions des faits ne laissent pas les mêmes traces. Les récits produits par les autorités ou diffusés par différents médias perdurent et peuvent ensuite être utilisés comme sources par les historiens ; à l’inverse, les récits au sein des familles, quartiers, villages et groupes divers auxquels appartiennent les acteurs des révoltes, s’ils ne sont pas fixés sous forme écrite ou transmis d’une autre manière, s’effritent et disparaissent avec le temps. À cela s’ajoute le fait que la répression dont font l’objet la majorité des révoltes décrites dans cet ouvrage fait souvent disparaître les acteurs mêmes des événements, contribuant ainsi un peu plus au déséquilibre entre les différentes versions des faits. Enfin, les épisodes de répression s’accompagnent toujours d’un effort pour légitimer le recours à la violence, en tentant notamment de museler ou d’affaiblir les lectures contradictoires des événements. Contre cette tendance, Arturo Álape, l’auteur du texte sur le Bogotazo, a passé plusieurs années de sa vie à recueillir les témoignages d’acteurs et d’actrices du 9 avril 1948, compilés dans une somme de 650 pages intitulée de manière significative : Le Bogotazo : Mémoires de l’oubli [5].
Structure de l’ouvrage
Le deuxième point du travail éditorial concerne la sélection des textes. Un livre, même épais, ne suffirait pas bien sûr à évoquer avec précision la multitude de révoltes urbaines [6] et surtout rurales [7] survenues depuis le 16e siècle en Amérique latine. Il a donc fallu faire un choix. Le premier critère a été d’associer des textes sur des événements relativement contemporains, au sens large – c’est-à-dire en fait de la seconde moitié du 20e siècle –, et des événements plus anciens (du 16e siècle à la première moitié du 20e siècle), ce qui permet de réinscrire les soulèvements urbains de l’après-Seconde Guerre mondiale dans une perspective historique plus large. Ce critère constitue la charnière du livre, avec ses deux parties. La première moitié du livre s’organise autour du thème résumé par son titre, « Subalternes en révolte » : ses cinq textes décrivent et analysent cinq révoltes menées par différents groupes subalternes des sociétés coloniales et postcoloniales – les esclaves, les Indiens, les familles pauvres de Canudos dans l’arrière-pays du Nord-Est brésilien, les ouvriers et les travailleurs ruraux des estancias [8] – à différentes époques : 16e, 18e, 19e et 20e siècles. Les six textes qui composent la deuxième partie traitent de cinq soulèvements urbains de la seconde moitié du 20e siècle. Leurs noms, à l’exception du cas chilien qui n’a pas reçu de nom propre – Bogotazo, Cordobazo, Caracazo, Santiagueñazo – témoignent des liens établis par les observateurs qui en ont fait des éléments d’une même série [9]. De fait, malgré la diversité des circonstances, du déroulement des événements et de leur fin, on verra plus loin que les points communs ne manquent pas.
Un deuxième critère, en rapport avec ce qui a été évoqué plus haut concernant l’imaginaire français de l’Amérique latine a été de partir des événements et figures qui évoquent déjà parfois quelque chose de ce côté de l’Atlantique pour en proposer une vision plus approfondie : c’est le cas par exemple de Túpac Amaru, de la guerre de Canudos ou du Caracazo. À ces événements dont le nom est parfois familier en ont été ajoutés d’autres, qui, au contraire, sont le plus souvent inconnus des lecteurs francophones, comme c’est le cas sans doute des palenques panaméens, ces communautés formées par des esclaves en fuite au 16e siècle. On connaît mieux en effet l’équivalent brésilien des palenques, les quilombos, et en particulier, le plus célèbre d’entre eux, le quilombo de Palmares (17e siècle), auquel Benjamin Péret a consacré un livre [10]. Des palenques ont existé dans tous les territoires où des esclaves noirs étaient présents [11], du Pérou au Mexique et dans les Caraïbes, en passant par la Colombie ou le Venezuela – des communautés d’esclaves en fuite existèrent aussi plus au Nord, aux États-Unis, même si pour des raisons linguistiques évidentes, elles ne sont pas appelées palenques. Et, à Saint-Domingue, la révolte des esclaves noirs conduira à l’indépendance d’Haïti en 1804.
Ces deux aspects du travail éditorial évoqués, reste la question centrale : pourquoi publier en France en 2016 un ouvrage sur les révoltes et soulèvements urbains en Amérique latine ?
La révolte, un répertoire d’action illégitime en « démocratie »
Tout d’abord, si révoltes et soulèvements semblent être une forme de revendication et d’action bien acceptée, et même « encouragée », dans des pays au régime politique considéré non démocratique, voire dictatorial, comme lors du « printemps arabe », il n’en est pas de même « à domicile », dans les pays occidentaux où les institutions de la démocratie représentative sont perçues comme fonctionnant de manière suffisamment correcte pour qu’il ne soit pas nécessaire de recourir à ce répertoire d’action [12] non institutionnel [13]. C’est un vieil argument : l’instauration du suffrage universel est censé avoir rendu « archaïques » et « primitives » ces formes d’action « de l’ancien temps ». Paul Bert, l’un des artisans de l’école gratuite, laïque et obligatoire de la 3e République française expliquait ainsi, pédagogue :
[M]ais aujourd’hui, c’est tout le monde qui commande, c’est la Nation tout entière qui parle par le suffrage universel. Contre qui se révolterait-on ? Contre la France ? Ce serait une trahison ! Si la loi est mauvaise, il n’y a qu’à le démontrer aux autres, puis il faut patienter, et attendre les élections nouvelles. Alors chaque citoyen prend son petit bout de papier blanc, inscrit un nom dessus et le met dans la boîte en bois ; on change ainsi la Chambre, qui change la loi tout tranquillement. Et cela vaut mieux que les révolutions qui coûtent du sang et de l’argent [14].
La manifestation, qui fait aujourd’hui partie des formes d’action politique perçues comme légitimes – au moins pour ce qui est des manifestations dûment autorisées par les autorités – n’est pas considérée en ces débuts de 3e République comme un répertoire d’action collective légitime, bien au contraire [15]. Elle ne le deviendra qu’au prix de sa progressive institutionnalisation, en tant que forme d’action encadrée et contrôlable.
Les émeutes, témoignage de la coupure entre classes populaires et système politique institutionnalisé
Dans ce contexte, les « émeutes urbaines », en Europe – France (automne 2005), Angleterre (août 2011) –, ou en Amérique latine, apparaissent d’abord comme le témoignage d’une coupure, parfois assez profonde, entre l’édifice institutionnel de la démocratie représentative et le reste de la société, tout particulièrement les classes populaires. Pour un penseur conservateur comme Samuel Huntington, ce type de coupure n’est d’ailleurs pas, en soi, un inconvénient, mais bien plutôt une condition du bon fonctionnement de la démocratie, pour laquelle des secteurs sociaux trop mobilisés constitueraient un danger :
Le fonctionnement efficace d’un système démocratique requiert en général un certain niveau d’apathie et de non-participation de la part de certains individus ou groupes. […] Une valeur qui est normalement bonne en soi n’est pas nécessairement optimale quand elle est maximisée. Nous en sommes venus à reconnaître qu’il y a potentiellement des limites désirables à la croissance économique. Il y a aussi potentiellement des limites désirables à l’extension indéfinie de la démocratie politique. La démocratie aura une vie plus longue si elle a une existence plus équilibrée [16].
Le cas du Venezuela au moment du Caracazo offre une illustration exemplaire de cette coupure. Comme l’expliquent les auteurs du texte qui lui est consacré, les énormes réserves pétrolières du pays passées sous le contrôle de l’État lors de la nationalisation de 1976 lui procure des revenus très importants et assure son indépendance économique vis-à-vis des contribuables. Cela a « permis au système politique vénézuélien […] de devenir extrêmement centré sur l’État et déconnecté des demandes de la population » [17]. Dans ce contexte, les campagnes électorales apparaissent avant tout comme l’occasion de rejouer le spectacle d’un « simulacre de démocratie nationale » et de mettre en scène un dialogue feint entre classe politique et électorat. Cette coupure profonde entre la sphère de la politique institutionnelle et les classes populaires n’empêchait pas les institutions politiques vénézuéliennes d’être considérées comme un modèle de stabilité et de réussite. Et, si l’on en croit Samuel Huntington, cette coupure constituait même un gage – au moins temporaire – de stabilité. Depuis la chute de la dictature de Marcos Pérez Jiménez et la conclusion du Pacte de Punto Fijo (1958) – alliance des partis principaux excluant le Parti communiste –, les élections s’étaient succédées tous les cinq ans, avec alternance au pouvoir du parti social chrétien (COPEI) et d’Action démocratique (AD, social-démocrate), alors que dans les pays environnants, les coups d’État se succédaient. Le Caracazo, au cours duquel entre en scène la fraction majoritaire, jusque-là passive et silencieuse, de la population fait apparaître au grand jour l’envers du décor de cette « réussite démocratique », sa part manquante.
Lors des « émeutes » urbaines, la coupure entre les classes populaires et le système politique institutionnalisé apparaît sous un double aspect. Le premier tient au fait que les personnes qui descendent dans la rue le font en dehors des canaux de participation « légitime » offerts par le système, elles s’introduisent dans la sphère publique comme par effraction. Le deuxième aspect, l’envers de la coupure, est qu’elles n’y sont souvent pas « bien reçues » : la teneur d’une large part des discours publics accueillant ces formes d’action en atteste [18].
La révolte, action politique
Le fait que ce type d’action n’emprunte pas les canaux de participation attendus la rend-elle moins politique ? Répondre à cette question suppose de préciser ce qu’on entend par « politique ». Un petit tour d’horizon sémantique montre que « politique » a deux acceptions principales.
La politique renvoie en effet tantôt à un espace d’activités spécifique – on parlera alors par exemple de « champ politique » – tantôt à « l’ensemble social lui-même, observé à un certain point de vue [19] » – comme en témoigne l’expression « société politique » ou l’idée grecque de politeia. Dans le premier cas, sont qualifiées de politique les activités, les institutions ou les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, sont en lien ou entrent en rapport avec ce « secteur particulier de la vie sociale [20] ». Dans le deuxième cas, « politique » ne renvoie plus à un champ d’activités spécifique, mais a trait à l’« organisation des pouvoirs [21] » propre à telle ou telle société politique, c’est-à-dire, en dernière analyse, au système de rapports de pouvoir qui lui donne sa forme et dont le champ particulier de la politique institutionnelle n’est qu’une région. En ce deuxième sens, une action peut être qualifiée de « politique » si elle contribue à transformer – ou à maintenir – le système des rapports de pouvoir, de manière ponctuelle ou plus globale, directe ou indirecte, et à plus ou moins grande échelle.
Ces précisions permettent désormais de présenter plus clairement l’axe directeur de l’ouvrage : ce que les onze textes donnent à voir, ce sont des moments où des groupes occupant des positions subalternes dans le système des rapports de pouvoir réussissent à les contester, voire à les renverser, même si c’est, dans les cas présentés ici et contrairement au cas d’Haïti, seulement de manière temporaire. Ces différentes révoltes constituent dans l’ensemble l’exception, plutôt que la règle, l’extra-ordinaire plus que l’ordinaire des luttes des groupes subalternes. Du fait de la difficulté à s’extraire ou à inverser des rapports de pouvoir défavorables, ces derniers adoptent en général plutôt des tactiques plus discrètes, moins coûteuses en cas d’échec et requérant moins de force individuelle ou collective, comme la négociation des rapports de pouvoir, leur contournement ou le « grignotage » – une infraction légère aux normes et aux lois.
Les articles rédigés pour la Gazette rhénane par Karl Marx en 1842, alors que la Diète rhénane débat de l’adoption d’une loi sur le vol de bois mort donnent une bonne illustration de ces pratiques de grignotage : le ramassage de bois mort dans les forêts étant jusque-là toléré, une tactique de grignotage des paysans pauvres consistait à faire des entailles dans les jeunes arbres pour les « aider à mourir » et pouvoir alors les couper [22]. Le fait que la question ait été débattue à la Diète témoigne du fait que le « chapardage » de bois est perçu comme une atteinte aux droits des propriétaires des forêts et à l’ordre établi, c’est-à-dire comme une remise en question de l’état actuel des rapports de force entre classes sociales – du statu quo socio-économique. Un peu plus d’un siècle plus tôt en Angleterre, le braconnage du gibier avait aussi fait l’objet d’une loi très sévère – le Black Act (1723) – punissant de mort 50 types de délits en lien avec le braconnage [23]. Là aussi, la loi constitue une étape dans la dynamique des rapports de pouvoir entre différents groupes sociaux : face au « grignotage » des classes populaires, la loi renforce et rigidifie un état du rapport de forces tout à l’avantage des classes possédantes. Mais la loi ne met pas pour autant fin au braconnage, deux braconniers, condamnés à mort pour avoir tué un cerf, osant même revendiquer la légitimité de leur acte : « Ils dirent que les cerfs étaient des bêtes sauvages et que les pauvres, autant que les riches, avaient le droit de les utiliser [24]. » Apparaît ici un élément qu’on retrouve dans nombre des révoltes décrites dans ce livre, l’affirmation que les actes commis sont légitimes.
Contexte et catalyseurs
Revenons justement à ces révoltes pour examiner d’abord comment on passe de l’ordinaire à l’extra-ordinaire. Le déclenchement des révoltes semble associer presque à chaque fois un contexte de mécontentement de fond et un catalyseur en lien le plus souvent avec un fort sentiment d’injustice. Dans le cas des esclaves révoltés de Panamá, l’injustice est évidente. Le soulèvement de Túpac Amaru a lui pour toile de fond les humiliations du colonialisme et l’intensification de l’exploitation de la population qui résulte des réformes des Bourbons adoptées à partir du début du 18e siècle, auxquelles s’ajoutent les difficultés économiques de la région de Cuzco ; l’augmentation de la pression fiscale imposée par le Visiteur Areche agit comme un catalyseur, provoquant des dizaines d’émeutes et de révoltes à partir de la fin des années 1770, dans différents secteurs des Andes, avec parmi elles le soulèvement mené par Túpac Amaru en novembre 1780. L’épisode des Canudos associe un contexte de grande pauvreté et un catalyseur qui n’est dans ce seul cas pas un événement, mais un homme, Antonio Conseilheiro, dont les prêches ouvrent un horizon d’espoir. Les grèves à Buenos Aires (1919) et en Patagonie (1921) ont pour déclencheurs la baisse des salaires et les conditions de travail imposées dans le premier cas, à nouveau des baisses de salaires et des licenciements dans le deuxième cas. Là aussi, un fort sentiment d’injustice est présent : en Patagonie, la prospérité des années de guerre n’avait conduit à aucune hausse de salaires, mais les baisses de la demande et des prix des exportations après la fin de la guerre sont suivies, elles, d’une baisse des salaires imposée… Le catalyseur du Bogotazo est le meurtre du leader du Parti libéral, Jorge Eliécer Gaitán, qui représentait un espoir de changement social pour les classes populaires, dans un contexte général d’accroissement de la misère et de frustration. Au Chili (1957) comme au Venezuela (1989), comme d’ailleurs au Brésil en 2013, c’est l’augmentation des tarifs du transport public, qui touche de plein fouet les catégories modestes de la population dont c’est le seul moyen de transport, qui déclenche les mobilisations. Au Chili, les troubles commencent d’ailleurs à Valparaiso, là où la hausse est la plus importante. En Argentine (1969), la dictature installée après le coup d’État du 28 juin 1966 et dirigée alors par le général Juan Carlos Onganía avait multiplié ou encouragé les mesures et réformes impopulaires – interdiction du parti péroniste, réformes touchant notamment la classe ouvrière et les étudiants (salaires gelés ou diminués, interdiction de fait des grèves, licenciements, universités placées sous le contrôle de l’État, privatisation du réseau d’autobus urbain de Córdoba…). C’est pour protester contre des mesures de ce type que les branches locales des syndicats décident d’organiser un « paro activo » commun associant grève et manifestation, à laquelle se joignent les étudiants. Un affrontement avec la police provoque la mort d’un travailleur et, avec elle, le basculement de la manifestation dans l’émeute. À Santiago du Chili (1957) aussi, la mort d’une étudiante sous les balles des troupes relance les affrontements et déclenche une mobilisation sociale massive qui déborde bientôt les carabiniers et reprend le contrôle du centre-ville, procédant à des destructions et des pillages. À Caracas, dans un contexte de déclin économique et de corruption, le candidat présidentiel Carlos Andrés Pérez est réélu le 4 décembre 1988 après avoir mené une campagne critiquant le néolibéralisme. Mais peu après son élection, il lance un vaste programme d’austérité, condition imposée par le Fonds monétaire international pour l’obtention de prêts. Le programme prévoyait notamment la fin du contrôle des prix et des subventions à l’importation et la baisse des droits de douane. Avant même l’entrée en vigueur des mesures, les industries nationales ont réduit leur production et les entreprises ont commencé à retirer des magasins les aliments et articles de consommation aux prix contrôlés par l’État, les stockant dans la perspective d’une hausse des prix. Les consommateurs qui en avaient les moyens ont fait de même et commencé à constituer des stocks, tandis que ceux qui n’en avaient pas les moyens, et n’avaient pas non plus de frigidaires, en étaient réduits à parcourir la ville à la recherche des produits dont ils avaient besoin. Les relations entre commerçants et consommateurs se sont alors envenimées provoquant colère et affrontements dans les lieux d’approvisionnement – marchés, épiceries, petits magasins et boutiques –, « loin des grandes entreprises qui exerçaient un monopole sur le commerce ». La décision de l’association des entreprises de transport public de doubler les tarifs – alors que le gouvernement avait fixé un plafond de 30 % à la hausse –, le lundi 27 février, constitue le détonateur de la mobilisation.
À Santiago del Estero (1993), en Argentine, il ne semble pas y avoir eu de catalyseur mais plutôt une escalade progressive qui a fini par faire basculer les grèves et les manifestations vers un autre répertoire d’action. Mais le contexte est déterminant : l’État provincial traversait une crise financière profonde et le gouvernement fédéral avait imposé aux États une série de mesures d’austérité. Les salaires des employés de l’administration publique n’avaient pas été versés depuis trois mois, les plus récents dans la fonction avaient été licenciés et les manifestations s’étaient succédées depuis un mois avec de plus en plus d’initiatives protestataires : occupations d’immeubles, pneus brûlés, combats avec la police, jusqu’au basculement du 16 décembre, où les manifestants finissent par incendier et détruire le palais du gouvernement, le tribunal et l’Assemblée de l’État, avant de procéder au pillage et à l’incendie des maisons de membres du gouvernement et d’élus importants.
Dans chaque cas, les événements se déroulent suivant une logique interne infléchie par une série de facteurs dont les différents textes tentent de rendre compte avec précision. À Santiago du Chili (1957) et à Córdoba (1969), des manifestations plus organisées, avec une présence forte d’organisations syndicales et étudiantes, se transforment en une mobilisation plus massive et spontanée après les morts provoquées par la police. À Caracas (1989), les pillages commencent très vite après les premières mobilisations de blocage pour empêcher la circulation des véhicules de transport public. À Bogotá (1948), la mobilisation vise d’abord un objectif bien défini : le palais présidentiel. L’échec d’un premier assaut, repoussé par les tirs de la garde présidentielle, puis d’un deuxième auquel l’entrée en action de chars met fin, dans le sang, est suivi de la mise à sac de la ville.
Une temporalité de la brèche
À chaque fois, et du fait aussi de l’échec de ces soulèvements, la temporalité de ces révoltes est une temporalité de la brèche, comme c’est d’ailleurs le cas pour d’autres types d’insurrections populaires, comme la Commune de Paris (1871) [25] : pour différents types de raisons, les mécanismes de contrôle social et politique se trouvent un moment débordés ou inadéquats et s’ouvre alors pour une durée d’abord indéterminée un espace-temps autre, où les codes et les normes en vigueur jusque-là se retrouvent comme suspendus et cessent d’avoir cours. Dans l’espace-temps de la révolte des cimarrons du Panamá, les esclaves deviennent rois ; en Patagonie, les grévistes exproprient des chevaux et de la nourriture, contre des reçus émis par la Fédération syndicale ; à Bogotá, de nombreux policiers, par peur ou par sympathie pour le leader assassiné, remettent leurs armes à la foule ; à Caracas, certains policiers aident à ce que les pillages se déroulent de manière ordonnée et y participent. Comme le notent les auteurs du texte sur le Caracazo, l’argent cesse pendant quelques jours d’avoir sa fonction habituelle de médiation et régulation des échanges.
Dans le cas des émeutes urbaines présentées dans la seconde partie de l’ouvrage – sur lesquelles les analyses qui suivent vont se focaliser – la brèche ouverte dans le carcan de la domination ordinaire a souvent une dimension festive. À Bogotá, la foule, induite en erreur par les informations erronées diffusées par la radio, célèbre la chute du gouvernement conservateur avec force victuailles et alcool après la mise à sac de la ville. À Córdoba, une fois le centre-ville occupé par les manifestants, l’intervention imminente de l’armée incite à la construction de barricades plutôt qu’aux célébrations. À Caracas et à Santiago del Estero par contre, la liesse est partie intégrante des émeutes. Dans la première ville, les manifestants entonnent fréquemment le début de l’hymne national en défonçant les portes des magasins et les habitants des classes populaires organisent des rassemblements festifs avec des biens de consommation qui leur étaient jusque-là inaccessibles. Les barbecues sont accompagnés de champagne et de cognac, et animés par des sonos flambant neuves. Dans la deuxième, les spectateurs qui assistent aux assauts contre les maisons des personnalités politiques de la ville encouragent les assaillants par des applaudissements, des cris et des sifflements – l’un des titres de l’édition du lendemain du journal El Liberal est d’ailleurs « Les gens fêtent les vols dans les maisons des politiciens ». Cet aspect festif donne aux émeutes où les pillages tiennent une place importante – principalement le Bogotazo, Caracazo et Santiagueñazo – une dimension carnavalesque.
Émeutes et carnaval
Ce parallèle peut d’ailleurs être poussé plus loin : les émeutes citées, comme le carnaval, constituent une remise en cause temporaire des rapports sociaux de pouvoir qui structurent la société dans laquelle elles font irruption [26]. Cette remise en cause passe par une suspension en acte – dans les pillages – des normes sociojuridiques en vigueur qui constituent le versant normatif et juridique de l’état contemporain du rapport de forces entre groupes sociaux. On a vu plus haut, avec l’exemple des débats sur la loi contre le vol de bois à la Diète rhénane, ou celui de l’adoption du Black Act en Angleterre que l’édifice normatif n’est pas gravé dans le marbre et que le curseur peut se déplacer, en fonction de l’évolution des rapports de force, du côté d’une plus grande protection des classes possédantes, ou, à l’inverse, d’une plus grande prise en compte des droits des plus démunis. Les rapports sociaux de pouvoir ayant en même temps une dimension économique – c’est aussi la différence de situations économiques et, partant, de besoins qui sous-tend les rapports sociaux de pouvoir –, leur remise en cause est, elle aussi, économique : Fernando Coronil et Julie Skurski décrivent en détail comment une organisation informelle de la redistribution se fait jour, qui s’efforce de respecter des principes de justice : les personnes âgées et les femmes avec de jeunes enfants se font « livrer à domicile » et les stocks de pâtes trouvés dans la fabrique Ronco sont chargés dans les camions de l’entreprise avant d’être distribués : « On s’est assuré que tout le monde reçoive son lot de pâtes », raconte fièrement un chauffeur.
La mise en cause des pouvoirs en place s’exprime aussi dans les destructions sélectives, le degré de « sélectivité » variant cependant selon les cas. À Bogotá, la foule des protestataires traîne la dépouille de l’assassin de Gaitán jusqu’au palais présidentiel où ils essaient de « l’attacher aux portes du palais et de l’y crucifier », vengeance et « acte symbolique qui désignait le gouvernement conservateur comme coupable ». Un peloton de la garde présidentielle sort et fait feu, tuant plusieurs personnes et entraînant le repli de la foule, qui s’attaque ensuite au parlement dont elle détruit les bureaux et brûle les documents, avant de tenter à nouveau de prendre le palais, peine perdue. La deuxième étape du soulèvement, avec la mise à sac de la ville, ne sera elle plus du tout sélective. Au Chili, la contestation, d’abord centrée sur la hausse des tarifs des transports publics se transforme en revendication généralisée et en rejet des autorités. Les cibles des attaques se transforment de même, passant des véhicules de transport public aux forces de l’ordre et aux sièges des pouvoirs publics et privés : le commissariat et la mairie à Valparaiso, les tribunaux, le Parlement et le palais présidentiel, ainsi que le siège du journal El Mercurio à Santiago. Les statues des héros nationaux sont aussi l’objet d’attaques. À Córdoba, il n’y aura pas, contrairement aux autres émeutes, de pillages et les destructions se cantonnent à des cibles symboliques : Xerox et Citröen, ainsi que le club des élèves officiers, « représentants du gouvernement » militaire et de « son supposé allié, l’impérialisme étranger ». À Caracas, les pillages de magasins s’accompagnent d’incendies de postes de police et de bureaux d’Action démocratique, le parti alors au pouvoir, ainsi que de l’encerclement du siège de Fedecámaras, « siège des plus grandes associations professionnelles du pays et symbole du monde des affaires avantagé par la politique du gouvernement ». À Santiago del Estero, les cibles choisies sont aussi hautement symboliques et témoignent du rejet du pouvoir en place. Dans ce cas, le pouvoir est aussi, comme dans le carnaval, tourné en dérision : durant le pillage de la demeure de l’ancien gouverneur, Carlos Juárez, certains enfilent les robes de luxe de sa femme et se pavanent sous les applaudissements, d’autres exhibent en riant les sous-vêtements des élus… Lors de la Révolte des barques (Brésil, 1959) [27], les usagers de la ligne de transport maritime reliant Niterói à Rio de Janeiro, ulcérés par l’accumulation des problèmes de transport détruisent l’embarcadère avant de s’attaquer à la résidence des Carreteiro, les propriétaires de la compagnie de transport, qu’ils incendient à son tour, après l’avoir pillé. Là aussi, une sorte de carnaval improvisé tourne en dérision les puissants :
Les hommes s’étaient emparés de vêtements de luxe des femmes Carreteiro et avaient improvisé un carnaval inhabituel où l’on voyait des pièces de lingerie fine revêtir des hommes corpulents, des manteaux de vison recouvrir le corps des mutins, des ombrelles délicates orner le défilé de mode qui s’était organisé, avec même des maillots et bonnets de bain. Le carnaval se poursuivit un certain temps autour des flammes et fut largement commenté [28].
Comme dans le carnaval, la contestation du pouvoir en place lors des émeutes est temporaire, suivie d’un rappel à l’ordre, par la violence – sauf dans le cas du Santiagueñazo. Malgré leur brièveté, ces épisodes sont perçus a posteriori comme des tournants – sauf, là encore pour le Santiagueñazo. Le Bogotazo marque le début du basculement de la Colombie dans la violence. Les émeutes chiliennes révèlent les fractures de la société chilienne et sont perçues comme les signes avant-coureurs des évolutions des années 1960 et 1970. Le Cordobazo entraîne la démission du gouverneur Carlos José Caballero et affaiblit le gouvernement d’Onganía qui devra démissionner un an plus tard. Le Caracazo a été présenté par Hugo Chávez et les officiers du Mouvement révolutionnaire bolivarien comme l’événement fondateur de leur lutte pour transformer le système politique élitiste, d’abord par une tentative de coup d’État (1992), puis par les urnes (1999). À Santiago del Estero, à l’inverse, l’estallido ne semble pas avoir eu d’effets politiques tangibles puisque l’ancien gouverneur Carlos Juárez, qui avait déjà réalisé trois mandats (1948-1952, 1973-1976, 1983-1987) et dont la maison avait été pillée et incendiée, a été réélu aux élections suivantes (1995-1998 et 1999-2002). En ce sens, et cela rejoint ce qui avait été noté plus haut sur la manière de tourner le pouvoir en dérision, c’est sans doute, parmi les cas présentés dans ce livre, la révolte qui s’apparente le plus au carnaval : une suspension des normes habituelles a lieu pendant une période brève – deux jours dans le cas du Santiagueñazo –, laissant le champ libre à la transgression et à la contestation des rapports de pouvoir et donc, des puissants ; la parenthèse se referme ensuite et la vie reprend alors son cours habituel avec les normes et les rapports de pouvoir qui la caractérise.
Durant le Moyen Âge et jusqu’au début de l’ère moderne existaient, dans les sociétés européennes, des espaces-temps institutionnalisés de transgression temporaire caractérisés par une suspension des normes et un renversement des rapports sociaux de pouvoir. L’exemple le plus connu est bien sûr le carnaval [29]. Mais l’historien Carlo Ginzburg évoque aussi les pillages rituels des propriétés des évêques, cardinaux et papes au moment de leur mort, ou encore les pillages du palais du cardinal élu pape, à l’occasion de son accession à la suma potesta [30]. Ces pillages, très fréquents à partir du 5e siècle au moins, étaient tacitement reconnus par l’Église et l’État comme un droit et donc tolérés, ils participaient aussi de rites de passage en lien avec la mort, réelle ou symbolique, des évêques, des papes ou des cardinaux. Dans de telles circonstances les autorités, qui s’attendent à des débordements, les anticipent même par une série de précautions, comme de déménager les prisonniers, pour éviter que la foule ne les libère lors des émeutes [31]. Après les événements, les autorités ne prononcent pas de condamnations.
De même, à Santiago del Estero, aucune condamnation n’a été prononcée et il n’y a pas eu de recherche des coupables et de procès. Si la police a arrêté 144 personnes le 16 et le 17 décembre, elles ont été très rapidement libérées. Il ne semble pas y avoir eu non plus d’actes de vengeance par la suite, quand bien même certains participants aux pillages étaient connus des propriétaires pillés. Ce parallèle supplémentaire avec le carnaval et les pillages rituels invite à considérer une autre dimension importante des émeutes évoquées, autour de la question de leur légitimité. Si les pillages rituels des biens de l’Église ne sont pas punis par les autorités, c’est parce que, bon gré mal gré, elles accordent à ces pratiques extraordinaires de contestation des pouvoirs et redistribution des richesses une forme de légitimité.
L’enjeu de la légitimité
Sur ce point, la différence principale entre le carnaval ou les pillages rituels, d’une part, et les émeutes décrites dans cet ouvrage, d’autre part, tient à comment ils se déroulent. Dans le premier cas, les espaces-temps de transgression sont institutionnalisés et partant, plus ou moins clairement délimités : le carnaval se produit durant une durée déterminée, à des intervalles eux aussi déterminés, les pillages rituels se produisent lors d’occasions exceptionnelles et comprises comme telles par les pilleurs et les autorités. Ces renversements temporaires des rapports de pouvoir participent de la régulation sociale et constituent des moments de respiration sociale pour les groupes subalternes, à la fin desquels tout rentre en principe dans l’ordre. Dans cette perspective, il n’est pas étonnant que le caudillo Carlos Juárez ait été à nouveau élu une fois refermée la parenthèse du Santiagueñazo.
Dans le deuxième cas, c’est l’accumulation des injustices et des frustrations sociales, associée, comme décrit plus haut, à un catalyseur, qui provoque un basculement du registre de l’ordinaire au registre de l’extraordinaire et de la transgression, qui, du fait des circonstances, s’affirme comme légitime. Les acteurs et actrices mobilisées dans les cinq émeutes de la seconde partie de l’ouvrage considèrent tous que le contexte rend leurs mobilisations légitimes, que celles-ci prennent la forme de manifestations ordonnées ou d’assauts et de pillages. Ils ne revendiquent pas explicitement un « droit de résistance [32] », mais ils l’exercent en actes. À Bogotá, la nouvelle de l’assassinat de Gaitán est suivie d’appels répétés à l’insurrection : « Aux armes ! ». Quincailleries, magasins vendant des armes de chasses, entrepôts et stations-service sont pillés avant l’assaut du Parlement. Au Chili, à Córdoba, Caracas et Santiago del Estero, la résistance mobilise d’abord des répertoires d’action courants comme la grève, la manifestation et le blocage de rues. À Valparaiso (Chili), les étudiants se couchent sur la chaussée pour empêcher le passage des bus ; à Caracas, ils occupent le terminal de bus de Nuevo Circo avant de bloquer plusieurs grands axes de la capitale. À Caracas et Santiago del Estero, comme d’ailleurs à Niterói (Brésil), voire à Bogotá, la foule mobilisée semble s’octroyer aussi un « droit de pillage » découlant des circonstances, comme si le franchissement de certaines limites morales par les autorités rendait légitimes des actes habituellement répréhensibles. À Santiago del Estero et Niterói, il s’agit clairement de pillages ciblés, s’attaquant directement aux « coupables », aux personnes jugées responsables des préjudices subis, membres du gouvernement de l’État et élus à Santiago del Estero, propriétaires de l’entreprise de transport maritime à Niterói. Une inscription sur un mur de Niterói explicite l’accusation : « Ici gît la fortune du Groupe Carreteiro, amassée par le sacrifice du peuple ! ». À Caracas, si les pillages touchent aussi certaines usines, comme la fabrique de pâtes évoquée plus haut, ils touchent tout particulièrement les magasins devenus durant les semaines précédentes des points de friction et d’affrontement du fait des problèmes rencontrés par les familles pour s’approvisionner. La découverte dans l’arrière-boutique de stocks mis de côté pour être vendus après la hausse des prix redouble l’ardeur des pillages. Parmi les slogans peints sur les murs ou proclamés, plusieurs explicitent la légitimité de la révolte et des pillages en en déclarant les motifs : « Le peuple est en colère », « Ils se sont moqués de nous », « Stop à la tromperie », « Le peuple a parlé » ou « Le peuple a faim ». D’ailleurs, durant la première phase de l’émeute, la légitimité des pillages est non seulement affirmée par ses acteurs et actrices, elle est aussi reconnue par de nombreux observateurs :
Au début, la faim rendait les pillages compréhensibles, et même légitimes. Un consensus partagé par de nombreux secteurs acceptait l’appropriation populaire de nourriture, la considérant juste. La crainte d’une pénurie de denrées alimentaires s’étant accentuée de semaine en semaine, beaucoup commençaient à s’inquiéter des menaces que le marché faisait peser sur la survie. Les femmes en particulier étaient convaincues que, en vertu du droit à l’alimentation, le vol de nourriture n’entrait pas dans la même catégorie morale que celui d’autres marchandises.
Mais, par la suite, alors que les pilleurs ont commencé à emporter des biens autres que les produits de première nécessité, comme du matériel audio ou même des meubles, et à s’attaquer à différents types de propriétés, la peur s’est progressivement installée au sein des classes supérieures et moyennes et les « vols » et le « vandalisme » se sont progressivement substitués aux « pillages populaires » dans la bouche des observateurs – la légitimité passant alors, pour certains observateurs, du côté des pillages à celui de la répression…
Dans plusieurs cas, les mesures prises – ou non prises – par les autorités témoignent d’une reconnaissance du fait qu’il y avait bien, à la racine des soulèvements, des revendications légitimes. À Niterói par exemple, le lendemain de la révolte, le gouvernement décide du passage de l’entreprise de transport maritime dans le giron de l’État. À Santiago del Estero, aucune condamnation n’est prononcée. Dans le port chilien de Valparaiso, lieu où la révolte a commencé, le 27 mars, des négociations aboutissent à l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs, plus modérés. À Santiago, où le soulèvement a été plus tardif, mais plus violent, après la mort d’une étudiante dans la nuit du 1er avril, une commission comprenant des représentants syndicaux et étudiants se forme le 5 avril pour discuter de la hausse tarifaire, et le 7 avril, l’augmentation est suspendue en attendant le résultat des travaux d’une nouvelle commission. À Caracas, comme d’ailleurs au Chili, les autorités associent répression et mesures pour désactiver la crise. Le président Carlos Pérez s’exprime finalement à la télévision le 28 février. Il annonce une suspension des garanties constitutionnelles et la mise en place d’un couvre-feu, tout en interprétant les émeutes comme une révolte des pauvres face aux injustices sociales, dont il fait porter la responsabilité aux gouvernements précédents ; il décrète aussi « une hausse générale des salaires et un gel des licenciements de quatre mois, deux mesures auxquelles le monde des affaires s’était jusque-là opposé ». À Bogotá et Córdoba enfin, les objectifs visés par les révoltés sont trop radicaux – prise du palais de Nariño et départ du gouvernement du président Mariano Ospina Pérez jugé responsable de la mort de Gaitán dans un cas, fin du gouvernement Onganía et de la dictature dans l’autre – pour que leur légitimité puisse faire l’objet d’une quelconque reconnaissance par les pouvoirs en place. En Colombie, le président réussit, après d’habiles manœuvres politiques, à se maintenir au pouvoir et forme avec les libéraux un cabinet d’Union nationale. L’émeute est écrasée dans le sang. À Córdoba, les quartiers occupés sont repris par l’armée et les arrestations se multiplient, sans aucune concession du gouvernement provincial ou fédéral. Dans ces deux cas, les autorités choisissent de « passer en force », sans considération aucune pour les revendications des révoltés : en Colombie, ce passage en force met fin aux espoirs d’une transformation par la voie constitutionnelle, comme le proposait Gaitán, et marque le début de la période de « La Violencia » ; en Argentine, à l’inverse, les pouvoirs en place sont profondément ébranlés par la mobilisation, qui provoque d’abord la démission du gouverneur de la province, puis celui du gouvernement d’Onganía, un an plus tard.
Comme cela est devenu clair au fil de ces analyses comparatives, il serait vain de prétendre trouver un modèle unique permettant de rendre compte des logiques des émeutes urbaines et, au-delà, des révoltes présentées dans cet ouvrage. On peut par contre repérer des continuums. Sur un axe qui va de l’organisation et de l’encadrement institutionnel d’un côté à la mobilisation spontanée et incontrôlée de l’autre, on retrouve ainsi à une extrémité le Cordobazo, puis les événements de mars-avril 1957 au Chili, le Santiagueñazo, le Caracazo et enfin, à l’autre extrémité, le Bogotazo. Le concept de continuum suggère que les émeutes occupant les positions les plus éloignées sur l’axe considéré ne se ressemblent pas sur ce point précis, mais qu’elles ressemblent aux émeutes occupant des positions adjacentes, qui elles-mêmes ressemblent aux émeutes classées de manière adjacente, et ainsi de suite, d’une extrémité à l’autre du continuum. Cela revient à dire que si les révoltes sont à chaque fois singulières, elles ont aussi, pour reprendre l’expression de Ludwig Wittgenstein, des « ressemblances de famille [33] ». Toutes les émeutes, tous les membres de la famille n’ont pas exactement les mêmes caractéristiques, la même couleur d’yeux, la même taille… mais chaque élément partage avec un ou plusieurs des autres éléments de la famille, des caractéristiques communes : j’ai la même couleur d’yeux que ma sœur, la même corpulence que mon frère et que mon père… De fait, dans les analyses qui précédent, les différentes émeutes urbaines ont été souvent classées en sous-groupes en fonction des points communs partagés, sous-groupes distingués d’autres sous-groupes où ces points communs n’étaient pas ou peu présents (répression ou non, etc.). Ces différents points communs, partagés par un nombre plus ou moins important de membres de la famille, ces « ressemblances de famille » donc, forment la base d’une grammaire provisoire et fragmentaire de la révolte, dont j’ai essayé de décrire les linéaments dans ces pages introductives. Les onze textes qui suivent permettront d’aller au-delà de cette présentation, trop brève et partielle, et d’entrer dans le détail d’événements qui sont autant de figures de la révolte.
*
Notes
[1] Les introductions (en italiques) des textes sont de Dial.
[2] Gérard Noiriel, Immigration, Antisémitisme et Racisme en France (19e-20e siècle) : Discours publics, Humiliations privées, Paris, Fayard, 2007, p. 690.
[3] George F. E. Rudé, The Crowd in History : A Study of Popular Disturbances in France and England, 1730-1848, Northampton, Interlink Publishing Group, [1964] 2005, p. 7-10.
[4] E. P. Thompson, « The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century », dans Customs in Common, New York, New Press, 1991, p. 185. Le texte est aussi disponible en français : E. P. Thompson, « L’économie morale de la foule dans l’Angleterre du 18e siècle », dans Florence Gauthier et Guy-Robert Ikni, La Guerre du blé au 18e siècle : La Critique populaire contre le libéralisme économique au 18e siècle, Montreuil, La Passion, 1988, p. 31-92.
[5] Arturo Álape, El Bogotazo : Memorias del olvido, 10e éd., Bogotá, Planeta Colombiana, 1987.
[6] Sur ce point, voir Silvia Marina Arrom et Servando Ortoll (dir.), Riots in the Cities : Popular Politics and the Urban Poor in Latin America, 1765-1910, Wilmington, Scholarly Resources, 1996.
[7] Pour une analyse détaillée de ces révoltes dans le cas du Mexique, voir Friedrich Katz (dir.), Riot, Rebellion, and Revolution : Rural Social Conflict in Mexico, Princeton, Princeton University Press, 1988.
[8] Grands domaines agropastoraux.
[9] Voir à ce sujet la mise en perspective du Cordobazo par rapport aux autres « -azos » de l’histoire argentine proposée dans le court texte d’Ezequiel Adamovsky.
[10] Benjamin Péret, La Commune des Palmarès : Que fut le quilombo des Palmarès, traduit par Batista Carminda et Robert Ponge, Paris, Syllepse, 1999. Voir aussi Michael Löwy, « La Commune des Palmares : Benjamin Péret et la révolte des esclaves du Brésil colonial », Tumultes, n° 27, décembre 2006, p. 53-68.
[11] Pour plus de détails, voir Richard Price (dir.), Maroon Societies : Rebel Slave Communities in the Americas, The Johns Hopkins University Press, [1973] 1996.
[12] La notion de répertoire d’action collective est une notion proposée par Charles Tilly pour mettre en évidence que selon les époques et les lieux, les formes que prend l’action collective varient. Voir Charles Tilly, La France conteste : De 1600 à nos jours, traduit par Éric Diacon, Paris, Fayard, 1986, p. 541-542 ; Charles Tilly, « Les origines du répertoire d’action collective contemporaine en France et en Grande-Bretagne », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 4, 1984, p. 89-108.
[13] La majeure partie des révoltes urbaines décrites dans la seconde partie de l’ouvrage sont non institutionnelles en un double sens. Elles se produisent d’abord en dehors des canaux institutionnalisés de participation, comme le vote ou la manifestation autorisée ; elles mobilisent aussi un nombre important de personnes en dehors des structures des organisations politiques et syndicales fréquemment dépassées par les événements.
[14] Cité par Yves Déloye, École et Citoyenneté : L’Individualisme républicain de Jules Ferry à Vichy, controverses, Paris, Presses de la FNSP, 1994, p. 134-135.
[15] Sur ce point, voir Michel Offerlé, « Périmètres du politique et co-production de la radicalité à la fin du 19e siècle », dans Annie Collovald et Brigitte Gaïti (dir.), La Démocratie aux extrêmes : Sur la radicalisation politique, Paris, La Dispute, 2006, p. 253-254.
[16] Michel Crozier, Samuel P. Huntington et Joji Watanuki, The Crisis of Democracy : Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, New York, New York University Press, 1975, p. 114-115.
[17] Les citations sans note pour préciser la source sont toutes issues des textes de l’ouvrage.
[18] Pour les émeutes d’août 2011 en Angleterre, Owen Jones relève l’utilisation récurrente de l’adjectif « feral » (sauvage) et l’assimilation des émeutiers à des « rats ». Voir Owen Jones, « L’ordre moral britannique contre la “racaille” », Le Monde diplomatique, septembre 2011.
[19] Raymond Aron, « Démocratie et totalitarisme », dans Penser la liberté, Penser la démocratie, Paris, Gallimard, 2005, p. 1231.
[20] Claude Lefort, Essais sur le politique : 19e-20e siècles, Paris, Le Seuil, [1986] 2001, p. 8.
[21] « Démocratie et totalitarisme », op. cit., p. 1238.
[22] Karl Marx, « Débats sur la loi relative au vol de bois (octobre-novembre 1842) », dans Daniel Bensaïd, Les Dépossédés : Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des pauvres, textes traduits par Pierre Lascoumes, Hartwig Zander et Jean-François Poirier, Paris, La Fabrique, 2007, p. 93.
[23] Voir Edward P. Thompson, Whigs and Hunters : The Origin of the Black Act, Harmondsworth, Penguin, [1975] 1977.
[24] Cité par E. P. Thompson, ibid., p. 162 (je traduis).
[25] Pour une analyse plus approfondie de ces « moments », voir Martin Breaugh, L’Expérience plébéienne : Une histoire discontinue de la liberté politique, Paris, Payot, 2007.
[26] Roberto DaMatta, dans l’analyse qu’il propose de la société brésilienne au prisme du carnaval établit de même « une relation entre les rites fondés sur l’inversion sociale, comme le Carnaval, et l’action populaire “spontanée” et extraordinaire (c’est-à-dire inattendue et non planifiée) des masses », Carnavals, bandits et héros : Ambiguïtés de la société brésilienne, Paris, Le Seuil, 1983, p. 53.
[27] Edson de Oliveira Nunes, A revolta das barcas, Rio de Janeiro, Garamond, 2000.
[28] Edson de Oliveira Nunes, A multidão violenta, Rio de Janeiro, IUPERJ, 1975. Cité dans Carnavals, bandits et héros, op. cit., p. 54.
[29] Sur ce point, voir Mikhaïl Bakhtine, L’Œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 2001.
[30] Carlo Ginzburg, « Pillages rituels au Moyen Âge et au début des Temps modernes », dans Rencontres internationales de Genève (éd.), Normes et déviances : Textes des conférences et des entretiens organisés par les 31e Rencontres internationales de Genève (1987), Neuchâtel, La Baconnière, 1988, p. 312-325.
[31] Lors du Bogotazo aussi, la foule libère les prisonniers qui se joignent alors aux pillages.
[32] Jean-Claude Zancarini (dir.), Le Droit de résistance : 12e-20e siècle, Lyon, ENS, 1999.
[33] Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, 4e éd. révisée, Chichester, Wiley-Blackwell, [1953] 2009, p. 36.
*
Image en bandeau via Venezuelanalysis.com









