
La politique agraire et la lente révolution encore à venir
À propos de : Habib Ayeb et Ray Bush, Food Insecurity and Revolution in the Middle East and North Africa: Agrarian Questions in Egypt and Tunisia, Londres, Anthem Press, 2019, 250 p.
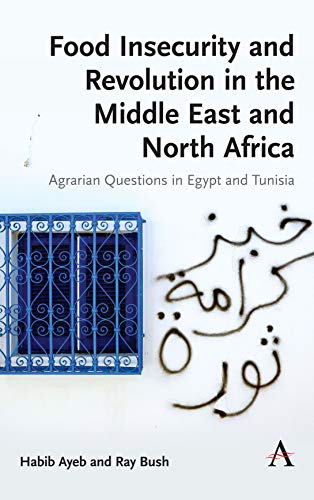
2010 et 2011 ont été initialement annoncées comme le nouvel âge du militantisme urbain, alors que des foules en ébullition envahissaient les places et les boulevards des villes égyptiennes et tunisiennes. En s’appuyant sur d’importantes vagues de grèves dans les centres manufacturiers et extractifs, le langage utilisé pour décrire ces événements soulignait le caractère urbain de masse, avec des expressions telles que le « droit à la ville » et les noms d’importantes places de la ville comme des abréviations des révoltes elles-mêmes, comme la place Tahrir du Caire. Les premières histoires de ces années se sont naturellement, sinon aveuglément, focalisées sur le syndicalisme industriel et les mobilisations urbaines de masse.
Dans les périphéries du système-monde, les questions agraires sont essentielles pour le développement et la démocratie. Cela est tout autant vrai pour des pays arabes tels que l’Égypte ou la Tunisie, éprouvés par la pauvreté dans leur arrière-pays rural, que pour partout ailleurs au sein de l’ancien Tiers-Monde. Les travailleurs culturels ont mis du temps à revenir à ces cas de rébellions nationales et à réécrire de telles histoires pour mettre au centre l’expérience de la dislocation agraire. Ce faisant, ils ont dépeint un portrait plus complet des luttes de classes menées par les victimes de l’implacable accumulation primitive qui a à la fois précédé et succédé aux événements très médiatisés de 2010-2011.
Presque 10 ans après les soulèvements de 2011, nous avons désormais un excellent livre synthétique de Habib Ayeb et Ray Bush, des militants chercheurs de longue date sur les questions agraires d’Afrique (du nord) et de leurs liens avec la souveraineté alimentaire, l’égalité sociale et l’écologie.
Leur livre, Food Insecurity and Revolution in the Middle East and North Africa, couvre la longue durée de la vie rurale et paysanne de ces deux pays, à partir des changements proto-dirigistes précoloniaux et de l’accumulation par le haut, de la dislocation et de destruction coloniale, puis du bref intérim de la modernisation postcoloniale et du soutien étatique à la reproduction sociale. Les auteurs nous amènent, enfin, jusqu’à la période néolibérale contemporaine, marquée par le renversement des programmes nationaux mis en œuvre pour protéger les petits exploitants ruraux. Les auteurs décrivent ensuite les dynamiques de la résistance paysanne à ces renversements, tout comme les horizons anti-systémiques possibles pour les petits exploitants tout comme pour les pays : la lente révolution encore à venir.
La panoplie théorique du livre puise dans les théories de l’échange et de l’accumulation inégaux à l’échelle mondiale de Samir Amin, dans les flux de valeur sud-nord (ou, plus formellement, périphérie-centre) ainsi que dans la notion de souveraineté alimentaire telle qu’elle s’est manifestée dans la théorie et la pratique locale dans le Sud, formant une partie du mouvement international pour la souveraineté alimentaire et la dignité rurale.
D’un point de vue analytique, la principale nouveauté du livre est de s’intéresser à la question agraire, ou aux conséquences sociales et politiques du changement agraire, ainsi qu’au rôle des campagnes dans la réalisation de la libération sociale, à travers le temps et l’espace, et de relire l’histoire agraire tunisienne et égyptienne dans un cadre intégré et comparatif.
Une telle juxtaposition fait ressortir la forte différence entre les transformations économiques sous le président Gamal Abdel Nasser en Égypte et le Premier ministre Habib Bourguiba en Tunisie. Le premier a renforcé les moyens d’existence des fellahin en tant que classe sociale, via des réformes agraires et en mettant en place d’importants filets de sécurité sociaux. Bourguiba et Ahmed Ben Salah (alors ministre à la Planification), au contraire, ne se sont pas opposés à la distribution de terres existante – limitant dramatiquement l’étendue de l’incorporation rurale. (Cela a été le cas au moins jusqu’en 1969, où Ben Salah a tenté d’étendre le programme de coopératives à tout le pays et a été destitué, dans le mécontentement des petits et gros agriculteurs s’inscrivant dans un vaste mouvement social). Les petits exploitants ont souvent vécu le programme d’alternance comme une forme d’accumulation primitive, puisqu’ils se retrouvaient « dépossédés de leurs terres et de leurs moyens de production pour devenir des travailleurs agricoles faiblement payés. » (p. 106)
L’analyse d’Ayeb et de Bush du déchirement de la vie rurale pour qu’elle entre dans le modèle technocratique de Ben Salah montre à quel point l’État restait distant de la vie paysanne quotidienne. Ici, une description plus fouillée des alternatives rurales qui ont brièvement germé sur le sol de l’idéologie développementaliste aurait pu être bénéfique : par exemple, le nationalisme économique ambiguë du leader du parti Neo-Destour Salah ben Youssef, l’appel à un schème de redistribution plus radical sur le mode « la terre à ceux qui la travaillent » de la part de celui qui a été brièvement ministre de l’Agriculture, Mustapha Filali, ainsi que les appels similaires de l’UGTT, tous finalement abandonnés en faveur du programme de modernisation/coopérative du Neo-Destour, financé par la banque mondiale.
Ayeb et Bush décrivent clairement et efficacement le lent passage du capitalisme agraire, avec quelques caractéristiques pro-paysannes, au retrait brutal de l’État à la fin des années 1980 et au début des années 1990 sous la pression des principales institutions financières internationales en Tunisie. Ils détaillent la conversion agressive des terres agricoles du pays en enclaves pour les exportations de fruits et de légumes vers l’Europe, réalisé à travers d’importants investissements domestiques et étrangers dans l’irrigation, nourrie par les eaux souterraines – drainant les ressources naturelles limitées de la Tunisie afin d’assurer l’accès des Européens aux produits tout au long de l’année.
En soulignant le rapport entre la production et l’exportation tunisienne et le modèle économique encouragé par les institutions financières internationales, les auteurs inscrivent les questions du développement du sud – que produire, comment nourrir la population avec de la nourriture de qualité et comment assurer des moyens d’existence décents dans les villes et les campagnes – dans le même cadre que les questions de consommation et de commerce agricole du nord.
Les discours des institutions financières internationales sur la sécurité alimentaire insistent sur le commerce et les échanges internationaux de biens agricoles, ce qui signifie que les pays pauvres financent l’importation d’aliments de base en exportant des marchandises hors-saison (fruits rouges, tomates) ou uniquement du sud (dattes, grenades), à des consommateurs du nord global. De tels cadres reposent sur le concept d’avantage comparatif pour donner une certaine légitimité théorique à des termes commerciaux déterminés par l’impérialisme, qui désavantagent la comptabilité nationale tunisienne et égyptienne et empêchent ces deux pays de se nourrir eux-mêmes.
L’idée selon laquelle les Nord-Africains devraient compter sur des céréales de l’Union européenne ou des États-Unis « produits plus efficacement » ne tient pas compte des contributions financières et écologiques massives que ces pays du centre fournissent à leurs producteurs. En réalité, l’avantage comparatif, qui peut expliquer certains flux commerciaux nord-nord, ne s’applique pas ici puisque les produits du sud ne peuvent pas pousser dans le nord.
Le réseau de subventions aux producteurs, dans le nord global, et les programmes des institutions financières internationales, ont engendré une situation déroutante : la Tunisie et l’Égypte, avec des populations largement rurales, importent perpétuellement plus de nourriture en termes de valeur qu’ils n’en exportent. De tels flux de valeur asymétriques constituent la carte de visite d’un rapport de dépendance classique. Ici, une référence aux travaux de Prabhat et Utsa Patnaik sur le blocage des prix des produits agricoles qui ne peuvent pas pousser en Europe aurait renforcé leurs arguments, compte tenu, surtout, du détail ethnographico-géographique minutieux avec lequel ils décrivent l’irrigation de l’agriculture d’exportation[1]. Mais le rapport de base est bien souligné.
Ayeb et Bush sont plus pertinents lorsqu’ils situent la désarticulation économique et sociale interne ainsi que le sous-développement à travers l’espace, comme prélude à leur discussion sur les luttes sociales pré-soulèvement qui ont balayé chacun des deux pays. Les chercheurs sur la Tunisie trouveront une actualisation bienvenue aux cartographies existantes de la dépossession. On voit ainsi comme la Tunisie « inutile » du Sud, le centre-Est et le Nord-Ouest reste socialement, mais non pas économiquement exclue. Beaucoup de valeur agricole découle des champs irrigués de Sidi Bouzid, mais peu de valeur y arrive en retour.
Des extraits du même type sur l’Égypte montrent la brutalité de la contre-révolution néolibérale d’État, soutenue par les États-Unis, dans les campagnes, broyant la législation qui protégeait encore les fellahin égyptiens. Les auteurs montrent les bords tranchants qui accompagnent les ternes contraintes des forces du marché néolibéral lorsqu’ils décrivent la violence des fonctionnaires et des propriétaires terriens pour protéger la propriété et le profit.
On trouve, mise à part la description de la lutte des classes, une autre contribution essentielle dans leur contextualisation de Mohammed Bouazizi, qui était, en fait, un paysan dépossédé incapable de faire face aux emprunts contractés par sa famille pour travailler leur petite parcelle de terre. Avant son immolation et sa mort, qui allaient faire de lui un symbole des soulèvements, Bouazizi a participé à un mouvement plus large à l’été 2010, impliquant « des dizaines de petits fermiers et paysans » (p. 70) vivant le même type de menaces vis-à-vis de leurs moyens de subsistance. Leur dépossession a été le prélude à la semi-prolétarianisation, à l’humiliation et, finalement, l’étincelle qui a mis le feu à la dictature politique.
Réécrire cette histoire participe du démantèlement d’une architecture idéologique qui continue de reléguer les questions agraires aux oubliettes et aux coins sombres, plutôt que s’en faire un élément central de l’histoire de l’accumulation du capital en Tunisie, en Égypte et dans le monde.
Le lecteur aurait bénéficié de fils liant la théorie du développement-sous-développement du centre-périphérie aux questions agraires, pas uniquement à celles de l’alimentation, de l’écologie et de la terre, mais aussi au travail. Il aurait été utile de lier plus intimement des histoires comme celle de Bouazizi aux théories structurales d’Amin sur lesquelles les auteurs s’appuient. Dans le cas présent, la contingence permanente fait baisser les salaires et donc la taille du marché interne dans la périphérie et est une caractéristique de l’accumulation désarticulée, ou de l’accumulation dans laquelle les secteurs internes n’interagissent pas avantageusement l’un avec l’autre. Le travail local vulnérable, à son tour, réduit le pouvoir du travail à une échelle globale en maintenant une armée de réserve du travail permanente dans la périphérie.
Le rôle d’une périphérie désarticulée pour l’accumulation à l’échelle mondiale constitue également le lien manquant nous permettant de comprendre la centralité des guerres impérialistes dans la région. C’est le sujet du deuxième chapitre du livre, qui détaille le rapport entre les guerres régionales et les questions agraires ainsi que le rôle joué par les programmes d’ajustement structurel régionaux. La guerre en continu réduit le pouvoir du travail au niveau régional, empêche les plans pro-paysans ou pro-travailleurs au niveau national et maintient ou aggrave la désarticulation interne. Cela garantit le maintien d’un statu quo régional, y compris le système de pétrodollars qui étaye les économies capitalistes centrales des États-Unis et de l’Europe tout comme l’économie financiarisée des États du Golfe.
Ayeb et Bush nous livrent ainsi une analyse d’histoires spécifiques tout comme des possibilités d’émancipation. Ils diagnostiquent le problème, puis prescrivent des solutions. Leur conclusion est une proposition – présente depuis longtemps dans la pensée développementale d’Afrique du Nord – pour un projet national basé sur l’empowerment des travailleurs ruraux et petits exploitants, valorisant les savoirs et pratiques paysans, redistribuant la terre, protégeant la nature, promouvant une véritable souveraineté alimentaire et achevant une « déconnexion partielle » de l’impérialisme (p. 162). Ce livre est une contribution intellectuelle précieuse à une mission politique urgente.
Traduit de l’anglais par Sophie Coudray et Selim Nadi
Publication initiale : https://merip.org/2019/12/agrarian-politics-and-the-slow-revolution-yet-to-come/
Illustration : Récolte céréalière © Dennis Jarvis/Flickr.
Note
[1]Utsa Patnaik et Prabhat Patnaik, A Theory of Imperialism (Columbia University Press, 2016).








