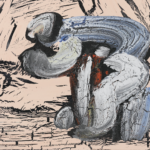Qui sont les traders ? Entretien avec Olivier Godechot
Entretien avec Olivier Godechot, sociologue de la finance à l’École Normale Supérieure, auteur de Working Richs (2007) et Les Traders (2001). Dans cette grande interview, il revient sur la crise actuelle du point de vue des salles de marchés. Il montre aussi comment le cas extrême que constitue la situation des salariés de la finance est un terrain fécond pour alimenter la réflexion théorique sur la nature de la firme capitaliste, l’hétérogénéité du salariat, les droits de propriété et les formes de l’exploitation.
Séverine Chauvel et Cédric Durand : Quelle est ton appréciation de la crise financière actuelle ? La perçois-tu comme une grande crise ?
L’analyse de cette crise nécessite de la prudence et une mise en perspective. Lors du krach de 1987, on a entendu : « c’est la fin du capitalisme, pire que la crise de 1929, une récession terrible …», alors qu’en 1988 le taux de croissance était élevé ! En 1991, avec la guerre du Golfe, on assiste à une nouvelle crise avec des pertes pour des banques, comme la Caisse d’Epargne, et la décennie suivante était extrêmement florissante. En 2001, c’est la fin du cycle sur les actions et la crise du monde internet, et 2002 marque le début d’un nouveau cycle boursier haussier qui dure jusqu’en 2007. Pour l’instant la crise actuelle ne traduit pas le franchissement d’un nouveau seuil qualitatif par rapport aux crises précédentes, c’est pourquoi j’éviterai de crier au loup avec les autres et d’affirmer que c’est la fin du capitalisme financier.
Ceci dit, l’effet de la crise actuelle peut être différent, dans la mesure où celle-ci a généré une crise de confiance entre les banques. Elles se demandent si elles peuvent continuer à mener des transactions les unes avec les autres, sachant qu’il y a un risque de crédit important, ce qui entraîne un « crédit crunch » qui a des effets aussi sur l’ensemble de l’économie. De plus, il est aussi possible que cette crise marque la fin durable de la super-profitabilité des activités financières : d’un point de vue économique, c’est étonnant. Les banques dégagent 25 % de ROEi pendant 20 ans alors que les autres secteurs dégagent 10% ! Et effectivement, si les conditions de la profitabilité des entreprises du secteur financier retombaient au niveau des entreprises de la manufacture, cela marquerait la fin d’une période.
Pour autant, la capacité de rebond du capitalisme financier est extrêmement forte. A chaque crise, ce n’est pas l’ensemble du système financier qui est en crise, mais seulement un segment. Ainsi, la crise asiatique de 1997 a produit des licenciements dans le domaine des produits des pays émergents, mais la même année, même si le marché action a été assez mouvementé, la plupart des banques positionnées sur les produits actions et les dérivés d’actions ont fait des profits considérables. De même, aujourd’hui, la spéculation reste très forte et les opportunités de faire des plus-values sur les matières premières ou les commodities restent très importantes. De ce point de vue, la nature de la crise actuelle ne semble pas différente des précédentes. Elle signale par contre que la vie économique est de plus en plus rythmée par des alternances de crises financières et de booms aux effets multiples mais qui ne conduisent pas pour autant à des crises généralisées.
S. C. & C. D. : Frédéric Lordon dans ses propositions pointe le caractère déstabilisateur car asymétrique des rémunérations des traders. Quelle est à tes yeux la responsabilité de ces mécanismes dans la crise actuelle ? Que penses-tu de sa proposition qui vise « à rétablir la symétrie d’incitation en rendant la rémunération des traders pleinement algébrique – c’est-à-dire susceptible de valeurs négatives ! Les pertes issues de la matérialisation des risques antérieurement contractés ne doivent plus seulement annuler les bonus mais les rendre négatifs. Les traders auraient ainsi à rembourser sur leurs gains passés les pertes présentes et dans les mêmes proportions » ?
Sur ce point, il y a beaucoup de discussions. A la suite de la crise des subprimes, des malversations sur le marché action en été 2007 et de l’affaire Kerviel, on s’est mis à chercher des coupables et on s’est tourné vers le système de rémunération des traders. On a alors redécouvert que le versement des bonus était un mécanisme très asymétrique dans la mesure où il consiste à privatiser les gains et à mutualiser les pertes au niveau de la banque. En cas de pertes importantes, les salariés sont loin d’en payer le coût ; au pire, ils peuvent être licenciés, ce qui représente un coût pour eux en termes de carrière et de perte de rémunération équivalent à quelques mois de salaires, alors que les sommes perdues peuvent se chiffrer en centaines d’années de salaires. En revanche, quand l’activité est gagnante, ils en privatisent une part conséquente. L’effet pervers de ce type de structure de rémunération est qu’il conduit les opérateurs financiers à chercher exclusivement les gains, sans chercher à éviter les pertes. C’est une incitation à prendre des risques, en particulier si l’activité se situe dans la zone de perte. En effet, voyant que son bonus va être nul, l’opérateur est incité à prendre un maximum de risque pour tenter de retourner dans la zone de profit plutôt que d’essayer de limiter les dégâts.
Ce type de phénomène est non seulement un problème pour chaque établissement financier mais aussi pour le système financier dans son ensemble, car il contribue à accroître son instabilité. C’est pourquoi des économistes célèbre, comme Raghuram Rajan de Chicago ou le président de la Banque Centrale anglaise, ont critiqué ce système de rémunération.
Pour ma part, je considère cette analyse partielle et partiale. Le raisonnement qui la sous-tend considère que le système de rémunérations par bonus dans la finance correspond à la même logique que la mise en place de primes pour inciter des ouvriers d’usine à être plus productifs. Or cela ne s’est pas du tout passé comme ça. Le système de rémunération par bonus a été imposé par les opérateurs des salles de marché financiers car ils avaient un pouvoir de négociation particulièrement fort. Ils pouvaient – on reviendra là dessus – transporter l’activité financière avec eux. Et ils l’ont fait dans un contexte historique marqué par le démantèlement des partnerships au milieu des années 1980 : au moment même où le marché du travail s’activait, les incitations à long terme s’écroulaient avec la fin de l’espoir de devenir « partner ».
La proposition de Frédéric Lordon suggère d’associer aux bonus des malus symétriques, c’est à dire d’engager la responsabilité des traders dans les mêmes proportions, que ce soient des pertes ou des profits. Ce n’est pas la seule sur le tapis. Une proposition plus classique consiste à diviser le bonus en plusieurs versements et à conditionner les versements ultérieurs à la pérennité de la profitabilité du portefeuille. Mais dans les deux cas, ces propositions visent à réguler les incitations en ignorant ce qui se passe sur le marché du travail de la finance et le pouvoir qu’y acquièrent les salariés. C’est sur ce point que j’émets des réserves. Car sauf si des régulations administratives sont mises en place – ce qui semble difficile en matière de rémunérations – dès que l’activité financière redeviendra florissante, les traders vont exiger et obtenir des clauses contractuelles qui rapprocheront les rémunérations des bonus actuels en changeant d’employeur car ils ont le rapport de force pour l’imposer.
De mon point de vue, le problème de l’incitation à la prise de risque est plus profond. Aujourd’hui, la rémunération est calculée en prélevant les bonus sur la valeur créée. Cela nécessite un certain nombre d’opérations de comptabilité analytique pour calculer non seulement les différents coûts mais aussi ce qui correspond à la rémunération du risque. En effet, la valeur créée à partir de laquelle se calculent les bonus correspond au résultat net moins la rémunération « normale de l’actionnaire », qui comprend une rémunération de la prise de risque. Or toutes ces opérations de comptabilité qui interviennent pour calculer l’enveloppe de bonus des différents services deviennent des enjeux politiques au sein de l’entreprise. Au lieu d’être une observation fidèle de la réalité, la comptabilité devient un système de partage qui, par définition, est le produit d’un équilibre entre les parties. Ici, on a affaire à une activité financière compliquée, qui repose sur un certain nombre d’hypothèses. En particulier, il faut évaluer un certain nombre d’actifs au prix du marché alors même que ces prix n’existent pas ; on utilise donc pour faire ces évaluations des modèles et, selon les hypothèses, les évaluations peuvent varier très fortement. Puisque les parties sont intéressées à ces évaluations – les bonus vont en dépendre-, les hypothèses retenues font l’objet d’une négociation entre les parties. Là, le front office va faire pression en faveur d’hypothèses pas trop conservatrices, car cela va limiter les montants qu’il faut provisionner pour le risque, donc augmenter la valeur créée et in fine augmenter leurs bonus.
Dans ce type de situation où la structure comptable devient un enjeu de négociation, le front office a trois avantages. Premièrement, l’origine sociale élevée, le fort capital scolaire, les rémunérations importantes créent une forme de noblesse statutaire, un pouvoir symbolique de ces salariés qui les place en position de force pour imposer des décisions. Deuxièmement, en raison de la structure très asymétrique des rémunérations, la plupart des contrôleurs de risques du middle ou du back office ont à surveiller des groupes de salariés dont ils voudraient faire partie. Pour ces contrôleurs qui aspirent à passer de l’autre côté de la barrière magique pour travailler au front office, mieux vaut ne pas se fâcher avec leurs employeurs potentiels. Troisièmement, le budget de bonus des activités de support lui-même est un pourcentage du budget du front office ; cela signifie donc que le bonus de ceux qui contrôlent sera plus élevé si les évaluations retenues ne sont pas trop conservatrices. Tout ça ne signifie pas que les modèles de contrôle de risque, c’est n’importe quoi. Mais il y a quand même un biais structurel en faveur des hypothèses du front office qui sont des hypothèses court-termistes, et peut-être qu’il y a là une part de l’explication de la crise des subprimes.
Je reste donc assez réservé face aux propositions focalisées uniquement sur les rémunérations individuelles et qui ne prennent pas en compte les enjeux liés à l’organisation du travail.
S. C. & C. D. : L’affaire Jérôme Kerviel a eu un écho considérable. Comment analyses-tu cet écho médiatique ? Plus fondamentalement, considères-tu que cette affaire est un syndrome des limites de la gestion néolibérale du travail (pression à la performance individuelle ; cassure des cadres collectifs du travail ; croissance de la part variable de la rémunération) ?
L’affaire Kerviel n’est pas un cas isolé et doit être replacée dans une histoire financière. On peut prendre l’exemple de l’affaire qui s’est produite à Calyon pendant l’été 2007 et qui a provoqué des pertes de 200 millions d’euros. Et il y a de nombreux autres cas de ce qu’on appelle rogue trader que l’on pourrait traduire par « trader pourri ». L’illégalité a toujours existé autour de l’activité financière. Avant 1987, dans le milieu très corporatiste des agents de change, la légalité était moins bien définie que maintenant. Une des tendances consistait à faire passer ses ordres personnels en s’appuyant sur ceux du client, ce qu’on appelle aujourd’hui le front running, une autre à pratiquer des délits d’initiés, ou encore les brown enveloppes, les bakchichs entre les courtiers et les banques. A partir de la fin des années 1980, avec la reprise en main du monde des agents de change par les bourses, on assiste au réveil des rémunérations dans la banque, et au passage d’un système de corruption externe à un autre, interne. Un système de régulation s’est néanmoins mis en place, qui engendre une course-poursuite entre les régulations et des salariés sommés de maximiser leur profit. S’ils sont dans l’impossibilité de le faire, ces salariés peuvent préférer maximiser l’indicateur de profit plutôt que le profit lui-même, y compris par des moyens illégaux.
Je ne pense pas qu’un « rogue trader » soit comparable avec un ouvrier qui craque et se jette du 5ème étage chez Peugeot. Loin d’un trader fou comme il a été présenté, Jérôme Kerviel n’a pas craqué : il était pris dans une spirale de contournement. Son cas est plutôt à rapprocher de celui de cette femme, employée par le Rectorat de Paris, qui s’est versée pendant 25 ans un salaire de professeur du Supérieur. Pour moi, ce sont des petites illégalités ordinaires, des bidouilles, mais la finance a ceci de spécifique que leurs effets peuvent être extraordinaires.
S. C. & C. D. : Tu écris à propos de Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux : « Tout se passe comme si cette société de bourse abritait au tournant du deuxième millénaire 500 PDG de moyennes entreprises », ou encore : «À BNP arbitrage, une petite filiale de la BNP, on se rapproche des salaires versés dans les comités exécutifs des plus grandes entreprises avec 560 000 euros en 2000 ». Qui sont ces working richs ? Quelle est l’historique de la formation de cette strate sociale ? Quel est son poids social et économique ?
Le terme working richs a été utilisé comme titre en 1997/98 par le magazine « Forbes » lors de la sortie de son classement annuel des plus hautes rémunérations. Il s’agissait de montrer que parmi les plus grandes fortunes, il y avait de plus en plus de gens qui devaient leur richesse à une forme d’activité de travail, en particulier les PDG. Ce ne sont pas uniquement les héritiers des grandes fortunes du début du 20ème siècle. L’expression, qui s’oppose au thème des working poors, met l’accent sur le fait qu’en travaillant, on peut accéder à des formes de richesses étonnantes. C’est précisément l’objet de mon livre. Comment l’insertion dans une activité économique permet l’accès soudain et brutal à la richesse ? D’un point de vue libéral, si les choses s’échangent équivalent contre équivalent comment comprendre que l’on obtienne par l’échange une très grande fortune ? Il faut bien que cet échange soit à un endroit déséquilibré. C’est la question que pose Marx au début du Capital : comment se fait-il qu’il y ait un cycle A-M-A’ où A’ est plus important que A ? Sa réponse c’est qu’on échange le travail au coût de sa reproduction et non au coût de sa force de production. J’ai voulu explorer cette question en me centrant sur une micro analyse des relations de travail parmi les salariés de la finance.
Aujourd’hui, la logique des relations de travail des activités financières se répand petit à petit dans les activités classiques sous plusieurs formes. Tout d’abord, les trésoriers d’entreprise sont en contact permanent avec les opérateurs financiers, ne serait-ce que pour gérer leurs opérations liées au change. Ensuite, il y a des rapprochements en termes de rémunérations pour un certain nombre d’activités en voie de « marchéisation », en particulier dans le secteur des matières premières. C’est le cas à Gaz de France ou chez Total où on voit apparaître des salles de trading, une division du travail et aussi des rémunérations très très élevées qui se rapprochent de celles que l’on connaît dans la finance. Mais cette logique se répand bien au-delà avec un management de la création de valeur qui conduit à individualiser et à parcelliser la responsabilité de la création de valeur et à distribuer des primes en conséquence. On est en train de passer d’une firme holistique au service des actionnaires à une firme en proie à des appropriations rivales de salariés de niveau supérieur, qui peuvent se prévaloir de leur participation à la création de la valeur.
S. C. & C. D. : « La finance, avant-garde du prolétariat ? », c’est le titre provocateur d’un article dans lequel tu montres que les salariés de la finance occupent un positionnement de classe ambigu1. Un positionnement qui découle en particulier des mécanismes spécifiques d’allocation de la « valeur crée » par l’industrie financière à travers les bonus. Qu’est-ce que cette « valeur » crée ? En quoi, selon toi, la construction comptable dans le monde de la finance de cette « valeur créée comme un bien vacant ouvert aux appropriations rivales des salariés et des actionnaires » ouvre-t-elle une brèche pour l’ensemble des salariés ?
On peut regarder les choses selon différentes perspectives. Les actionnaires qui considèrent les salariés comme un tout indifférencié se demandent pourquoi ceux-ci obtiennent des salaires aussi importants au vue de leurs compétences et réussissent à imposer un partage de la valeur qui leur soit si défavorable, par rapport à ce qui se passe dans des secteurs relativement proches. Ces actionnaires, comme d’ailleurs certains salariés de la finance, peuvent lire le partage comme le produit d’un rapport de force entre deux groupes : les salariés et les actionnaires. Et il est vrai que, quand un chef de salle va négocier bec et ongle la formule de l’enveloppe de bonus pour lui et son équipe (qui peut comprendre plusieurs centaines de personnes), l’opération prend la forme d’un partage sur la valeur ajoutée extrêmement classique. Ce n’est pas le fait d’un leader de la CGT, mais cela se présente de la même façon. Dans cette logique, les actionnaires peuvent se dire que les salariés arrivent à leur soustraire une part de leur profit et qu’il y a bien une forme de vol de l’actionnaire.
Mais, du point de vue des salariés de la finance, il en va autrement. Un chef de salle qui quitte l’entreprise et emporte avec lui une grande partie de l’activité la vole aux actionnaires. Mais on peut aussi considérer que cette activité est le produit du travail de générations successives de salariés et qu’il n’y a pas de raison pour qu’elle aille aux actionnaires ! Cette activité représente en fait un bien vacant que différents groupes essayent de s’approprier. Même si je suis amené parfois à parler d’expropriation des actionnaires, ce n’est pas forcément ça : c’est simplement un bien qui n’a pas forcément à être approprié par les actionnaires, et qui est approprié autrement.
Après, on peut se demander si cela a des conséquences pour le salariat en général. Et la réponse est non : ce n’est jamais que de l’appropriation individuelle, faite par un nombre extrêmement réduit d’individus et selon des modalités extrêmement inégalitaires. Par rapport à la perspective marxiste, l’apport d’une telle perspective est de montrer que l’exploitation ne suit pas nécessairement les lignes des droits de propriété définis dans le code civil. L’exploitation peut aussi découler des droits de propriété implicites que j’essaie de décrire dans l’entreprise financière.
La forte hétérogénéité que tu observes parmi les salariés de la finance empêche-t-elle de faire un lien entre ton concept de « salariés supérieurs » et celui d’ « aristocratie ouvrière » développé par Engels et Lénine ? Dans les deux cas, la situation privilégiée de certains salariés découle, d’une part, de la possibilité des firmes de générer des surprofits en raison d’un régime faiblement concurrentiel, et d’autre part, d’une stratégie des firmes consistant à s’attacher des salariés dont les compétences/qualifications sont rares.
Mon analyse reste une analyse de mécanismes, plutôt qu’une analyse de groupes, même si j’identifie des groupes par commodité, pour caractériser les acteurs. Les mécanismes que je mets au jour dans le monde de la finance ne lui sont pas spécifiques. La finance est un observatoire de ce qui se passe sur le marché du travail avec des effets grossissants étant donné l’importance des rémunérations : ce qui se passe ailleurs de manière un peu tamisée et floue apparaît ici très nettement. Par exemple, pendant la révolution industrielle, les entrepreneurs français allaient débaucher les contremaîtres anglais, non parce qu’ils étaient très habiles de leur main, mais parce qu’ils apportaient la technologie anglaise en France. En cela, ils transportaient avec eux bien plus que leur propre personne. Ainsi, par le biais du marché du travail, les entreprises s’appropriaient une part des actifs de leurs concurrents anglais. On retrouve ce type de mécanisme ailleurs, en particuliers dans les secteurs immatériels où les droits de propriété formels sont mal fixés. Dans ces conditions, les salariés peuvent devenir porteurs des actifs, alors que, dans les firmes classiques, les actifs restent bien attachés à l’actionnaire.
Mais là où je nuancerais la comparaison, c’est qu’il y a d’autres raisons qui peuvent conduire à des rémunérations élevées. Une des analyses actuelles du cadrisme par Dumenil et Levy consiste à dire que la bourgeoisie s’attache des salariés pour qu’ils lui soient fidèles et qu’ils soient efficaces pour donner des ordres aux ouvriers. C’est une forme de rétrocession de plus-value : on va rémunérer des cadres pour que l’autorité fonctionne bien. Ce n’est pas le mécanisme que j’étudie.
Je ne m’intéresse pas non plus à la question de la rémunération des compétences ni à celle qui l’accompagne de la productivité du capital humain : mon analyse ne porte pas sur le fait que les gens dont le travail est peu qualifié soient moins bien payés que ceux très diplômés. Elle consiste au contraire à montrer que les écarts de rémunération que l’on constate dans la finance ne peuvent se réduire à ces phénomènes-là. Toutes les formes d’inégalité qui consistent à donner à une frange du salariat un certain nombre de privilèges ne sont pas réductibles à une analyse en termes de compétences.
S. C. & C. D. : Tes travaux se distinguent de ceux des Pinçon Charlot qui mettent l’accent sur la bourgeoisie en tant que classe mobilisée. Cependant, as-tu identifié des modalités par lesquelles les working richs (salariés supérieurs) s’affirment en tant que strate/classe « pour soi » ? Ont-ils des formes d’organisation et de mobilisation collective spécifiques ?
Je ne suis pas un spécialiste des travaux des Pinçons-Charlot mais j’ai lu certains de leurs ouvrages. La vie dans les beaux quartiers, cela permet d’étudier la sociabilité de la bourgeoisie traditionnelle. En revanche, là où j’aurai quelques réserves, c’est qu’il existe un risque de considérer que cette sociologie de la bourgeoisie traditionnelle est le tout de la sociologie de la bourgeoisie ou de la sociologie des riches. Ainsi, dans leur ouvrage dans la collection « repères »2, ils expliquent que la bourgeoisie est une classe mobilisée en donnant comme exemple les manières de conserver l’entre-soi dans les quartiers, dans les rallyes. Or il me semble qu’il en faut davantage pour parler de classe mobilisée. Pour comprendre comment la bourgeoisie défend ses intérêts qui sont avant tout des intérêts économiques, il faut faire une sociologie de la vie des affaires.
Pour en revenir aux personnes du monde la finance sur lesquelles je travaille, peut-on dire qu’elles font partie de la bourgeoisie au sens classique ou au sens des Pinçon-Charlot ? Je ne sais pas. On a affaire à des jeunes gens qui, pour la plupart, sont issus de milieux cadre supérieur, petits entrepreneurs ou enseignants. Mais ce ne sont pas des héritiers, ou c’est extrêmement rare. Ainsi ce sont des gens qui ont tout à apprendre de la gestion de l’argent. Quand on s’intéresse à cette question, on se rend compte qu’ils font face à un grand embarras. Par exemple, ils ne savent pas comment éduquer leurs enfants dans leur relation par rapport à l’argent. Alors que dans les grandes familles de la grande bourgeoisie, le fait d’avoir plein d’agent n’empêche pas d’éduquer ses enfants. Pour les working richs, le problème, c’est qu’ils n’ont pas de modèle éducatif.
Ces salariés de la finance ne constituent pas une classe mobilisée au sens classique de la sociologie politique. Leur horizon de mobilisation éventuel, ce sera l’entreprise financière ou le marché du travail mais pas le champ du pouvoir, pour parler à la manière de Bourdieu. Ce sont des gens qui vont faire valoir leurs droits au sein de l’entreprise ou en passant d’une entreprise à une autre. Mais pas uniquement de manière individuelle, puisque la manière efficace de gagner du pouvoir c’est d’être agrégé en petits groupes. Le chef d’équipe, c’est à la fois la personne qui a l’autorité sur ses subordonnées, mais c’est aussi le délégué de ses subordonnés. C’est lui qui va négocier l’enveloppe de bonus pour lui et ses subordonnés, c’est lui, qui en passant d’une banque à une autre, fera venir une partie de ses subordonnés à sa suite. Il peut donc y avoir des phénomènes de délégation à petite échelle qui, par certains aspects, ressemblent à la délégation syndicale. Le rôle de ces chefs d’équipe peut être comparé à celui des tâcherons lors de la première révolution industrielle. Ce sont des entrepreneurs de main d’œuvre. Payés au titre de leur apport en main d’œuvre ils organisent la division du travail. En France, ils étaient vus comme d’horribles exploiteurs par le mouvement ouvrier et ont finalement été interdits. Mais Gordon et Reich ont montré que ce sont des personnages très ambivalents, car ils jouent aussi le rôle de délégués ouvriers pour défendre les intérêts de l’aristocratie ouvrière. D’ailleurs, le mouvement de taylorisation a servi à défaire cette forme d’organisation qui, par certains aspects, participait d’un rapport de force favorable aux ouvriers face aux capitalistes.
S. C. & C. D. : Existe-t-il à certains moments des convergences entre ces « salariés supérieurs » et les « autres salariés » ?
Ce sont des salariés. Même si le paradoxe, c’est que ce n’est pas en étant salariés qu’ils peuvent devenir riches, ils ont cependant accès à toutes les ressources du salariat. Notamment en cas de licenciements. En France, où le droit du travail est protecteur, où l’activité financière se fait essentiellement au sein de grandes banques et où les syndicats sont puissants, les traders licenciés n’ont pas hésité à solliciter les syndicats pour les défendre. Ce fut par exemple le cas à la Société Générale en 1998 lorsque, à la suite de la crise asiatique, il y a eu une vague de licenciement dans les activités liées aux produits de taux et aux marchés émergents. La CGT s’est alors saisie de cette situation pour éviter qu’il y ait une coupure entre les salariés de la banque classique ou des centraux et les salariés des marchés.
Également en 1998, un autre exemple, un peu particulier, fait suite à l’informatisation de deux marchés de produits dérivés, le MATIF et le MONEP, qui jusque-là fonctionnaient à la criée. Beaucoup d’emplois ont été supprimés, au point d’ailleurs qu’il n’y a aujourd’hui plus aucune activité à la bourse de Paris. Sur ces marchés, il y avait deux types de métiers : des salariés qui exécutaient des ordres pour les banques et les sociétés de bourse et puis, des négociateurs individuels de parquet. Ce sont des « locals », entrepreneurs individuels présents pour fournir de la liquidité, c’est-à-dire prendre en permanence des ordres à l’achat et à la vente. Ces travailleurs dont le gagne-pain disparaissait ont fait des procès au Matif et au Monep pour disparition de métier ; ils ont fait une grève pendant laquelle ils sont montés sur le toit de la bourse, et y ont hissé leurs vestes en drapeau… et ces vestes étaient rouges !
On peut remonter encore dans le temps. Jusque dans les années 1980, les agents de change avaient de nombreux commis, qui étaient des salariés. C’était un marché du travail fermé, car les agents de change n’avaient pas le droit de les débaucher d’une charge à l’autre. Les salaires fixes n’étaient pas très élevés, mais il y avait des primes assez importantes et une nébuleuse de choses pas forcément légales qui faisaient qu’ils étaient quand même très bien rémunérés, du moins par rapport aux autres secteurs. Les commis, issus de la petite bourgeoisie, étaient des personnages hauts en couleur, un peu des « Titis parisiens » pour prendre une image d’Epinal, avec pas mal de gouaille. Ils étaient très syndiqués. Succédant à la CFTC, la CFDT était alors un syndicat très actif au palais Brognard. Ils ont ainsi fait des grèves majeures : en 1974 et en 1979, ils ont bloqué la bourse pendant un mois ! Au sein de la CFDT, il y avait alors une tendance libertaire et autogestionnaire très puissante. J’ai rencontré quelques acteurs de cette époque qui avancent un discours du type : « C’est pas parce qu’on est anarchiste qu’on veut être pauvre ! La richesse pour tout le monde ! » C’est un autre monde, une autre époque, mais cela montre qu’il peut y avoir des connexions avec les mobilisations sociales, même si cela reste périphérique.
En Angleterre, où les syndicats du secteur sont moins puissants et où Banques de réseau et Banques d’affaires sont beaucoup plus séparées, le repositionnement du côté des salariés se fait davantage via des procès que par le biais de l’action syndicale ou de la mobilisation collective. Des femmes ont obtenu 1 millions de £ pour discrimination sexuelle ; certains ont obtenu la levée des bonus différés ou des clauses d’exclusivité car ce n’est pas compatible avec le droit du travail. Mais là encore, les salariés de la finance n’hésitent pas à utiliser les dispositions du droit du travail pour défendre leurs intérêts.
S. C. & C. D. : Pourtant le sort de ces salariés de la finance est immensément loin du sort des autres salariés. Existe t-il des manifestations de cette divergence d’intérêt ? Puisque les bonus sont pris sur la valeur crée, ne tirent t-ils pas avantage de la faiblesse des salaires ?
Ces points sont visibles quand se pose la question de la distribution au sein de la banque entre les salariés du middle, du front et du back office. D’un point de vue systémique, les salariés du front office essaient d’avoir les bonus les plus élevés, quitte à faire baisser ceux des autres. Mais, dans les faits, les choses se passent assez différemment. Vu les relations de travail et de proximité qui s’établissent, ce sont souvent des membres du front office qui feront pression sur la banque pour obtenir des niveaux de bonus plus élevés pour ceux et celles qui se trouvent dans leur périphérie immédiate. Par contre, la banque fera pression dans l’autre sens en expliquant qu’il n’y a aucune raison de verser 50 000 euros de bonus à un bac + 2 dont le travail consiste à enregistrer d’un point de vue comptable des transactions. Mais les personnes du front office, qui voient que le salarié du bureau d’à-côté est payé 2000 euros par mois plus 3000 euros de primes, alors qu’eux sont payés 5000 euros par mois plus 100 000 euros de primes, trouvent le contraste choquant et vont faire pression pour que ça monte. Il y a donc un effet de porosité des bonus que les banques essaient de freiner.
Les salariés de la banlieue immédiate de ceux du front office entretiennent avec eux des relations très ambivalentes. D’un côté, ils voient les tâches quotidiennes des gens du front office et se rendent compte qu’elles n’ont pas grand chose d’extraordinaire et que, d’une certaine manière, c’est aussi grâce à leur travail qu’ils font beaucoup de profit. Par exemple, un certain nombre de tâches du middle office, comme corriger des erreurs, évitent de perdre beaucoup d’argent mais ne vont pas être rémunérées, alors que les transactions gagnantes le sont. Ce type de situation génère des relations de frustration et d’envie. Mais en même temps, ces salariés de la banlieue de la finance savent bien aussi qu’étant donné leurs compétences et leurs diplômes, ils ont une très grande chance d’être dans cette périphérie. Leurs rémunérations sont très largement supérieures à celles qu’ont des gens de même niveau de qualification et qui travaillent dans la banque de réseau ou dans d’autres départements de la banque.
Le régime d’exception propre aux activités liées à la finance produit en permanence un jeu symbolique dans la banque pour définir dans quel monde on est. Ainsi les comptables qui travaillent dans le domaine des marchés ne veulent pas être comparées aux comptables de toute la banque, mais seulement aux comptables des marchés. Pour tous les métiers, l’enjeu est de faire partie d’un ensemble qui s’appelle « marchés financiers » car cela permet d’être rattaché à l’entité qui privatise une partie des profits vers les salariés à travers les bonus.
Au delà de la proximité individuelle que j’ai signalée, il a aussi un aspect systémique que l’on peut voir de la manière suivante. Dans la Banque, il y a une catégorisation extrêmement prégnante, c’est l’opposition centre de coûts / centre de profits. Les centres de profits sont ceux qui sont censés faire gagner de l’argent : à eux la noblesse et les bonus ! Et puis, il y a ceux qui ne sont que du coût. Or, autant d’un point de vue gestionnaire, on sait bien inciter ceux qui font du profit à faire du profit avec des mécanismes d’indexation, autant l’incitation du côté des centres de coût est quelque chose de complexe : dans le prêt-à-penser libéral, il n’y a pas de bonne méthode. Par exemple, on peut inciter à réduire les budgets, mais les budgets sont liés à l’activité ; la réduction qui a lieu peut n’avoir rien à voir avec l’action du responsable mais simplement avec une réduction de l’activité. Ou au contraire, si on a mis en place une incitation à la réduction des budgets lorsque l’activité explose, cela peut compromettre le développement de la firme. Bref, on a du mal à calibrer un système d’incitation, si bien qu’on paye ces personnes avec un salaire fixe en se disant : « bon, c’est des gens coûteux, eux, le profit ils n’y peuvent rien ». Par contre, on leur donne quand même l’injonction permanente de rationaliser leur activité, de réduire les coûts, mais sans qu’ils aient la possibilité de privatiser une part du bénéfice de ces réductions de coûts. Pourtant, au final, ce processus de division du travail de réduction des coûts va impacter le profit du front office. Un exemple que j’aime bien se passe en Angleterre. Le type concerné est à cheval entre une activité de profit et une activité de coût. Il est en charge d’une activité d’exécution bas de gamme dans la banque où il doit servir les clients en exécutant des transactions. On lui a dit : « tu coûtes trop cher, il faut que tu fasses du cost-cutting », en clair virer des gens. Il s’exécute. A la fin de l’année, on lui dit : « tu avais 100 personnes dans ton service l’an dernier, mais cette année tu n’en as plus que 80, donc on réduit ton budget de bonus de 20% ». On ne le rémunère pas pour le travail de rationalisation et de licenciements, au contraire, cela affecte négativement son revenu. Par contre, les coûts se sont réduits ; en conséquence, même si le revenu de la firme est resté constant, les profits se sont accrus, ce qui va impacter positivement le bonus du front office.
S. C. & C. D. : Tu mobilises la notion de droits de propriété implicites sur les actifs de l’entreprise et découlant de l’organisation du travail. En quoi ce développement théorique peut-il contribuer à un renouveau des approches socio-économiques de l’exploitation ? Et de quelles manières ces analyses peuvent-elles être mobilisées dans une perspective de transformation sociale ?
Les droits de propriété implicites permettent de rendre compte d’une double dimension de la division du travail. D’une part, la division du travail a une dimension smithienne d’efficacité économique qui correspond aux gains liés à la spécialisation. C’est une dimension relativement forte en finance ; ainsi, plutôt qu’une seule personne fasse le pricing, les logiciels, appelle les clients, etc., toutes ces tâches sont partitionnées en différents métiers. D’autre part, cette spécialisation a son corollaire : elle donne à chacun des salariés un accès à des actifs de l’entreprise plus ou moins stables et volumineux. Petit à petit, les salariés s’approprient ces actifs. En effet, l’accès aux actifs, dès lors qu’il s’accompagne d’une forme d’exclusivité, de durabilité, tend à ressembler à un droit de propriété. Ainsi, dans une salle de marché, quelqu’un qui est chargé du portefeuille Italie a l’exclusivité de la gestion de ce portefeuille et va se défendre contre l’incursion d’autres opérateurs. Au bout du compte, cela ressemble à un monopole local qui est assez similaire à un droit de propriété.
Regarder les choses de cette manière permet de lever un certain nombre de difficultés. D’abord, faire de la firme seulement la propriété de ses actionnaires n’est pas satisfaisant. Le droit civil le dit d’ailleurs : les actionnaires sont propriétaires de leurs actions, un point c’est tout. Introduire des droits de propriété là où le droit n’en voit pas permet de comprendre à la fois le système de légitimation interne du partage du profit et le rapport de force qu’arrivent à établir certains salariés. Les salariés qui obtiennent des droits de propriété sur des actifs importants et aussi faciles à déplacer sont ceux qui vont pouvoir imposer un rapport de force qui leur soit favorable, car ce sont ceux qui peuvent soustraire à l’entreprise des actifs cruciaux.
Une telle analyse peut enrichir notre vision des relations d’exploitation en faisant le pont entre l’analyse de l’exploitation à la manière de Marx et celle proposée par Boltanski et Chiappello. Pour Boltanski et Chiappello, l’exploitation est une inversion de la formule « le bonheur des grands fait le bonheur des petits » qui devient « le bonheur des grands fait le malheur des petits ». Dans la cité connexionniste, cela se décline sous la forme suivante : « le bonheur des mobiles fait le malheur des immobiles ». Le problème de l’exploitation correspond dans cette perspective au problème de la causalité du malheur et, ainsi posé, on peut penser a priori que cela n’a rien à voir avec la question des droits de propriété. Or, ce que je montre, c’est que la question de la mobilité ne se pose jamais indépendamment de celle des droits de propriété : ceux qui arrivent à exploiter les autres, ce sont ceux qui arrivent à mouvoir avec eux d’autres choses, ceux qui portent et transportent l’activité. Ce sont des droits de propriétés, et la possibilité de déplacer ces droits de propriétés, qui permettent aux plus mobiles d’exploiter les plus immobiles.
Mes travaux se situent donc dans une perspective critique, mais ne sont pas directement mobilisables sur le plan programmatique. D’une certaine façon, les différentes parties peuvent s’en saisir pour défendre leurs intérêts : les actionnaires doivent casser le marché du travail et instaurer des clauses d’exclusivité pour empêcher des équipes de faire défection. Les traders doivent faire jouer à plein l’avantage que leur donne des droits de propriétés informels sur les actifs mobiles de l’entreprise et leur mobilité, pour soutirer aux actionnaires une part toujours plus importante des profits. Les syndicats et les salariés ordinaires doivent critiquer la division du travail et les écarts de revenus gigantesques qui en découle. Mais l’essentiel est peut-être ailleurs, mes travaux invitent les salariés à dénaturaliser le caractère inéluctable de ces partages. Le plus souvent, les salariés ont des moments critiques, mais qui restent ponctuels, et très vite le discours méritocratique revient au galop avec l’illusion que le marché du travail rémunère des compétences. Ce que j’essaie de faire pour ma part, c’est déconstruire cette illusion pour reconstruire un discours alternatif qui soit cohérent.
1 Godechot Olivier, 2006, «La finance, avant-garde du prolétariat ? Les salariés de la finance et la structure de classe », Carnets de bord, n°10, p. 55-66. http://olivier.godechot.free.fr/hopfichiers/FinanceAvant-gardeProletaria…
2 Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, Sociologie de la bourgeoisie La Découverte, coll. « Repères », Paris 2000.
i R.O.E est l’acronyme de Return On Equity, c’est un ratio qui mesure le taux de rentabilité des fonds investis par les actionnaires.
Nos contenus sont placés sous la licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 FR). Toute parution peut être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.