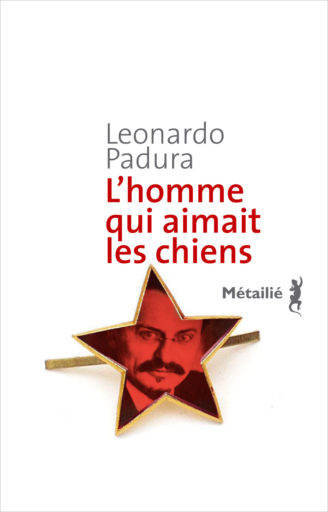
Un entretien avec Leonardo Padura au sujet de son livre L’Homme qui aimait les chiens, (Paris, Métailié, 2011).
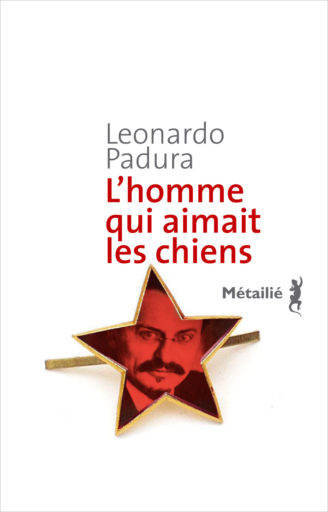
Né d’un père maçon et d’une mère catholique, ainsi qu’il se présente parfois, Padura jeune aimait les lettres et le beisbol. Diplômé de littérature hispano-américaine, il collaborera aux pages littéraires de la revue des Jeunesses communistes El Caimán Barbudo. S’il se résoudra vite à n’être jamais une épée à la batte ou au lancer, dans l’édition dominicale du quotidien Juventud Rebelde, on s’arrachera ses interviews des gloires mythiques du sport roi de l’île. Il y fera aussi des reportages au plus près des gens de son pays.
À la fin des années quatre-vingt, il entre à la prestigieuse Gaceta de Cuba, le périodique de l’Union des écrivains et artistes cubains, fondé par Nicolás Guillén. Ici, artistes ayant quitté le navire ou bien homosexualité, point de tabous. Surtout qu’en ces années, le vieux slogan de Fidel « Dans la Révolution, tout ; contre la Révolution, rien » se trouve frappé d’inanité. Avec 1989, la fin du soutien de l’URSS et son effondrement, c’est l’époque d’une dépression critique[1], et d’une immense désillusion. Dans L’Automne à Cuba[2], une furieuse envie démange Mario Conde : en toute justice, et totale iniquité, coller le crime sur lequel il enquête sur le dos d’un vieil économiste à la soviétique, ancien expert en planification désastreuse.
Le héros des romans policiers de Leonardo Padura n’avait pas de poil au menton quand les barbus providentiels entrèrent dans La Havane. Comme Leonardo, il a grandi nourri aux fruits de la révolution, accédant à l’Université. S’il n’ignore rien de ces bienfaits, s’il fait la part des choses, s’il sait de quel poids pèse sur la société l’embargo jamais relâché de Washington, parvenu à l’âge mûr, c’est l’heure de l’amertume au regard des horizons bouchés, des idéaux salis et des misères criantes ou muettes. Au moins le « père » du Conde a-t-il pour lui l’écriture. Padura, en 1995, a renoncé à son poste envié de rédacteur en chef à La Gaceta, pour se consacrer principalement, succès à l’étranger venant, à son œuvre romanesque. Elle avait débuté, croyions-nous, avec Passé parfait, en 1991. Mais voilà qu’on apprend que, depuis plus longtemps, un autre livre faisait son chemin, que Padura portera en lui deux décennies.

Photo Rena Effendi
Vingt ans pour la révision au fond la plus abyssale de toutes, pour qui n’avait jamais appréhendé le drame fondamental qui s’est joué le siècle dernier dans la révolution mondiale qu’au travers de Trotsky le traître et de Trotsky le renégat, deux manuels distribués par les « grands frères » russes aux jeunes Cubains de sa génération. Le terme de cette véritable descente aux enfers, ce sera L’Homme qui aimait les chiens. Ce roman, dont on ne soupçonne pas encore la portée, fait déjà un malheur, bientôt traduit jusqu’en Russie…
Et d’où cela nous vient-il ? Décidément, Cuba nous étonnera toujours.
Ph. B.
La preuve de leur existence réelle, et de leur présence à Cuba, vous la trouverez au début du film Les Survivants, réalisé en 1978 par Tomas Gutiérrez Alea, l’auteur de Fraise et chocolat. Un jour, en effet, le cinéaste tombe sur eux, qu’on voyait alors se promener dans La Havane avec leur maître (sans que nul ne sache qu’il s’agissait de l’assassin de Trotsky). Et Gutiérrez de se dire que ces lévriers, avec leur allure si aristocratique, iraient très bien dans son film, l’histoire d’une famille de la grande bourgeoisie ruinée par la révolution, et qui, un temps, continue à faire étalage des signes extérieurs de son ancienne fortune. Aussi aborde-t-il leur propriétaire, qui, sous le nom de Jaime López, dissimule son identité véritable, condition de son autorisation de séjourner à Cuba. Pour prêter ses chiens, Mercader a forcément dû demander la permission à quelqu’un. Et il se trouve qu’elle lui a été accordée. Ainsi les lévriers russes du roman ont bel et bien existé, et il est toujours possible de les voir, au cinéma.
Leurs courses sur la plage l’hiver sont tout aussi certaines : en cette saison, à Cuba, c’est le meilleur endroit pour donner de l’exercice aux chiens, sans danger pour personne, parce qu’alors aucun Cubain ne va à la plage. D’ailleurs, à cette époque, on disait que, pour y aller l’hiver, il n’y avait que les Russes – ils étaient quelques-uns – et les parfaits givrés.
Le personnage de Mercader reste un grand mystère. On connaît très peu de choses de sa vie privée, ce qui m’exposait à un grand risque mais me procurait aussi un avantage.
Dans l’unique livre plus ou moins crédible paru sur lui, écrit, ou plutôt dicté, par son frère Luis[3], il y a quelques pistes, au milieu d’une analyse très partiale. J’ai lu les quelques entretiens où il est question de lui, et j’ai pu parler avec des gens qui l’ont connu, y compris sans savoir qu’il s’agissait de Mercader. Son fils, Arturo, ou sa nièce, la fille de Luis auraient pu m’en dire plus sur sa personnalité ; aucun des deux n’a accepté de me recevoir, même vingt-cinq ans après sa mort. Je crois aujourd’hui que c’est peut-être mieux ainsi : une connaissance exhaustive de la réalité-réelle oblige l’écrivain à se conformer à ces données, qui ne sont pas forcément intéressantes pour son roman, et qui réduisent d’autant l’espace de l’imagination. La documentation m’a fourni le squelette ; la peau et les muscles sont de ma création. En même temps, tout ce que j’invente à son propos découle de ce que j’ai appris sur lui, et je pense que si certaines choses n’ont pas eu lieu, elles l’auraient très bien pu.
Ainsi, par exemple, on sait que Trotsky, le crâne ouvert sous le coup de piolet, s’est levé de son siège et s’est jeté sur son agresseur, le mordant à la main droite pour le désarmer. Cette main, on la voit bandée, sur les photos de Mercader après son arrestation. Des années plus tard, il efface la cicatrice en y appliquant une lame de couteau chauffée à blanc. Cela, je l’ai inventé. En même temps, ce qui est avéré, parce qu’il l’a raconté à beaucoup de gens, toute sa vie Mercader s’est souvenu du cri de Trotsky quand il l’a frappé. Dès lors tout porte à croire que la vue de ce stigmate faisait sans cesse résonner le cri de Trotsky dans sa tête d’assassin…
Sur Trotsky, l’ouvrage avec lequel j’ai le plus travaillé est la trilogie[5] d’Isaac Deutscher, cet impressionnant exercice de biographie et d’analyse politique et historique fort de 1 400 pages. Je crois que c’est le travail le plus intéressant concernant le personnage. Deutscher avait été trotskiste, il était juif, il a écrit cette œuvre entre les années 1950 et 1960, après avoir reçu l’autorisation de travailler sur les archives non encore ouvertes de Léon Trotsky, et à une époque où nombre de protagonistes, avant tout Natalia Sedova, étaient encore vivants. Cette œuvre aura été essentielle pour moi ; Deutscher connaît d’autant mieux cette histoire qu’il a aussi écrit une biographie de Staline[6].
J’ai lu, étudié et annoté beaucoup d’autres livres. Certains ont été de vraies révélations pour moi, contenant des informations généralement ignorées avant l’ouverture, dans les années quatre-vingt-dix, des archives de Moscou. Elles ont trait à la guerre civile espagnole, ainsi España traicionada (Espagne trahie)[7], qui compile les renseignements envoyés à Moscou par les agents du Komintern, ou En busca de Andreu Nin (À la recherche d’Andrès Nin)[8] de Jose Maria Zavala, ou encore la trilogie d’Angel Viñas[9] sur l’histoire de la République. Je me suis aussi intéressé aux derniers ouvrages sur Staline, où l’on commence à entrevoir sa face intime. Certains documents m’ont laissé une très forte impression, en particulier les procès-verbaux de l’enquête et les actes du procès de Mercader. Et puis il y a eu des conversations, nombreuses, avec des gens qui m’ont fait accéder à une connaissance plus complète d’une histoire depuis des années, et encore aujourd’hui, totalement ignorée des Cubains. Très important aussi : une série de films documentaires, réalisés dans les années quatre-vingt-dix, comme le magnifique Asaltar los cielos (L’Assaut des cieux)[10], des Espagnols Javier Rioyo et Jose Luis López Linares, un matériel incomparable pour connaître Ramon Mercader, son époque, le contexte.
De cette première visite me sont restées deux choses dans la rétine et une idée dans la tête. Je retiens toujours l’atmosphère d’abandon, de marginalisation qui y régnait. Je vois encore le bureau de Trotsky, sa table de travail, ses lunettes cassées dans la bagarre qui a suivi le coup de piolet. Et c’est peut-être là que m’est venue l’idée d’écrire ce roman : était-il nécessaire, pour assurer un avenir meilleur à l’humanité, son avenir socialiste, d’assassiner ce vieil homme, seul, presque sans partisans, qui avait dû se réfugier dans un lieu qui, en 1989 encore, apparaissait si éloigné du monde ? Cet assassinat, présenté comme une nécessité politique, n’était-il pas plutôt l’expression de la haine d’un homme malade et à l’esprit criminel ?
Ces quinze années, c’est ce qu’il m’a fallu pour être en capacité d’écrire, avec la connaissance historique et politique nécessaire. Avant ce moment de 2004 où j’ai commencé à réfléchir à comment écrire ce roman, tous les composants, littéraire, historique, politique, n’étaient pas encore parvenus à maturité. Par exemple, si, avant cela, je n’avais pas écrit les Mario Conde, et surtout fait l’expérience du roman historique avec La novela de mi vida (Le Palmier et l’Étoile)[11], si je n’avais pas lu tout ce que j’ai lu dans ces années-là, comme Vie et destin[12] de Vassili Grossman, les romans de Milan Kundera ou de Paul Auster, sincèrement, je n’aurais jamais pu écrire L’Homme qui aimait les chiens.
Et si, pendant ces années, les archives de Berlin et de Moscou n’avaient pas été ouvertes, si l’histoire du socialisme du XXe siècle n’avait pas été réécrite avec les informations terribles trouvées dans les archives du PCUS, du KGB, de la Stasi et du Komintern, sans cette connaissance preuve en main d’à quel point l’idéal socialiste a été manipulé et de cette désinformation dont nous avons été l’objet, je n’aurais pas pu écrire ce roman tel qu’il est. Ajoutons à cela l’expérience d’un Cubain qui vit les années de la désintégration de l’URSS, laquelle a provoqué ici la crise baptisée par euphémisme « Période spéciale en temps de paix », une période de pénurie absolue : nourriture, électricité, transports… même les cigarettes. Cette expérience nous a permis de comprendre, dans notre propre chair, à quoi nous étions arrivés dans le développement socialiste du pays : à une catastrophe dont le gouvernement tente aujourd’hui de sortir. La désillusion que nous avons vécue, la découverte de certaines réalités et les kilos que nous avons perdus en pédalant dans La Havane nous ont fait différents, nous ont donné un autre aperçu des choses, qui m’a été essentiel pour entrer dans mon roman.
J’ai exercé durant trente ans les deux métiers en parallèle. En certaines périodes, j’étais plus journaliste, en d’autres, plutôt romancier. Dans mon travail littéraire, je dois beaucoup à ce que j’ai appris en tant que journaliste, non seulement de l’approche de la réalité mais aussi des ressources de l’écriture et de la communication. Je pense que le journalisme et la littérature peuvent avoir la même dignité, les mêmes défis de style, la même recherche de la meilleure façon d’exprimer une idée. Ce en quoi ils sont différents – je dirais complémentaires – c’est de par leur fonction : le journaliste analyse ou informe dans l’immmédiateté et la concision ; le romancier travaille dans une dimension élargie et dans la profondeur de champ. En ce qui me concerne, je n’ai pas besoin de débrancher un câble et d’en connecter un autre pour changer de rôle.
La façon d’organiser l’information dans un roman policier a ses particularités, et le travail sur un sujet ou une figure de l’histoire dans le cadre d’un roman historique a les siennes. Mais ce que je me propose de faire, c’est de rapprocher ces deux manières. Ainsi, dans Les Brumes du passé[14], il y a un voyage dans le passé proche de Cuba, ces années 1950 si riches et si sujettes à polémique ; et dans L’Homme qui aimait les chiens, il y a une mise en haleine comme dans un roman policier. Ici, la gageure était de maintenir l’intérêt du lecteur pour une histoire dont, avant de la lire, tout le monde connaît le point d’accomplissement, l’assassinat de Trotsky. On connaît aussi l’assassin matériel, et l’assassin intellectuel. Dramaturgie interne, structure du récit, tension qui court sous ces choses que personne n’ignore, finalement, mon propos est toujours le même : prendre le lecteur par le col et, 200 ou 700 pages, lui faire lire un roman où il ne s’agit pas de plaire, de rendre les choses faciles, mais d’obliger à penser, et à souffrir…
Depuis Passé parfait, en 1991, il marque mon écriture. Les six romans où il apparaît sont des morceaux de ma vie, avec mes joies, mes frustrations, mes réflexions. Et ce sont les meilleurs livres que j’aurais pu écrire au moment où je les ai écrits. Jamais je n’ai pensé que, parce qu’il s’agissait de romans policiers, ils devaient être superficiels. Je me suis toujours efforcé de soigner la langue, les personnages, la structure, le message délivré au lecteur. Un roman de 150 pages comme Adios Hemingway est une réflexion sur la personne privée et la personne publique de l’écrivain, sur le travail d’écriture, sur la fidélité et le sens de l’honneur. Qui a tué qui ?, ce n’est pas cela l’important ; Conde et ses amis policiers ne réussissent d’ailleurs jamais à le découvrir. Ce qui compte à mes yeux, ce sont les problèmes humains et la réflexion artistique et éthique. Je crois que je suis et serai, fondamentalement, l’écrivain des romans de Mario Conde, puisqu’avec eux et leur protagoniste, on retrouve le meilleur témoignage de mes apprentissages et doutes, de ma conception de la réalité, de la vie et de la morale.
Carpentier disait que l’écrivain ne devrait jamais divulguer ses auteurs de prédilection car on verrait alors tout ce qu’il doit aux autres. Moi, je n’ai pas de problèmes à reconnaître que, des textes bibliques à Homère et jusqu’à aujourd’hui, je dois un peu à tous les auteurs que j’ai lus, et même à ceux que je n’ai pas lus : nous sommes tous le résultat d’une culture. Mais, entre mes écrivains préférés, parmi les Cubains, je dois beaucoup à Carpentier, à Guillermo Cabrera Infante et à Lino Novas Calvo. Parmi les autres auteurs hispanophones, je citerai Vargas Llosa, Rulfo, Garcia Marquez, Fernando del Paso et Vasquez Montalban, suivis d’un grand « etc. ». Parmi les auteurs non hispanophones, des auteurs de romans policiers comme Chandler et Hammett, d’autres comme Hemingway, Salinger, Dos Passos, Auster, Kundera et Camus… Je continue ?
Le livre a été publié d’abord en Espagne, en 2009. Il est sorti à Cuba début 2011, à 4 000 exemplaires, m’a-t-on dit, mais je crois que la quantité mise en circulation est bien inférieure. Du côté officiel, des journaux, il n’y a rien eu : silence total, comme si ce livre et les prix qui l’ont récompensé n’existaient pas. Il y a tout de même eu quelques comptes rendus, très favorables, dans des revues culturelles. En même temps, l’accueil des lecteurs a été très enthousiaste, beaucoup grâce à l’édition espagnole, alors que dans cette édition le livre coûte l’équivalent d’un salaire mensuel à Cuba. Beaucoup de lecteurs, par différents canaux, m’ont fait savoir que ce livre leur avait permis de rentrer dans une histoire qu’ils n’imaginaient même pas, et la majorité d’entre eux m’ont remercié pour cela. C’est ce qui importe, pas l’accueil officiel mais celui du lecteur, et spécialement le lecteur cubain, celui pour lequel j’écris en premier.
En Espagne, nous en sommes à la dixième édition, ce qui est beaucoup. En Amérique latine aussi le livre a bien marché, malgré un prix de vente qui le rend difficilement accessible. Dans tous ces pays la critique a été très favorable. Comme en Italie, où j’ai obtenu le prix du meilleur roman historique 2010. En Allemagne et au Portugal, les ventes et les critiques ont été très bonnes, ainsi qu’en France. Nous verrons ce qu’il en sera dans les autres pays. D’ici à la fin de l’année, le livre sera traduit en danois, en grec, en anglais, en bulgare, et en russe…
Chez nous, les gens parlent tout le temps, et partout, avec ceux qu’ils connaissent comme avec les inconnus. On sait qu’il y a des choses dont on ne peut pas parler dans certains lieux, et on parle quand même. Cela compte. La raison profonde pour laquelle je vis à Cuba, c’est mon appartenance à sa culture, à une manière de voir la vie, d’utiliser la parole, d’entrer en relation avec les gens.
Non. Mais je vais continuer à travailler les sujets historiques. Je suis en train d’écrire un roman qui commence à Amsterdam, en 1643, quand un jeune juif vient vivre chez Rembrandt pour apprendre à peindre. L’histoire se poursuit en 1930, avec un autre personnage juif, à La Havane, et elle se terminera de nos jours, avec Mario Conde cherchant une vérité qui s’est perdue avec le temps. J’ai une grande fascination pour l’histoire, pour vivre d’autres époques, mais aussi y retrouver les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, éternels : dans ce roman, il est question de la liberté individuelle et des méthodes utilisées par la société et ses dirigeants pour la restreindre.
Dois-je dire que ce sont les chiens ? Chez moi il y en a toujours eu, avant même que je naisse. Aujourd’hui, j’en ai deux, Chori et Nata, qui occupent une place importante dans ma vie.
Propos recueillis par Philippe Binet et Patrick Bèle. Entretien précédemment publié dans le n° 11 de la revue Contretemps. Pour vous abonner, voir ici.
[1] Le gouvernement cubain se refusera toujours à céder aux sirènes d’un emprunt au FMI ou à la Banque mondiale.
[2] Dernier roman du cycle « Les Quatre Saisons », dont le premier est Passé parfait, suivi de Vents de carême et de Électre à La Havane, et qui tous ont pour théâtre l’année 1989. Éditions Métailié.
[3] Luis Mercader, avec Rafael Llanos et Germâan Sânchez, Ramon Mercader : Mi hermano : cincuenta anos despues, Espasa-Calpe, 1990. Du même Luis Mercader, lire dans Inprecor n ° 449-450 (juillet-septembre 2000), et accessible sur le site de cette revue, traduite du russe et présentée par Jean-Michel Krivine, l’interview qu’il donna en 1990 à Troud, le quotidien des syndicats soviétiques.
[4] Pierre Broué, Trotsky, Fayard, 1988.
[5] Isaac Deutscher. Trotsky I. Le prophète armé, 1879-1921, Éd. Omnibus, 1996 [1re éd. : 1954] ; Trotsky II. Le prophète désarmé, 1921-1929, Éd. Omnibus, 1996 [1re éd. : 1959] ; Trotsky III. Le prophète hors-la-loi, 1929-1940, Éd. 10-18, 1998 [1re éd. : 1963].
[6] Isaac Deutsche, Staline, Paris, Gallimard, 1973 [1re éd. : 1949].
[7] Ronald Radosh, Mary R. Habeck et Grigory Sevostianov, España traicionada, Editorial Planeta, 2002.
[8] José María Zavala, En busca de Andreu Nin, Vida y muerte de un mito silenciado de la Guerra Civil, Plaza et Janès, 2005.
[9] Angel Viñas, La soledad de la República : El abandono de las democracias y el viraje hacia La Unión Soviética ; El escudo de la República : El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937 ; El honor de la República : Entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin, Critica, 2006, 2007, 2008.
[10] Asaltar los cielos, moyen-métrage diffusé en 1996 par Canal + Espagne.
[11] Leonardo Padura, Le Palmier et l’Étoile, Métailié, 2009.
[12] Vassili Grossman, Vie et destin, Pocket, 2002.
[13] Pour une étude synthétique des romans policiers de Padura, lire l’article de Néstor Ponce « Leonardo Padura, les territoires de la fiction dans la révolution cubaine », in Amerika, revue du Laboratoire interdisciplinaire de recherches sur les Amériques (Lira), Université Rennes II, 1, 2010 : http://amerika.revues.org/568.
[14] Leonardo Padura, Les Brumes du passé, Métailié, 2006.
[15] Con la espada y con la pluma, 1984, ou encore Un camino de medio siglo : Alejo Carpentier y la narrativa de lo real maravilloso, 1993.
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.