
Pierre Salama est avec Jean-Luc Dallemagne et Jacques Valier le fondateur de la revue Critiques de l’économie politique, lancée à la fin de l’année 1970 dans un contexte de grande activité militante et dans la perspective de nourrir l’action politique de la compréhension des dynamiques du capitalisme contemporain. Nous revenons avec lui sur l’histoire de cette revue (et publions en annexe les tables des matières de l’ensemble de ses numéros).
J’ai commencé ma vie militante dans le syndicalisme étudiant et l’opposition à la guerre d’Algérie, puis aux autres conflits impérialistes. J’entre en classe prépa à Paris au tout début des années 1960 et rejoins l’UNEF, qui avait à l’époque un rôle très important puisqu’elle était l’organisation au sein de laquelle les différentes chapelles de la gauche contestataire se retrouvaient et pouvaient discuter. J’arrive ensuite à la faculté de droit et d’économie de Paris pour y suivre un cursus d’économie, et là c’est très différent puisque l’extrême-droite y est massivement présente et occupe quasiment tout l’espace politique. Cependant, dans le cadre des comités Vietnam, nous parvenons là encore à unifier différentes tendances et à constituer un groupe relativement important.
À l’époque, le contexte oblige à se serrer les coudes. Ainsi Jacques Valier, que je rencontre à ce moment là, est proche des maoïstes, ce qui n’a jamais été mon cas. Après les comités Vietnam, ou à peu près en même temps, c’est la naissance de la JCR, fondée par des jeunes communistes exclus par le PCF. Et enfin, la Ligue Communiste Révolutionnaire, fondée dans la suite de mai 68. C’est dans le cadre de cette trajectoire, parallèle à notre trajectoire universitaire, qu’il faut comprendre la fondation de la revue : les organisations et les tendances sont très nombreuses mais il n’existe pas vraiment d’organe intellectuel permettant de discuter les analyses des uns et des autres. Alors même que le milieu militant de l’époque est très massivement étudiant et donc potentiellement intéressé par ces discussions.
La première chose à savoir est que je me destinais au départ, du fait de mes bons résultats scolaires, à une carrière d’ingénieur et que le choix de faire de l’économie, et de l’économie marxiste qui plus est, répond à une volonté militante. La théorie vient après l’engagement, pour le nourrir. Quant aux enseignements d’économie, ils étaient encore très peu fixés et assez divers, quoique assez pauvres pour la plupart. Ce qui explique aussi sans doute que nous ayons tant investi dans la lecture et l’auto-formation intellectuelle.
Il y avait bien entendu quelques figures importantes : Henri Denis tout d’abord, historien de la pensée économique, intelligent et érudit, qui nous a aidé à intellectualiser notre radicalisation politique en pointant la spécificité théorique du marxisme. Plus paradoxalement, il faut aussi mentionner les cours de Raymond Barre [Premier ministre de Giscard entre 1976 et 1981], qui était alors la star de l’économie française et faisait des cours pédagogiques et au fait des discussions les plus récentes. En revanche, et cela dit beaucoup de l’ambiance de l’époque, il a fait une fois un très mauvais cours sur Marx, qui a donné lieu à une manifestation étudiante réclamant … un « vrai » cours sur Marx ! Le lendemain, il admettait son erreur et nous gratifiait d’un cours excellent sur les crises du capitalisme et leur explication marxiste.

Il y en avait quelques autres, Henri Bartoli par exemple, issu de la gauche chrétienne et radicalisé par les événements. Mais globalement, c’était faible.
C’est vrai. La chance que j’ai eu, du point de vue universitaire, c’est que malgré la méfiance qui entourait les « gauchistes », mon niveau de maths m’a permis de grimper assez aisément, en devenant par exemple l’assistant d’Henri Guitton juste après mon DES en 1967. DES que j’ai rédigé sous la direction de C. Furtado et qui portait sur la substitution aux importations en Argentine. Donc quelque chose de développementaliste, oui, ce qui m’a permis d’une part de m’intéresser à des problèmes directement politiques, tout en leur appliquant des analyses directement universitaires.
De même, ma thèse de doctorat, Étude sur les limites de l’accumulation nationale du capital dans les économies semi-industrialisées, a été rédigée sous la direction de René Passet, devenu plus tard le premier président scientifique d’ATTAC. Par ce biais, donc, il était possible de politiser l’économie tout en reprenant des questions débattues depuis longtemps au sein du camp marxiste. D’autant plus qu’avec d’autres, nous nous tenions au courant des débats des Cambridgiens sur la fonction de production, le concept de capital, etc. Et on allait chercher dans ces débats très techniques la possibilité de donner à nos thèses une dimension théorique que n’avaient pas la plupart des thèses en économie à l’époque.
C’est cette formation qui me poussera, un peu plus tard, à m’intéresser aux débats proprement théoriques sur la valeur.
À vrai dire, c’était assez improvisé et plutôt inespéré. Nous avions fini nos thèses, Jean-Luc Dallemagne, Jacques Valier et moi, et passions la grande majorité de notre temps à militer. Mais on ressentait en même temps un vrai besoin d’analyses chez les militants. D’autant plus que nous vivions alors dans l’idée que les dynamiques du capitalisme, explicables « en dernière instance » par l’économie, étaient directement liées aux événements politiques et qu’une compréhension claire des tendances et des rythmes permettrait de se tenir prêt pour les révoltes et révolutions à venir. C’est pourquoi l’idée d’une revue, résolument militante et de haute tenue intellectuelle, s’est imposée à nous.
Pour ce qui est de sa fondation concrète, l’histoire est plus triviale. Nous étions tous les trois dans un bar de Concarneau et c’est là, après quelques verres, que nous nous sommes décidés à solliciter François Maspero pour éditer la revue. Nous l’avons rencontré ensuite, dégrisés et assez terrifiés par la stature du personnage et le côté un peu prétentieux de notre demande. Maspero a joué avec un élastique durant tout le temps de notre présentation, avec sa manière à lui d’être à côté. Mais finalement, ses seuls mots furent : « Quand est-ce qu’on sort le premier numéro ? » Et le premier numéro sortit en septembre 1970.
Au départ, à vrai dire, nous avons recyclé nos thèses. Jacques Valier avait travaillé sur l’inflation rampante, Jean-Luc Dallemagne sur le système monétaire international et l’inflation et moi sur le sous-développement : ça vous donne les trois premiers numéros de CEP. Nous étions peu nombreux au début, et la plupart des articles sont rédigés par une seule et même personne, utilisant plusieurs pseudonymes. Mais pas les mêmes que ceux que nous avions à la Ligue (LCR) : j’ai été Merlin dans le n°1, puis Bailly dans le n°3 et J.-L. Dallemagne était Jourdain. Mais très vite, nous avons abandonné et écrit en nos noms propres.
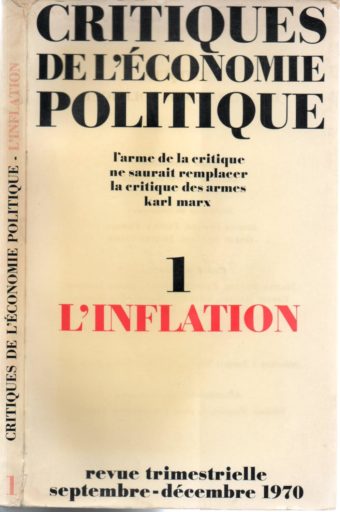
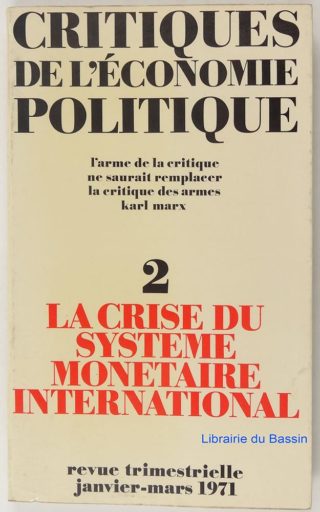
Par ailleurs, la revue se voulait au départ œcuménique (au sein du marxisme). Ainsi, Carlo Benetti a participé au premier numéro (sous le pseudonyme de Dubois) alors même qu’il était très éloigné du trotskisme puisque proche de ce qu’on appelait alors la tendance italienne. Mais après avoir vu que nous faisions de la publicité pour Rouge dans la revue et que nous évoquions la Ligue dans la présentation, il a mis fin à sa collaboration avec nous.
De manière générale, le juste milieu a été difficile à trouver : nous refusions de plier notre activité aux décisions de Congrès de la Ligue mais revendiquions cela dit un ancrage militant très fort. Mais malgré ces hésitations et ces quelques problèmes, le succès a tout de suite été au rendez-vous. Nous avons tiré à 5000 exemplaires, immédiatement vendus, retiré 2500 exemplaires vendus eux-aussi, puis les premiers numéros ont même fait l’objet d’une réédition en Petite Collection Maspero (ainsi que d’autres numéros plus tardifs, notamment sur l’impérialisme). Plus tard, notre petit livre, Une introduction à l’économie politique, s’est vendu à 70 000 exemplaires en français et dix ou onze traductions !
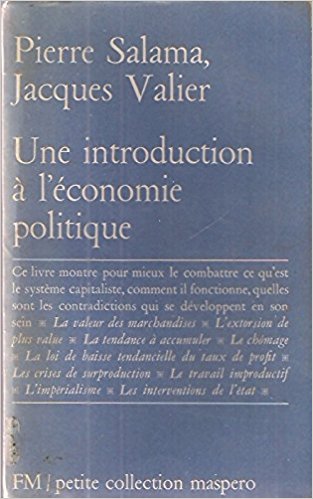
Le succès de la revue nous a permis de nous diversifier, oui. D’autant plus que, militants à temps plein, il nous était impossible de tenir le rythme des premiers numéros. Nous tenions des réunions tous les quinze jours, plus la rédaction des articles, les relectures, etc.
Après les premiers numéros, nous avons introduit dans la revue et dans une collection de livres des traductions d’auteurs marxistes plus classiques (Trotsky, bien sûr, mais aussi Rosdolsky, Roubine par exemple), ainsi que des marxistes contemporains dont les travaux nous paraissaient intéressants (H. G. Backhaus, E. Altvater, sans parler de Mandel). C’est cela qui nous a mis en contact avec des germanistes et des gens qui avaient une approche plus philosophique du marxisme, C. Colliot-Thélène ou J.-M. Vincent par exemple.
Mais tout cela rejoignait nos aspirations à un marxisme ouvert et en prise sur l’actualité réelle. D’où des numéros sur la « méthode » (tourné en grande partie contre Althusser et Bettelheim), sur la valeur, le travail productif, l’État, etc. Toutes les notions que nous utilisions dans l’approche économique ont fait l’objet d’une élaboration collective. Et tout cela, rappelons-le, dans un contexte polémique très marqué au sein même du camp marxiste : nous avons ainsi hébergé des polémiques avec Poulantzas sur l’État.
Bettelheim en revanche, alors même que nous avons consacré un numéro au « socialisme réel » et que Jean-Luc Dallemagne a poursuivi dans cette voie, n’a jamais vraiment répondu à ce qui était de fait une incitation – certes violente – au débat.
Assez inexistants. Nous bénéficiions de fait d’une forme de monopole, puisque nous étions la seule revue de cette ampleur à la gauche du PCF avec une orientation théorique et critique. Le PCF, bien sûr, en la personne de Bernard Marx je crois, nous a attaqués lorsque nous avons publié l’introduction mentionnée plus haut. De même, nous pensions beaucoup de mal de la thèse du capitalisme monopoliste d’État de P. Boccara.
Les liens que nous avons eus sont venus ensuite, et plutôt avec les franges les plus radicales de la Deuxième gauche. Ainsi, nous avons été liés à des militants et des intellectuels de la Gauche Ouvrière et Paysanne, qui était alors intégrée au PSU. Là, il y avait quelques discussions. Vous trouverez un écho de tout cela dans les articles sur la paysannerie par exemple, question très importante à l’époque puisque liée aux problèmes du développement et intervenant de manière directe dans les débats historiographiques sur les premières années de l’URSS.
Mais par ailleurs, la dimension très théorique d’un grand nombre de débats, nourris de philosophie allemande et d’économie cambridgienne, nous a protégé des polémiques les moins intéressantes. D’autant plus, encore une fois, que nous étions très libres vis-à-vis de la direction de la Ligue, qui nous regardait de loin, plutôt avec bienveillance, mais de loin. Pour l’anecdote, l’article qui a fait sans doute le plus de bruit « politiquement » est celui que Mandel consacre à l’Amérique latine, dans le n° 16-17. On était alors en plein débat sur la stratégie à avoir vis-à-vis de la guérilla et ce texte a été lu comme une défense de la politique de la Ligue par les Morénistes, opposés à la lutte armée et encore membres de la IVe Internationale.
La première chose à savoir est que le public de l’époque était avide de débats de ce genre. La plupart d’entre nous avions lu Marx dans le texte, mais les militants de la Ligue, plus jeunes, apprenaient Marx à partir de Mandel et de ce que nous écrivions.
Cela dit, nous étions totalement opposés à une perspective comme celle de C. Benetti et J. Cartelier par exemple, qui isolaient la théorie de la valeur de toute approche des phénomènes empiriques du capitalisme contemporain (la vieille histoire du Livre I du Capital contre le Livre III). Dans tous nos travaux, dans les miens en tous cas, j’ai toujours cherché à mettre le travail théorique et conceptuel (sur la valeur, sur l’État) au service des approches concrètes : lorsqu’on étudiait la valeur, par exemple, c’était pour comprendre l’accumulation et les phénomènes monétaires ; lorsque j’ai étudié l’État, c’était pour comprendre mieux le rôle qu’il jouait dans les économies de la périphérie, etc.
Ainsi, on pouvait sans trop de mal aller faire des formations militantes dans les écoles de la Ligue. D’autant plus que l’on jouissait d’un grand succès. Dans les facs, malgré des freins posés à notre carrière, les autres enseignants avaient peur de nous, convaincus que nous avions derrière nous les masses étudiantes, prêtes à se lever au moindre de nos appels. Jacques Valier, pour l’anecdote, s’est vu interdire la tenue d’une conférence en Suisse, qu’il a faite tout de même, et qui a été un franc succès.
C’est très différent aujourd’hui. T. Hai-Hac, avec qui j’ai écrit plus tard une introduction à l’économie de Marx, m’a ainsi raconté avoir expliqué, lors d’une formation récente à l’économie politique devant les militants de ce qui était encore la LCR, que la force de travail n’était pas une marchandise. Il s’attendait à une levée de boucliers, ce qui aurait été le cas quelques années avant, mais personne n’a rien dit. Encore une fois, l’époque était très particulière de ce point de vue.
La première série s’arrête en 1977, oui. Mais en tout, la revue a tout de même duré encore sept ans, soit quinze ans en tout. Et à la fin, elle se vendait encore à 1800 exemplaires, abonnements compris. Avec par ailleurs une version espagnole composée pour moitié de traduction et pour moitié de textes propres. C’était organisé par un groupe trotskiste local.
Plutôt que d’une disparition, il s’agit en effet d’une transformation, que l’on peut résumer par deux mouvements : un mouvement d’ouverture politique, puisque nous avons alors recruté plus largement, par exemple un certain nombre de régulationnistes parfois assez éloignés de notre radicalisme politique. Ensuite, un changement thématique s’est opéré, puisque la revue a délaissé la théorie pour une approche davantage tournée vers l’économie appliquée, notamment l’économie du travail. Mais il s’agissait là d’un processus de long terme, déjà en germe dans les derniers numéros de la première série.
D’autre part, pour tout un tas de raisons liées à l’histoire de la Ligue à cette époque, et notamment son mouvementisme exacerbé et une certaine forme d’aventurisme qui ne nous convainquait pas, nous avons été amenés à quitter la Ligue, Jean-Luc Dallemagne assez vite, moi et Valier – qui ne participait plus de facto aux réunions – un peu plus tard, en 1979. Et tout cela dans un contexte qui s’éloignait petit à petit de l’ambiance des années 1970.
L’exemple qui me frappe le plus est celui des rapports entre l’enseignement et la politique. Alors que j’étais enseignant au début des années 1980, il y a eu un mouvement de grève dans la fac, en 1983, il me semble. Et j’ai pu me rendre compte à quel point les techniques d’agitation qui faisaient notre quotidien quelques années auparavant soit avaient été oubliées (il fallait « apprendre » aux étudiants à s’organiser) soit étaient de moins en moins efficaces. Et surtout, après la grève, tout est redevenu comme avant ! Les différents mouvements des années 1970 modifiaient à chaque fois la façon de faire cours, ils transformaient les enseignements car les étudiants sortaient des mouvements sociaux avec des aspirations nouvelles qu’ils entendaient bien faire valoir dans les cours. Aujourd’hui, on a l’impression que les grèves et les blocages constituent une parenthèse, ponctuelle, sans véritable prise sur la routine universitaire.
D’un format identique, non, certainement pas. La tâche est plus difficile aujourd’hui et elle n’est pas la même. En économie par exemple, c’est la possibilité même d’une alternative théorique, d’une pluralité de courants, qui doit être démontrée. Et encore, même dans les quelques facs où l’on enseigne encore cette diversité, je suis stupéfait de voir à quel point elle est vidée de tous ses enjeux intéressants. Les différents courants sont simplement juxtaposés les uns aux autres sans qu’on sache très bien pourquoi ils existent, ce qui les oppose, les positions plus globales qu’il y a derrière, etc.
C’est toute l’ambiguïté de l’hétérodoxie aujourd’hui, qui brandit comme seule revendication le pluralisme. Sans doute est-ce lié à des enjeux stratégiques, mais cela rend difficilement compréhensibles les enjeux et les tendances, qui sont parfois tout aussi éloignées les uns des autres au sein de l’hétérodoxie qu’elles peuvent être opposées au mainstream.
CEP n’avait pas ce problème : il s’agissait d’élaborer sur une base déjà présente. Et avec des enjeux qui étaient diffus dans l’atmosphère de l’époque. D’autre part, il y a bien sûr des transformations sociologiques évidentes : dans un contexte de plein emploi, vous pouvez considérer vos années d’université comme un moment de formation intellectuelle plutôt que professionnelle. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, sauf pour une frange extrêmement minoritaire de la population (qui ne semble d’ailleurs pas toujours être très motivée par la formation intellectuelle). Pour le reste, les études supérieures sont avant tout considérées sous l’angle de la professionnalisation. Et ce qui professionnalise en économie, ce qui est efficace, c’est par définition ce qui est installé, ce qui domine.
Cela dit, malgré les difficultés, on assiste à un sursaut me semble t-il. Outre les économistes atterrés, les étudiants eux-mêmes commencent à protester contre ce qu’on leur enseigne. Peut-être y a t-il donc une place pour des formes de production et de diffusion d’une économie alternative, scientifiquement ambitieuse et qui assume les désaccords et les enjeux politiques. Peut-être est-ce le cas dans d’autres disciplines. Mais en tout cas, notre histoire est celle d’une institutionnalisation – difficile mais réelle – de la perspective critique. Nous vivons la fin de cela. Des questions stratégiques se posent par conséquent, sur le rapport au monde universitaire, la possibilité de prospérer à ses marges, etc. Il faut travailler.
Le conseil principal que j’ai à donner porte sur la formation. Je crois qu’il faut prendre le temps de lire des textes de base, les ouvrages fondamentaux et un peu moins de « working papers » ou d’extraits de livre. Il faut lire également les adversaires théoriques, les connaître mieux que ceux qui adoptent leurs thèses, même si le travail est parfois ingrat (et nous l’avons mené à propos de la loi de la valeur et de l’économie marginaliste). Je crois vraiment que c’est par des débats sur le fond qu’on se forme vraiment et qu’on se solidifie.
Je note par ailleurs avec bonheur que l’on assiste à un certain retour de la théorie, mais il est vrai que les éditeurs préfèrent les travaux descriptifs et que les institutions universitaires quant à elles valorisent les tests économétriques, même et surtout sans réflexion sur la construction des données, par rapport aux spéculations théoriques. Si bien qu’il est difficile à ceux qui veulent faire carrière dans les universités de ne pas se plier à ces exigences. Je note cependant qu’à l’étranger on trouve beaucoup de blogs théoriques, polémiques, écrits par des gus qui apparemment se plient aux exigences du mainstream et se « défoulent » dans leurs blogs. Contretemps, qu’il s’agisse de sa version papier ou du site, est de ce point de vue un excellent outil.
Propos recueillis par Guillaume Fondu.
À partir du numéro 2 et jusqu’au numéro 20 inclus, chaque revue s’ouvre sur ces lignes :
La participation à la revue de tous ceux qui se réclament du marxisme, c’est-à-dire de la classe ouvrière et de son combat, n’est pas pour nous une simple clause de style. Compte tenu de la « misère » de l’économie politique marxiste, depuis quelques décennies, nous estimons que l’ouverture des débats est condition nécessaire pour que la critique scientifique du mode de production capitaliste et des sociétés de transition progresse.
Le Comité de Rédaction.
1. L’inflation (septembre-décembre 1970)
2. La crise du système monétaire international (janvier-mars 1971)
3. La formation du sous-développement (avril-juin 1971)
4-5. Sur l’impérialisme (juillet-décembre 1971)
6. La construction du socialisme (janvier-mars 1972)
7-8. La nature des pays de l’Est (avril-septembre 1972)
9. Sur la méthode (octobre-décembre 1972)
10. Travail et emploi (janvier-mars 1973)
11-12. Crises / Travail / Chili Avec un inédit en français de K. Marx (avril-septembre 1973)
13-14. L’impérialisme (octobre-décembre 1973)
15. Paysannerie et réformes agraires (janvier-mars 1974)
16-17. Amérique latine. Accumulation et surexploitation (avril-septembre 1974)
18. Dialectique de la forme valeur. L’Italie en crise. Agriculture et lutte des classes (octobre-décembre 1974)
19. Internationalisation du capital. Classes sociales (janvier-mars 1975)
20. Un inédit de Léon Trotsky. L’internationalisation du capital / Valeur et prix de production / La Chine (avril-juin 1975)
21. Crise de l’énergie ou crise du capitalisme ? Internationalisation du capital et impérialisme. La trajectoire du maoïsme (juillet-septembre 1975)
22. Crise de l’énergie ou crise du capitalisme à l’échelle mondiale ? Un capital financier autonome dans des pays coloniaux ? (octobre-décembre 1975)
23. Travail et Emploi (janvier-mars 1976)
24-25. La Crise. Agriculture-Valeur. (avril-septembre 1976)
26. Luttes ouvrières et emploi en Italie. Valeur, prix et réalisation (janvier-mars 1977)
27. Les partis communistes et les « petits » et « moyens » patrons. L’Amérique latine (avril-juin 1977)