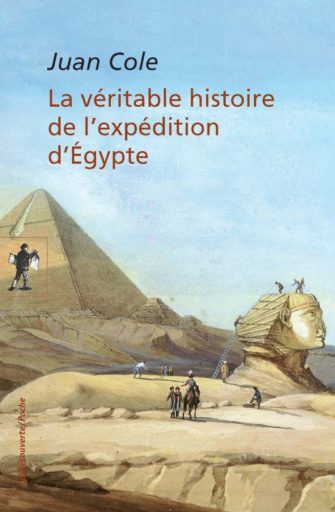
Nous publions ici un extrait de La véritable histoire de l’expédition d’Egypte (à paraître en septembre 2017 aux éditions La Découverte), de Juan Cole. Professeur d’histoire à l’université du Michigan, il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont notamment Engaging the Muslim World (Palgrave MacMillan, 2009) ou encore Colonialism and Revolution in the Middle East: Social and Cultural Origins of Egypt’s `Urabi Movement (Princeton University Press, 1993).
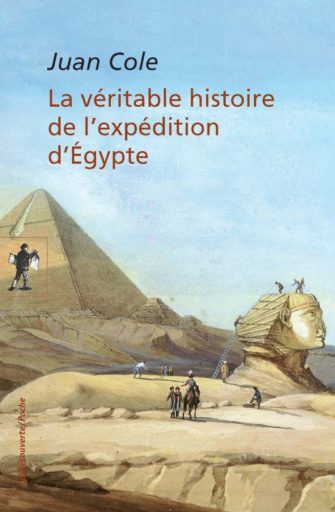
Parler de « colonialisme républicain » ou encore d’« impérialisme libéral », n’est-ce pas associer des termes contradictoires ? Si on accepte les principes de base du libéralisme, il est difficile pour des dirigeants et des hommes politiques de faire publiquement l’éloge de la soumission d’un autre peuple, car cela implique de le priver de cette souveraineté populaire qui, selon le libéralisme, est la caractéristique inaliénable des êtres humains. C’est pourquoi des stratégies rhétoriques s’avèrent nécessaires pour justifier l’empire sans sembler remettre en cause ce principe de la souveraineté populaire. Il ne s’agit donc pas d’une question de comportement, car on sait bien que les Etats se réclamant du libéralisme ont sans aucune ambigüité établi des empires. La question qui m’intéresse ici est, en fait, celle du langage politique qui est alors utilisé comme justification.
Les plus anciennes justifications d’une politique impériale, ou celles auxquelles ont eu recours les Etats fascistes du xxe siècle, considéraient que les êtres humains sont inégaux et qu’il faut, pour leur bien, maintenir des hiérarchies sociales où certains « peuples » (ou, plus tard, certaines « races ») occupent le sommet. Le plus fort a le droit, et peut-être même l’obligation, de soumettre les inférieurs et les faibles. En ce qui concerne l’Italie de Mussolini on sait que « l’hypothèse de base du Duce… c’était que la vie est un combat. L’histoire devait être vue comme une succession sans fin de conflits entre les élites, les Etats, les tribus. A chaque époque, une élite ou un Etat précis doit donner le ton. Par définition, les élites ou les Etats dominant sont les plus forts… » Hiérarchie et domination sont donc les mots clefs des philosophies politiques antilibérales.
Dans les systèmes plus démocratiques acceptant l’égalité civique de tous les citoyens, les dirigeants ne peuvent pas aussi facilement faire référence à une inégalité hiérarchisée devant le pouvoir et la loi. Dans les régimes parlementaires, les élites ont en conséquence mis au point des stratégies rhétoriques pour tenter de justifier de telles inégalités et hiérarchies. L’une d’entre elles est l’infantilisation. Les populations exclues sont considérées comme des enfants et non pas comme des citoyens autonomes capables de participation politique. Cette approche a l’avantage d’impliquer qu’il s’agit d’une inégalité temporaire, car avec le temps les enfants grandissent. Ainsi, les femmes, les travailleurs privés dépossédés et les minorités raciales ont tous à un moment ou à un autre été infantilisés et privés de droits politiques dans les sociétés libérales. Cette stratégie est néanmoins instable et susceptible d’être battue en brèche et défaite au fil du temps quand les populations exclues arrivent à mobiliser suffisamment de ressources et à réclamer avec suffisamment de puissance l’égalité politique. Il est notoire que l’infantilisation des sujets de pays étrangers conquis a été une stratégie essentielle pour les partisans de l’impérialisme. Les sujets coloniaux ont été définis comme n’étant pas totalement adultes, comme devant faire un long apprentissage avant de disposer dans un lointain futur du droit à s’autogouverner.
Pour le sociologue Joseph Schumpeter, l’impérialisme « est la disposition, dépourvue d’objectifs, que manifeste un Etat à l’expansion par la force ». Par « dépourvu d’objectifs », il fait référence, par exemple, à des guerres dont l’objectif n’est pas de s’opposer à une attaque imminente. Cette définition implique que l’Etat impérial s’empare, conserve et administre des territoires au-delà de ses frontières immédiates. Schumpeter pensait que ce trait était incompatible avec un régime capitaliste libéral et démocratique. Il refusait de considérer les guerres coloniales du XIXe siècle comme le résultat d’un mercantilisme tardif qu’il pensait totalement abandonné dès le début du xxe siècle, ce qui devrait mener inévitablement à la paix (le mercantilisme, ou capitalisme de monopole promu par l’Etat, a été une doctrine économique des débuts de l’époque moderne). Schumpeter était de manière évidente dans l’erreur. Je pense que la tentation impériale existe que les régimes favorisent le mercantilisme, le laissez-faire ou le socialisme d’Etat. Les conquêtes extérieures semblent toujours promettre des bénéfices économiques à la métropole, quel que soit le système économique en vigueur. Les bénéfices matériels ne sont qu’une des motivations qui animent les hommes politiques inspirés par des idéaux démocratiques qui rêvent d’empire ; il y a aussi la compétition stratégique avec des impérialismes rivaux, le ressentiment face aux mauvais traitements d’Etats plus faibles, et la peur que ces Etats soient malgré cela capables d’infliger des torts à l’Etat libéral.
L’impérialisme en tant que stratégie directrice a l’inconvénient d’imposer des coûts à la métropole, pour autant qu’il nécessite l’administration directe ou au moins une domination minutieuse de la société qui a été conquise. L’Inde a souvent coûté à la Grande-Bretagne plus chère que ce qu’elle lui a rapporté en impôts divers, même si le monde privé des affaires a alors bénéficié d’un marché captif. Il y a aussi les coûts politiques. Il arrive qu’en métropole même, des oppositions se manifestent face aux sacrifices militaires demandés aux jeunes qui sont sous les drapeaux ou que l’on se sente coupable des massacres et de la répression indispensables au maintien de la soumission des sujets coloniaux. L’impérialisme soft, ou néo-impérialisme, ou des Etats puissants assurent leur domination grâce à des mécanismes plus subtils (offre ou refus de prêts, menaces militaires déguisées, opérations secrètes), est généralement moins couteux et est de plus en plus la solution adoptée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
D’une certaine manière, Talleyrand et Bonaparte ont été les premiers à théoriser cette forme de colonialisme républicain.
De 1795 à 1799, le Directoire a représenté un bref épisode de libéralisme parlementaire succédant à la Terreur et précédant le Consulat. Les hommes politiques de l’époque du directoire ont tenté de suivre un cours évitant à la fois les excès de Robespierre et les menaces d’une résurgence du royalisme. Ils représentaient les intérêts de la classe des hommes d’affaires et des rentiers, et on peut les voir comme les champions corrompus des possédants non-aristocrates.
Le plan de Bonaparte d’envahir l’Egypte a plusieurs origines. Le grand historien André Raymond estime qu’environ 15 % des céréales produites en Egypte arrivaient à Marseille dans la seconde partie du xviiie siècle, une période pendant laquelle on en manquait cruellement en France. Cette statistique est particulièrement intéressante quand on sait que l’empire ottoman réservait à sa propre consommation l’ensemble de la production égyptienne et considérait ces envois en Europe comme une forme de contrebande. Les grands marchands français importateurs s’intéressaient donc de près à Alexandrie. Quant à Bonaparte, il semble qu’il ait commencé à manifester sérieusement de l’intérêt pour une invasion au cours de l’été 1797 après ses succès en Italie et cela dans une perspective géopolitique passant par l’Adriatique et la Méditerranée. Venise et la ville de Raguse (aujourd’hui Dubrovnik) étaient alors les principaux partenaires du port égyptien d’Alexandrie. La France révolutionnaire, désormais établie comme puissance italienne, avait plus d’intérêts que jamais au Levant.
Dans un discours tenu l’été précédent devant l’Institut, Charles Maurice de Talleyrand, évêque défroqué, révolutionnaire et homme politique de première importance, avait expliqué que des colonies étaient indispensables à la prospérité de la France. (Le Canada et la plupart de ses possessions en Inde et dans les Caraïbes avaient été perdues). Pour lui, l’expansion est une chose inhérente à la révolution : « L’effet nécessaire d’une Constitution libre est de tendre sans cesse à tout ordonner, en elle et hors d’elle, pour l’intérêt de l’espèce humaine. » Il disait avoir été frappé, pendant son bref exil aux États-Unis pendant la Terreur, par la différence entre la situation postrévolutionnaire là-bas et en France. Il n’avait pas rencontré aux États-Unis la haine terrible et les conflits propres à la France. Cette harmonie toute relative était due, selon lui, à la nécessaire conquête d’un immense continent, qui préoccupait en premier lieu les anciens révolutionnaires. (Son idée selon laquelle c’était la frontière qui créait de l’unité au centre était fausse, et ce fut précisément la question de l’économie politique des Etats frontières – la question de l’esclavage – qui a été, des années plus tard, à l’origine de la guerre civile américaine. Bien plus, les guerres étrangères et le maintien d’armées sont toujours une mauvaise chose pour la démocratie, justifiant un Etat qui privilégie la sécurité nationale.)
Talleyrand avance plusieurs arguments en faveur d’une nouvelle forme de colonialisme, d’abord dans son discours de 1797 puis, plus tard, dans ses mémoires. On était d’abord à la fin de l’esclavage et les anciennes plantations coloniales esclavagistes étaient de manière évidente devenues des dinosaures. Il n’était pas question pour autant de renoncer à une relation d’exploitation entre les économies développées et celles d’Afrique et d’Asie. Il s’intéressait à des pays disposant de terres fertiles, de cultures de haute valeur comme le sucre, le coton et l’indigo, à l’existence d’une main-d’œuvre libre et abondante et, alors, la Syrie, l’Egypte et l’Afrique du Nord semblaient des territoires prometteurs d’un nouveau type de colonies économiques. Pour lui, le colonialisme devait être un atout économique, en plus des avantages extra-économiques dont bénéficiaient les Britanniques au Bengale grâce à un marché captif et un accès privilégié à un sucre peu cher et aux textiles. (Sur ce point, il était ainsi en désaccord avec l’économiste Turgot selon lequel que les marchandises coutent aux consommateurs le même prix dans les pays dotés d’un impériaux et dans ceux qui n’en possèdent pas.)
Talleyrand devint ministre des Affaires étrangères peu de temps après avoir défendu cette position, qui trahissait les idéaux égalitaires des Droits de l’homme. Selon moi, ce discours a été le signe d’un renouveau du soutien à des aventures étrangères d’une partie des révolutionnaires dans la droite ligne de ce qui était en vogue à la cour de Versailles au XVIIe siècle. On pourrait à ce propos parler d’un néo-conservatisme du XVIIIe siècle.
On peut en retrouver l’idée dans des observations faites par Talleyrand dans ses mémoires à propos de l’Italie sous domination française :
« Si à cette époque le directoire eût voulu faire de l’Italie un boulevard pour la France, il le pouvait, en appelant tout ce beau pays à ne former qu’un seul État. Mais bien loin de cette pensée, il frémit en apprenant qu’on s’occupait secrètement en Italie de la fusion des nouvelles républiques en une seule, et il s’y opposa autant qu’il était en lui. Il voulait des républiques, ce qui le rendait odieux aux monarchies, et il ne voulait que de petites républiques faibles pour pouvoir occuper militairement leur territoire, sous prétexte de les défendre, mais en réalité, afin de les dominer et de nourrir ses troupes à leurs dépens, ce qui le rendait odieux à ces mêmes républiques. »
C’est dire sans ambages que la voie colonialiste française consistait à établir des républiques sœurs faibles, autorisant les citoyens locaux à voter, établissant la liberté de parole et de presse, mais en s’assurant dans le même temps de l’hégémonie de la république mère, la France, qui restait militairement dominante. Ce modèle diffère considérablement de l’ancien modèle impérial, dans lequel les territoires conquis étaient dirigés par décrets par un vice-roi nommé par l’empereur. Mais il s’oppose aux principes de la souveraineté populaire et à tout projet d’un monde formé de républiques égales les unes aux autres telles que Jean-Jacques Rousseau, par exemple, avait pu l’imaginer.
Bonaparte et Talleyrand étaient convaincus que le déclin de l’empire ottoman s’accélérait, produisant un puissant et dangereux motif pour la Grande-Bretagne et la Russie pour tenter d’usurper le pouvoir dans les territoires sous domination ottomane. Si les pouvoirs européens se trouvaient bientôt en situation de s’emparer de provinces appartenant au sultan Selim III, alors Bonaparte et Talleyrand voulaient que la République française mette en avant ses propres prétentions. Leur rêve était de faire de la Méditerranée un lac français et d’ouvrir une route vers l’Inde par la mer Rouge. Ainsi, dans ses mémoires, Talleyrand se plaint de l’inconstance de Bonaparte au sujet de ses projets :
« Cependant la fougue de son imagination et sa loquacité naturelle l’emportant hors de toute prudence, il parlait quelquefois de revenir en Europe par Constantinople, ce qui n’était pas trop le chemin de l’Inde ; et il ne fallait pas une grande pénétration pour deviner que s’il arrivait à Constantinople en vainqueur, ce ne serait pas pour laisser subsister le trône de Sélim, ni pour substituer à l’empire ottoman une république une et indivisible. Mais il paraissait si utile au directoire de se débarrasser d’un homme qui lui faisait ombrage, et qu’il n’était pas en mesure de contenir, qu’il finit par céder aux instances de Bonaparte, ordonna l’expédition d’Égypte, lui en donna le commandement, et prépara ainsi les événements qu’il avait le plus à cœur de prévenir. »
Talleyrand s’était convaincu qu’à Istanbul le sultan lui-même devait craindre les projets des Britanniques et des Russes concernant l’Egypte, et qu’il accueillerait donc avec bienveillance une action préventive d’un allié puissant pour empêcher cette province de tomber entre des mains ennemies. De fait, il intriguait pour être envoyé comme ambassadeur à Constantinople en 1798 pour expliquer la situation au sultan Selim III. Ses plans échouèrent, ce qui fut aussi bien pour lui – celui qui occupait ce poste fut enfermé dans un donjon quand le sultan apprit l’attaque de son domaine par Paris. Talleyrand a été le premier homme politique occidental, mais en aucune manière le dernier, à surestimer le degré de gratitude que manifesteraient les peuples du Moyen Orient face à une occupation militaire.
Dans le but de motiver ses troupes à attaquer l’Egypte, Bonaparte prononça le 9 mai 1778, un discours mobilisateur où il comparait l’armée française assemblée à Toulon aux troupes romaines à la conquête de Carthage. Il est typique de la rhétorique impérialiste d’essayer de réhabiliter des aventures impériales plus anciennes et d’en faire des références pour celles en cours. Mais les hommes politiques sous influence des idées libérales doivent oublier les éléments impériaux qui ne gênaient pas les anciens césars et sultans, c’est-à-dire la promesse de pillages, d’extorsions et de puissance. Bonaparte expliqua à ses troupes : « Le génie de la liberté, qui a rendu la République dès sa naissance arbitre de l’Europe, veut qu’elle le soit des mers et des contrées les plus lointaines. » Ainsi les Français sont à la fois semblables et différents des Romains à Carthage. Ils sont les représentants du triomphe de la civilisation européenne dans une Afrique récalcitrante, mais leur raison d’être n’est pas la vengeance ou le simple désir de conquête, c’est répandre la liberté dans le monde. On peut tout à fait penser que Bonaparte a prononcé là le premier discours libéral impérialiste.
De manière révélatrice, Bonaparte allait au-delà des pouvoirs qui lui avaient été donnés en promettant à ses soldats des lots de terre à leur retour, ce que le Directoire ne l’avait aucunement autorisé à faire. La promesse a du être supprimée des versions imprimées de son discours, mais le compte rendu oral ne laisse aucun doute sur le fait qu’il provoqua des espoirs irréalistes parmi de nombreux soldats. Dans les sociétés plus démocratiques, les impérialistes ne peuvent pas dépendre principalement de mercenaires payés, mais doivent promettre aux citoyens-soldats que leurs efforts leur apporteront la sécurité et une vie meilleure à leur retour. Motivés par cette promesse fallacieuse, les soldats crièrent : « Vive la République immortelle ! » Ils se livrèrent dans l’après-midi à un rituel républicain en plantant des arbres de la liberté ornés d’un « Il grandit chaque jour ! » Cette cérémonie était destinée à renforcer la solidarité entre Français et, comme l’a montré Lynn Hunt, à remplacer l’ancien charisme monarchique par un nouvel univers symbolique autour du corps de la république.
Parmi ceux qui participaient au corps expéditionnaire, certains eurent néanmoins conscience de la rhétorique égalitariste et en vinrent à mépriser de plus en plus les comportements de plus en plus impériaux de Bonaparte. Alors que l’on faisait route vers Alexandrie, le maître de timonerie et chef de l’atelier habillement, François Bernoyer, se rendit sur L’Orient, le navire amiral, et visita les quartiers du général. Selon son témoignage, ses pièces de réception étaient « plutôt faits pour loger un souverain, né dans la mollesse et l’ignorance, qu’un général républicain, né pour la gloire de sa Patrie ». Les officiers jouent sur une table couverte d’or : « on eut dit que nous venions de faire la conquête du Pérou ». Il ajoute : « Il règne ici une discipline des plus sévères parmi les troupes et, chez le Général, on observe l’étiquette la plus stricte : on cherche à copier les usages anciens de la cour, et cela paraît tellement ridicule qu’il nous semble voir celle d’un grand seigneur au milieu d’un camp de spartiates. » Les réalités de la hiérarchie et l’opulence au sommet contrastait selon Bernoyer avec les sentiments républicains exprimés dans les discours officiels.
Après la conquête de Malte, Bonaparte ordonna que l’on distribue aux soldats la proclamation écrite sur L’Orient le 12 juin. « Soldats ! – proclame Bonaparte – Vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. » Il déplore que des beys et des seigneurs de guerre dirigent l’Egypte, beaucoup d’entre eux étant d’anciens soldats esclaves ayant atteints les sommets, gagnés la liberté et le pouvoir, alors qu’ils étaient théoriquement vassaux du sultan ottoman. Il explique qu’ils ont commencé à faire preuve d’un favoritisme exclusif en faveur du commerce anglais et défavorisé les marchands français. Bien plus, ils tyrannisent les malheureux habitants du Nil. Il promet à ses troupes des marches épuisantes mais promet que les soldats esclaves (les mameluks en arabe), « quelques jours après notre arrivée n’existeront plus ». Il demande à son audience composée de libres penseurs, de déistes, d’athées et de catholiques romains de respecter l’Islam, Mohammed et les coutumes musulmanes, de la même manière que les Français avaient fait preuve de tolérance envers les juifs et les catholiques italiens en Europe, et il leur rappela la politique de tolérance religieuse qui était celle des troupes romaines.
Ainsi, il faisait l’amalgame entre des griefs économiques nationaux et un appel de nature universaliste à la libération des victimes étrangères du despotisme. L’intervention est nécessaire parce qu’un despote menace à la fois le pouvoir impérial et son propre peuple. En se portant à l’aide des opprimés, l’empire s’aide lui-même. Ce double objectif permettait de justifier l’expédition auprès d’un public métropolitain fatigué, et devait aider à réduire la haine qu’une intervention étrangère provoquerait dans un Etat soumis.
Au départ, Bernoyer partage l’optimisme de la rhétorique libérale. Il écrit dans un courrier destiné à la France qu’en Egypte la tyrannie exerce toujours un pouvoir absolu, laissant ses sujets mourir de faim au milieu même de l’abondance. Dans une lettre confidentielle adressée à son épouse au cours de l’été 1798, il écrit : « Bonaparte supprimera sans doute cet état de choses… » Il critique jusqu’aux pyramides comme étant un étalage réalisé par des despotes voulant rendre leur nom immortel pour un cout considérable aux dépens du peuple, et ces monuments lui apparaissent typiques de toute la tradition égyptienne jusqu’à aujourd’hui. Quant aux maisons égyptiennes, des huttes en pisé, il fait le pari que « la prospérité, fille de la liberté » permettra à leurs habitants de les abandonner. On peut ici remarquer la confiance qu’il porte dans les élections parlementaires et la règle de la loi toujours synonymes d’amélioration économique, tandis que l’oppression politique tire un pays vers le bas. Le terme « libéral » fait à la fois référence aux élections et au capitalisme. Selon ses théoriciens, le commerce serait paralysé par le despotisme mais favorisé par des institutions libérales. Pour lui, la pauvreté en France résultait de l’indolence des pauvres mais, à l’étranger, elle était le résultat du despotisme.
Jean Honoré Horace de Say, dont les mémoires ont été publiées anonymement par un dramaturge de second rang, Louis Laus de Boissy (qui fréquentait le salon de Joséphine), allait dans le même sens : « Le peuple en Égypte était très malheureux ; et comment ne chérirait-il pas alors la liberté que nous lui avons apportée ? » Il accuse l’élite égypto-ottomane de s’être emparé de la plupart des terres et d’avoir imposé au reste de la population tout un ensemble de taxes et d’impositions qui laissait à peine à la paysannerie assez pour soigner son corps et son âme. « Malheur à celui qui était soupçonné d’avoir de l’aisance ! Cent espions le trouvaient toujours prêts à le dénoncer. » Comme Bernoyer, de Say voient dans les haillons qui habillent de nombreux Egyptiens pauvres une accusation contre les beys soldats-esclaves. Tout, écrit-il, montre « l’esclavage et la tyrannie ». Il se plaint du manque de justice, des exécutions sommaires et des confiscations de propriétés privées.
De Say identifiait de manière explicite les mameluks avec l’Ancien Régime en France. Tous ceux qui ont un cœur, dit-il, voudront aller au secours des Egyptiens qui vient dans la misère. Néanmoins, fait-il observer, il y a des Parisiens qui ont critiqué la « noble opération » menée par le Directoire. Selon lui, ces critiques viennent pour l’essentiel de riches jeunes femmes appartenant à l’ancienne aristocratie « mameluk », qui n’hésitent pas à dépenser 20 000 francs en extravagance. Elles sont, rapporte-t-il, « nées dans une caste que le mamelouk Robespierre avait anéantie ». Ces femmes du monde plaidaient pour « ces malheureux beys que la rage républicaine poursuivait, disaient-elles, jusque dans les déserts d’Afrique ». Ainsi, pour De Say, les mameluks sont ici le symbole de deux choses très différentes. En tant que classe dirigeante, féodale, ostentatoire, ils sont les équivalents des dandies de l’Ancien Régime. Mais, par ailleurs, ils symbolisent aussi les radicaux sans-culottes, qui gouvernaient par l’arbitraire et la terreur. Ainsi, ces auteurs représentent l’histoire moderne française avant Thermidor et la mise en place du Directoire libéral, sous les traits d’une sorte de mamelukisme français, caractérisé soit par l’avidité aristocrate, soit par la politique sanguinaire des esclaves libérés. La République sous le Directoire serait assiégée en France par les restes de l’aristocratie et à l’étranger par les mameluks égyptiens, et ces derniers sont présentés comme sympathisants avec les premiers.
De Say écrit sur la fête tenue par les Français en Egypte au mois de septembre : « C’était un spectacle vraiment intéressant pour des Français de voir le pavillon tricolore, emblème de leur liberté et de leur puissance, flotter sur cette terre antique, où la plupart des Nations ont puisé leurs connaissances et leurs lois ; de voir que depuis Alexandrie jusqu’à Thèbes, et depuis Thèbes jusqu’aux bords de la mer Rouge, tout reconnaissait la domination de leur patrie ! » On a ainsi affaire à des intellectuels français qui défendent le Directoire et se montrent incapables de voir la contradiction entre ce discours de domination et l’idéal de libération qu’ils défendent simultanément. La « liberté », symbolisée par le pavillon tricolore et évoquée ici est la liberté des Français. Dans le même temps, partout en Egypte, il est un symbole de « domination » de cette terre étrangère par la patrie, par la mère-patrie.
Avec le temps, ce discours sur la liberté a été abandonné au profit d’une franche reconnaissance des réalités du pouvoir. La « domination de la patrie » est de toute évidence devenue plus importante que l’exportation de la liberté. Dans une lettre au général Menou au sujet de l’organisation de la ville portuaire de Rosetta, Bonaparte écrit : « Les Turcs ne peuvent se conduire que par la plus grande sévérité ; tous les jours je fais couper cinq ou six têtes dans les rues du Caire. Nous avons dû les ménager jusqu’à présent pour détruire cette réputation de terreur qui nous précédait : aujourd’hui, au contraire, il faut prendre le ton qui convient pour que ces peuples obéissent ; si obéir, pour eux, c’est craindre. » (Ce traitement sans pitié destiné aux musulmans contraste avec la manière dont Bonaparte demande avec insistance que l’on prenne soin des chrétiens coptes chargés de collecter les impôts.) Les Français de cette génération avaient une grande expérience de la terreur et de son pouvoir coercitif. Même si de nombreux officiers et savants méprisés par Robespierre et les sans-culottes et qui pour certains avaient beaucoup souffert sous leur régime, n’avaient pas totalement renoncé à l’idée que la terreur est d’abord une manifestation de justice. A la fin de l’année 1798, 15 Français naviguant sur le Nil furent capturés et tués par les villageois de Alkam. Parmi eux, il y avait Julien, un aide de camp de Bonaparte. « « Le général autant sévère que juste, ordonna que ce village serait brûlé. Cet arrêt fut exécuté avec toute la rigueur possible. Il était nécessaire de prévenir de pareils crimes par le frein de la terreur. »
Avec le temps, ces « crimes » devinrent de plus en plus importants , y compris au mois d’octobre 1798 pendant le soulèvement populaire du Caire. Après coup, De Say constate la nécessité d’habituer ces « fanatiques habitants » à la « domination » de ceux « qu’ils appellent des infidèles ». Il ajoute : « Nous devons croire qu’un Gouvernement qui garantit à chacun la liberté, l’égalité et le bonheur qui en est naturellement la suite, amènera insensiblement cette désirable révolution. » Ce type d’affirmations est si incongru, si évidemment contradictoire, qu’elle nous oblige à nous poser la question de savoir si les auteurs du XVIIIe siècle utilisaient ces mots dans un sens totalement différent de celui qu’ils ont pris dans ce début du XXIe siècle. Comment un gouvernement étranger qui insiste sur sa volonté d’imposer sa « domination » sur une population qui le considère comme illégitime (ce que signifiait sans aucun doute « infidèles » pour les Egyptiens) peut-il dans le même temps proclamer qu’il garantit la « liberté et l’égalité » à chaque Egyptien ?
Qu’est-ce que la « liberté » voulait dire pour de Say ? Cela n’impliquait évidemment pas l’auto-détermination. Dans ce monde pré-wilsonien, un empire étranger pouvait apporter la liberté et l’égalité dans un autre Etat. Il s’agissait de renverser un despote et de s’allier avec la classe moyenne locale. Pour les Français, la souveraineté populaire n’impliquait pas le droit à l’auto-détermination, mais constituait bien davantage une valeur qui pouvait être respectée dans un dessin impérial. La fiction des républiques sœurs, chacune sur le modèle du directoire, ne constituait qu’un voile jeté sur la domination de la sœur ainée, Paris. L’Egypte aussi a eu droit à son Directoire, ou Divan. Mais il ne constituait pas le gouvernement de l’Egypte. C’était le gouvernement de la République française d’Egypte. De plus, le peuple ne pouvait pas vraiment constater qu’on l’avait sauver de la tyrannie. De Say semble nous proposer une version avant l’heure de la « fausse conscience » marxiste. Les Français avaient libéré les Egyptiens, mais ces derniers étaient incapables de le reconnaître, aveuglés qu’ils étaient par le « fanatisme ». Ils pouvaient néanmoins s’habituer à la loi française jusqu’au jour où ils reconnaitraient soudainement le cadeau qui leur avait été fait.
Tous les Français ne croyaient pas aux promesses alléchantes de la terreur et de l’arbitraire. Bernoyer a observé avec horreur la « libération » de l’Egypte qui lui apparut comme une occupation militaire rude où la taxation est destinée à ce que le pays conquis paye pour sa conquête. Bernoyer rapporte combien il a trouvé détestable d’être envoyé dans un village de huttes en terre, écrasé par la pauvreté, pour réclamer plus d’impôts. Quand le chef du village se révéla incapable de réunir les sommes demandées, les Français le bastonnèrent (le frappant sur la plante des pieds). Celui qui avait dessiné les uniformes d’un nouveau corps militaire montant des chameaux fulmine contre la façon dont le général d’Armagnac fait exécuter sommairement des rebelles capturés après l’échec du soulèvement populaire du Caire en octobre 1798. Pour lui, insiste-t-il, ce n’étaient pas des criminels justement exécutés, mais des victimes : « J’appelle victime toute personne qu’on fait mourir sans jugement. » La suppression des lettres de cachet et des autres pratiques royales impliquant des décisions et des arrestations arbitraires faisait partie des revendications les plus importantes de cette génération qui avait fait la révolution. En partisan de Voltaire et de Rousseau, Bernoyer était profondément bouleversé de voir l’armée française employer des techniques de gouvernement typiques de l’Ancien régime. Pire, il s’inquiétait de voir Bonaparte ressembler aux indigènes. « Ce qui nous mortifiait au plus profond de nous-mêmes, poursuit-il, c’était que Bonaparte employait les mêmes méthodes que les mamelouks. » Bernoyer passa très vite de l’euphorie de l’espoir d’une renaissance éclairée de la nation égyptienne à la réalisation soudaine que les Français s’étaient eux-mêmes transformés en despotes orientaux.
La mésaventure française en Egypte ne dura que trois ans. Déstabilise par les révoltes locales multiples et les opérations militaires ottomanes, l’affaire se termina par une défaite face à une invasion anglo-ottomane en 1801. Le dernier commandant français, le général Menou, était allé au-delà des pires craintes exprimées par Bernoyer : il s’était dans le même temps converti à l’islam et avait dirigé les Egyptiens avec une poigne de fer. Le directoire égyptien, ou divan, fut balayé par le nouveau vice-roi ottoman, ses différents membres plaidant qu’ils avaient été contraints par la force à collaborer avec l’infidèle. Un de ses principaux membres, le religieux et historien Abd al-Rahman al-Jabarti, sénateur de la République française d’Egypte, a laissé un compte-rendu acerbe de l’occupation française, sans doute en partie pour se réhabiliter comme bon sujet ottoman. La seule pratique administrative due aux Français qui leur a survécu est la division du Caire en huit arrondissements.
Trois raisons servent typiquement de justifications à l’impérialisme libéral pendant l’occupation de l’Egypte mais aussi au cours des deux siècles suivants. D’abord, on a prétendu que le pays que l’on s’apprêtait à envahir menaçait militairement ou économiquement la métropole. Ensuite, on a dit que le gouvernement du pays concerné était si faible qu’il ne pouvait pas s’opposer aux attaques contre les intérêts de la métropole dus à des pirates, des terroristes ou d’autres puissances impériales, c’est-à-dire un tiers. Enfin, on a expliqué que les dirigeants du pays visé étaient illégitimes, imposant une tyrannie antilibérale, maltraitant sa propre population, ou d’autres raisons semblables. Le nouveau gouvernement colonial allait gagner en légitimité grâce à une bonne gouvernance et à un renouveau civilisationnel. Les théoriciens, comme Paul Wolfowitz, de la guerre initiée en 2003 par l’administration Bush ont déployé ces trois arguments pour justifier leur guerre, faisant ainsi écho à Bonaparte envahissant l’Egypte.
Les Français prétendaient que les mameluks opprimaient leurs marchands et interféraient dans le commerce méditerranéen, aux dépens de la France. Les mameluks auraient également accordé des privilèges aux Britanniques, ce qui était une autre attaque contre la France. Les dirigeants étaient représentés comme des despotes vidant le pays de sa population et opprimant leur propre peuple. Il est exact que le régime des mameluks était oppressif, en particulier à l’encontre des habitants des villes, particulièrement surtaxés, alors que le fardeau était plus supportable pour les paysans. Il n’en reste pas moins qu’il est hautement improbable que quelque Egyptien que ce soit se soit ait eu l’impression d’être « libéré » par la conquête de Bonaparte ou ait pu croire que le pouvoir français était plus légitime que le gouvernement mameluk.
L’intervention française en Egypte s’est révélée un désastre immense. L’incapacité des Français à imposer un contrôle naval de la Méditerranée a donné à la flotte britannique la possibilité de couler l’escadre française, provoquant l’échec de Bonaparte et de son armée. Les Français se révélèrent également incapables d’opérer une percée en Syrie ottomane en prenant Acre (Akka) sur la côte syrienne, les navires britanniques interceptant leurs navires transportant de l’artillerie lourde depuis Alexandrie.
Les architectes de cette vilaine aventure ne renoncèrent pourtant pas à leur conviction que cette invasion avait été une bonne idée. Dans ses mémoires, Talleyrand écrit :
« Avec quelques succès prudemment ménagés, on aurait bientôt vu des colonies européennes se former sur les côtes de l’Égypte et de la Syrie. Et dans les guerres qu’auraient suscitées les jalousies et les rivalités des princes confédérés, la France, par sa position, aurait eu d’immenses avantages que plus tard elle n’a pu retrouver dans la lutte qu’a occasionnée la découverte de l’Amérique. De nos jours, les grandes difficultés de religion étant éteintes, des arrangements commerciaux pourraient entrer dans les intérêts de toutes les puissances de l’Orient qui, par elles-mêmes, ne sont pas essentiellement navigatrices. C’est pour cela qu’à une époque de ma vie, où j’en ai eu le pouvoir, j’ai introduit dans le traité d’Amiens comme vue philosophique, afin de ne point donner d’ombrage, quelques dispositions qui tendaient à la civilisation de la côte d’Afrique. Si le gouvernement y eût donné suite ; si, au lieu de sacrifier tout ce qui restait de la belle armée d’Égypte, au vain espoir de reconquérir Saint-Domingue, on eût dirigé contre les États barbaresques cette force imposante et déjà acclimatée; il est probable que ma philosophie fût devenue pratique… »
En fait, les Français furent rapidement usés par les soulèvements populaires mais aussi les maladies locales, et n’avaient aucune chance de tenir longtemps contre les Ottomans et une attaque conjointe des Britanniques et des Ottomans destinée à les expulser d’Egypte. Bonaparte quitta discrètement le pays au bout d’un an seulement, dissimulant le désastre aux yeux du public et réussissant à se maintenir au pouvoir. En 1801, les soldats français se rendaient et revenaient en France sur des bateaux britanniques, en promettant de ne plus jamais s’opposer aux soldats de sa gracieuse majesté !