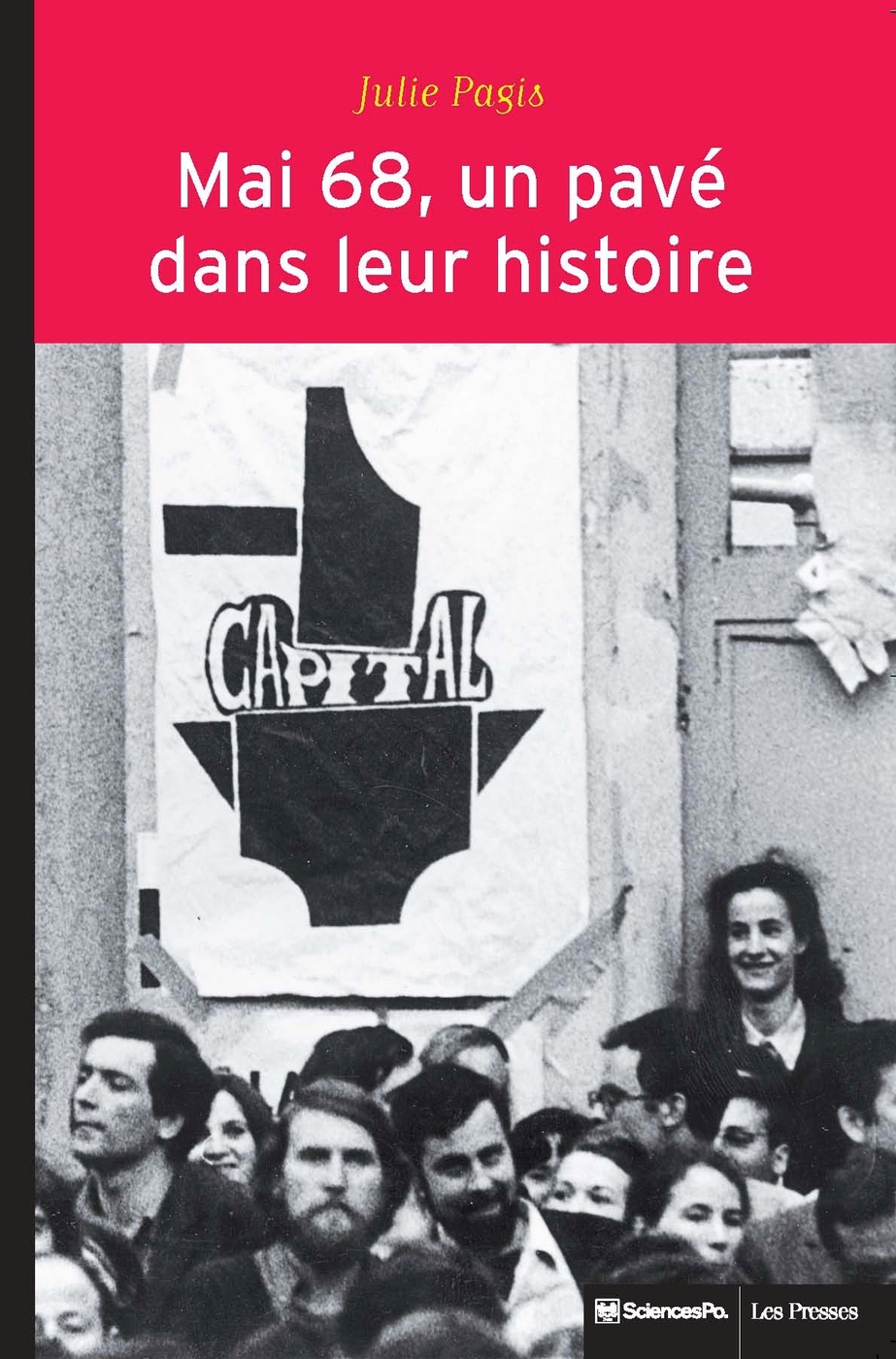
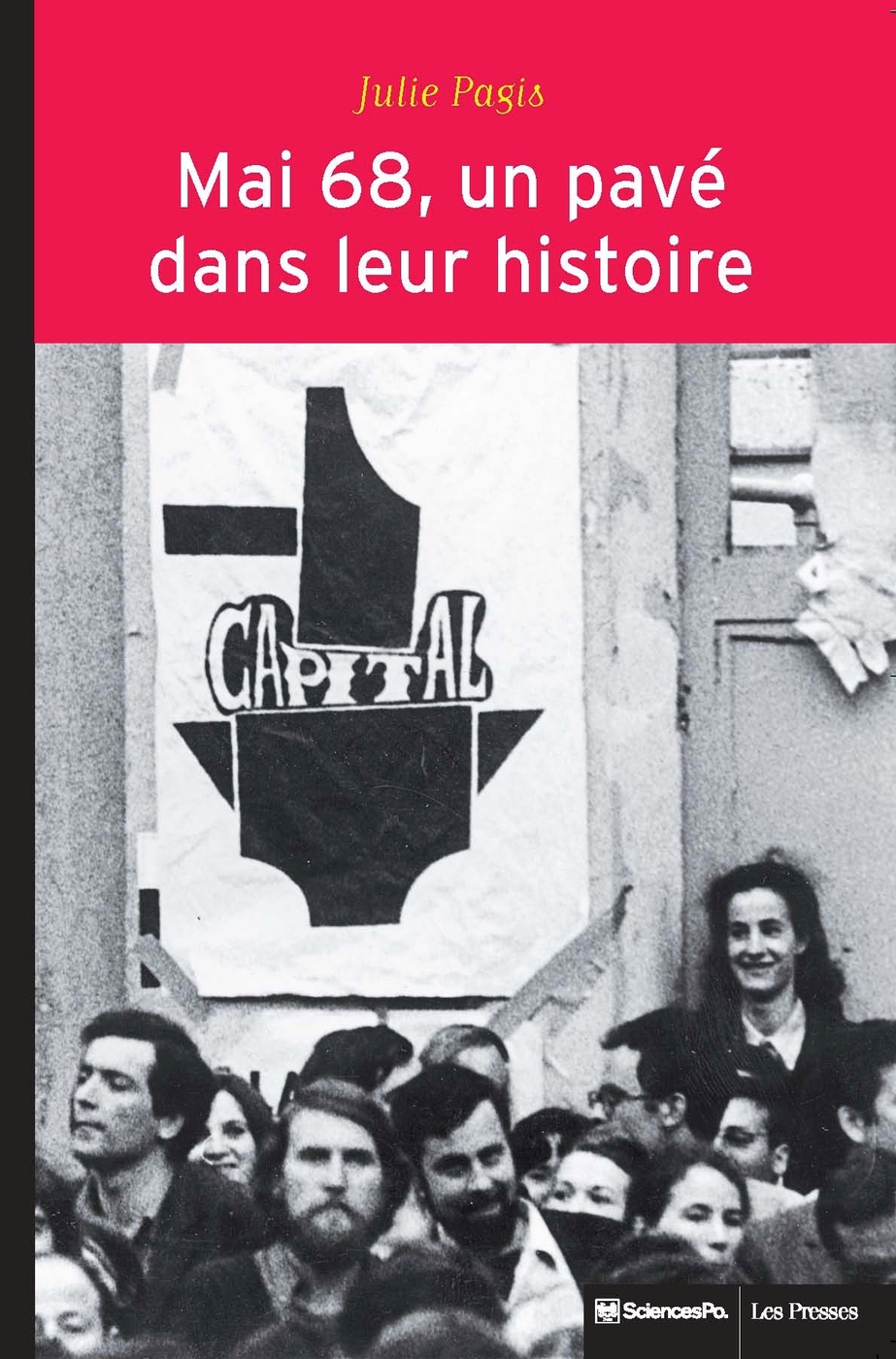
Julie Pagis, Mai 68. Un pavé dans leur histoire, Paris, Presses de Sciences Po, 2014
Julie Pagis, sociologue au CNRS, a publié en octobre 2014 un ouvrage intitulé Mai 68. Un pavé dans leur histoire , qui retrace les parcours de celles et ceux qui ont vécu Mai 68 en posant la question des effets de cet événement sur leur trajectoire professionnelle, politique, amoureuse, etc. Avec le portrait d’Anne, dont nous publions des extraits, on peut lire les effets de la « discordance entre des aspirations et les possibilités effectives de les satisfaire ». Comment rester fidèle à la contestation de l’ordre dominant après l’expérience de Mai 68 ?
1949-1968 : Le baby-boom blues
Née en 1949, Anne est issue de la petite bourgeoisie intellectuelle : son père est écrivain et sa mère documentaliste en région parisienne. Ils sont athées, votent à gauche, mais la politique ne constitue pas un objet de discussions au sein de la sphère familiale. Élevée par ses grands-parents paternels jusqu’à l’âge de six ans, Anne hérite d’une mémoire familiale marquée par la figure héroïque de son grand-père, résistant, arrêté par la Gestapo en 1944, et qui s’évade la veille de sa déportation. Elle est beaucoup moins proche de ses parents, qui l’ont eu très jeunes, et semblent peu investis dans son éducation : « Je venais d’une famille double discours : on dit qu’on aime, sans rien ressentir, on dit qu’on est de gauche, on ne fait rien. On est laïque, mais on inscrit sa fille chez les sœurs1… »
Réfractaire à l’ordre scolaire, Anne connaît une scolarité chaotique, renvoyée de multiples établissements pour indiscipline. Après avoir été congédiée d’un énième lycée, elle s’inscrit en 1967 dans un cours de théâtre à Paris, tandis que ses parents partent vivre en Bretagne. Mais Anne entre dans une phase d’anorexie et ses parents la rapatrient peu de temps après. (…) L’impossibilité d’adhérer au rapport éducatif dans la sphère familiale et une rupture d’adhésion précoce à l’autorité scolaire (traits caractéristiques de la matrice des incohérences statutaires, cf. chapitre 1) viennent renforcer ici un discours typique de la première génération à ne pas connaître de guerre (Sirinelli, 2008, p.177).
Anne vit chez ses parents en Bretagne au printemps 1968. Son père se rend au quartier latin, dès les premiers jours des événements, en spectateur. « Collée à la radio et suspendue aux journaux », Anne cherche également à rejoindre Paris, mais ses parents l’en empêchent : à 19 ans, elle est encore mineure. Elle garde de ce rendez-vous manqué un sentiment de grande frustration et l’« impression que cette génération devant [elle, ne lui] laissait pas de place. »
Quelques mois après les événements, Anne retrouve à Paris d’anciens camarades de lycée et tombe amoureuse d’un militant de la Gauche prolétarienne. Alors que ses parents comptent l’envoyer aux États-Unis et lui ont donné de l’argent pour le billet d’avion, elle achète finalement « une mobylette pour sillonner la banlieue, vivre et militer avec Alain ». Les événements de Mai-juin 68 jouent ici un rôle de socialisation de prise de conscience, dans la mesure où Anne découvre et s’approprie un langage politique qui vient donner sens à son humeur révoltée. Pourquoi, cependant, et face au large spectre de l’offre militante en 1970, Anne rejoint-elle alors une organisation maoïste ? La rencontre amoureuse est déterminante du passage à l’acte, mais c’est avant tout un sens du placement bien particulier qui explique cette orientation : « Je m’amusais plus avec les libertaires, mais je voulais absolument appartenir au truc le plus dur. » Davantage que l’adhésion à des idées (marxistes, maoïstes), l’engagement d’Anne à la GP procède de dispositions à une surenchère dans la radicalité, qui sous-tendent d’ailleurs la suite de sa trajectoire.
1970-1974 : maoïsme, établissement, théâtre, vie en communauté et premier enfant
Anne obtient son baccalauréat en candidat libre, et s’inscrit en chinois à l’Université de Dauphine en 1970. Bien que préférant les écrits de Marx à ceux de Mao – « je trouvais la littérature maoïste simpliste : j’arrivais pas à lire » –, elle n’en vend pas moins La Cause du peuple2 devant les usines Renault et sur le marché, milite activement à la GP, et donne des cours d’alphabétisation à des ouvriers algériens de Citroën : « Les pauvres, me dit-elle rétrospectivement, je leur apprenais à lire sur la Cause du Peuple ! »
En 1971, Anne rencontre Fab3, jeune artiste anarchiste, dans un théâtre de Sèvres, où il met en scène une pièce d’Artaud. Quelques mois plus tard, ils partent avec un ami s’installer à Rouvière dans les Cévennes pour y monter une pièce de théâtre militant. L’Amicale, ancien théâtre, dont ils réussissent à obtenir les clefs auprès du maire, est vite transformée en communauté. Parallèlement, Anne décide de s’établir : elle est embauchée comme ouvrière non qualifiée dans une usine de textile. Mais ses espoirs révolutionnaires se heurtent rapidement au gouffre qui sépare la théorie maoïste de la réalité de son usine (…). Anne est par ailleurs la seule militante maoïste de la communauté composée d’anarchistes, de libertaires et de « babas-cool », avec lesquels elle n’a pas beaucoup d’affinités : « Quand on se lève à cinq heures du matin, qu’on part à l’usine, et qu’on est la seule à bosser, on est nettement moins cool ! » Elle apprécie néanmoins d’y côtoyer toutes sortes de jeunes en quête de projets pour différer le retour à l’ordre (…)
L’Amicale sert ici d’espace transitionnel, au tournant de 1972, où se retrouvent des militants issus de divers groupes d’extrême gauche en quête de prophéties alternatives pour « prolonger l’inspiration utopique qui n’a pu se réaliser à l’échelle de la société toute entière » (Léger, 1979, p. 48). Dans un contexte de forte dévalorisation des engagements d’extrême gauche, l’espace communautaire amortit le choc des désillusions individuelles. Il permet ainsi aux communards4 de faire collectivement le deuil d’espoirs révolutionnaires, tout en restant fidèles à la rupture : l’espoir de « changer la société » y est insensiblement reconverti en espoir de « changer la vie ». L’espace communautaire permet ainsi de différer la refermeture du champ des possibles, et de perpétuer l’indétermination sociale par diverses formes d’exil. Ces quêtes d’ailleurs peuvent prendre une dimension spatiale dans les projets de retour à la terre, ou de voyages lointains, une dimension temporelle pour les « engouements passéistes ou futuristes » (Mauger, 1999, p. 235), une dimension psychique avec l’usage de drogues, etc.
Les communautés pallient ainsi l’absence d’institutions légitimant les communards dans ce qu’ils sont (après la disparition des organisations politiques dans lesquelles ils ont milité), et compensent le défaut d’intégration sociale5, du fait des ruptures familiales et amicales engendrées par le militantisme ou l’entrée dans la marginalité. Pour Anne, la diversité sociale et politique des communards constitue par ailleurs un moyen de perpétuer l’utopie d’une société sans classe (ou du moins le décloisonnement social) (…).
Dans ces lieux d’intenses sociabilités, certaines rencontres – amicales et amoureuses – sont à l’origine d’inflexions biographiques d’autant plus décisives qu’elles interviennent à l’âge de l’indétermination (et représentent alors autant de futurs possibles). Anne reconnaît ainsi qu’elle n’aurait pas hésité à prendre les armes si elle en avait eu l’occasion à cette époque : « J’étais perdue [après la dissolution de la GP] et j’étais à la recherche du truc, de quelque chose de plus extrême ; c’est-à-dire que si j’avais rencontré des gens qui étaient dans la lutte armée à ce moment-là, j’aurais foncé, c’est sûr : avec la mentalité que j’avais, le désir d’en découdre que j’avais, j’aurais certainement plongé (long silence). Bon, j’ai rencontré 80 % de babas, donc j’ai eu quelques envies de violence, mais c’est tout ! (elle rit) ».
À vingt-trois ans, éloignée de toute organisation politique structurée, et sans aucun avenir professionnel stable, Anne se trouve dans une situation d’« irresponsabilité provisoire » (Bourdieu, 1984) prolongée, qui la rend particulièrement réceptive aux diverses offres utopiques contre culturelles.
Faire se révolter les paysans : de désillusions en désillusions
Anne, Fab et leur troupe de théâtre finissent par donner plusieurs représentations d’une pièce de Rabelais qui connaît un vif succès auprès de la population locale, d’autant que le pasteur de Rouvière et d’autres natifs cévenols ont intégré la troupe. Forts de cette réussite, ils décident de s’attaquer à une pièce plus ambitieuse politiquement : « C’était après mes constats à l’usine : il fallait s’ouvrir à la paysannerie. On s’est dit : on va monter un spectacle pour les paysans, avec l’idée de les faire se révolter. Croyant aux vertus de l’exemple, on a monté un spectacle sur les révoltes paysannes successives. »
Anne est enceinte de six mois, quand son médecin l’arrête pour des problèmes de santé. Elle quitte l’usine où elle est établie. Peu de temps après, la troupe part faire un tour de France des communautés, et jouer sa pièce avec un succès très relatif… Le seul public vraiment réceptif est celui, singulier, de Saint-Alban : « Le principe [à Saint-Alban], c’est que les fous sortaient dans le village. Ils ont mis trois jours à calmer les pensionnaires ! Ah ben oui : on appelait à l’insurrection, donc là on a eu notre meilleur public : ils sont rentrés en insurrection sur le champ ! C’est là aussi où j’ai compris que je voulais quitter cette troupe : ils se sont moqué des fous et je ne l’ai pas supporté… Je me suis dit : mais en fait, je suis avec des beaufs, c’est pareil : ils sont aussi cons que les autres. »
Ici encore, Anne réagit selon le principe évoqué plus haut : fuir tout ce qui pourrait être perçu comme conformiste et chercher – vainement – l’appartenance la plus radicale ou la plus marginale. L’antipsychiatrie alimente sa critique des membres de la troupe renvoyés au statut de « beaufs » pour avoir pris le parti des « normaux » : posture qu’elle dénonce et traque chez les autres comme chez elle. Cette quête d’une appartenance sans compromis avec le « système » est épuisante. Pour Anne, elle ressemble de plus en plus à une fuite.
1973-1975 : communautés, LSD, départ pour New York, féminisme
En fin de grossesse, Anne est épuisée physiquement et psychiquement. Elle doute de l’opportunité d’avoir un enfant dans les conditions de vie qui sont les siennes, dans la marge la plus totale, la drogue et le dénuement6. Déçue par la vie en communauté, elle persuade Fab de partir vivre à Montpellier, afin notamment de reprendre des études. Mais la vie communautaire la rattrape : Fab et ses amis se réinstallent en communauté dans l’Aveyron et Anne, qui vient d’accoucher de Mikaël, n’a d’autre solution que de les suivre. Elle ne s’étend pas sur la période qui suit, où elle connaît le froid, la faim, la grande difficulté matérielle et morale d’élever quasiment seule son nourrisson, et les inévitables tensions au sein des communautés. Toujours en résistance, Anne bouscule alors ses propres limites corporelles et psychiques, jusqu’à l’hospitalisation : « C’est dur à expliquer : quand j’ai été hospitalisée à force de n’avoir rien à manger, et que le médecin qui m’a soignée n’en revenait pas, j’étais en accord avec moi-même. C’est dur à faire comprendre : j’étais sûre d’être dans le vrai parce que je payais de ma personne. […] J’ai grandi comme tout le monde au pays des mensonges, au pays des résistants, tu parles, des républiques populaires qui ne l’étaient pas, des grands silences derrière les célébrations, sans parler des formidables ressources familiales, nous connaissons tous cela, alors mon corps qui morfle, ça me paraissait vrai, exact, juste. […] La principale question que je me posais alors, je vous jure que j’y pensais chaque jour, c’était : jusqu’où suis-je capable de résister ? Et à quoi ? […] »
Anne « se lance à corps perdu dans une entreprise de dénonciation dont le risque corporel contribue à asseoir l’authenticité, comme […] dans le cas du martyre » (Boltanski et Thévenot, 1991, p. 283) cherchant par d’autres moyens à (re)vivre la Résistance à une échelle personnelle. Le spectre de la seconde guerre mondiale, déjà analysé comme déterminant de l’engagement chez Paul ou Colette, est tout aussi essentiel dans la trajectoire d’Anne qui évoque à un moment de l’entretien le fait que la guerre ne finit pas mais se continue avec d’autres moyens.
En 1973, Fab et Anne rentrent à Paris, là encore rattrapés par la marge : « On s’est retrouvés à la rue complète, et cette amie psychiatre de Saint-Alban nous a prêté une chambre de bonne pour tenir : j’étais arrivée à une sorte de point de non-retour… »
Anne vit de petits boulots, de traductions, notamment d’articles pour Playboy. Elle aide le week-end son ami Laurent, un centralien rencontré quelques années plus tôt en communauté, à rénover une péniche, discutant de linguistique sous LSD. Gagnant un peu d’argent, elle réussit à louer un petit appartement et exige de Fab qu’il n’y ramène aucun de ses amis… en vain. À ce stade d’avancement dans la carrière marginale, il n’est pas aisé d’en sortir. Le capital social est alors déterminant des conditions de sortie de la marginalité: « Laurent a vendu sa péniche, il est arrivé un soir et m’a dit : écoute, c’est vital pour toi, tu te casses, et il a balancé un paquet de fric ; le lendemain j’ai acheté un billet pour New York. »
Anne confie Mikaël (qui a alors à peine plus d’un an) à Laurent, la seule personne de son entourage en qui elle peut avoir confiance, me dit-elle, le père de Mikaël étant alors « trop défoncé ». À New York, elle découvre que la jeune fille au pair qu’elle avait connu, enfant, est une militante active du Gay Front. Cette dernière l’introduit dans les milieux féministes radicaux et Anne se souvient avec émotion avoir ainsi côtoyé, peu de temps après l’avoir lue, Kate Millett. Elle est alors « happée dans le mouvement féministe le plus extrême. Pendant quelques mois, Anne sillonne les États-Unis en quête d’appartenances diverses « comme une promeneuse plutôt qu’un membre actif… tout en cherchant frénétiquement à adhérer totalement ». En 1974, de retour auprès de son fils, elle sait qu’elle veut dorénavant sortir de la marge. Mais cela va prendre plusieurs années.
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
références
| ⇧1 | J’ai réalisé un entretien avec Anne à son domicile le 2 juillet 2008, puis nous avons continué à échanger par courriels dans les mois qui ont suivi. |
|---|---|
| ⇧2 | Journal de la Gauche prolétarienne. |
| ⇧3 | Fab a été abandonné à sa naissance, recueilli dans plusieurs familles d’accueil avant d’arriver à la maison de Sèvres, orphelinat tenu par des anarchistes. |
| ⇧4 | Terme utilisé par Bernard Lacroix notamment pour qualifier les membres des communautés (Lacroix, 1981). |
| ⇧5 | Pour Michel Voisin, la solution communautaire « réalise une sorte de mobilisation collective dans la débandade » (Voisin, 1977, p. 300). Bernard Lacroix décrit également le rôle intégrateur des communautés, mais il le rapporte me semble-t-il trop rapidement au déclassement des communards qui produirait leur exclusion sociale (Lacroix, 1981, chapitre 4). |
| ⇧6 | Anne explique en entretien avoir regretté assez vite ce projet d’enfant qui était, selon elle, « aussi utopique que le projet théâtral, la vie en pleine garrigue, le retour fantasmé à la terre ». Pour une analyse de la trajectoire de cet enfant, Mikaël, de son éducation contre culturelle et de son devenir, voir Pagis (2015, à paraître). |