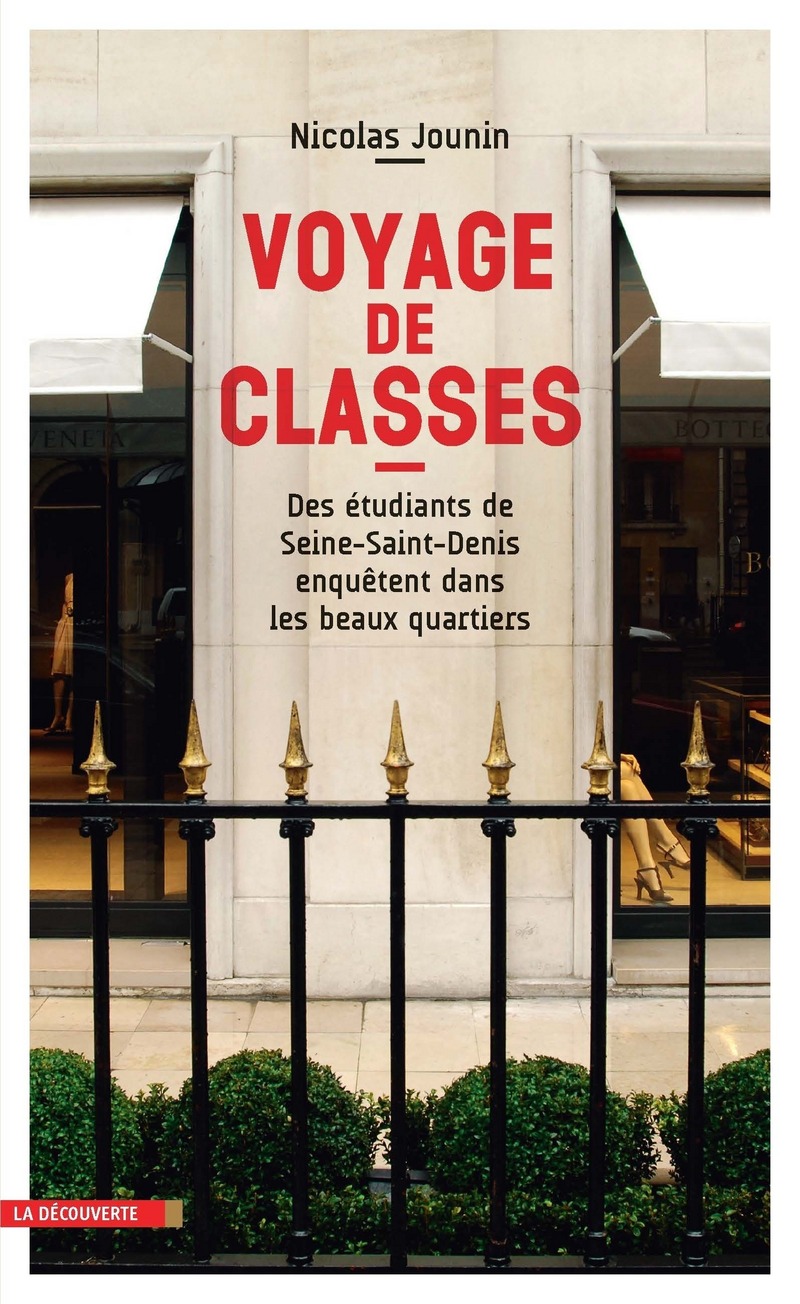À lire : un extrait de « Voyage de classes » de Nicolas Jounin
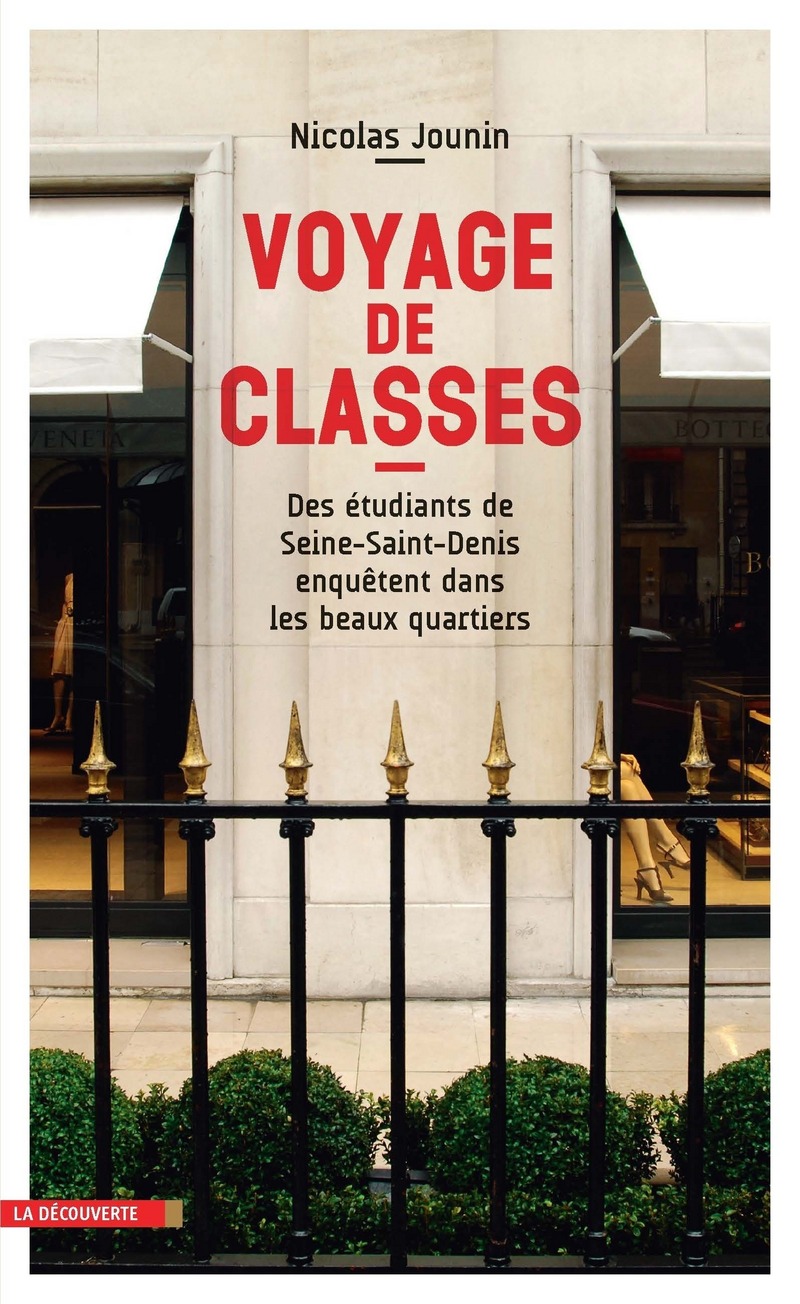
Nicolas Jounin,Voyage de classes. Des étudiants de Seine-Saint-Denis enquêtent dans les beaux quartiers, La Découverte, 2014. 209 p.
Conclusion
« Malinowski alla aux îles Trobriand et étudia des populations qu’il n’aurait probablement pas aimé inviter à dîner ; Radcliffe-Brown étudia les habitants des îles Andaman qui mangeaient du cochon cuit à la broche – cela s’appelle l’anthropo- logie, l’étude de l’homme. Lorsque nous nous sommes mis enfin à étudier les populations qui se trouvaient ici, dans nos propres villes, nous avons appelé cela la “sociologie”, l’étude de nos conci- toyens. Dans les deux cas, notre but n’était pas d’étudier les populations qui sont les plus proches. Nous continuons à étudier les populations qui sont relativement défavorisées. En pratique, nous gardons l’idée qu’il y a ceux qui ont un mandat pour faire des études, et ceux dont le destin est d’être étudiés afin d’être préservés comme les abo- rigènes, ou afin d’être éclairés et réhabilités. Mais, que nous nous nommions anthropologues ou sociologues, nous nous acheminons vers l’égalité avec ceux qui sont les objets ou les sujets de nos études. Nous pourrons un jour n’étudier que nos égaux, c’est-à-dire des gens qui pourraient très bien nous étudier. »
Everett C. Hughes.
Sonder un fossé qui se creuse
Quand on vient de Saint-Denis, explorer des quartiers qui sont parmi les plus riches de France, aller à la ren- contre de leurs habitués, c’est faire un grand écart. Pour le réa- liser, on a intérêt à avoir les tendons encore plus souples et allongés qu’il y a trente ans, car le fossé des inégalités écono- miques s’est creusé. Dans ces quartiers vivent des représen- tants d’une classe qui a tiré le meilleur parti de la « crise » ouverte dans les années 1970. En fait de crise, il faut plutôt voir un régime de croissance économique réduite (en regard des « Trente Glorieuses », exceptionnelles à l’échelle de l’his- toire de l’humanité), mais toujours positive. Cet affaissement relatif a été l’occasion et la justification de la remise en cause des compromis, salariaux notamment, tissés entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 1970, et de la répartition des richesses qui en découlait. Alors que les longues batailles et les ruptures brutales du XXe siècle avaient réduit les inégalités économiques (et notamment l’incroyable concentration de richesses par une petite minorité qui avait marqué le XIXe siècle), les dernières décennies ont vu un mou- vement inverse. Ainsi, depuis le début des années 1980, la part des richesses produites revenant aux salaires a diminué, pen- dant que celle affectée aux profits a augmenté. Les détenteurs de capitaux ponctionnent une part accrue des richesses pro- duites.
En France comme dans bien d’autres pays, les inégalités de revenus et de patrimoines augmentent. En 2001, les 10 % de ménages les plus riches percevaient un revenu moyen (après redistribution) six fois supérieur aux 10 % de ménages les plus pauvres ; en 2011, c’est sept fois plus. La récente crise exacerbe plutôt qu’elle n’atténue ce mouvement : entre 2008 et 2011, les revenus des ménages les plus riches ont augmenté, tandis que ceux des plus pauvres ont diminué. Désormais, les 10 % les plus riches s’approprient une part des richesses pro- duites dans l’année plus élevée que celle perçue par les 50 % les plus pauvres.
Le patrimoine, c’est-à-dire le stock de ce que possèdent les individus, est encore plus inégalement réparti, et, là aussi, à l’encontre du mouvement des trois premiers quarts du XXe siècle, les inégalités se creusent depuis une quarantaine d’années. En 2010, les 10 % les plus riches concentrent 62 % du patrimoine, tandis que les 50 % les plus pauvres n’en détiennent que 4 % ; les premiers détiennent un patrimoine moyen quatre-vingts fois supérieur aux seconds. Au niveau mondial, les estimations sont plus difficiles mais les inégalités apparaissent encore plus béantes, puisque les millionnaires en dollars, moins de 1 % de la population, posséderaient plus de 40 % des richesses. Même imparfaite, une telle mesure mon- diale est nécessaire, car les richesses sont produites et transi- tent à l’échelle planétaire, et elles sont accaparées par quelques centres. Les quartiers bourgeois de Paris abritent des habi- tants qui doivent leur prospérité à des rapports d’exploitation déployés mondialement.
Revenons à la France, et rentrons dans les détails de la for- tune. Pour la plupart des gens qui possèdent quelque chose, la propriété de son logement constitue la partie la plus impor- tante du patrimoine. Mais pour les plus riches s’ajoute une composante majeure : le patrimoine financier. Si les revenus des riches et, parmi ces derniers, des plus riches d’entre eux ont augmenté au cours des dernières années, c’est notam- ment grâce à leur patrimoine (immobilier et surtout finan- cier), qui leur assure un flux de revenu croissant. Alors que, pour la majorité des ménages, les revenus du patrimoine repré- sentent moins de 5 % du revenu, les 10 % les plus riches en sont bien plus dépendants puisque ces revenus-là constituent plus d’un quart de ce qu’ils gagnent. Plus on est aisé, moins on tire ses revenus de son travail et plus on les obtient grâce à ce que rapporte son patrimoine : la majeure partie des revenus des 0,1 % les plus riches en est le produit.
Cette richesse se transmet : le compteur d’euros n’est pas remis à zéro à chaque nouvelle génération. Les inégalités se reproduisent donc. On l’oublie parfois – et la sociologie a peut- être contribué à cet oubli en s’intéressant davantage à la trans- mission de la culture dominante qu’à celle des ressources directement exprimables monétairement –, l’argent circule de génération en génération. Il peut faire l’objet d’une transmis- sion sans contrepartie, sous la forme d’un don ou d’un héri- tage. En 2010, les deux tiers des patrimoines des individus en sont issus (et un tiers seulement vient de l’épargne), contre un peu plus de 40 % en 1970. Les catégories sociales sont iné- gales devant cette transmission de richesses : les chefs d’entre- prise, les cadres, les membres de professions libérales donnent ou lèguent à leurs enfants des montants bien plus élevés que les employés ou les ouvriers ; et, au sein de ce volume déjà supérieur, ils transmettent une part plus importante de valeurs mobilières (actions ou obligations), c’est-à-dire des valeurs permettant l’appropriation directe d’autres valeurs, un droit de tirage sur les richesses produites dans la société. Lorsqu’on vise l’aisance financière, il redevient plus intéres- sant de convoiter un héritage que des postes bien rému- nérés.
Derrière ces individus et ces montants qui s’additionnent, il y a plus que des atomes agrégés par la seule magie de la mise en chiffres. Une partie des riches sont liés entre eux davan- tage que par la connexion abstraite des catégories statistiques. Ils sont rattachés par des affiliations, des réseaux, des organi- sations, des allégeances, qui vont du conseil de quartier (bour- geois) jusqu’au Cercle de l’Union interalliée, en passant par les rallyes ou les écoles privées. Les riches ne font pas que se res- sembler, ils s’assemblent, multipliant les occasions de ren- contres et d’alliances. Dans ces moments, ils mêlent souvent l’utile à l’agréable, la défense des intérêts à la sociabilité, la mise en œuvre d’une solidarité interne à la production d’une culture spécifique. La densité de leurs relations sociales, l’étendue et la robustesse du maillage qu’elles permettent de tisser paraissent supérieures à celles d’autres classes. C’est ce qui fait dire à Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot que,
« classe en soi et classe pour soi, [la bourgeoisie] est la seule aujourd’hui à prendre ce caractère qui fait la classe réelle, à savoir d’être mobilisée ».
Il y a donc un fossé, un gouffre peut-être, qui s’ouvre devant de jeunes étudiants de première année de sociologie sommés d’enquêter sur quelques-uns des quartiers abritant la bourgeoisie. Une distance sociale se révèle, et il a fallu l’arpenter, dans le double sens du mot : la mesurer et la par- courir. Faisant face au dépaysement et, pour la première fois, aux exigences de la méthode sociologique, les étudiants ont dû naviguer entre deux écueils. Le premier est le sentiment d’écrasement social, la sensation sinon d’être inférieur, du moins d’être (mis) à l’écart du monde exploré. Ce sentiment risque d’annihiler toute volonté de savoir, de détruire le projet même de l’enquête. Nous n’en sommes jamais arrivés là. Mais c’est un spectre qui planait chaque fois que les étudiants ont été traités ou se sont perçus comme des intrus ou des infé- rieurs. En mettant en commun les expériences, par des discus- sions hebdomadaires et des écrits collectifs réguliers, nous avons pu, sinon anéantir ce sentiment, du moins le mettre suf- fisamment à distance pour préserver, voire accroître la capa- cité et la détermination d’enquêter. Ce livre espère poursuivre ce travail en donnant envie à d’autres de se lancer dans ce genre d’investigations avec une anxiété qui, si elle ne disparaît pas, peut du moins être raisonnée et canalisée.
Un autre écueil est celui de l’exotisation. Devant un tel dépaysement, les étudiants risquent de généraliser et essentia- liser, c’est-à-dire que, en découvrant quelques traits spéci- fiques qui leur apparaîtraient particulièrement étranges, ils croiraient pouvoir en déduire la nature profonde et uniforme de la classe bourgeoise. Une telle posture oublie de prendre en compte les clivages internes, la diversité des positions et prises de position au sein du milieu étudié. Si les étudiants de Saint- Denis n’ont pas toujours échappé à ce travers, ils étaient peut- être davantage préparés que d’autres à en percevoir les dérives, estimant fréquemment que les milieux auxquels ils appartien- nent eux-mêmes sont victimes de commentaires exotisants et de généralisations abusives. En menant des incursions répétées sur le terrain, en utilisant différentes méthodes, les étudiants ont braqué différents projecteurs sur le 8e arrondis- sement, permettant de faire droit à une complexité qui est sou- vent refusée aux quartiers dont ils sont issus.
Pour autant, la découverte de la complexité ne doit pas amener à dissoudre la volonté de savoir dans l’infinie variété des cas d’espèce. Chaque cas est particulier, tout en participant d’un ensemble que la sociologie se donne pour tâche de des- siner. Renoncer à rapprocher les cas, à établir des équivalences, par peur des généralisations abusives, c’est aussi renoncer à l’analyse. L’analyse, autant que possible, décompose la réalité dans ses particularités les plus infimes, mais tente dans un second temps d’en faire remonter une synthèse, c’est-à-dire quelques énoncés généraux permettant une compréhension sinon globale, du moins plus large que d’ordinaire. Au risque de heurter une certaine morale humaniste vantant l’irréducti- bilité et l’incommensurabilité de toute vie humaine, il s’agit de mettre en rapport, de comparer, au besoin de mesurer des facettes, des expériences d’individus divers ; de réduire la variété infinie des existences observables et des interprétations qu’en proposent les acteurs pour en augmenter l’intelligibilité.
Ce travail de réduction de la réalité à quelques énoncés est contrôlé par la collecte de données empiriques qui viendront confirmer ou infirmer le cadre d’analyse ; et par d’autres recherches, d’autres interprétations, c’est-à-dire des entre- prises concurrentes de réduction de la réalité à des fins d’intel- ligibilité. Ce travail est infini car des choses nous échappent toujours ; elles pourront être récupérées et mises en valeur par d’autres recherches, d’autres perspectives. Mais, si l’on ne réduisait pas, la réalité s’enfuirait tout entière, et on s’interdi- rait d’en comprendre le moindre bout.
Si l’on est convaincu que l’objectivation (entendue comme processus tendant vers l’inatteignable objectivité) est une réduction, mais aussi qu’une telle opération en vaut la peine, on peut dans un second temps se demander de qui émane cette opération et vers qui elle se tourne. Qui est objec- tivé, c’est-à-dire pris pour objet ? Qui voit ses pratiques et ses discours, ses origines et ses représentations, ses bénéfices et ses privations, ses trajectoires et ses attitudes décortiqués ? Qui est réduit par l’analyse ? Comment se distribuent les places de réducteurs et de réduits, les regards objectivants et les cibles objectivées ? On pourrait esquiver cette question en répon- dant que l’objet de la sociologie est constitué par les rapports sociaux, et non les populations qui en sont le produit. Dans cette perspective, une population quelconque n’est jamais l’objet de l’étude, elle n’en est que le terrain. Une telle précau- tion est bienvenue, mais ne suffit pas à enterrer le problème. Certes, il n’y a pas de pauvres sans riches, d’exploités sans exploiteurs, de femmes sans hommes, de Noirs sans Blancs, de discriminés sans discriminateurs, et c’est le rapport qui lie les uns aux autres qui constitue l’objet d’étude. Il reste que l’enquête elle-même s’installe dans un ou quelques points précis de l’espace social.
Le choix du lieu où l’on s’installe n’est jamais unique- ment scientifique. Scientifiquement, tout point de l’espace social peut devenir un terrain d’enquête, et tous les terrains d’enquête sont équivalents : chacun offre une perspective sur les rapports sociaux qu’on entend étudier. Parce que les cher- cheurs en sciences sociales ne sont pas doués d’ubiquité, parce qu’ils sont limités par les moyens économiques qui leur sont alloués à un moment donné, ils ne peuvent bien sûr constituer tous les points de l’espace social en terrains d’enquête. Dans cette grande masse largement inconnue, ils effectuent périodi- quement une plongée, un coup de sonde, et cherchent à éta- blir des liens entre les sites explorés. Pourquoi à tel endroit plutôt que tel autre ? Il faut faire des choix. Ces choix sont dictés par des considérations scientifiques, mais aussi person- nelles, liées aux origines et trajectoires personnelles du cher- cheur, à sa sensibilité, son système de valeurs, sa perspective politique. Si le choix de la cible dépend de celui qui vise, alors, pour comprendre le type de recherches et de problématisa- tions sociologiques susceptibles d’émerger, il faut aussi tourner le regard vers la personnalité de ceux qui sont amenés à faire ces choix, leurs profils, les catégories dont ils sont issus, les régions de l’espace social où ils se sont construits, les affects et les intérêts qu’ils portent. Qui sont ceux qui s’autorisent à chercher et discourir sur l’existence de leurs congénères ? Une élite confinée ou une part massive et diversifiée de la popula- tion ? Des personnes originaires de catégories favorisées ou de groupes souffrant de privations et de déconsidérations ?
Une forme pédagogique à contre-courant
Le travail d’enquête mené par les étudiants fut une découverte d’autrui. Cet autrui n’a rien à voir le fantasme de peuplades introuvables, qui entretiendraient quelque part un mode de vie radicalement différent du nôtre, et qui sur- tout n’auraient eu aucun lien préalable avec notre société. Ici, il s’agit simplement d’autres membres de la même société, au mode de vie particulier certes, mais dont les fondements, les conditions et même les raisons de vivre s’éclairent par la mise en lumière de rapports sociaux dont participe tout un chacun, y compris l’enquêteur. En explorant un point éloigné de l’espace social, on élargit son champ de vision, on apprend à envisager sa propre existence dans un monde plus vaste dont elle dépend. Une telle démarche de recherche, sur un terrain apparemment exotique, est aussi, en fait, une introspection sociologique, car elle conduit à se demander : quelle est ma place en regard de celle des personnes que je suis en train d’étudier ? Quelles conditions de vie et quelles mentalités en sont le produit, par comparaison avec celles de ces personnes ?
La sociologie s’intéresse aux différentes manières qu’ont les humains de s’associer entre eux afin de réaliser certaines choses (produire, manger, éduquer, habiter, connaître, mourir, prendre soin, se divertir, avoir des relations sentimen- tales, sexuelles, amicales, expliquer le sens des existences, définir la part qui revient à chacun… et arbitrer les incerti- tudes et litiges qu’engendrent toutes ces activités), et elle met souvent l’accent sur les asymétries et antagonismes qui les pro- duisent et qu’elles produisent. Elle enregistre les controverses qui éclatent ou sourdent de ces activités, et y participe par la fabrication de nouvelles connaissances. Elle n’a donc pas pour ambition de décrire un homme moyen (encore moins un Français ou un Allemand ou un Malien moyen), mais une configuration collective, l’ensemble des relations tissées entre les êtres humains et des positions relatives qui en découlent. Vaste programme, interminable même, dont les frontières avec les autres sciences humaines ou le journalisme sont d’ail- leurs poreuses. Comme dans toute autre forme de science, ce que l’on découvre est aussi une découverte sur soi-même, puisque mieux comprendre le monde, c’est mieux comprendre la place qu’on y occupe. L’introspection sociologique permet de considérer sa propre vie comme une expérience socialement et historiquement située ; de l’objec- tiver comme un cas particulier, non parmi des cas identiques, mais au sein d’une constellation différenciée (et inégalitaire) d’existences.
Par conséquent, chaque personne est porteuse d’un bout de réalité du monde social, donc d’un bout de vérité de la dis- cipline sociologique. Cette idée fut utilisée dans un cadre pédagogique par certains sociologues de l’école de Chicago dès les années 1930 et 1940, enthousiasmés par la diversification de leur public étudiant. Provenant de couches variées de la société étatsunienne, dont certaines étaient jusque-là tenues à l’écart de l’université, les étudiants apportaient avec eux une multiplicité d’origines et de trajectoires qui nourrissaient la connaissance et la réflexion sociologiques. Dans son texte inti- tulé « L’enseignement comme travail de terrain », publié en 1970, Everett C. Hughes revient sur l’usage indissociablement pédagogique et scientifique qui fut fait de cette diversité :
« Chacun ajoute une nouvelle dimension ou un nouveau cas qui doit être compatible avec le cadre d’analyse – ou même qui nécessite un changement de cadre d’analyse destiné à donner une place à l’information nouvelle qu’il comporte. Ainsi, les étudiants donnent à l’enseignant des idées nouvelles et des données, et ils reçoivent en retour. » Que reçoivent-ils ? « Le professeur de sociologie était celui qui pouvait écouter leurs histoires, pas simplement comme quelqu’un à qui on confesse un sentiment de culpabilité et de honte, mais comme quelqu’un qui considère leur cas particulier dans une perspec- tive plus large. Ainsi leur cas personnel prenait place dans la comédie humaine, et eux-mêmes prenaient place dans un monde plus vaste.»
Cette utilisation de l’expérience des étudiants permet de transformer le rapport pédagogique. L’enseignant n’est plus le détenteur suprême du savoir, dont il distribue quelques miettes avant de vérifier qu’elles ont bien été digérées, tandis que l’étudiant, même zélé, ne peut que reproduire un savoir inférieur, tout entier englobé par celui de l’enseignant.
Lorsque l’enseignant sollicite les expériences des étudiants, il aide à les accoucher, à les mettre en forme, à les mettre en rap- port avec d’autres expériences, à tisser des liens féconds, mais il le fait à partir d’une matière qui lui échappe. Les étudiants deviennent producteurs de connaissances plutôt que consom- mateurs passifs ; ils disent et expliquent des choses que l’ensei- gnant ne sait pas ; ils ont quelque chose en propre à apporter à la grande entreprise de compréhension du réel.
Mais les étudiants peuvent apporter davantage encore. Rien n’oblige à les confiner dans une mise en forme de ce qu’ils ont personnellement vécu, à leur faire observer les lieux et interroger les individus du milieu de leur socialisation. L’enseignant peut donner aux étudiants pour consigne qu’ils mènent l’enquête dans des zones de l’espace social dont ni lui ni les étudiants ne savent rien. Ce n’est plus l’enseignant qui circule parmi les existences des étudiants, mais l’enseignant et les étudiants qui vont ensemble à la découverte d’autres exis- tences. Les étudiants n’ont dans ce cas pas de savoir préalable sur leur objet d’étude, mais ils vont construire et acquérir des connaissances que personne d’autre ne détient. Ainsi, ils gar- dent toujours par-devers eux un savoir propre que l’ensei- gnant ne maîtrise pas. Dans ce cas, le rôle de l’enseignant est de vérifier les conditions d’obtention de ces connaissances, la qualité de leur communication et de leur mise en rapport avec d’autres connaissances déjà constituées. On conserve l’apport propre des étudiants, tout en ne limitant pas l’investigation aux seuls milieux dont ils sont issus – sans quoi, à Paris-8, nous ne pourrions jamais rien savoir des quartiers les plus bour- geois.
Le rapport au savoir construit par un enseignement de ce type contribue à transformer la relation pédagogique : l’ensei- gnant n’est pas le gardien d’un savoir pétrifié qu’il distille à la piétaille ignorante, mais juste quelqu’un qui a déjà emprunté le chemin menant à la production de connaissances et qui, sorti plus expérimenté de ce parcours, accompagne les étu- diants qui tentent de faire de même sur d’autres sujets (ce qui permettra en même temps à l’enseignant d’apprendre plus de choses et de devenir encore plus expérimenté). Entre le cours d’amphithéâtre et le cours d’enquête, il y a une différence dans le régime de présentation du savoir : dans le premier cas, il est présenté comme une chose extérieure, clairement identifiée et empaquetée, qui doit simplement circuler de la chaire à l’audi- toire ; dans le second, le savoir apparaît comme une œuvre toujours inachevée à laquelle chacun est susceptible de parti- ciper. Alors les théories (et parmi elles les théories sur les méthodes) peuvent perdre le caractère intouchable que confère la parole magistrale, pour prendre le statut d’outils ser- vant à rendre intelligible le monde que l’on étudie – des outils que l’on peut mettre en œuvre, mais que l’on peut aussi criti- quer et délaisser lorsqu’on juge qu’ils ne fonctionnent pas.
Derrière ce type d’enseignement, il y a donc l’idée que, selon la formule lapidaire d’Hélène Cixous, « il n’y a pas de savoir, il n’y a que de la recherche ». Ce n’est pas une attaque contre les gigantesques et vénérables connaissances patiem- ment édifiées par nos prédécesseurs. C’est affirmer plutôt que même l’acquisition et l’organisation de ces connaissances résultent d’un processus de recherche, c’est-à-dire de prospec- tion, d’analyse et de tri. C’est justement parce que le stock de données et de théories cherchant à leur donner sens est trop énorme pour être assimilable par un être humain que l’appro- priation de certaines d’entre elles (plutôt que d’autres) est le résultat d’un parcours particulier. Ce parcours n’est pas forcé- ment solitaire ; il est encadré, collectivement, institutionnelle- ment, matériellement, et se traduit par exemple par des manuels. Mais le fait que l’entreprise soit collective n’enlève rien à son aspect contingent : d’autres tris, d’autres choix que ceux qui ont effectivement été réalisés auraient pu être opérés. On le vérifie parfois lors de revirements spectaculaires : par exemple Tocqueville, incontournable « père fondateur » de la sociologie d’après les manuels de la discipline, ne l’est en fait devenu qu’un siècle après sa mort (et sans employer lui- même le mot « sociologie »), à la faveur d’une importation par Raymond Aron dans le champ des sciences sociales. En revanche, qui connaît sa contemporaine Harriet Martineau, auteure britannique ayant traduit Auguste Comte (l’inven- teur du mot « sociologie ») et ayant comme Tocqueville tiré un ouvrage de sa propre enquête aux États-Unis, associé à un second ouvrage pionnier consacré exclusivement à la manière de collecter des données par l’enquête (et notamment à la tenue du journal de terrain) ? Dans un tel exemple, la contingence du tri opéré entre les auteurs canoniques et les oubliés se mue en arbitraire sexiste. Cela montre, plus généra- lement, que l’invocation de théories et de connaissances déjà sédimentées passe par un processus actif de sélection – il n’y a pas de legs transparent et indiscutable –, tout comme l’enquête empirique passe par une sélection des informations disponibles – car ces dernières ne s’imposent jamais « d’elles- mêmes » à l’enquêteur.
C’est pourquoi, plutôt que d’opposer les enseignements « théoriques » aux enseignements « méthodologiques » (et de reconnaître un plus grand prestige aux premiers, comme c’est souvent le cas), je vois plutôt une distinction entre les cours qui s’efforcent de présenter le savoir sous la forme d’une tenta- tive toujours inachevée, d’un corpus toujours discutable, d’une boîte à outils riche et complexe mais nécessairement imparfaite et incomplète, et ceux qui offrent un beau paquet de certitudes établies et d’auteurs incontestables. Contre l’ordre établi du savoir, ma préférence va aux enseignements qui permettent de voir et sentir qu’on a affaire à un champ de batailles où il faut prendre parti et s’engager.
L’université est une institution qui devrait tout particuliè- rement stimuler un tel rapport au savoir. Cela ne signifie pas qu’il ne peut exister d’enseignements de ce type plus tôt dans le cursus ou ailleurs dans l’enseignement supérieur. Mais c’est l’université qui, déjà, réunit le plus intimement enseigne- ment et recherche, diffusion et production de connaissances, et qui donc devrait être le fer de lance de l’enseignement à la recherche. Puisque les pouvoirs publics affichent l’objectif d’amener 50 % d’une classe d’âge au niveau licence, ce serait l’occasion de fabriquer assez largement un rapport actif au savoir.
L’objectif des 50 %, s’il est atteint, le sera principalement grâce à l’université. Les filières sélectives de l’enseignement supérieur – sections de techniciens supérieurs (STS) et diplômes universitaires de technologie (DUT) à un pôle, grandes écoles à un autre –, parce qu’elles sont contingentées, ne recevront qu’une petite partie des nouveaux étudiants, tout comme elles n’accueillent aujourd’hui qu’une minorité des inscrits. Mais il y a un problème de taille : en période d’aus- térité budgétaire, les universités n’ont pas les moyens de pour- suivre la massification de l’enseignement supérieur. Faussement rendues autonomes par les réformes des dernières années, elles voient leurs dotations budgétaires gelées et nom- breuses sont celles qui basculent dans le déficit. Pour en sortir ou pour l’éviter, les universités procèdent à des coupes, lais- sent les effectifs gonfler dans les salles de classe ou bien pré- viennent cette croissance en faisant une sélection discrète, au bord de l’illicite, des candidats aux études. Elles ne tarderont probablement pas à réclamer l’augmentation des droits d’ins- cription.
Pour faire face à cette contradiction entre le mot d’ordre de 50 % d’une classe d’âge au niveau licence d’un côté, et des moyens réduits de l’autre, les pouvoirs publics semblent opter pour deux voies : transformer les licences en « collèges univer- sitaires », sortes de duplications du lycée dédiées à l’enseigne- ment et d’où la recherche (et l’enseignement à la recherche) serait bannie ; et développer les cours en format numérique, diffusés massivement à des publics hétérogènes. C’est la réin- vention du savoir à sens unique, l’écran venant remplacer la chaire qui sépare l’enseignant des étudiants. Une telle perspec- tive a du moins le mérite d’obliger les enseignants de l’univer- sité à réfléchir à leur pédagogie : ils ne pourront s’opposer aux cours en ligne au nom de la vieille université qui fait du cours d’amphithéâtre la clé de voûte de l’enseignement ; ils devront s’engager résolument sur les chemins les plus originaux et interactifs tracés depuis une quarantaine d’années.
Pendant que l’université subit une cure d’austérité et n’impose que le baccalauréat comme condition d’entrée, les grandes écoles continuent de prospérer et de saper l’égalité des chances. Pour la plupart, elles bénéficient de larges subven- tions de l’État, ont une grande liberté dans la détermination des droits d’inscription (bien plus élevés qu’à l’université), et font appel aux dons de leurs anciens élèves. Ces derniers ont d’autant plus à donner qu’ils perçoivent souvent des revenus substantiels, liés d’une part aux postes obtenus grâce au pres- tige de leur diplôme, et d’autre part au fait que, sélectionnés par un concours d’entrée, ils étaient déjà issus de milieux sociaux privilégiés. En effet, si les catégories aisées sont sur- représentées dans l’enseignement supérieur dans son ensemble, elles le sont encore bien davantage dans les classes préparatoires et les grandes écoles. Aucune ouverture sociale n’est à noter au cours des dernières années, en dépit des dis- cours ou des nouveaux dispositifs amplement médiatisés. Lorsqu’ils accèdent à l’enseignement supérieur, les enfants des classes populaires se retrouvent de manière écrasante en STS ou DUT et à l’université (notamment les universités périphé- riques comme Paris-8), et non dans les grandes écoles. Ces der- nières restent la chasse gardée de groupes sociaux singuliers, déjà favorisés avant d’arriver dans ces établissements aux conditions d’études plus favorables qu’ailleurs : l’École nor- male supérieure (ENS) de Paris dispose d’un budget par étu- diant de plus de 60 000 euros, Sciences Po de 15 000, et Paris-8 d’un peu moins de 6 000. Ainsi donne-t-on plus à ceux qui ont déjà plus. La pédagogie n’est pas forcément meilleure à Sciences Po ou l’ENS, mais du moins, si une réflexion pédago- gique s’y déploie, elle est moins contrainte par les moyens matériels.
Sciences Po et l’ENS puisent dans les classes déjà domi- nantes ceux qui domineront plus tard, qui détiendront des positions de pouvoir et d’explication du monde social. Il en découle une faible diversité d’origines et de trajectoires parmi ceux qui détiennent ces positions. Cela a un impact non seule- ment sur l’égalité des chances, bafouée, mais sur le contenu même des recherches et des prises de position sur le monde social. Il suffit de se rappeler que l’oppression des femmes par les hommes n’a pu commencer à être un sujet des sciences sociales qu’avec la féminisation des professionnels de ces dis- ciplines pour admettre que la diversification des origines des professionnels de la parole sur le monde social est une condi- tion de la clairvoyance et de la pertinence d’une telle parole.
Pendant ce temps, Paris-8 ne peut que donner moins à ceux qui ont déjà moins. Dans ce contexte, le ton de ce livre se veut aussi une prise de position politique au sein de l’espace inégalitaire de l’enseignement supérieur. En périphérie des établissements d’élite parisiens, c’est à Paris-8 et dans les éta- blissements similaires que les hiérarchies sociales, scolaires et scientifiques ont une chance d’être un tant soit peu sub- verties. C’est ici que devraient affluer les ressources néces- saires à la démocratisation de l’enseignement supérieur, car c’est d’ici que l’on fera advenir la prédiction de Hughes : un jour nous serons égaux, c’est-à-dire que n’importe qui pourra étudier n’importe qui.
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.