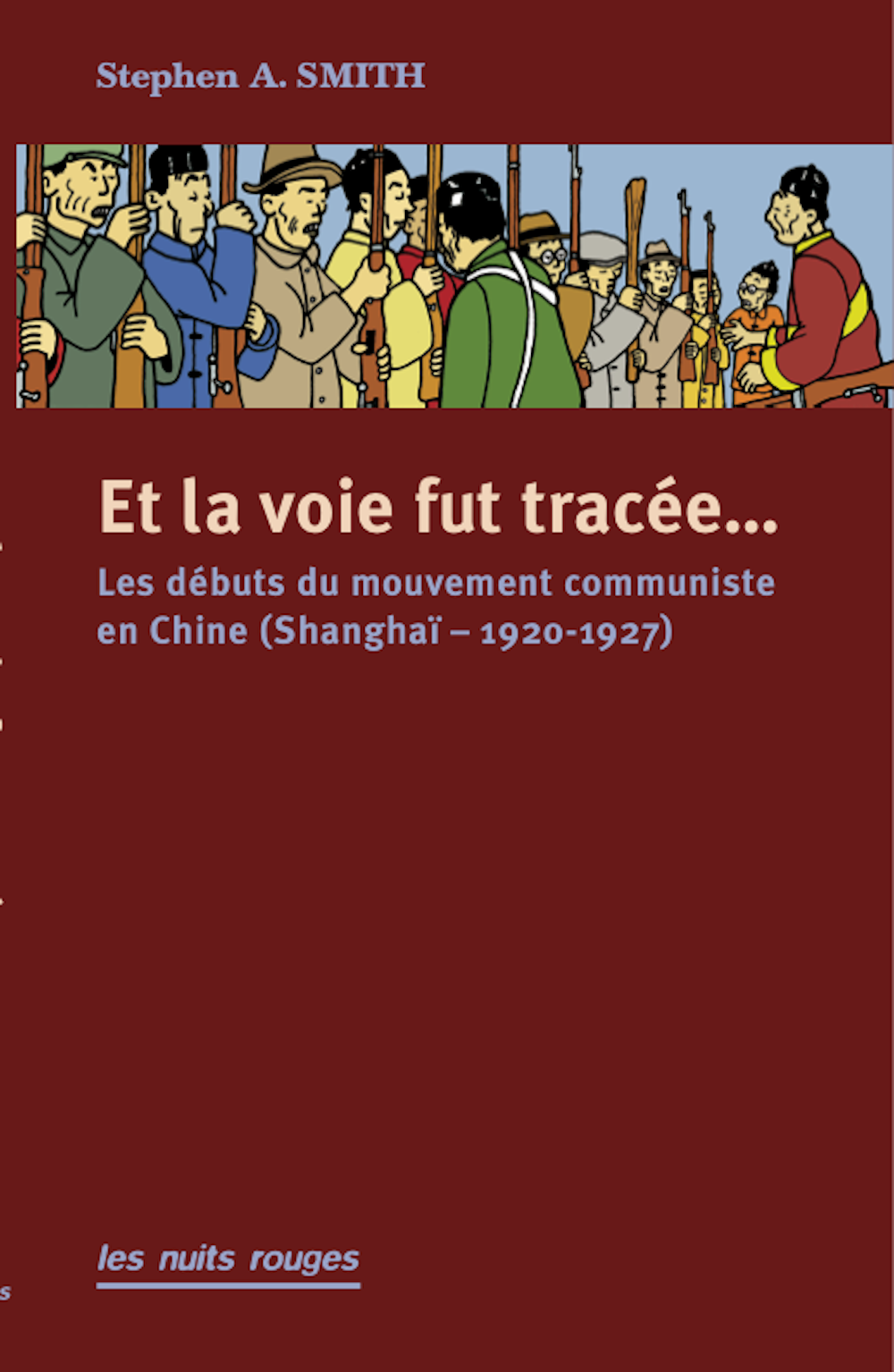
Nous sommes heureux de publier, avec l’aimable autorisation de la maison d’édition un extrait du livre de Stephen Smith : Et la voix fut tracée… Les débuts du mouvement communiste en Chine (Shanghaï – 1920-1927), Paris, Les nuits rouges, 2019.
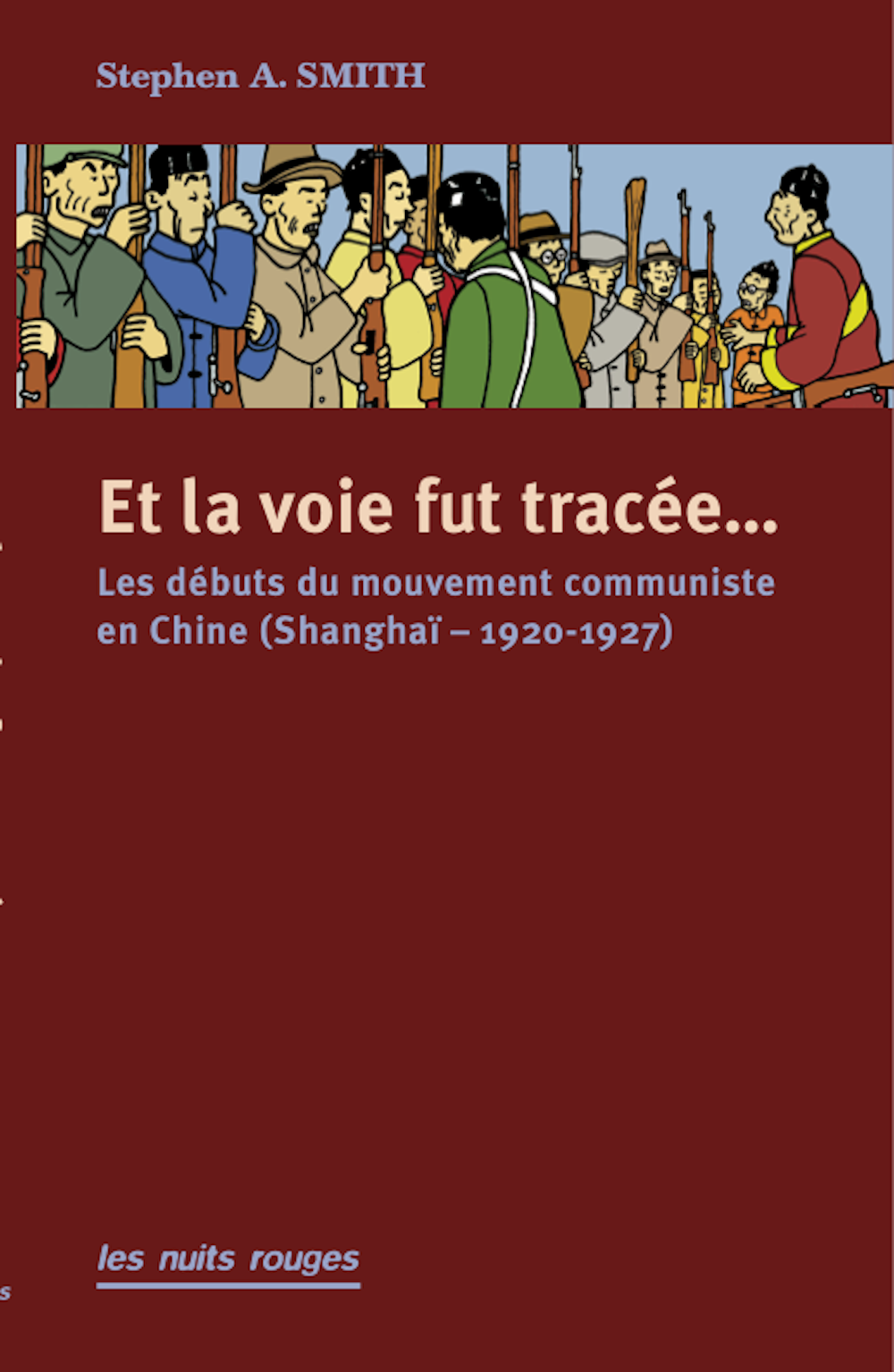
Avec ses trois millions d’habitants en 1930, Shanghaï, troisième grande métropole d’Asie par la taille, avait doublé sa population depuis 1910[1]. Elle avait été ouverte au commerce extérieur par les « traités inégaux » imposés successivement à la Chine après chacune de ses défaites face aux puissances étrangères au cours du xixe siècle. La ville était dominée par la Concession internationale et la Concession française, chacune étant, selon les mots de John K. Fairbank, une « république marchande » possédant son administration, sa police et son appareil judiciaire propre[2]. Mais l’État chinois possédait néanmoins trois quartiers – Nandao, Zhabei et Pudong – qui faisaient l’objet de la convoitise de « seigneurs de la guerre »[3] rivaux, notamment en 1924 lorsqu’un conflit éclata entre ceux des provinces voisines du Jiangsu et du Zheijiang[4]. Jusqu’en 1949, la ville était plus un centre commercial qu’un centre industriel. En 1919, la valeur de son commerce extérieur était huit fois plus élevée qu’en 1865, en 1920 dix fois plus et en 1926 dix-huit fois plus[5]. C’est le capital étranger qui le contrôlait, tout comme les secteurs de la banque, de l’assurance, du transport maritime et des communications, mais les commerçants indigènes y participaient avec ardeur depuis la fin du siècle précédent[6]. Shanghaï était aussi le centre industriel le plus important du pays, dominé par le capital étranger dans des secteurs tels que le textile et le tabac, la construction, la réparation navale et les services publics[7]. Mais, lors de la Ière Guerre mondiale, les industriels chinois purent tirer avantage de l’affaiblissement du commerce international pour occuper quelques positions en matière de fabrication et de transport. Durant le boom de 1919-22, le nombre de filatures de coton passa de 26 à 51, augmentant la part des entreprises chinoises de 42 à 47 %[8]. Celles-ci dominaient aussi les industries de la filature de la soie et de la transformation des aliments et s’implantaient dans le secteur du tabac.
Avec ses institutions et ses immeubles à l’occidentale, ses magasins, ses dames aux cheveux courts et maquillées, ses messieurs en complet-veston, Shanghaï était un puissant symbole de modernité. Dans cette ville, les catégories sociales traditionnelles formées par les lettrés, les paysans, les artisans et les petits commerçants tombaient en déliquescence tandis qu’émergeaient de nouvelles catégories : les hommes d’affaires, les intellectuels, les bureaucrates et les ouvriers. Pour les conservateurs, la modernité de Shanghaï remettait en question les traditions, menaçant de dissoudre tous les liens et les devoirs sociaux. La ville était perçue comme un lieu où se pratiquait un culte malsain de la nouveauté, où l’argent était roi et la morale laxiste[9]. Pour d’autres, en revanche, Shanghaï permettait de s’émanciper des liens paralysants de la famille patriarcale et de l’ordre social traditionnel, surtout chez les jeunes instruits. Ces perceptions radicalement divergentes découlaient des contradictions de la modernité elle-même. D’une part, l’avancée de l’industrialisation et de l’urbanisation capitalistes créait une société aliénée, déchirée par l’exploitation, et destructrice de nombreuses valeurs communautaires. De l’autre, le même processus élargissait les possibilités de mobilité sociale et d’accomplissement individuel, qui tendaient à se libérer des catégories immuables du passé pré-capitaliste[10].
Cependant, mettre trop unilatéralement l’accent sur la modernité de Shanghaï serait trompeur, car la ville combinait des éléments de la culture occidentale et du capitalisme avec beaucoup d’autres plus traditionnels. La grande masse de la population, par exemple, était composée de migrants, principalement de jeunes hommes, qui venaient tout juste d’arriver de la campagne : en 1930, seulement 22 % de la population était née dans la ville[11]. L’afflux constant de migrants, en plus de créer de la pauvreté et de la misère à une échelle monstrueuse, reproduisait aussi des formes culturelles traditionnelles dans l’espace urbain moderne. Aux yeux de la minorité qui se considérait « shanghaïenne », la masse des migrants pauvres et ignorants était constituée de « bouseux », assimilés à des blocs de bois (A Mulin) ou à des mottes de terre (A Tusheng)[12]. Dans le monde désorientant de la ville, les migrants s’appuyaient sur des réseaux sociaux fondés sur la région d’origine pour trouver un emploi et un logement, sur des sociétés secrètes, sur des relations de clientélisme avec les contremaîtres, les patrons ou les caïds de quartier[13]. Des réseaux quasiment ataviques étaient ainsi utilisés à de nouvelles fins dans l’environnement urbain et industriel tout en formant une tête de pont qui reliait les habitants de la ville à leurs proches demeurés dans l’arrière-pays rural.
De ce point de vue, Shanghaï était le bastion d’une culture hybride – à la fois urbaine, paysanne, occidentale et chinois –, matrice de fortes contradictions sociales et culturelles qui avaient un effet dissolvant sur l’ordre traditionnel[14]. Shanghaï était ainsi emblématique de l’exploitation capitaliste et de la consommation ostentatoire, de l’impérialisme étranger et de la résistance patriotique, de l’individualisme et de la société de masse ; une ville où les gratte-ciel côtoyaient les bidonvilles, et les limousines les rickshaws. Li Dazhao, co-fondateur du Parti communiste, décrivait dans la revue Xin Qingnian (Jeunesse nouvelle) en mai 1918, la dislocation psychologique produite par la juxtaposition confuse de l’ancien et du nouveau :
« La vie des Chinois aujourd’hui est totalement contradictoire. […] Les gens à travers le pays poursuivent leur vie au milieu de phénomènes contradictoires et se sentent donc mal à l’aise et malheureux. […] Une vie contradictoire, c’est une vie où le nouveau et l’ancien ne sont pas en harmonie : il y a du nouveau et il y a du vieux, d’innombrables choses séparées les unes des autres, mais réunies en un seul lieu, et où elles se confrontent les unes aux autres. »[15]
Shanghaï, plus que partout ailleurs en Chine, semblait promettre la possibilité d’acquérir cette modernité créée par l’Occident, qui seule semblait capable de sauver le pays de l’extinction. Mais, en même temps, elle mettait en évidence l’impossibilité de le faire, chaque étape du progrès semblant menacée par la misère économique et la gabegie politique croissantes. C’est cette anxiété créée par une situation « où l’ancien et le nouveau ne sont pas en harmonie » qui poussa des jeunes radicaux éduqués vers le communisme après le Mouvement du 4 mai 1919[16].
La fin du XXe siècle, quand fut écrit ce livre, fut un moment approprié pour réfléchir à l’importance du défi politique le plus puissant qui fut lancé au capitalisme libéral. Ce siècle, qui vit des révolutions communistes éclater à l’échelle mondiale, vit aussi la fin du communisme en Russie, en Europe de l’Est, en Yougoslavie, à Cuba, au Vietnam et, surtout, en Chine, au cours de sa dernière décennie. La présente étude, en étudiant l’histoire politique, sociale et culturelle du Parti communiste chinois (PCC) à Shanghaï au cours de ses années de formation, cherche à retracer les origines de ce régime, le plus puissant au monde après celui de l’Union soviétique ; et de mettre en lumière sa nature ambivalente, à la fois force de libération nationale et de justice sociale, offrant de l’espoir à un pays abattu par l’impéritie de ses gouvernements successifs et les rapines impérialistes – et cela malgré un tropisme pour le despotisme, qui allait se perpétuer dans un des régimes autoritaires des plus durables. En explorant l’idéologie et l’organisation du premier PCC, et en particulier ses relations avec les groupes sociaux qu’il cherchait à mobiliser, cette étude montre comment l’ambivalence du projet communiste s’est inscrite dès le début dans ses activités et sa politique.
Pendant la guerre froide, une bonne part de l’historiographie consacrée à la révolution nationale, qui culmina avec la réunification de la Chine par Chiang Kaï-shek en 1927, attribuait à Moscou un rôle primordial dans le processus révolutionnaire[17]. En ce qui concerne la naissance du PCC, des historiens comme Conrad Brandt et Allen Whiting en attribuèrent la paternité à Moscou, quoique, dès le début, d’autres comme Benjamin Schwartz et Maurice Meisner soulignèrent aussi ses origines indigènes[18]. Une génération plus récente de chercheurs suivit cette dernière voie en minimisant l’importance des influences extérieures dans la formation du parti et la révolution nationale en général. Dans son admirable étude, Hans Van de Ven a retracé le développement du PCC à partir de réseaux d’amis, de camarades d’école, chacun enraciné dans un environnement régional et social particulier[19]. De la même manière, Wen-hsin Yeh a décrit avec élégance les racines du radicalisme dans la province du Zhejiang – un fournisseur crucial de recrues pour le parti jusqu’à nos jours, espace trépidant d’une des régions de Chine des plus développées sur le plan commercial et des plus raffinées sur le plan culturel[20]. Plus récemment, l’intéressante étude de Patricia Stranahan relie les succès des communistes shanghaïens dans la construction d’une organisation clandestine face à la répression du Guomindang aux spécificités du contexte urbain[21]. Cette histoire du communisme à Shanghaï suit le travail de ces intellectuels novateurs, en se fondant fermement sur sa composition sociologique et ses dynamiques internes, sur ses relations avec les ouvriers de la ville, les sociétés secrètes, les étudiants, les femmes, les hommes d’affaires et les nationalistes. Mais notre travail contredit aussi une autre tendance qui consiste à minimiser l’influence des facteurs extérieurs. Utilisant les documents devenus accessibles avec l’ouverture des archives de la Comintern en 1991, il accorde plus d’importance que beaucoup d’autres travaux sur le rôle de l’Internationale communiste, non seulement dans la naissance du PCC mais aussi dans le développement de la révolution nationale en général[22].
Franz Schurmann a soutenu que la République populaire de Chine était cimentée par l’idéologie et l’organisation[23]. Depuis le début, ces deux points étaient reconnus par le parti comme étant d’une importance vitale. L’idéologie occupait une place centrale dans sa raison d’être, sa stratégie et ses tactiques, sa propagande et ses méthodes d’agitation, ses modes de légitimation et ses allocations internes de pouvoir. Cette étude, cependant, déplace l’attention des questions d’idéologie et de stratégie vers une analyse des activités du parti parmi les différents secteurs de la société shanghaïenne. Cela se justifie en partie parce qu’il existe maintenant quelques excellentes études sur l’idéologie du PCC au cours de cette période. Dans une recension magistrale des idées radicales pendant le Mouvement du 4 mai, Arif Dirlik a resitué le PCC dans un champ fluide de forces politiques et idéologiques, dominé par l’anarchisme et le socialisme d’Etat[24]. Et Michael Luk a mis en lumière l’émergence d’un système de pensée politique distinct parmi les communistes chinois au cours des années 1920[25]. Ces études rendent superflue toute tentative de ma part de traverser le même terrain. Néanmoins, étant donné l’importance primordiale que les dirigeants du parti attachaient aux questions idéologiques, les débats sur la nature de la révolution chinoise et les âpres querelles concernant la stratégie et la tactique ne peuvent être totalement ignorés. La présente étude se limite donc à indiquer les principales questions théoriques et stratégiques qui ont agité le parti et, lorsque de nouveaux éléments apparaîtront – en particulier en ce qui concerne la politique du Front uni avec le Guomindang –, elle s’attardera plus en détail sur ces questions. Cependant, les questions vitales telles que la politique agraire ou la stratégie militaire ont été ignorées, car elles n’ont eu que peu d’influence sur les activités du parti à Shanghaï. Sur la question tout aussi importante de l’organisation, je n’ai pas non plus essayé de reprendre l’excellent récit de Van de Ven, qui a retracé la transformation structurelle et culturelle du PCC en un parti léniniste, un processus qui ne s’est réellement achevé qu’en 1927[26]. Cependant, la présente étude examine spécifiquement le développement organisationnel du Comité régional du PCC, dont ses relations avec le Comité exécutif central (CEC) qui, pendant pratiquement toute la période, résidait à Shanghaï[27]. Elle examine également les relations du CEC et du Comité régional avec la LJS, Ligue de la jeunesse socialiste (plus tard Ligue de la jeunesse communiste, LJC) et avec le Syndicat général du travail de Shanghaï (SGT), créé en mai 1925. De plus, elle utilise de nouveaux documents, en particulier des archives de la Comintern, pour examiner les interactions dans l’élaboration des politiques successives entre le Comité régional de Shanghaï, le CEC, les agents de la Comintern installés dans la ville, le Comité exécutif de la Comintern (CE de l’IC) et le Bureau politique soviétique. Notre ouvrage étudie ainsi non seulement les questions politiques qui provoquèrent des conflits à différents niveaux de la hiérarchie de la Comintern, mais aussi les différends sur les questions financières et organisationnelles, ainsi que leurs implications dans le fonctionnement quotidien du parti et les rapports entre les individus. En montrant que ce conflit était endémique, mais aussi plus complexe qu’une confrontation entre un parti communiste autochtone et un centre de contrôle situé à l’étranger, l’étude confirme la perspective qui se dégage de l’édition méticuleuse de Tony Saich des archives de Hendricus Sneevliet[28], qui a d’abord révélé non seulement la profondeur des divisions au sein de la Comintern, mais aussi la marge de manœuvre dont un individu comme lui pouvait jouir sur le terrain[29]. Enfin, à cet égard, l’ouvrage examine les difficultés pratiques rencontrées par la Comintern pour chercher à contrôler le PCC et s’interroge sur la mesure dans laquelle la politique menée par les communistes à Shanghaï correspondait aux intentions et aux attentes de Moscou.
Le livre se concentre donc principalement sur les activités pratiques du parti à Shanghaï, en particulier sur ses efforts pour mobiliser les travailleurs, les étudiants, les jeunes, les femmes, les petits commerçants et les marchands, ainsi que l’ensemble des patriotes dans la lutte pour la libération nationale[30]. Une grande attention y est accordée aux activités de la LJS dans le mouvement étudiant et aux efforts pour orienter les organisations féminines de la ville vers un anti-impérialisme de classe. Tout au long de la période, cependant, à l’exception d’une année où le Front uni avec le Guomindang (GMD) fut une réalité, la direction du parti s’est principalement attelée à la construction d’un mouvement ouvrier et syndical dans la ville. Pour cette raison, ce livre y accorde une attention particulière[31]. Il examine les problèmes rencontrés pour surmonter les travers particularistes liés au lieu d’origine, au métier, à l’affiliation à une société secrète, au clientélisme et au genre qui divisaient la main-d’œuvre shanghaïenne. Il retrace les efforts du parti pour mener des grèves, créer des syndicats et installer des piquets de grève armés, ainsi que son utilisation de techniques propagandistes allant de l’éducation et de l’agitation à la terreur et à l’insurrection armée. Dans ses efforts pour organiser les travailleurs de Shanghaï, le Syndicat général du travail soutenu par le PCC s’est inévitablement heurté à la Bande verte (Qingbang) et, dans une moindre mesure, à la Bande rouge[32], qui constituaient les principaux réseaux mafieux de la ville. Les « boss » de niveau inférieur de la Bande verte étaient souvent des « entrepreneurs en main-d’œuvre » ou des contremaîtres qui plaçaient des travailleurs sur le front de mer et, de manière croissante, dans les transports, les usines et les services publics[33]. Les efforts d’organisation du PCC menaçaient évidemment les opérations lucratives de ces éléments et leur emprise sur leurs « clients » ouvriers. Pendant la période que nous allons étudier, les chefs du parti essayèrent alternativement de collaborer avec les sociétés secrètes et de s’y opposer – stratégie qui s’est retournée contre le PCC en avril 1927, lorsque les « Trois Grands » qui contrôlaient la Bande verte se sont retournés de façon dramatique contre lui. De même, le PCC a cherché à coopérer avec les milieux d’affaires de Shanghaï, non seulement pour faire avancer la lutte pour la libération nationale, mais aussi dans l’espoir de persuader la Chambre générale de commerce de soutenir les syndicats et d’améliorer le sort de leurs employés. Mais les milieux d’affaires restèrent méfiants à l’égard du PCC après le Mouvement du 30 mai[34] avant finalement de se retourner contre lui et de rejoindre ses ennemis.
Le livre tente aussi de combler une lacune identifiée par Jeffrey Wasserstrom qui a souligné que nous en savons beaucoup plus sur les idéologies formelles et les luttes de faction au sein de la hiérarchie du PCC que sur la façon dont ses membres vivaient et travaillaient[35]. L’étude pionnière de Christina Gilmartin a beaucoup fait pour aborder ces questions du point de vue des femmes à l’intérieur et à l’extérieur du PCC[36]. Notre étude suit son exemple, en apportant une perspective sexospécifique à la vie interne du parti, et en cherchant à élargir le champ des relations personnelles comme un facteur qui façonna son caractère. Il passe en revue les antécédents et les orientations des intellectuels et des travailleurs qui furent attirés par lui, se faufilant dans les courtes biographies narratives des individus qui mettent en évidence leurs antécédents familiaux et leurs relations personnelles – souvent très peu conventionnelles, selon les normes confucéennes. Il est maintenant possible de le faire grâce à l’excellent travail accompli par les historiens de la République populaire de Chine (RPC) pour reconstituer les vies de centaines des premiers communistes, dont beaucoup furent cruellement fauchées dans la force de l’âge[37]. Il examine également les tensions qui existaient entre intellectuels et travailleurs au sein du parti, ainsi que les dynamiques d’autonomisation et de domination qui régissaient les relations entre les communistes et le mouvement ouvrier.
Ce livre parut à une époque où les historiens occidentaux étaient devenus plus critiques à l’égard des récits qui axent l’histoire de la Chine moderne sur le thème de la révolution, et plus encore sur l’histoire du PCC[38]. En tant que sujet de la présente étude, le PCC domine nécessairement l’exposé, mais j’ai essayé de situer ses activités dans un champ plus large de contestation globale des forces sociales et politiques qu’il n’est d’usage. En particulier, il cherche à mettre l’accent sur le GMD en tant que force politique indépendante plutôt que simple complément du PCC. Les historiens ont beaucoup discuté de la politique du « Front uni » du point de vue des conflits idéologiques qu’elle a inspirés, mais nous avons voulu ici étudier son fonctionnement en pratique dans la ville. On verra par là ce que signifiait réellement le Front uni et l’ampleur des oppositions à cette politique tant au sein du PCC que des cercles influents du GMD à Shanghaï.
On n’y trouvera donc pas un compte rendu complet des politiques menées par le PCC sur toutes les questions qui ont ponctué cette période turbulente, mais un examen en profondeur de son rôle dans les deux crises qui éclatèrent à Shanghaï et eurent un impact majeur sur la politique nationale. La première fut le Mouvement du 30 mai 1925, qui peut être considéré comme le début de la révolution nationale à Shanghaï, puisque c’est à ce moment-là que le nationalisme anti-impérialiste radical acquit une base populaire. Grâce à son influence dans les mouvements de masse, en particulier le mouvement ouvrier, le PCC était devenu un acteur-clé du mouvement nationaliste dans la ville. Cependant, ce n’est que dans la seconde moitié de 1926, lorsque Chiang Kaï-shek mena « l’Expédition du Nord » contre les seigneurs de la guerre pour former un gouvernement vraiment national, que le PCC devint une force majeure à l’échelle du pays. Entre octobre 1926 et mars 1927, il fit trois tentatives, en alliance informelle avec le GMD, pour chasser de Shanghaï les seigneurs de la guerre. Le « troisième soulèvement armé », qui culmina avec la brève prise du pouvoir par les milices armées du Syndicat général du travail (SGT) en mars 1927, est peut-être connu de nos lecteurs qui ignorent l’histoire du PCC, puisqu’il est au cœur du saisissant roman d’André Malraux, La Condition humaine. Encore qu’on puisse considérer rétrospectivement qu’il mettait en évidence la faiblesse plutôt que la force des communistes dans la ville. Le 12 avril 1927, Chiang Kaï-shek fit en sorte que des gangsters, appuyés par des troupes de son Armée nationale révolutionnaire (ANR), saccagent le quartier général des milices ouvrières et liquident des centaines de communistes et de militants ouvriers. Ce bain de sang, qui mit fin au Front uni entre le PCC et le GMD, a depuis lors fait l’objet d’une controverse politique passionnée, certains attribuant la débâcle à cette alliance imposée par Moscou à un PCC réticent, d’autres reprochant à ses dirigeants de ne pas avoir mené leur propre politique avec suffisamment de vigueur. Le livre jette un regard neuf, à la lumière du nouveau matériel disponible, sur les responsabilités respectives de la Comintern et de la direction du PCC dans les événements dramatiques qui mirent fin à la première époque du Parti communiste.
Une vaste quantité de documents sur le PCC shanghaïen a été publiée en RPC depuis le début des années 1980 : mémoires, résolutions et statistiques[39]. Les résolutions et directives du CEC sont maintenant disponibles dans leur intégralité, mais pas les comptes rendus de ses réunions (s’il en existe)[40]. Ceux du Comité régional de Shanghaï n’ont été publiés que de façon fragmentaire, bien qu’ils soient assez fournis pour la période des trois soulèvements armés[41]. Cette étude s’appuie largement sur les documents de la Comintern relatifs à la Chine – y compris les verbatim de la commission chinoise du Politburo soviétique – qui ont été publiés par une équipe exceptionnelle d’universitaires russes et allemands[42]. En outre, elle s’appuie sur les dossiers de la police municipale de Shanghaï et sur les dossiers consulaires et de renseignement du Public Record Office de Londres. Elle s’appuie également sur une lecture exhaustive de la presse du PCC de l’époque, complétée par les principaux journaux progressistes des années 1920, en particulier le Shenbao (Les Nouvelles du matin) et le Minguo ribao (Le Quotidien républicain). Mais si beaucoup de choses sont devenues disponibles depuis 1991, d’autres ne le sont toujours pas – que ce soit, on s’en doute, dans les archives du PCC ou dans les archives militaires de l’ex-Union soviétique.
Comme le savent tous ceux qui ont travaillé sur l’histoire du mouvement communiste, son langage est hautement abstrus et pétri de jargon. Pour les non-initiés, les différentes résolutions et contributions au débat semblent souvent dire la même chose, puisqu’ils utilisent les mêmes formules récurrentes et habitent un seul univers conceptuel. Une des tâches de l’historien est donc de capter les nuances subtiles de la différence d’interprétation, l’accent ou le silence révélateur, la marginalisation d’une question particulière dans le discours. Bien que la langue du communisme, comme sa pratique politique, ait réussi avec le temps à s’internationaliser – partagée par des militants d’origines culturelles diverses –, je suis régulièrement frappé par les problèmes de traduction entre les langues, par le fossé qui existe entre, par exemple, une résolution du CE de l’IC, rédigée en russe ou en allemand, et sa traduction en chinois ; et par le fossé supplémentaire qui se creuse lorsque je tente de la retraduire en anglais (et a fortiori lorsqu’elle est comme ici reretraduite en français). Je pense qu’un travail productif pourrait être entrepris à l’avenir en explorant ces lacunes, mais je n’ai pas ici tenté de m’attaquer au problème de l’incommensurabilité de la langue ou du rôle qu’elle a pu jouer dans l’échec de la Comintern en Chine[43].
Une dernière mise en garde. L’objectif de ce travail est de montrer le rôle substantiel joué par le minuscule PCC dans la révolution nationale de 1925-27. C’est dans cette période qu’« une voie fut tracée », lorsque les communistes s’attaquèrent aux problèmes de la construction d’un mouvement révolutionnaire et apparurent comme une option politique crédible. Néanmoins, au cours de cette période, les gens que le parti réussit à mobiliser se comptèrent par dizaines de milliers plutôt que par millions. Et il aurait pu facilement disparaître à la fin des années 1920 pour ne devenir qu’une note de bas de page de l’histoire de la Chine du XXe siècle. En d’autres termes, la marche vers la prise du pouvoir sous Mao Zedong n’avait rien d’assurée. En effet, la séquence suivante montrera la disproportion des forces entre le Parti communiste dans sa première période et l’Armée rouge appuyée sur la paysannerie, qui feraient finalement la révolution en Chine.
[1] B. R Mitchell, International Historical Statistics : Africa and Asia, London, 1982, p. 70. En 1930, 54 % de la population vivaient sous juridiction chinoise, contre 32 % dans la Concession internationale et 14 % dans la Concession française. Zou Yiren, Jiu Shanghai renkou bianqian de yanjiu, Shanghaï, 1980, p. 92.
[2] J. K. Fairbank, « The Creation of the Treaty System », Cambridge History of China, vol. 10, part. 1, Cambridge, 1978, p. 242.
[3] Seigneurs de la guerre (junfa) ou « militaristes ». Suite aux divers ébranlements de l’Etat chinois consécutifs à la disparition de la monarchie, les chefs militaires régionaux avaient pris leur indépendance et privatisé en quelque sorte les troupes dont ils disposaient, menant avec leurs « cliques » des politiques personnelles, faites d’alliances et de brusques retournements avec ou contre leurs homologues.
[4] La guerre est le propos d’A. Waldron, From war to nationalism : China’s turning point, 1924-25, Cambridge, 1995.
[5] Tsai Kyung-we, « Shanghai’s Foreign Trade : An Analytical Study », Chinese Economic Journal, vol. 9, n° 3,1931, pp. 967-78.
[6] R. Murphey, Shanghai : Key to Modern China, Cambridge, Mass., 1953.
[7] Sun Yutang (éd.) Zhongguo jindai jingji shi cankao ziliao congkan : Zhongguo jindai gongye shi ziliao, vol. 1, Beijing, 1957, pp. 34-6.
[8] Wusa yundong shiliao, vol. 1, Shanghaï, 1981, p. 198. (WSYDSL).
[9] Shanghai shi zhinan, éd. Shen Bojing, Shanghai, 1933, pp. 140-1.
[10] P. Anderson, « Modernity et Revolution », New Left Review, 144, 1984, p. 97.
[11] Zou Yiren, Jiu Shanghai, p. 112.
[12] Shanghai shi zhinan, p. 143. Sur les immigrants du Subei, voir la fascinante étude d’E. Honig, Creating Chinese Ethnicity : Subei People in Shanghai, 1850-1980, New Haven, 1992.
[13] Voir les études pionnières suivantes, respectivement consacrées aux réseaux régionaux et aux sociétés secrètes : B. Goodman, Native Place, City and Nation : Regional Networks and Identities in Shanghai, 1853-1937, Berkeley, 1995 ; B.G. Martin, The Shanghai Green Gang : Politics and Organized Crime, 1919-1937, Berkeley, 1996. Sur le clientélisme, voir S.A. Smith, « Workers and Supervisors : St Petersburg, 1905-1917 and Shanghai, 1895-1927 », Past and Present, 139, mai 1993, 131-177.
[14] F. Wakeman et Wen-Hsin Yeh, « Introduction », Shanghai Sojourners, Berkeley, 1992, p. 5.
[15] Li Dazhao, « Xinde, Jiude », Li Dazhao Wenji, vol. 1, Beijing, 1984, p. 537.
[16] Mouvement du 4 mai. Au début de la guerre de 1914-18, le Japon avait pris le parti de l’Entente et s’était emparé des territoires occupés par les Allemands, notamment du Shandong. En 1919, les alliés de l’Entente attribueront ces territoires au Japon, ce qui déclenchera, le 4 mai 1919 donc, la colère étudiante, bientôt rejointe par celles d’autres forces sociales. La colère était d’autant plus grande que le gouvernement de Pékin qui avait accepté cette issue, était suspectée d’avoir reçu de l’argent à cet effet. Parti d’une revendication nationaliste, le mouvement se prolongera par une agitation remettant en cause le poids des traditions dans tous les domaines. Voir chapitre 1.
[17] C’est tout à fait le cas de R. C. North, Moscou and the Chinese Communists (2e éd.), Stanford, 1963.
[18] C. Brandt, Stalin’s Failure in China, 1924-1927, Cambridge, Mass., 1958 ; A.S. Whiting, Soviet Policies in China, 1917-1924, New York, 1954 ; B.I. Schwartz, Chinese Communism and the Rise of Mao, Cambridge, Mass., 1951 ; M. Meisner, Li Ta-chao and the Origins of Chinese Communism, Cambridge, Mass., 1967.
[19] H.J. Van de Ven, From Friend to Comrade : The Founding of the Chinese Communist Party, 1920-1927, Berkeley, 1991.
[20] Wen-hsin Yeh, Provincial Passages : Culture, Space and the Origins of Chinese Communism, Berkeley, 1996.
[21] P. Stranahan, Underground : The Shanghai Communist Party and the Politics of Survival, 1927-1937, Lanham, MD, 1998.
[22] L’étude estimable de Daniel Kwan sur Deng Zhongxia n’est que le travail le plus récent qui sous-estime l’impact de la Comintern, soulignant la capacité de Deng à initier une politique indépendamment de Mikhaïl Borodine. D.Y.K. Kwan, Marxist Intellectuals and the Chinese Labor Movement : a Study of Deng Zhongxia, 1894-1933, Seattle, 1997, pp. 116-17.
[23] F. Schurmann, Ideology and Organization in Communist China, Berkeley, 1968, p. 1.
[24] A. Dirlik, The Origins of Chinese Communism, New York, 1989.
[25] M.Y.L. Luk, The Origins of Chinese Bolshevism, Hong Kong, 1990.
[26] Van de Ven, Friend, p. 4.
[27] Pendant une partie de cette période, le titre exact du Comité régional de Shanghai était Comité exécutif régional du Jiangsu et du Zhejiang (Jiang-Zhe qu zhixing weiyuanhui).
[28] Hendricus Sneevliet (dit Maring) (1883-1942) : révolutionnaire néerlandais. Secrétaire de la Commission de l’IC aux nationalités et à la question coloniale. Il fut le premier envoyé de la Comintern en 1921. Il sera exécuté dans son pays par la Gestapo. Voir chapitre 1.
[29] T. Saich, The Origins of the First United Front in China : the role of Sneevliet (alias Maring), (2 vols.), Leiden, 1991.
[30] Les marchands de la ville sont étudiés in J. Fewsmith, Party, State and Local Elites in Republican China : Merchant Organizations and Politics in Shanghai, 1890-1939, Honolulu, 1985, et in M-C Bergère, The Golden Age of the Chinese Bourgeoisie, 1911-1937, Cambridge, 1989. Les étudiants sont étudiés in Wen-shin Yeh, The Alienated Academy : Culture and Politics in Republican China, 1919-1937, Cambridge, Mass., 1990, et J.N. Wasserstrom, Student Protest in Twentieth-Century China : The View from Shanghai, Stanford, California, 1991.
[31] Il existe une riche littérature sur les questions du travail à Shanghaï. Voir J. Chesneaux, The Chinese Labor Movement, 1919-1927, Stanford, 1968 ; E. Honig, Sisters and Strangers, Women in the Shanghai Cotton Mill, 1919-49, Stanford, 1986 ; E.J. Perry, Shanghai on Strike : The Politics of Chinese Labor, Stanford, 1993 ; A. Roux, Le Shanghaï ouvrier des années trente : coolies, gangsters et syndicalistes, Paris, 1993.
[32] Réunissant en son sein de nombreux hommes d’affaires, la « Bande verte » contrôlait la quasi-totalité des activités illégales de Shanghaï, alors capitale mondiale du commerce de l’opium. La « Bande rouge » assurait la protection des chargements d’opium qui descendaient le Yangtsé jusqu’à Shanghaï où les « Verts » faisaient le reste sous la protection de la police française. La Bande verte opérait également dans les jeux et la prostitution ; ses services étaient aussi régulièrement demandés pour disperser des réunions syndicales et des grèves. Voir Elizabeth J. Perry : Shanghai on Strike: The Politics of Chinese Labor, Stanford University Press, 1993.
[33] Martin, Shanghai Green Gang, pp. 9-18 ; Zhou Yumin & Shao Yong, Zhongguo banghui shi, Shanghai, 1993, pp. 257-64 ; Li Shiyu, « Qingbang zaoqi zuzhi kaolii », in Jiu Shanghai de banghui, Shanghai, 1986, pp. 29-50.
[34] Le Mouvement du 30 mai 1925 commença par une fusillade déclenchée par des policiers de la Concession internationale qui fera une dizaine de victimes. Elle débouchera sur des grèves et des manifestations qui toucheront plusieurs grandes villes.
[35] J.N. Wasserstrom, « Toward a social history of the Chinese Revolution : a review », part. 2, Social History, vol. 17, n° 2, 1992, p. 312.
[36] C.K. Gilmartin, Engendering the Chinese Revolution : Radical Women, Communist Politics and Mass Movements in the 1920s, Berkeley, 1995.
[37] Zhonggongdang shi renwu zhuan, 55 volumes disponibles au moment de la rédaction de ce livre, Xi’an, 1980-1994 (ZGDSRWZ) ; Zhongguo gongchandang renming da cidian, Beijing, 1991.
[38] J.W. Esherick, « Ten Theses on the Chinese Revolution », Modern China, vol. 21, n° 1, janv. 1995, pp.45-76. L’exemple le plus récent est l’histoire détaillée du PCC publiée en RPC, dont les deux premiers volumes couvrent notre période. Cela déplace l’histoire du parti dans un récit de la nation – où la classe est marginalisée –, soulignant comment, en offrant organisation et leadership au peuple patriotique, le PCC sauva la Chine. Voir éd., Zhongguo gongchandang tongshi, vols. 1 et 2, Changsha, 1996.
[39] Des revues telles que Dangshi ziliao congkan, Zhonggong dangshi ziliao, Dangshi yanjiu, Dangshi yanjiu ziliao et Dang’an yu lishi ont publié des choses très intéressantes. Une partie des nouvelles données ont été examinées par Tony Saich, « Through the Past Darkly : Some New Sources on the Founding of the Chinese Communist Party », International Review of Social History, vol. 30, part. 2, 1985, 167-180. On trouvera d’importants éléments sur le « petit groupe » de Shanghai in Gongchanzhuyi xiaozu, vol. 1, Beijing, 1987.
[40] Zhonggong zhongyang wenjian xuanji [Documents choisis par le Comité central du PCC], vol. 1, 1921-1925 ; vol. 2,1926 ; vol. 3,1927, Hebei, 1989. (ZGZYWJXJ).
[41] « Wusa yundong qijian Zhonggong Shanghai diwei huiyi jilu (xuanzai) (Yijiuerwu nian wuyue) », Zhonggong dangshi ziliao, 22, 1985, 3-12 ; Shanghai gongren sanci wuzhuang qiyi, Shanghai, 1983. (SGRSCWZQY) ; Zhongguo gongchandang Shanghai shi zuzhishi ziliao, 1920.8 -1987. 10, Shanghai 1991. (ZGGCDSH).
[42] VKP(b), Komintern i natsional’no-revoliutsionnoe dvizhenie v Kirae. Dokumenty, vol. 1, 1920-1925 ; vol. 2 (en deux parties), 1926-27, Moscou, 1994, 1996. (VKP(b)).
[43] Ces questions m’ont été suggérées par la stimulante étude de Lydia Liu, Translingual Practice, Stanford, 1995. Un petit exemple peut suffire. Un lecteur qui ne connaît pas le titre original de l’œuvre-phare de Lénine, l’Etat et la Révolution, pourrait légitimement traduire son titre chinois, Guojia yu geming, en anglais comme Etat-nation et révolution, ou même Nation et Révolution, ce que le titre russe, Gosudarstvo i revoliutsiia, ne permettrait guère. Les deux termes du titre chinois sont chargés de résonances culturelles et historiques. Laissant de côté l’étymologie du terme pour révolution, geming, qui se référait à l’origine au retrait du mandat du Ciel donné à l’empereur, le terme (guojia) est un néologisme, introduit à la fin du XIXe siècle depuis le japonais pour désigner le concept moderne de l’Etat-nation. Il reliait le « royaume » (guo) à la « famille » (jia), de sorte que s’il désignait un Etat territorialement délimité représentant la nation chinoise, il le voyait comme l’extension directe et verticale de la famille, et l’autorité comme organisation hiérarchique des sujets, plutôt que des citoyens actifs, comme constituants de l’Etat. Le terme « Etat » (gosudarstvo) dans le titre russe originel avait une signification tout aussi lourde, bien que très différente. Considéré à l’origine comme un attribut – la dignité – du souverain nommé par Dieu (gosudar), il en est venu à désigner le domaine personnel de celui-ci. Plus tard, comme son homologue anglais, il désignait principalement les institutions du gouvernement, mais sans jamais perdre le sentiment que celles-ci étaient la propriété personnelle du souverain. Le fait est que les concepts marxistes-léninistes ne pouvaient pas franchir les barrières de la langue sous une forme non falsifiée : leur signification était nécessairement façonnée par le contexte culturel dans lequel ils étaient implantés. J. Levenson, Confucian China and Its Modern Fate, Berkeley, 1958, pp. 105-108 ; M.V. Il’in, Slova i smysly, Moscou, 1997, pp. 192-3 ; R. Pipes, Russia Under the Old Regime, London, 1974, p. 78.