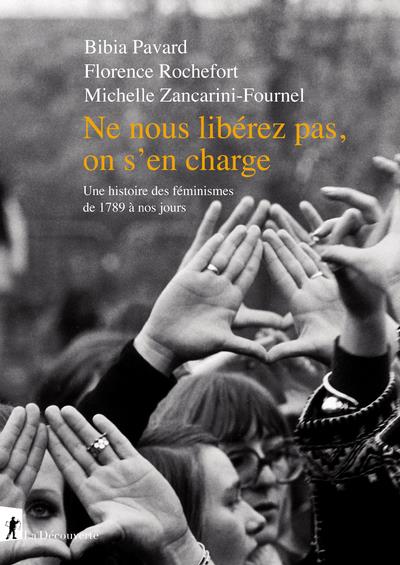
Comment les féminismes ont-ils émergé en France ? Doit-on parler de « féminisme bourgeois » ? Quels liens ont existé entre féminismes et socialismes ? Y a-t-il eu des féminismes noirs ? Les féministes étaient-elles toutes colonialistes ? Existe-t-il des féminismes religieux ? Comment s’articulent mouvements lesbien, gay, trans et mouvements féministes ? Quel a été le rôle du féminisme institutionnel ? Qu’est-ce qui est nouveau dans les groupes féministes aujourd’hui ? Qu’est-ce que révèle #Metoo sur la capacité des femmes à se mobiliser ?
Le livre de Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michelle Zancarini-Fournel, intitulé Ne nous libérez pas, on s’en charge (La Découverte, 2020), entend fournir quelques clés indispensables afin de penser les féminismes d’hier et d’aujourd’hui à la lumière des grands défis contemporains, des inégalités sociales, raciales et de genre. Cette sociohistoire renouvelée des féminismes rend compte des stratégies plurielles déployées par les femmes et les hommes féministes qui ont combattu les inégalités entre les sexes et l’oppression spécifique des femmes, de la Révolution française à nos jours.
Pour Contretemps, les autrices reviennent sur les enjeux généraux du livre et la manière dont il est le produit et participe d’un renouvellement historiographique en cours alimenté par la perspective intersectionnelle, entre autre, dans un contexte où la nouvelle vague féministe apporte de nouveaux questionnements.
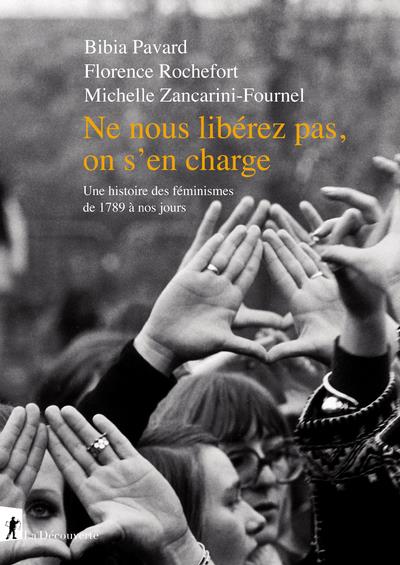
Parmi les enjeux généraux du livre, il y a la volonté de restituer la diversité des prises de parole, des actes qui ont fait l’histoire des féminismes en France. Il s’agit de proposer un ouvrage de synthèse et une histoire plurielle, où des questions sont posées au passé depuis notre présent. Différents moments de lutte féministe sont donc appréhendés, entre révoltes individuelles et collectives pour forger une histoire sociale des féminismes. Comment ce projet a-t-il émergé ?
Bibia Pavard : Au fond, ce livre est le produit de notre démarche dans le séminaire à l’EHESS, dans lequel nous avons réinterrogé depuis 2013 l’histoire des féminismes à partir des questions posées par les étudiantes. Nous souhaitions restituer des généalogies en insistant sur le poids des contextes dans un aller/retour fécond pour penser le présent, avec le passé.
Michelle Zancarini-Fournel : Dans le cadre de ce séminaire, nous nous sommes refusées à donner une ligne, c’est pourquoi il s’agit d’une histoire plurielle, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas des points de vue exprimés. Cependant, nous avons souhaité rendre compte des différentes orientations, des débats qu’elles ont suscités sans prendre explicitement position. Le programme du séminaire puis le livre ont donc été le produit d’une interaction : la question de l’intersectionnalité est venue d’une demande d’étudiant.es. C’est pourquoi, nous sommes retournées vers l’histoire pour comprendre, souligner par exemple comment au 18e siècle l’antiesclavagisme est concomitant à l’expression d’une pensée féministe.
Florence Rochefort : Effectivement, en relation avec cette expérience avec les étudiantes, nous avons cherché à donner des éléments de connaissance pour répondre à leurs questionnements. Par ailleurs, une synthèse manquait : de très nombreux livres ont été publiés dans la période récente, des thèses ont été soutenues faisant émerger des problématiques nouvelles. Nous avons souhaité rendre compte de ces différentes recherches avec l’ambition d’être aussi accessibles à un grand public. Nous cherchions également à aller à l’encontre des idées reçues, montrer les contradictions, la complexité, l’importance des différents contextes : il y a un besoin d’histoire, un besoin de récit historique pluriel et inclusif.
Vous avez déjoué la chronologie féministe des vagues tout en proposant une autre temporalité pour l’histoire des féminismes. Pourquoi ?
BP : La question des vagues a d’abord été une discussion très riche entre nous, avec des désaccords et des lignes qui ont bougé ; on a toutes les trois évolué. Moi, je l’utilisais comme entrée en matière tout en insistant sur les continuités peu rendues par la métaphore. Et progressivement, on a été alimentées par d’autres recherches et on s’est aperçu que cela ne convenait pas pour décrire la complexité : nous avons choisi de ne pas retenir cette métaphore même on nous y ramène sans cesse. Là aussi, nous avons été confrontées aux étudiantes qui évoquaient la 3e voire la 4e vague. Nous avons souhaité réagir à cette facilité de langage et essayer de la déconstruire, montrer que les débats stratégiques et les débats historiographiques ne se situent pas au même niveau. Et bien sûr, cela nous a obligées à réfléchir autrement à chaque rupture chronologique pour en saisir le sens. Par exemple, on s’est longuement interrogées sur la place de 1968 dans l’ouvrage.
MZF : Sur la 3e voire 4e vague, il était important pour moi d’entendre ce qu’avaient à dire les étudiantes car leurs points de vue représentaient une distanciation par rapport aux féministes de la 2e vague.
FR: On a beaucoup peaufiné notre propos au cours des années de séminaire. Une année, nous avions opté pour programme thématique : il nous a semblé que cela provoquait beaucoup de confusions face aux manques de repères historiques de chaque période et des enjeux spécifiques ou significations particulières selon les moments étudiés. Par exemple, l’égalité n’a pas le même sens durant la Révolution Française qu’au XIXe siècle ou qu’aujourd’hui. Finalement, on a donc insisté sur les différentes mobilisations féministes dans leurs contextes politiques selon une trame chronologique. Commencer en 1789 rendait encore plus impossible de parler d’une première vague, puisque l’usage est souvent de les numéroter, ce qui ne supporte pas la longue durée.
Votre livre répond également à un besoin en termes d’enseignement. Vous théorisez le moment #Metoo, comme un moment historique en vous appuyant sur des documents qui peuvent être immédiatement utilisables par les enseignant·e·s.
BP : Effectivement. Il y a une multiplicité d’ouvrages sur des périodes précises mais pas grand-chose qui puisse servir aux étudiant-e-s et aux enseignant-e-s. Et par ailleurs, nous avions la volonté de réintégrer cette histoire des féminismes dans une histoire plus générale. Proposer de nombreux documents, cela vise également à enrichir des cours qui ne portent pas uniquement sur les féminismes.
MZF : Réfléchir aux mots et aux événements sur la longue durée, nous a conduit à modifier l’écriture du récit historique. Ainsi, sur l’ « entre-deux-guerres », partir des féminismes noirs permet de reconsidérer comment la question du suffrage pouvait s’y articuler : notre regard a donc changé sur des questions déjà étudiées par ailleurs.
FR : Il y avait la volonté politique de réaliser une histoire sociale des féminismes, en privilégiant la mobilisation collective tout en dégageant quelques portraits et en soulignant l’impact politique des féminismes. En voulant désidéologiser certaines questions-clés pour les réhistoriciser, il nous semble qu’on repolitise finalement les féminismes, car on ne part pas d’une instrumentalisation idéologique de l’histoire des féminismes: on défait les idées reçues et les raccourcis et on dégage des modes spécifiques de subversion à différentes époques étudiées, sans nier les contradictions internes ou certains conservatismes.
Vous soulignez en conclusion : « Tout au long de l’écriture, ce souffle de révolte nous a portées sans éteindre le souci de véracité historique, mais en espérant que ce livre, grâce à la connaissance du passé, participe pleinement de l’ « insurrection féministe ». » Avez-vous réalisé une histoire féministe ?
BP : Dans les années 2000, j’ai commencé ma thèse, pour être prise au sérieux, il ne fallait pas recevoir l’étiquette d’histoire féministe. Il fallait faire ses preuves et être reconnue comme une historienne qui ne soit pas décriée pour son militantisme. Aujourd’hui, c’est différent, on est poussées par l’histoire en train de se faire. On peut davantage réconcilier les deux et affirmer que faire une histoire solide participe d’un projet militant.
FR : Ce n’est pas vraiment notre vocabulaire bien que nous assumions être portées par ce moment d’insurrection féministe et d’y participer dans une certaine mesure. Dans les années 1990, nous sommes défendues de réaliser une « histoire féministe » parce qu’on nous le reprochait et parce que Christine Delphy prônait alors une « science féministe » a laquelle nous ne souhaitions pas être raccrochées mais aujourd’hui ces craintes sont moins fortes.
MZF : Surtout, il me semble qu’il n’y a pas une seule façon féministe de voir le monde ; Certes, nous avons un point de vue situé, mais c’est un point de vue d’historiennes avec le souci constant de replacer les évènements dans une histoire longue et pas seulement pour une raison disciplinaire. Par ailleurs, si la théorie féministe est nécessaire, je me méfie des théorisations qui ne s’appuient pas sur des éléments et des situations précises et ne correspondent pas à l’histoire des mouvements.
FR : Il me semble difficile de qualifier l’histoire que nous réalisons ainsi car les féminismes comportent toutes sortes de pièges. Tout le monde croit savoir ce que c’est, mais les définitions sont multiples et réaliser une histoire féministe risque de nous enfermer dans un courant. En fait, en réalité, ça dépend du contexte et de la réception.
Durant l’été 2020, il a été question de la trop grande radicalité des féministes actuellement. Pensez-vous qu’il y a une rupture aujourd’hui ? Les féministes ont-elles toujours été radicales ?
FR : La radicalité traverse tout le livre, dans les modes d’actions, les positions etc. Par exemple, les Saint-Simoniennes sont très radicales : ce qu’elles écrivent en 1832 est très audacieux : « La femme, jusqu’à présent, à été exploitée, tyrannisée. Cette tyrannie, cette exploitation, doit cesser. Nous naissons libres comme l’homme, et la moitié du genre humain ne peut être, sans injustice, asservie à l’autre »[1]. Il y a une forme de radicalité dans les discours mais également dans les pratiques. Mais il faut aussi interroger que cela signifie, « être radical » ? Car certaines féministes modérées passaient au regard des préjugés de leur époques pour terriblement radicales, et si on les replace dans l’ensemble d’un mouvement on peut cependant les distinguer par leur prudence, leur modération, voire même leur conservatisme sur certaines questions concernant les mœurs ou le colonialisme par exemple, point que nous avons voulu mettre en lumière.
BP : En réalité, ces différences de positionnement ne sont pas l’apanage du présent et c’est ce qui fait la force et la spécificité des mobilisations féministes. Il y a un enjeu à sortir des catégories utilisées dans le débat public pour décrire le présent. Par ailleurs, l’adjectif radical dans l’histoire est tantôt affublé de connotations positives et tantôt négatives. Aujourd’hui, c’est moins simple d’être radical que dans les années 1970.
Comment s’est nouée cette volonté de proposer une synthèse des féminismes dans une perspective intersectionnelle alors que c’est encore faiblement mis en pratique en histoire ?
MZF : Outre la demande étudiante, il y a la volonté de relire l’histoire sociale et politique en prenant en compte des protagonistes et des situations largement occultées ; c’était l’ambition Des luttes et des rêves également et par ailleurs, en travaillant sur l’histoire longue des Antilles, j’ai découvert d’autre mondes. C’est pourquoi, nous avons relu différemment des textes que nous avions déjà lus de Condorcet, d’Olympe de Gouges, etc. Il y a parfois des utilisations mythifiées de théoriciennes féministes états-uniennes et nous avions la volonté de rendre visibles des élaborations méconnues même si, à Paris, dans les années 1930, il y a beaucoup de circulations avec les textes, les romans, les poèmes d’écrivains américains. Il faut remettre en scène cette pensée et l’envisager dans son contexte.
FR : Outre notre intérêt pour le post-colonial, nous avons souhaité élargir le questionnement, élargir l’espace étudié, en incluant d’autres histoires ; Cela nous a permis de revisiter des enjeux concernant la classe et le mouvement ouvrier en retournant aux sources, c’était très intéressant de voir qu’il pouvait être question de classe voire de race chez Condorcet, par exemple ou encore chez Jeanne Deroin qui parle clairement en 1849 de lutter contre les inégalités « de classe, de race et de sexe ». Cela nous a également permis de relire Hubertine Auclert et son « féminisme colonial ».
BP : il y a également le rôle des études de genre, pluridisciplinaires, dans lesquelles on s’inscrit qui alimente cette perspective. Des travaux en cours ou récents ont par exemple interrogé la place des lesbiennes marginalisées aujourd’hui et dans l’histoire. Nous avons cherché à nouer ensemble ces expériences dans une histoire plurielle, avec une volonté de rééquilibrer le récit.
FR : Oui, quand on parle de genre, on inclut aussi la sexualité : c’est une thématique fondamentale de l’histoire des féminismes. Chez les Saint-Simoniennes, la question du désir s’exprime à travers une politisation des sexualités dans une perspective utopiste ; durant la IIIe République, des lesbiennes qui se disent ouvertement lesbiennes ne font pas le lien avec les féministes ; en revanche elles dénoncent la domination masculine. Il était important de produire un récit inclusif qui donne sa place à la question LGBTQIA+ jusqu’aux revendications actuelles mettant en cause la binarité des sexes comme le font Sam Boursier et Paul Préciado.
Malgré les nombreuses études et votre travail, comment s’assurer que la transmission se fasse ?
FR : L’antiféminisme et la domination masculine tendent à empêcher cette transmission. Il y a également des retours en arrière, dans les programmes d’enseignement, par exemple où les quelques acquis ont été balayés après les mobilisations de la « Manif pour tous ». Face aux stratégies de blocage pour que cette histoire ne se transmette pas dans l’enseignement, il faut trouver des relais intellectuels, médiatiques, pédagogiques et féministes bien sûr. Les nouvelles générations de journalistes, blogueuses, vulgarisatrices féministes sont très efficaces.
*
Propos recueillis par Clyde Plumauzille et Fanny Gallot.
[1] La femme libre, 1er numéro, 1932.