
Revaloriser les métiers à prédominance féminine : c’est le moment ! Entretien avec Rachel Silvera
Après la crise sanitaire et le confinement, la revalorisation des métiers à prédominance féminine est à l’ordre du jour, comme en atteste le reportage de « Cash investigation » du 19 mai consacré à l’égalité professionnelle, tandis qu’une pétition de chercheuses et de syndicalistes revendiquant la revalorisation des « emplois et carrières à prédominance féminine » recueille près de 65 000 signatures et que 6 conseillères régionales de Nouvelle-Aquitaine publient une tribune demandant à ce que « les subventions et marchés publics » soient conditionnés à l’égalité salariale et « les emplois majoritairement occupés par des femmes » revalorisés, entre autre[1].
Dans cet entretien, Rachel Silvera, économiste et autrice de Un quart en moins. Des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaires, paru aux éditions La Découverte en 2014, revient sur ces enjeux et leur actualité. Elle montre que « les métiers les plus utiles socialement sont les moins payés »[2] et insiste sur la nécessité d’inverser les priorités.
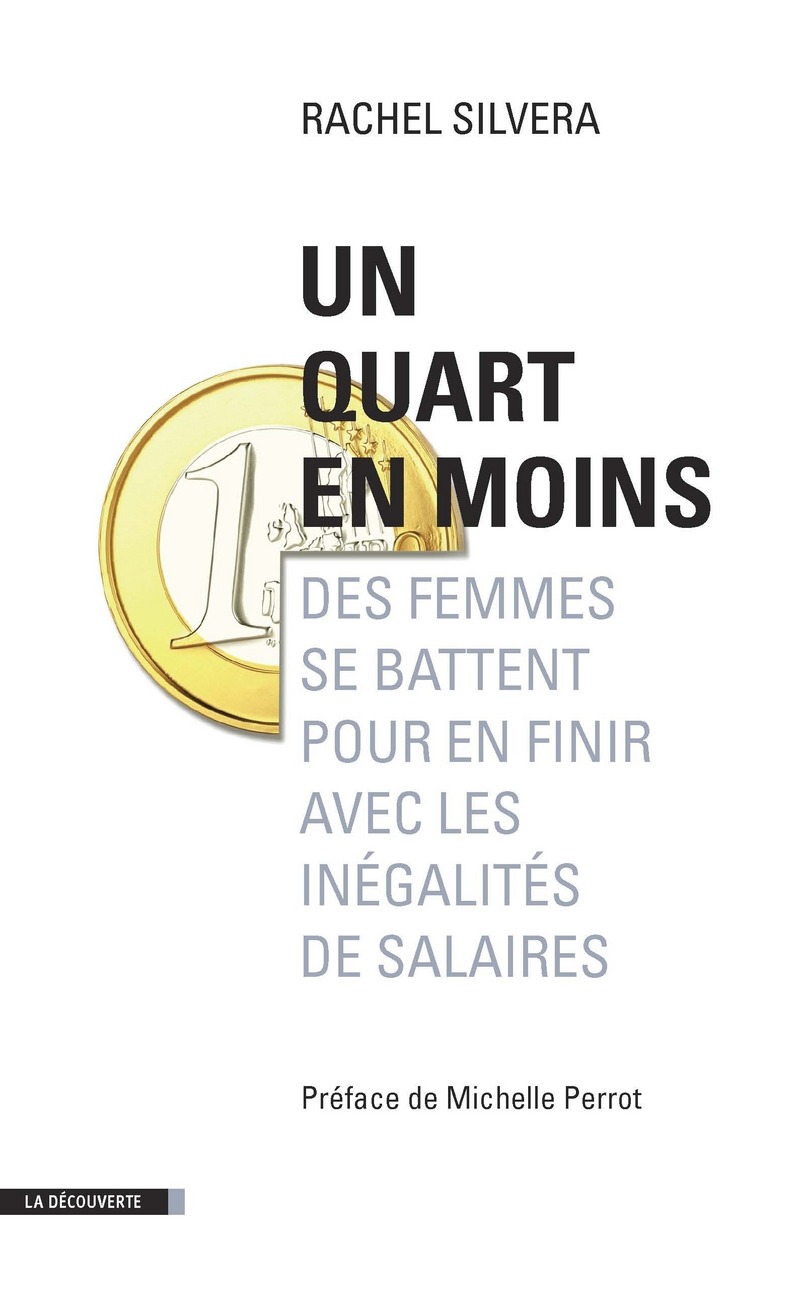
Comment expliquer l’ouverture de cette brèche ?
Notre génération a connu une crise historique qui s’est inscrite dans un climat de grève, contre la réforme des retraites juste avant la crise du covid-19 d’une part, mais aussi, depuis plus longtemps dans les hôpitaux, les urgences, les EPHAD d’autre part où le manque de moyens chronique est dénoncé.
Pourtant, on a toujours considéré que la France était à la pointe en matière de santé, en ignorant totalement le fait que la cheville ouvrière de ce système, ce sont des millions de femmes : elles sont 722 000 infirmières soit 86,6% de la profession, 495 000 aides-soignantes soit 91% de la profession, etc.[3] : leurs horaires sont le plus souvent décalés, et leur rémunération s’élève à 1700 à 2000 euros pour les premières et au SMIC pour les secondes. Ce sont aussi des aides à domicile, des agentes d’entretien ou des caissières, qui non seulement sont payées au smic mais subissent aussi des temps partiels courts, éclatés… et dont on a moins parlé pendant la crise.
Dans les circonstances que l’on a connues, elles ont dû toutes maintenir leur activité et se sont trouvées « davantage exposées aux risques de contamination » selon une enquête de l’UGICT-CGT ce qui leur a quelquefois coûté la vie. C’est pourquoi elles ont été applaudies tous les soirs. Nous nous situons dans un moment clé ou les travaux de recherche obtiennent enfin un certain écho médiatique, où les syndicats se saisissent de la question, sans doute en relation avec la nouvelle dynamique féministe mondiale. Jusque-là, ça n’avait pas fonctionné en France car nous n’avions jamais pu observer ce triptyque : recherches féministes, enjeu syndical essentiel et volonté politique, ce qui a été le cas du Québec en 2006, lorsque le gouvernement – de droite – a lancé une nouvelle politique en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur la revalorisation des emplois féminisés autour de « l’équité salariale » : il y a été contraint par un mouvement d’ampleur. En France, on n’a jamais connu cela.
Peux-tu revenir sur les enjeux autour de la « valeur égale des travaux » ? Qu’est-ce que cela signifie ?
Globalement, il s’agit de comprendre que les femmes et les hommes ne font pas les mêmes travaux, rappelons qu’il n’y a que 17% d’emplois mixtes. Pour autant, on peut comparer des emplois à prédominance féminine et masculine et voir s’ils se valent et donc appellent une rémunération équivalente. Aujourd’hui, dans bon nombre de cas, lorsque l’on fait cet exercice de comparaison, on observe qu’un travail à prédominance masculine vaut plus qu’un travail à prédominance féminine, même à diplôme et qualification équivalents.
Par exemple, comment comprendre qu’en fin de carrière, une infirmière hospitalière (en catégorie A seulement depuis 2010) gagne moins qu’un technicien hospitalier (en catégorie B), du fait notamment de primes de « technicité » ? Cette question de la dévalorisation de nombreuses professions féminisées prend un écho particulier aujourd’hui, car on comprend à quel point leurs travaux sont essentiels. S’il est impossible du jour au lendemain de rebattre les cartes de la division sexuée du travail, une revalorisation profonde est envisageable et elle s’accompagne d’une évaluation de la « valeur égale des travaux ».
En France, ce champ d’étude sur la valeur égale des emplois s’est peu développé. Seuls le Comité du Travail Féminin, une institution française du féminisme d’État ou la CFDT dans les années 1980 ont abordé cette question. A propos de la loi de 1972 qui prévoit un salaire égal pour un travail de valeur égale, le Comité du Travail Féminin pointe cette question : pour estimer la valeur du travail, il en faut une estimation objective qui doit se mesurer à travers les qualités professionnelles mobilisées qu’il s’agisse des connaissances, des capacités, de la dextérité, de l’habileté ou de la force physique, qualités qui impliquent un effort physique ou intellectuel dans leur mise en œuvre.
La loi dite Roudy sur l’égalité professionnelle de 1983 traite de la « valeur égale des travaux » et prend en compte cette question mais malheureusement, elle est peu appliquée. Pourtant, depuis cette loi, le code du travail précise que « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».[4]
Et maintenant, où en est-on à ce sujet ?
Petit à petit, on a mis la pression. L’économiste Séverine Lemière a réalisé sa thèse sur les discriminations salariales entre hommes et femmes en 2001, en intégrant cette démarche. Nous avons élaboré un guide pour le Défenseur des droits intitulé Pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine[5], à partir de l’étude de deux branches professionnelles, le commerce et les assurances.
Pour la réalisation de ce guide, nous avons créé un groupe de travail pendant deux ans à la Halde (avant qu’elle ne devienne le Défenseur des droits), avec des juristes, des sociologues, économistes et des syndicalistes ; mais le MEDEF a refusé de venir, considérant que nous n’étions pas objectives. En 2013, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle est signé par certaines organisations syndicales et prévoit que les classifications soient révisées pour que les critères d’évaluation ne soient pas discriminants.
Mais ceci est resté encore une fois lettre morte… Du coup, le Conseil Supérieur à l’Égalité professionnelle a repris le flambeau, en rédigeant un nouveau guide, auquel j’ai participé, pour inciter les branches à intégrer notre démarche. Le MEDEF, qui participe à cette instance, est présent dans le groupe de travail mais refuse, au dernier moment, le texte et considère que le CSEP n’a pas à s’immiscer dans les prérogatives des branches. Le guide sortira tout de même, avec l’avis de chaque acteur social[6].
Aujourd’hui, on avance. En avril, la tribune a recueilli la signature des 8 organisations syndicales, de leur n°1 et de leurs responsables femmes, ce qui est très rare. Le contexte est donc très favorable. Il faut mettre en avant l’utilité sociale des professions féminisés. Il y a actuellement une volonté de porter le sujet. Par exemple, la CFDT lance une réflexion sur les « compétences naturelles » présumées féminines. La CGT porte la question de la revalorisation des emplois féminisés depuis une dizaine d’années et veut relancer une campagne sur le sujet, etc. Bien sûr, cela suscite des débats, des détracteurs y voyant une querelle des sexes : le salaire des hommes éboueurs ou dans les abattoirs n’est-il pas à revaloriser également ? Il me semble que ça n’est pas la question.
Tu as été consultée dans le cadre de l’élaboration des lois proposées par François Ruffin ? Dans quelle mesure cela s’insère dans les enjeux de revalorisation des métiers à prédominance féminine ?
Après un premier projet sur les « femmes de ménage », il propose actuellement une loi sur les auxiliaires de vie sociale. Et c’est tout à fait lié avec la revalorisation des métiers à prédominance féminine car ce sont des métiers sous-payés, très précaires, déqualifiés – les qualifications ne sont pas reconnues, parce qu’il s’agit justement de « métiers de femmes », comme le disait il y a fort longtemps Michelle Perrot.
Sur les « femmes de ménage », l’idée était de limiter les dégâts de l’externalisation, pour faire en sorte que les droits sociaux des salarié·e·s soient les mêmes que ceux des donneurs d’ordre. Il souhaitait également taxer à 50% les heures avant 9h et après 18h. Cette loi où Géraldine, femme de ménage, prend la parole, est passée à la commission des affaires sociales et LREM a transformé le projet en demandant aux entreprises qui emploieraient des salarié·e·s en dehors des heures de journée de « motiver leurs refus », ce qui n’était pas du tout l’objectif. François Ruffin a donc décidé d’abandonner le projet.
Actuellement, il a remis un rapport avec Bruno Bonnel (LERM) sur les métiers du lien et ils élaborent une proposition de loi sur les auxiliaires de vie sociale : ils partent du vécu de ces femmes et propose que l’ensemble des AVS soient regroupées dans un seul statut et que leur temps de travail soit mieux reconnu, en intégrant le temps de transport, et que leur intervention ne puisse être sur des très courtes durées, par exemple un quart d’heure seulement pour une toilette. Je crois qu’on peut encore aller plus loin, car la plupart du temps, ces salariées sont à mi-temps et cela renforce encore leur précarité. Je me demande s’il ne faudrait pas défendre un SMIC mensuel, car en réalité, il n’y a que le SMIC horaire qui s’applique.
Dans le cadre des lois concernant la revalorisation des métiers à prédominance féminine et l’égalité professionnelle, n’as-tu pas l’impression que les classes populaires sont souvent absentes ?
Dans les politiques publiques en matière d’égalité en général, ce qui a bien fonctionné, c’est ce qui favorise l’accès des femmes au niveau des catégories supérieures, comme c’est le cas de la loi Copé-Zimmermann sur les femmes dans les Conseil d’Administration des entreprises. Oui, ce phénomène existe comme l’évoque Le féminisme pour les 99%[7], ou encore le travail de la sociologue Sophie Pochic sur « l’égalité élitiste » : l’égalité, c’est devenu une arme pour celles d’en haut[8]. On retrouve le même principe dans l’index égalité salariale, où finalement pour le ministère du travail, il n’y aurait pas de problème d’égalité salariale en France, mais un problème d’accès aux 10 plus hautes rémunérations dans l’entreprise pour les femmes ! Mais de quelles femmes parle-t-on ? Qu’en est-il de la lutte contre la précarité et les bas salaires ?
Et, avec les réformes actuelles, les plus atteintes sont toujours les femmes les plus précaires, comme c’est le cas de la réforme sur l’indemnisation du chômage ou encore de la réforme des retraites, où le gouvernement a osé annoncer que les femmes seraient les grandes gagnantes !
Pour ce qui est de la question de la revalorisation, il s’agit surtout de catégories intermédiaires de salariées des services. Mais c’est vrai que de nouvelles divisions apparaissent entre celles qui acquièrent une certaine visibilité, comme les infirmières aujourd’hui, tandis que tout un champ reste invisible comme c’est le cas des agentes d’entretien hospitalières embauchées par des sous-traitants, souvent d’origine étrangère et qui ont disparu du Ségur sur la Santé. D’ailleurs, certaines font grève actuellement pour demander une revalorisation salariale, comme c’est le cas au CHU de Nantes. Je pense que mon combat, en tant que chercheuse féministe, c’est justement que cette revalorisation concerne aussi toutes ces professions invisibles que l’on considère à tort comme non qualifiées, alors qu’elles sont aussi essentielles !
Propos recueillis par Fanny Gallot.
Notes
[1] La Tribune, Reconnaissons la place des femmes après cette crise !, le 26 mai 2020.
[2] https://blogs.alternatives-economiques.fr/alterco/2020/05/26/les-distinctions-sociales-ne-peuvent-etre-fondees-que-sur-l-utilite-commune-chiche
[3] Ibid
[4] Art L3221-4 du code du travail
[5] Rachel Silvera, Marie Becker et Séverine Lemière, Pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine, 2013, Le défenseur des droits. https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_gui_20130301_discrimination_emploi_femme.pdf
[6] CSEP, Guide pour la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les systèmes de classification, 2017 https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/11/GUIDE_EGALITE_SYSTEMES_DE_CLASSIFICATIONS-V2-bat-Vfinale.pdf
[7] Arruzza Cinzia, Bhattacharya Tithi, Fraser Nancy, Le féminisme pour les 99%. Un manifeste, La Découverte, 2019.
[8] Pochic, Sophie. « Féminisme de marché et égalité élitiste ? », Margaret Maruani éd., Je travaille, donc je suis. Perspectives féministes. La Découverte, 2018, pp. 42-52.









