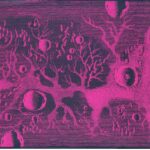Siempre Maradona
Pendant quelques années de ma vie, j’ai cru que j’étais une passionnée de foot. La coupe du monde de 1986 reste parmi les souvenirs les plus heureux de mon enfance. Les sensations éprouvées lors de chaque match de l’équipe d’Argentine ont subsisté presque intactes dans ma mémoire. L’équipe montait à grande vitesse lors de chaque contre-attaque.
On regardait ces matchs tous ensemble en famille, en se tenant les mains à chaque belle action, en sursautant sur le canapé après chaque but manqué ou action ratée de l’équipe adverse, en pleurant de joie à la fin de chaque match. Le cœur battait très fort. L’adrénaline, la joie ? Les deux sûrement. Je n’ai jamais vu mes parents aussi heureux. Ils rigolaient, ils faisaient des blagues, s’embrassaient. Ils étaient assis côte à côte sur le canapé. En les voyant, je me disais bien que c’était ça le bonheur.
Pendant plus d’un mois, on n’a pas entendu parler des problèmes financiers du foyer causés par l’hyperinflation dans laquelle plongeait le pays. Aux interminables heures de travail de mes parents pour nourrir une famille de quatre enfants (le cinquième naîtra quatre ans plus tard), succédaient le réconfort face aux matchs de l’Argentine.
On avait même droit à du Coca-Cola et des chips pendant les matchs ! Ce qui autrement était réservé aux fêtes d’anniversaire.
À l’école, garçons et filles, on ne parlait que de ça : « Tu as vu cette passe de Burruchaga ? Trop fort le mec », « et le jeu de Passarella ? », « Pumpido (j’étais amoureuse de lui à l’époque), sans doute le meilleur gardien du monde ! », « Maradona, un dieu ! », « On a un gardien qui est une vraie merveille, il arrête les pénaltys même assis sur une chaise ! », on chantait ça en chœur et sans arrêt à la recrée.
On échangeait des figurines de ces joueurs qui étaient pour nous tous et toutes des dieux. Ils nous rendaient heureux, ils rendaient heureuses nos familles. Ils étaient presque en train de réussir l’impensable : nos parents ne se disputaient plus. Ils étaient en train de nous prouver que le bonheur existe.
Et puis, il y a eu le quart de finale.
L’Argentine était arrivée en quarts ! Le bonheur allait continuer et le rêve serait peut-être possible !
L’année 1986 avait été déclarée année de la paix par les Nations Unies. A chaque match on pouvait lire l’emblème « Football for peace – Peace Year ». Mais comment imaginer la paix à quatre ans à peine de la Guerre de Malouines ? Un des souvenirs les plus traumatiques de mon enfance.
Avoir six ans et habiter en Patagonie pendant cette guerre. Voir passer les avions militaires pendant mes jeux d’enfant et lever les yeux au ciel, troublée par le bruit assourdissant. « Il vont aux Malouines », me disaient mes parents, « vas-y salue avec tes mains nos soldats héroïques ».
Avoir six ans et devoir penser à ça. Se rendre chez la fermière voisine pour lui acheter du lait. Sonner à sa porte et la voir arriver toute excitée parce qu’elle avait cru que j’étais le facteur qui apportait une lettre de son fils parti aux Malouines. Il avait dix-huit ans son fils, comme la plupart des 12.500 soldats qui y sont partis.
Il faisait partie de la promotion malchanceuse qui avait commencé le service militaire obligatoire au mois de mars, et qu’un mois plus tard à peine le gouvernement dictatorial envoya aux Malouines. Il n’avait jamais pris un fusil, on lui a appris à s’en servir en urgence. Il savait moins encore se servir d’un canon, on le lui a probablement enseigné sur place. Il n’est jamais revenu le fils de la fermière, comme 649 autres soldats.
Avoir six ans et écrire une lettre pour la glisser dans une tablette de chocolat à envoyer au front.
Avoir six ans lorsque les cours à l’école s’arrêtent et qu’on nous emmène cueillir des fruits, dont les adultes feraient de la confiture à envoyer aux soldats des Malouines. « Une douceur pour les réconforter, car ils sont seuls, ils ont peur, ils ont faim et surtout ils ont très froid là-bas », nous disait-on, tandis que d’autres enfants trouvaient dans des tablettes de chocolats achetées dans les commerces de tout le pays des lettres adressées à ces mêmes soldats, signe que le gouvernement ne leur faisait pas parvenir ces gestes de réconfort.
Avoir six ans et faire des cauchemars de Margaret Thatcher, qui était pour moi la femme la plus méchante qui ait jamais existé. Je l’imaginais assise sur une espèce de banc démesuré qui coupait en deux le champ de bataille, s’amusant à voir de petits soldats éventrés par ses bombes.
Il faut avoir vécu ces années-là en Argentine pour comprendre l’ampleur de ce match de quart de finale.
Ce n’était plus seulement du foot : quelque chose d’autre, de l’ordre de la revanche et de la dignité populaires se jouait ce jour-là. Il y a d’abord eu ce premier but de la tête (du moins c’est ce qu’on a cru sur le moment), marqué par Maradona à la minute 51, au début de la deuxième période, et alors qu’on était en train de se dire que les Anglais ne pouvaient pas s’en tirer ainsi. L’arbitrage vidéo de nos jours l’aurait annulé de suite. Mais à l’époque cette technologie n’était pas au point. Il est passé. Nous, on n’a rien vu de tout ça, mais on a vidé nos poumons à s’en déchirer la gorge en criant le but : « Gooooool, goooooool, gooooool ».
Après le match, c’est désormais légendaire, el Diego reconnaîtra que ce fut un but marqué de la main, mais pas la sienne, celle de Dieu, car il fallait gagner ce match à tout prix, c’était très important pour les Argentins et Dieu a rendu possible ce que les hommes n’auraient pas pu.
Je n’ai plus jamais vécu de moments de joie aussi bouillonnants que celui-là. Je me suis dit que c’était toujours comme ça le foot. Ou la vie, peut-être.
Et puis, minute 54, cet autre but, Maradona part du milieu du terrain, esquive, dépasse, se débarrasse de tous ces Anglais, et comme si rien n’était, comme si des actions comme celle-là étaient courantes au foot, il marque un but. À ce moment précis, le foot était devenu un art et ce but un chef-d’œuvre. S’y ajoutaient les commentaires du journaliste sportif Victor Hugo Morales, ses larmes de joie, et ses excuses pour ces larmes. Ses mots et onomatopées marquaient avec une extrême précision chaque mouvement de Maradona. Des mots si justes qu’on dirait préparés à l’avance, et qui n’étaient que la spontanéité la plus pure.
Ce jour-là est né chez moi le goût pour le langage, pour la parole précise qui donne vie aux choses. Car je ne peux pas séparer « le but du siècle » du récit de notre Victor Hugo. « Cerf-volant cosmique d’où sors-tu pour laisser sur ton chemin autant d’Anglais ? ». Il l’a fait, il a vengé la mémoire de nos jeunes soldats, l’absurdité de leur mort sur les froids rivages de l’Atlantique sud.
L’Argentine gagne la coupe du monde de 1986, on connaît la suite de l’histoire : un mythe a été consacré ce jour-là. Un mythe qui était déjà en train de se construire depuis ses exploits dans l’équipe de Naples. « Siempre Maradona… », « Toujours Maradona », disait Victor Hugo Morales au moment de commenter cette action incroyable, pour guider l’auditeur et lui faire comprendre qu’un même joueur était en train de faire tout cela[1].
Après cela, j’ai vraiment cru que le foot était quelque chose d’extraordinaire.
Par la suite j’ai été déçue. Plus jamais, je n’ai retrouvé une telle adrénaline et une joie pareille lors d’aucun match. Plus jamais, aucune compétition ni coupe du monde ne m’a fait un tel effet.
Avec le temps, j’ai décidé de passer à autre chose, le foot n’a pas autant de valeur que je l’avais cru.
Il paraît que Maradona a fait de même, on connaît malheureusement d’autres suites de son histoire : drogue, femmes, excès, machisme et violences physiques ou psychologiques envers ses propres filles et son ex-femme, refus de reconnaître ses nombreux enfants illégitimes (en bref, le comportement type de nombreux fils modèles du patriarcat, mais sous le zoom des caméras et les facilités de l’argent).
Mais je garde toujours en moi le Maradona de 1986 et celui des quelques années qui ont suivi. Celui qui a fait pour tant d’autres Argentin·es la même chose qu’il a faite pour moi : nous rendre heureux·ses. Je garde le Maradona qui avait le génie du langage, la perspicacité de la rue, la lucidité du peuple, car il nous a laissé des expressions mémorables qui pimentent le parler quotidien argentin.
Mais il est toujours imprévisible celui-là.
Il meurt au moment même où Netflix diffuse la saison 4 de The Crown, que je regarde, curieuse justement du portrait de Margaret Thatcher.
Comme je m’y attendais, la série passe très rapidement sur le conflit de Malouines, Margaret Thatcher apparaît plutôt comme une femme très humaine, anéantie par la disparition de son fils. Au même moment, elle était en train de faire tuer ou mutiler les fils de centaines de femmes argentines. Cela, jusqu’à son dernier souffle, Maradona ne m’a pas permis de l’oublier. Ah, siempre Maradona…
*
Publié initialement sur le blog de Bettina Ghio.
Notes
[1] Lire également Mickael Correia, « Maradona, Dieu et le Diable », CQFD, 25 novembre 2020.