
Le communisme de Weimar comme mouvement de masse. Entretien avec Ralf Hoffrogge
Dans cet entretien, l’historien allemand Ralf Hoffrogge propose une synthèse des débats historiographiques autour du mouvement communiste sous la République de Weimar – à partir d’un ouvrage co-dirigé avec Norman LaPorte. Des débats autour de la stratégie du Front Unique aux positions de l’opposition de gauche du KPD, Hoffrogge – dont l’ouvrage sur Richard Müller vient d’être traduit en français, aux éditions Les Nuits rouges – propose un tour d’horizon des grandes tendances historiographiques dans l’approche de l’un des mouvements ouvriers les plus importants de l’Europe de l’entre-deux guerres.
Ralf Hoffrogge est chercheur associé à l’Institut des mouvements sociaux (Université de la Ruhr à Bochum). Son principal champ de recherche est l’histoire du mouvement ouvrier allemand et en particulier les biographies de militants ouvriers. En 2008, il a publié une biographie de Richard Müller (1880-1943), figure de proue de la Révolution allemande de 1918, récemment traduite sous le titre Richard Müller. L’Homme de la révolution de novembre 1918 (éditions Les Nuits Rouges, 2018). Sa dernière publication est une biographie de Werner Scholem, frère de Gershom Scholem et membre du Reichstag allemand : A Jewish Communist in Weimar Germany – The Life of Werner Scholem (1895-1940) (Brill Publishers Leiden 2017, le livre broché sortira chez Haymarket Press cette année). En ce moment, Hoffrogge travaille sur une étude comparative des syndicats de la métallurgie allemands et anglais.
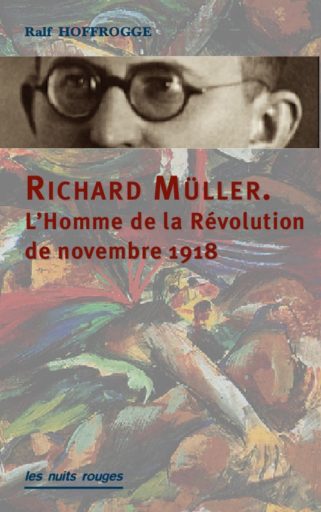
Le livre que tu as coordonné avec Norman Laporte, Weimar Communism as Mass Movement, 1918-1933 (Lawrence and Wishart, 2017) se penche sur une période historique relativement longue. Comment avez-vous décidé des thèmes traités dans le livre ?
Le livre s’intéresse aux dernières recherches disponibles sur le communisme allemand. Mais en dehors de la chercheuse française Constance Margain, qui a écrit un chapitre sur les syndicats communistes de marins, toutes ces études n’étaient disponibles qu’en allemand – seuls des spécialistes pouvaient y avoir accès, ce qui est dommage. Car il y a encore beaucoup de choses à découvrir : en raison de l’ouverture des archives jusqu’alors fermées, à Moscou et à Berlin-Est en 1989, nous en savons bien davantage à présent sur le mouvement communiste en Allemagne.
Tandis qu’une première vague de recherches s’étaient penchées sur la RDA et son parti au pouvoir après 1949, le SED, les années 2000 ont connu l’essor de recherches sur le communisme pendant la République de Weimar. Ces années ont vu l’exhumation de faits et perspectives inconnus auparavant : les études sur l’aile gauchiste du parti qui s’est opposée à Staline, des études sur le KPD et les agriculteurs, des biographies de dirigeants tels qu’Ernst Meyer ou Ruth Fisher, la première femme à avoir dirigé un parti de masse en Allemagne. Nous voulions rendre ces formidables études accessibles à un public international.
Une question importante soulevée dans ce livre est celle de la politique du front unique du KPD. Pourrais-tu expliquer dans quelle mesure le front unique n’était pas qu’une sorte de Realpolitik mais également un moyen d’affaiblir le SPD en « démasquant » celui-ci ?
Ernst Mayer, l’un des dirigeants du KPD, qui a inventé cette approche, la désignait par le concept de « revolutionäre Realpolitik » – Realpolitik révolutionnaire. Florian Wilde a écrit un chapitre sur ce point dans notre livre. Il ne s’agissait pas tellement de « démasquer » le SPD – le « démasquage » était une adaptation assez vulgaire de ce schéma. Il s’agissait en réalité de formuler des revendications qui puissent être crédibles pour les ouvriers, et non pas utopiques, mais dépassant le syndicalisme contemporain. Cela comprenait des luttes salariales offensives mais également d’autres revendications – par exemple un référendum pour exproprier la noblesse allemande en 1924.
La révolution avait pris le pouvoir politique aux aristocrates, mais pas leur grand nombre de titres fonciers et autres propriétés. Cette campagne était républicaine et non communiste, mais elle s’en prenait à la propriété privée. Celle-ci allait donc au-delà du seul cadre des luttes dans lesquelles les dirigeants sociaux-démocrates étaient prêts à s’engager. Ainsi, l’idée originale d’un front unique ne consistait ni en une union défensive contre le fascisme ni en un effort sectaire pour « démasquer » le SPD par une propagande éclairée. La perspective initiale était d’enclencher des luttes ouvrières par le bas, qui puissent faire bouger l’ensemble de la sphère politique vers la gauche.
Comme Norman Laporte et toi l’écrivez dans l’introduction, le KPD n’était pas un parti prolétarien uniquement d’un point de vue idéologique, mais également d’un point de vue sociologique, alors que la majorité de la population vivait dans les campagnes. Pourrais-tu revenir sur les conséquences politiques de cet aspect du KPD ?
L’urbanisation était forte, même dans la République de Weimar, et les décisions politiques étaient prises dans les villes. Néanmoins, l’électorat était disséminé dans les campagnes et était bien plus conservateur. On peut donner l’exemple de la Révolution allemande – une révolte dans les villes, dominée par des revendications socialistes. Mais les premières élections, en 1919, n’ont pas abouti à une majorité de gauche. Des partis religieux, comme le Zentrum, arrivaient à organiser les ouvriers dans une perspective conservatrice. Ils dominaient le milieu rural, l’Église y faisait toujours figure d’autorité, tout comme le Reichslandbund. Cette organisation était dirigée par de grands propriétaires mais représentait symboliquement les petits agriculteurs et les campagnes dans leur ensemble.
Le KPD, comme le SPD auparavant, n’a jamais réellement eu accès à ces milieux ruraux. À l’Est, où il y avait de grands domaines, beaucoup d’agriculteurs pauvres ont quitté la campagne pour la ville et sont devenus des prolétaires, les nouveaux arrivants étaient des ressortissants étrangers – ils ne pouvaient pas voter et des campagnes racistes, contre les ouvriers polonais, ont réussi à ce que les électeurs allemands restent alignés sur un agenda conservateur. Les petits agriculteurs dominaient à l’Ouest et dans le Sud. Mais ils se percevaient comme des exploitants et certainement pas comme faisant partie de la classe ouvrière.
Cet aspect était renforcé par l’économie de guerre de la Seconde Guerre mondiale : les campagnes devaient nourrir les villes, une économie planifiée était synonyme de bas prix et de pertes de profits pour les agriculteurs. C’est là qu’a pris racine un sentiment anti-urbain que l’Église et les conservateurs étaient prêts à exploiter. Le KPD n’a jamais réellement saisi ces dynamiques, pas plus que le SPD d’ailleurs.
Le chapitre que tu as écris dans le livre porte sur l’opposition d’extrême-gauche à Berlin entre 1921 et 1923. Pourrais-tu expliquer quelle était la position de cette opposition sur le front unique et en quoi celle-ci était liée à une position antinationaliste ?
L’opposition de gauche, telle qu’elle se dénommait elle-même, avait peur que le KPD ne perde son « visage communiste » lorsqu’une première version du front unique a été discutée en 1921-22. Ils avaient à l’esprit des figures comme Paul Levi, un ancien dirigeant du parti qui avait quitté le KPD et rejoint les sociaux-démocrates après une insurrection ratée en 1921. L’aile gauche craignait qu’il ne devienne un modèle à suivre pour l’ensemble du parti, par conséquent, ils se sont opposés à toute perspective de rapprochement avec les sociaux-démocrates. Ils méprisaient le SPD pour sa « politique de coalition » – des coalitions avec les partis chrétiens et libéraux. Au lieu de cela, l’aile gauche du KPD espérait qu’une nouvelle révolution éclate sous peu.
Il s’agissait également d’une scission majeure au sein de l’aile modérée du KPD : leurs partisans d’une « Realpolitik révolutionnaire », tels qu’Ernst Meyer par exemple, avaient pris conscience que la révolution était terminée, ils ont donc inventé la stratégie du front unique comme une stratégie à long terme. Mais l’aile gauche a rejeté celle-ci, espérant bâtir une avant-garde bolchévique, un petit noyau pouvant guider les masses au cours de l’inévitable prochaine crise qui mènerait à une nouvelle révolution. Cet espoir était intimement lié à l’idée d’une révolution mondiale. C’est pourquoi l’aile d’extrême gauche du KPD était très internationaliste et souvent même anti-nationaliste. La gauche communiste détestait le SPD non seulement à cause de leurs compromis, mais également en raison du tournant nationaliste pris en 1914, avec le soutien à la guerre du Kaiser. Selon eux, la guerre et les compromis de classes étaient intimement liés – c’est pourquoi ils ne pouvaient accepter le front unique.
Deux chapitres se penchent notamment sur le rapport du KPD avec les syndicats. Pourquoi avoir choisi de consacrer toute une partie du livre à ce sujet ?
Tout simplement parce que le front unique, qui impliquait un travail au sein des syndicats, n’a jamais pris racine dans le communisme allemand. Le KPD n’a jamais eu de politique cohérente concernant le syndicalisme (trade-union) : en 1919, le KPD était principalement syndicaliste (syndicalist), nombre de ses membres formaient de nouvelles organisations syndicales (unions) contre les fédérations dominées par le SPD. Mais dans le même temps, un autre groupe d’ouvriers communistes est resté au sein des vieilles fédérations – contrairement à la France, les syndicats ne se sont pas scindés sur des questions politiques.
Après quelques années, les communistes allemands ont abandonné cette stratégie duelle infructueuse. En 1924, le KPD a demandé à ses membres de rejoindre les syndicats sociaux-démocrates et de travailler au sein de ceux-ci. Il y a eu quelques succès, mais dès 1928, le KPD a pris un virage à gauche et a, de nouveau, commencé à mettre sur pieds des « syndicats rouges » purement communistes. Pour la majorité des syndicats, il était désormais aisé de les dénoncer, arguant du fait que les communistes divisaient et détruisaient l’unité de la classe ouvrière.
Néanmoins, les « syndicats rouges » jouissaient d’un véritable soutien durant la récession économique des années 1930. Alors que des recherches plus anciennes affirment que ces syndicats étaient des machines-outils de Moscou, les essais de Stefan Heinz et de Constance Margain publiés dans notre livre démontrent qu’il y a eu un moment de radicalisation au sein des syndicats rouges – bien qu’il n’ait jamais eu de soutien de masse ou conquis l’hégémonie.
Un point extrêmement intéressant concerne l’attitude de certaines figures du KPD envers l’« approche Schlageter » ainsi qu’envers le nationalisme et l’antisémitisme. Pourrais-tu revenir sur cette question ?
L’ « approche Schlageter » a été nommée d’après un sympathisant nazi ayant saboté des trains français transportant du charbon en 1923 – la France avait saisi les mines de charbon dans la région de la Ruhr, le charbon étant pris comme réparation pour la Première Guerre mondiale. L’extrême droite a mis sur pied des groupes paramilitaires pour en saboter le transport et Schlageter a été exécuté par les Français pour y avoir participé.
Inspiré par Karl Radek, un expert allemand du Komintern, le KPD avait lancé une campagne nationaliste qui, d’une part, mettait en garde contre la montée du fascisme, mais de l’autre, saluait la « bravoure » de Schlageter. L’idée était de gagner des sympathisants fascistes à la cause communiste. Mais cela n’a jamais marché – en acceptant le cadre nationaliste, les communistes avaient laissé le débat à la droite. Cette approche a donc été abandonnée après quelques semaines. Mais celle-ci est toujours débattue aujourd’hui, souvent citée comme preuve du nationalisme, voire même de l’antisémitisme, qui serait à la racine du KPD.
C’est absurde, car la ligne Schlageter n’a duré que quelques semaines. Mais j’ai également découvert de nouvelles preuves selon lesquelles la gauche communiste, avec des personnalités telles que Werner Scholem ou Max Hesse, s’est âprement opposée à la ligne Schlageter. Selon eux, tout appel à l’unité nationale était une trahison de la lutte des classes internationale – leur opposition au front unique comprenait une forte opposition au nationalisme allemand. Mais l’essentiel de cette critique n’a jamais été rendue publique. À cause de la discipline du parti, elle a uniquement été discutée dans des débats internes qui ont été enfouis dans les archives.
Si l’on prend ceci en compte, il devient évident que la ligne Schlageter n’était pas partagée par l’ensemble du parti et qu’elle était fortement contestée.
Quelle influence le KPD a-t-il eu sur les artistes durant l’entre-deux guerres ? Le chapitre de Fredrik Petersson[1] sur Willi Münzenberg est fascinant. Dans quelle mesure les questions esthétiques croisaient-elles celles de la propagande au sein du KPD ?
Le chapitre de Petersson montre le vif internationalisme défendu par Münzenberg, qui était le cerveau derrière l’agitation de l’Internationale communiste (IC) contre le colonialisme et le racisme, il a amené des travailleurs et militants d’Afrique, d’Inde, mais également des ouvriers noirs des États-Unis, à écrire pour ses journaux, conquérant ainsi une audience de masse en Europe.
Münzenberg avait compris que son message avait besoin d’une nouvelle esthétique – il travaillait étroitement avec des artistes et des graphistes d’avant-garde, comme John Heartfield. Les couvertures de son journal sont des œuvres d’art intemporelles, qui continuent d’influencer notre perception de l’Allemagne de Weimar. Mais la direction du KPD n’était pas tellement avant-gardiste – si l’on regarde le journal Rote Fahne et qu’on le compare aux journaux de Münzenberg, il était bien plus conventionnel, moins expérimental.
Finalement, c’est ce conservatisme culturel qui dominait. Dans son article sur le communisme et la littérature, Ben Fowkes montre que le « réalisme socialiste » est devenu de plus en plus dominant au début des années 1930, affaiblissant la position d’écrivains plus indépendants au sein du mouvement littéraire du KPD.
Tu as également écrit une biographie politique de Werner Scholem, récemment traduite en anglais. Quel a été le rôle de Scholem dans la « bolchévisation » du KPD ?
Scholem était un personnage paradoxal : représentant la bolchévisation tout en étant un fervent opposant à la stalinisation. Il était l’un des protagonistes de la gauche communiste. En 1924-1925, Scholem faisait partie d’une direction de gauche du parti qui a remplacé l’ancien centre du parti. Bien que la charismatique Ruth Fischer était la dirigeante officielle du parti, Scholem était à la tête de l’appareil de parti – et il a orchestré une campagne de « bolchévisation » qui a déplacé la position de tous les partisans du front unique.
Il prônait une Révolution bolchévique mondiale – pour lui, la gauche ne servait qu’à se débarrasser de l’ancienne direction, mais Staline ne voulait clairement pas de communisme allemand indépendant. Il s’est donc débarrassé de Fischer et de Scholem, et Ernst Thälmann, qui était bien plus obéissant vis-à-vis de Staline, a été mis en place. Scholem et Fischer sont donc entrés dans l’opposition, les gauchistes ayant été les premiers à critiquer le « stalinisme » – un terme encore inconnu à l’époque. Mais le tragique a été qu’en purgeant la droite par la « bolchévisation » du KPD, la gauche communiste a également préparé le terrain à la purge de la gauche par Staline. Ils se sont fait battre par leurs propres méthodes autoritaires.
Quels sont les manques concernant la recherche sur le KPD durant la période de Weimar selon toi ?
Norman LaPorte et moi avons déterminé certains programmes de recherche – nous pensons tous les deux que la division ville-campagne mérite davantage d’attention, tout comme de petites villes qui ont souvent favorisé la droite – bien qu’à certains endroits le communisme ait eu des bastions locaux. Il n’y a pas eu beaucoup de recherches sur ce point. Bien que les études sur le communisme aient pris leurs distances avec l’idée selon laquelle le Comintern était un bloc monolithique, il n’y a que peu d’études localisées sur les dynamiques sociales du communisme allemand. Comment les cellules locales du parti fonctionnaient-elles, de quelle manière le stalinisme a-t-il modifié des choses sur le terrain et de quelles façons ?
En parlant du local, il serait également intéressant d’en savoir plus sur la manière dont des communistes locaux interagissaient avec la politique mondiale – il y a, désormais, davantage de recherches sur Münzenberg et ses activités anticoloniales, mais pas tellement sur la base de ces campagnes, sur l’écho des agendas anticoloniaux et anti-impérialistes dans le milieu communiste.
Entretien mené par Selim Nadi. Traduit de l’anglais par Sophie Coudray et Selim Nadi.
Notes
[1] En français, on peut notamment lire cet entretien avec Fredrik Petersson, « Willi Münzenberg, la Ligue contre l’impérialisme et le Comintern », Période, http://revueperiode.net/willi-munzenberg-la-ligue-contre-limperialisme-et-le-comintern-entretien-avec-fredrik-petersson/
![La Révolution allemande, les conseils ouvriers et l’ascension du nazisme [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Germany_at_the_End_of_the_First_World_War_Including_Scenes_of_the_German_Revolution_1918-1919_MH34187-150x150.jpg)

![Fascisme : vieux démons et nouveaux monstres [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/734662-150x150.jpeg)




