
Écofascisme et néo-malthusianisme
On sait qu’une partie des extrêmes droites contemporaines, comme le FN/RN en France, tentent depuis quelques années de verdir leurs positions en affirmant que le nationalisme, en particulier la fermeture des frontières, seraient la solution enfin trouvée au basculement climatique. On sait moins que les sensibilités proprement écofascistes – qui se renforcent à mesure que s’approfondit la crise environnementale – ne sont pas nées dans un rapport d’extériorité radicale à l’écologie.
C’est notamment à une généalogie intellectuelle et à une cartographie politique de ces courants que se consacre Pierre Madelin dans son dernier livre, paru tout récemment aux éditions Écosociété, dont nous publions ici un extrait, où il explore les liens entre néo-malthusianisme et écofascisme.
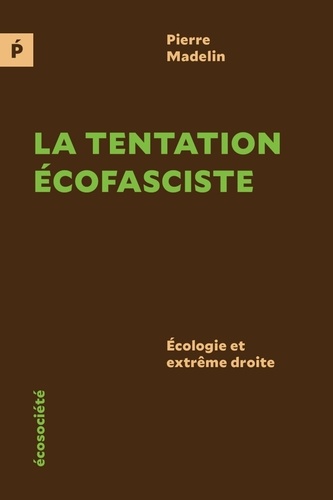
Néomalthusianisme, autoritarisme et racisme
L’optimisme techno-solutionniste d’un Malthus a donc cédé la place à une vision franchement pessimiste. Une position qui apparaît également chez Garett Hardin, un autre néo-malthusien passé à la postérité pour son article sur « La tragédie des communs »[1]. Dans ce dernier, il affirme explicitement que l’humanité habitant désormais un monde clos, aux ressources matérielles et alimentaires limitées, les problèmes posés par la surpopulation ne pourront pas être durablement réglés par la recherche agronomique, l’exploitation des océans ou le développement technologique. Cette inversion radicale du rapport à la technologie et au futur s’est accompagnée d’un revirement total sur la question de la contraception. Alors que Malthus s’y opposait, celle-ci devient un élément phare des politiques publiques défendues par les néo-malthusiens. William Vogt soutenait ainsi qu’il fallait conditionner l’aide internationale au contrôle des naissances et rétribuer les stérilisations volontaires. Puis ce fut au tour d’Ehrlich de se prononcer en faveur de l’émancipation des femmes et du contrôle des naissances, avant que Garett Hardin ne multiplie les interventions en faveur de l’avortement.
Dès les années 1950, les néo-malthusiens ont donc joué un rôle important dans la défense des droits reproductifs – par exemple le droit à l’avortement – et dans la promotion des techniques contraceptives comme la pilule ou le DIU. Ainsi Margaret Sanger, Katherine McCormick, Gregory Pincus et John Rock, quatre personnes ayant joué un rôle central dans le développement des premières pilules, étaient également profondément préoccupées par la croissance démographique. Aussi n’est-il pas surprenant qu’il ait existé dans les années 1960 une alliance significative et largement oubliée aujourd’hui entre féministes et néo-malthusiens. Ces derniers furent nombreux à en appeler à une refondation des rôles sociaux dévolus aux femmes, afin que celles-ci ne soient plus cantonnées à leur « vocation » maternelle.
Mais dans les années 1970, les relations entre féministes et néo-malthusiens se distendent quelque peu. Plus que le simple accès à la contraception, les féministes revendiquent désormais l’autonomie reproductive et réalisent que celle-ci pourrait être menacée par des politiques de contrôle des naissances, dont la vocation ne serait certes plus d’assigner les femmes à leur « fonction » reproductrice, mais d’entraver celle-ci au nom de la protection de l’environnement, qui deviendrait alors un nouvel argument pour nier leur liberté. « Lorsque l’on se demande comment réduire la population à un milliard », peut-on lire dans un texte de l’organisation Women Against Genocide, « ce ne sont pas les riches et les puissants qui s’en iront, mais les pauvres, les noirs et les personnes de couleur, sans parler des femmes qui seront manipulées, stérilisées, empoisonnées chimiquement et assassinées »[2].
Cette critique qui résume assez bien les griefs adressés au néo-malhusianisme jusqu’à nos jours est-elle justifiée ? Oui et non. Car lorsque elles évoquent les mesures à prendre pour mettre en place des politiques de contrôle des naissances et de décroissance démographique, les grandes figures du néo-malthusianisme diffèrent. Et chez un même auteur, des positions contradictoires et des évolutions notables peuvent apparaître au fil du temps, notamment sur les questions relatives aux classes sociales, au genre et à la « race ». Ainsi Ehrlich, fondateur dès 1968 de l’association Zero Population Growth (ZPG), dont l’objectif est de stabiliser la population américaine, est-il ambigu en ce qui concerne les options coercitives. S’il y est opposé aux États-Unis[3], où il « promeut des méthodes de restriction volontaire de la fertilité (contraception, stérilisation choisie), via la sensibilisation de public et le lobbying politique »[4], il y est en revanche plutôt favorable au niveau international, préconisant même dans certains textes des stérilisations forcées et une aide alimentaire proportionnée aux efforts des pays destinataires en matière de contrôle des naissances.
Quid du racisme, dont le néo-malthusianisme a si souvent été accusé, à tel point que les deux termes se recoupent dans l’esprit de nombreuses personnes ? Là encore, les choses ne sont pas si simples, il n’est qu’à penser au cas d’Ehrlich pour s’en convaincre. En invitant les États des pays du sud à prendre des mesures coercitives pour endiguer leur croissance démographique alors qu’il semblait en appeler à la seule bonne volonté des citoyens dans les pays du Nord, Ehrlich s’attira bien évidemment – et à juste titre – les foudres de nombre de penseurs et d’organisations sensibles aux enjeux relatifs au racisme et au colonialisme. Pour ne rien arranger, c’est par le récit apocalyptique et anxiogène d’une traversée en taxi de la ville indienne de Dehli submergée par la foule qu’il choisit d’ouvrir son ouvrage sur la Bombe P. Mais dans ce qui reste sans doute à ce jour le meilleur ouvrage consacré à l’histoire de la pensée néomalthusienne aux États-Unis, The Malthusian Moment, auquel ce chapitre doit d’ailleurs beaucoup, l’historien Thomas Robertson a bien montré à quel point il serait simpliste et injuste de réduire Ehrlich à un idéologue raciste.
Déjà Fairfield Osborn, néo-malthusien des années 1950 et auteur du best-seller La planète au pillage[5], avait défendu avec force l’universalité du genre humain, affirmant notamment que « nous sommes tous frères sous la peau » (« we are all brothers under the skin »[6]). William Vogt, profondément affecté par la misère qu’il avait eu l’occasion d’observer pendant la seconde guerre mondiale en Amérique latine alors qu’il y travaillait, souhaitait que les ressources des pays les plus riches soient utilisées pour aider les peuples moins dotés. Mais c’est bien Paul Ehrlich, qui défendit lui aussi la nécessité de mettre en place des politiques de redistribution entre le nord et le sud[7], qui alla le plus loin dans ce domaine, s’engageant précocement en faveur du mouvement des droits civiques aux États-Unis, et s’opposant vigoureusement au racisme persistant dans les sciences naturelles et notamment en biologie. Preuve de la longévité de cet engagement, il s’attaqua en 1977 aux positions du prix Nobel William Shockley lorsque celui-ci suggéra que les différences raciales pouvaient être un facteur explicatif de l’intelligence des individus. Et lorsque ses appels au contrôle des naissances furent critiqués par des groupes afro-américains, qui jugeaient insuffisant son anti-racisme universaliste et estimaient que dans une société profondément raciste[8], toute politique démographique comporterait nécessairement des biais racistes, Ehrlich fit preuve d’une remarquable réactivité.
Il admit ainsi que de nombreuses personnes obsédées par le contrôle des naissances ne souhaitaient pas tant contrôler les « blancs et les riches » que les « noirs et les pauvres » : « le contrôle de la population est perçu comme un complot ourdi par des blancs riches pour supprimer les personnes ‘racisées’ du monde, disent certains. Et malheureusement, dans l’esprit de certains membres de notre société blanche et raciste, c’est effectivement ainsi qu’elle est envisagée »[9]. A l’encontre de positions qu’il avait pu tenir quelques années plus tôt, il ajouta qui plus est que la plus grande menace pesant sur la survie humaine n’était pas la croissance démographique des populations du tiers-monde mais celle des américains eux-mêmes, « consommateurs et pollueurs par excellence » : « le bébé américain moyen, écrit Ehrlich, a davantage d’impact sur les systèmes vivants de notre planète que de douzaines d’enfants indiens et latino-américains »[10]. Anticipant la critique du racisme environnemental, il remarqua également que « les groupes minoritaires – les noirs, les chicanos – ne sont pas, en général, à l’origine de la pollution, et qu’ils sont au contraire les premiers à souffrir de celle qui est produite par les blancs »[11].
S’il m’a semblé important de revenir ici sur la complexité des positions néomalthusiennes sur la question raciale, c’est pour souligner que le néo-malthusianisme ne se confond pas nécessairement avec des écologies politiques identitaires, nationalistes ou anti-immigrationnistes. Trop souvent aujourd’hui, les recherches ou les articles consacrés à l’éco-fascisme ont tendance à assimiler deux sensibilités qui se sont souvent rencontrées mais qui demeurent pourtant irréductibles l’une à l’autre. Pour le dire simplement, si les éco-fascismes attirent presque toujours l’attention sur la surpopulation, les néo-malthusiens ou les écologistes sensibles à la question démographique ne sont en revanche pas tous, loin s’en faut, disposés à adopter une conception racialisée des populations considérées comme « surnuméraires », ni à prôner des mesures autoritaires pour réduire la population mondiale. Il ne faut pas perdre de vue que le constat inquiet d’un monde plein et même trop-plein a été largement partagé dans l’écologie politique des années 1970, y compris au sein de ses courants les plus anti-autoritaires et les moins enclins au racisme et au rejet de l’immigration.
Ainsi, en Norvège, le fondateur et principal théoricien de l’écologie profonde – et ancien résistant au nazisme, sans doute est-il opportun de le rappeler ici -, Arne Naess, a placé la décroissance démographique au cœur de la plateforme de son mouvement : « l’épanouissement de la vie et des cultures humaines, écrit-il, est compatible avec une diminution substantielle de la population humaine. L’épanouissement de la vie non-humaine requiert une telle diminution »[12]. En France, dans les années 1970 (très exactement le 2 septembre 1974), André Gorz, un auteur que l’on a pas vraiment coutume d’associer à des positions nationalistes ou racistes, écrit dans le Nouvel Observateur un article au titre inquiet, « Douze milliard d’hommes ? » et prône une relance des campagnes antinatalistes dans les pays du Sud. Peu après, Françoise d’Eaubonne, pionnière de l’éco-féminisme, dénonce vigoureusement le « lapinisme phallocratique » et ses effets dévastateurs sur la planète.
En revanche, il est indéniable que c’est bien dans l’orbe du néo-malthusianisme qu’une écologie politique raciste et anti-immigrationniste, que je n’hésiterai pas à qualifier d’éco-fasciste, est apparue dans les États-Unis des années 1970. Né en 1915, formé à la biologie et à l’écologie scientifique dans les années 1930, le biologiste Garett Hardin, que j’ai déjà brièvement évoqué, fut rapidement conquis par les idées eugénistes, dont il resta un fervent partisan jusqu’à sa mort en 2003. Hanté par la perspective d’un déclin du capital biologique de la société américaine, il s’est très tôt engagé en faveur d’une politique d’« amélioration » de la population, souhaitant favoriser d’un côté la reproduction des individus les mieux dotés, tout en empêchant de l’autre celle des « faibles d’esprit », si besoin est en les stérilisant[13]. Violemment opposé à l’État-Providence, dont il assimilait la politique à un eugénisme inversé, dans la mesure ou elle venait en aide à des individus que leur infériorité naturelle supposée avait placés en bas de l’échelle sociale, il n’était pas pour autant opposé à toute forme de politique publique en matière de reproduction, à condition que celle-si veille à assurer et à améliorer la qualité des reproducteurs et de leur progéniture.
Quelques décennies plus tard, alors qu’il est devenu une figure éminente du néo-malthusianisme, ce souci pour la qualité de la population ne l’a pas quitté, mais il est désormais indissociable d’une préoccupation pour sa quantité. S’il n’est pas hostile à un « marché des droits à enfanter » aux États-Unis, il estime en revanche que dans des pays comme l’Inde ou la Chine, « seul un gouvernement impératif peut permettre de placer quantité et qualité de la population sous contrôle »[14]. Peut-être est-ce cette double obsession pour la qualité et la quantité qui le conduit dans les années 1970 à militer contre l’immigration. Celle-ci peut en effet être perçue simultanément comme une menace qualitative pour les populations d’accueil, par l’hybridation délétère qu’elle provoque à ses yeux, et comme une menace quantitative, dans la mesure où la croissance démographique à laquelle elle contribue risque d’entraîner un dépassement de la capacité de charge du territoire d’accueil. C’est en tout cas ce que suggère Hardin en 1974 dans son article « Living on a lifeboat »[15], où il décrit les nations occidentales comme des canots de sauvetage saturés qui sombreraient si elles accueillaient davantage de migrants : « une immigration sans restriction revient à faire venir les populations là où se trouve la nourriture, cela accélérant la destruction de l’environnement des pays riches »[16]. Ironie du sort, avec sa métaphore du canot, Hardin en revenait, probablement sans le savoir, au sens originel du concept de capacité de charge. Renouant avec la longue histoire de l’articulation entre questions migratoires et questions environnementales, Hardin a été contemporain et partie prenante du renouveau de cette articulation à la fin des années 1970, période à partir de laquelle, pour nombre d’organisation et d’auteurs, les murs frontaliers des États-Unis sont « devenus verts »[17].
Notes
[1]Garett Hardin, La tragédie des communs. Paris, PUF, 2018.
[2] Cité par Thomas Robertson, The Malthusian Moment, opus cité, p. 193.
[3] Il envisagea néanmoins d’y placer des contraceptifs chimiques dans le réseau d’eau potable avant d’admettre que ce n’était pas envisageable !
[4] F. Locher, « Les pâturages de la guerre froide », opus cité, p. 27.
[5]Fairfield Osborn, La planète au pillage. Arles, Actes Sud, 2008.
[6]Cité par T. Robertson, The Malthusian Moment, opus cité, p. 55.
[7] Paul R. Ehrlich, Loy Bilderback, Anne H. Ehrlich, Golden door : international migration, Mexico and the United States. New York, Wideview Books, 1981.
[8] Des groupes afro-américains craignent même que ce contrôle ne soit exercé pour entraver la croissance démographique de leurs communautés et pour neutraliser ainsi la menace politique qu’elles représentent dans un contexte où les émeutes sont nombreuses. Certains vont même jusqu’à évoquer un « génocide des noirs ».
[9]Cité par T. Robertson, The Malthusian Moment, opus cité, p. 173.
[10]Ibid., p. 173.
[11]Ibid., p. 174.
[12] https://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde.
[13] Ainsi écrit-il en 1949 : « Les recherches révèlent que tant que perdurera la présente organisation sociale, on constatera un déclin lent mais continu de l’intelligence moyenne ; il y aurait peu de risques que nous privions la société d’un avantage précieux en stérilisant l’ensemble des personnes faibles d’esprit, sachant que l’on pourrait obtenir des résultats plus spectaculaires encore en empêchant la procréation de nombreux membres des classes supérieurs à la normale, mais supérieurs aux faibles d’esprit. », Biology : its human implications. San Francisco, W. H. Freeman, 1949, p. 611-612.
[14] Locher, « Les pâturages de la guerre froide », opus cité.
[15] https://www.garretthardinsociety.org/articles_pdf/living_on_a_lifeboat.pdf
[16]Ibid.
[17] Une expression que j’emprunte au titre du livre de John Hultgren, Border walls gone green, opus cité.




![Que veulent Modi et les ultranationalistes hindous ? [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Path_Sanchalan_Bhopal-1-150x150.jpg)
![La Révolution allemande, les conseils ouvriers et l’ascension du nazisme [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/Germany_at_the_End_of_the_First_World_War_Including_Scenes_of_the_German_Revolution_1918-1919_MH34187-150x150.jpg)
![Trajectoires du fascisme en Turquie [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/turquie-erdohan-mhp-bahceli-150x150.jpg)
![Rebelles réactionnaires et extrémisation des droites [Podcast]](https://www.contretemps.eu/wp-content/uploads/President_Trump_Delivers_Remarks_at_CPAC_49608880598-150x150.jpg)

