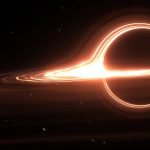L’économie écologique tiraillée de tous côtés
Ali Douai et Gaël Plumecocq, L’économie écologique, Paris, La Découverte, « Repères », 2017.

Deux jeunes chercheurs, Ali Douai et Gaël Plumecocq (D&P) viennent de publier L’économie écologique. Le premier est en poste à l’Université de Nice, le second à l’INRA de Toulouse. Tous ceux qui s’intéressent à la prise en compte de l’écologie dans la vie humaine et dans la vie en général trouveront dans cet ouvrage une mine d’informations. Informations non pas tant sur la dégradation de la planète ou l’épuisement des ressources, choses qui sont désormais très connues, que sur les tentatives de conceptualisation et de théorisation au sein d’une discipline nouvelle qui a suffisamment pris d’ampleur aujourd’hui pour justifier une appellation la distinguant des écoles traditionnelles de l’économie.
L’économie écologique (EE) s’est peu à peu constituée depuis une trentaine d’années, au fur et à mesure qu’est apparue l’incapacité de la science économique officielle – la théorie néoclassique et sa branche dite « économie de l’environnement et des ressources naturelles » – à considérer la nature et les écosystèmes autrement que comme une affaire d’équilibre de marchés à réaliser. L’originalité du livre de D&P est bien sûr de dresser une histoire de cette EE, mais surtout de montrer que, au-delà de l’inévitable tâtonnement d’une discipline en construction, l’EE n’est pas un bloc homogène. Elle est composée de plusieurs courants, les uns proches de l’économie dominante, les autres éloignés, voire radicalement opposés. Des rapprochements ou des oppositions qui ont trait aux objectifs, aux méthodes, en bref à l’épistémologie d’une discipline scientifique.
Une catégorisation originale de l’EE
Le chapitre 1 qui constitue la première partie du livre de D&P propose une généalogie et une catégorisation de l’EE. Alors que l’économie dominante commence à s’affairer autour de l’environnement dès lors que pollutions et dégradations écologiques se confirment dans les années 1970, quelques chercheurs écologues (les frères Odum, Holling) développent une analyse systémique, mettant en évidence les interrelations entre systèmes sociaux et écosystèmes, notamment sous forme de flux énergétiques et matériels. Au même moment, d’autres insistent sur la nécessité d’appliquer la thermodynamique à l’économie (Boulding, Georgescu-Roegen). Cela n’est pas sans influencer quelques économistes prenant conscience de l’incapacité de l’économie dominante à penser la « valeur » de la nature à travers la catégorie de prix de marché.
« Pour autant, la position de l’EE vis-à-vis de la pensée économique mainstream reste ambiguë : s’il apparaît d’emblée évident aux initiateurs de l’EE que la conception standard du marché ne permet pas de penser les limites biophysiques (seuils de résilience, capacité de charge, taux de renouvellement des ressources, etc.), certains adoptent pourtant une attitude optimiste à l’égard du marché. » (p. 19). Si commencent ici les divergences sur la supposée capacité du marché à allouer efficacement les ressources, elles n’empêchent pas de formuler des principes que l’on retrouve dans tous les courants de l’EE : l’économie est encastrée dans la nature, la nature supporte la vie, les systèmes écologiques et les systèmes économiques sont en interrelations et en coévolution. Les divergences avec l’économie dominante apparaissent alors concrètement : la croissance économique n’est pas, au-delà d’un certain seuil, porteuse de bien-être, et le capital manufacturé n’est pas substituable indéfiniment au capital naturel.
À la classification retenue traditionnellement (approche néoclassique de l’environnement, économie écologique, socio-économie), D&P opposent une autre cartographie : « la vraie ligne de césure dans le champ de l’économie autour des questions d’environnement et de développement soutenable se situe au sein de l’EE, parmi ses différents courants qui sont ouverts à d’autres approches et disciplines. » (p. 9). Ils distinguent d’un côté l’approche néoclassique (économie de l’environnement et des ressources naturelles), à l’autre extrême les approches en termes d’économie politique (notamment celle issue de Marx), et, au « centre de gravité », deux sous-courants : l’économie écologique elle-même constituée de la nouvelle économie des ressources naturelles et d’un nouveau paradigme environnemental proches de l’économie néoclassique, et la socio-économie écologique proche de l’économie politique. Cette catégorisation structure ensuite tout le livre.
L’EE a beaucoup à voir avec la critique du développement
Les deux chapitres suivants constituent la deuxième partie de l’ouvrage de D&P. C’est la partie qui retrace les points qui sont les mieux connus et le plus souvent abordés dans les débats autour de l’écologie.
La croissance économique est-elle compatible avec le respect de l’environnement naturel ?
Les auteurs rappellent qu’une première réponse à cette question fut donnée par la « courbe environnementale de Kuznets » : au départ défavorable à l’environnement, la croissance économique lui devient ensuite favorable. Cette courbe en forme de cloche a fait l’objet de tests qui sont restés toujours très discutés.
Une deuxième réponse s’inscrit dans le cadre standard, celui de Hicks qui définissait la non-décroissance du revenu dans le temps. Se sont illustrés les néoclassiques les plus connus comme Solow ou Stiglitz, qui ont intégré l’environnement comme facteur de production dans les modèles d’équilibre général[i], à la condition « que les rentes dégagées de l’exploitation du capital naturel soient investies dans l’accumulation d’autres capitaux, et que les marchés pour les actifs naturels fonctionnent de manière parfaite » (p. 37), comme Hotelling et Hartwick l’avaient théorisée. Les économistes néoclassiques de l’environnement ont aujourd’hui adopté la proposition de Hotelling et Hartwick, mais, ce faisant, ils se rallient à l’idée que l’on peut substituer indéfiniment du capital manufacturé au capital naturel : c’est l’option de la soutenabilité dite faible, par opposition à la soutenabilité forte qui postule la complémentarité des facteurs de production et non leur substituabilité.[ii]
Les difficultés soulevées expliquent les écueils pour bâtir une macroéconomie écologique. D&P évoquent l’émergence d’une macroéconomie écologique postkeynésienne. Il serait intéressant de se demander pourquoi les traditions keynésienne et postkeynésienne n’ont pas – ou seulement tardivement – pris en compte les questions écologiques. Sans doute, est-ce parce que les problèmes écologiques n’ont pas été vus comme s’insérant dans des structures sociales, dans des rapports sociaux. Pourtant, au cœur de la problématique postkeynésienne que l’on trouve par exemple chez Kaldor, Robinson ou Kalecki, une relation forte est établie entre la croissance économique et la répartition du travail et des revenus. Mais sans que, à leur époque, le lien soit fait avec l’insertion dans la biosphère.
D&P citent un travail de Victor et Jackson de 2015 qui ouvrirait une démarche nouvelle de type postkeynésien parce que ces auteurs intègrent la productivité, le partage du travail et le plein emploi dans leur problématique écologiste d’une économie stationnaire. Cette nouveauté n’en est pas vraiment une car elle avait été posée vingt ans auparavant : l’intégration de la soutenabilité du développement dans le cadre d’un nouveau modèle social impliquant partage du temps de travail et des revenus, sans, il est vrai, que cela suscite à ce moment-là un grand intérêt. On va voir ci-dessous, et D&P le diront explicitement, que cette intégration du social et de l’écologie n’est vraiment possible que dans une perspective d’économie politique, sinon marxienne. Or, dans les années 1990, associer écologie et économie politique, a fortiori la critique de l’économie politique, faisait ouvrir des yeux ronds à tout le monde académique. Aujourd’hui, le modèle proposé par Jackson ne donne pas la certitude que l’augmentation du prix des ressources naturelles s’épuisant suffise pour découpler de façon absolue la croissance de l’économie et l’utilisation de ressources.[iii] Sans doute, D&P auraient pu approfondir ce problème, ce qui aurait conforté leur thèse selon laquelle les méthodes de ce courant de l’EE ne s’écartent pas vraiment de l’appareillage néoclassique et, au final, se révèlent sans doute bien peu postkeynésiennes.
Décroissance, métabilisme et soutenabilité
La deuxième question au sujet des rapports entre économie et écologie porte sur la décroissance. D&P rappellent que le courant qui s’en réclame est issu des travaux déjà anciens de Gorz, Ellul, Illich, Georgescu-Roegen. L’influence de ce dernier est particulièrement marquante car « la nature entropique des phénomènes économiques borne les possibilités de croissance, ce qui nécessite d’amorcer une décroissance » (p. 43). Mais il s’agirait d’une « décroissance soutenable » dans une optique « socio-centrée » (p. 44).
Il s’ensuit la troisième question autour de la dépendance de l’économie par rapport à l’énergie qui définit le métabolisme social. Comme le disent D&P, « il s’agit d’une extension du phénomène biologique à l’échelle d’une société » (p. 46). Cela implique que « le métabolisme social englobe le métabolisme biologique, de sorte qu’un développement soutenable passe par le respect des conditions de fonctionnement du métabolisme biologique et du métabolisme social simultanément. » (p. 46-47). Et c’est là que les problèmes commencent avec le difficile découplage entre production et consommation de matières et d’énergie, pour causes d’entropie, de diminution du taux de retour énergétique et d’effet rebond.
Quelles sont les dimensions politique, sociale et culturelle de la soutenabilité ? Cette question trace l’une des frontières entre l’économie néoclassique de l’environnement et les approches critiques. Il s’agit de « replacer le développement au cœur des rapports homme-nature » (titre du chapitre 3, p. 50). Trois apports théoriques sont abordés. Le premier concerne « la coévolution comme cadre d’analyse des rapports société-nature » (p. 55) mis en avant par Norgaard. Le deuxième porte sur les neuf besoins fondamentaux définis par Max-Neef (cf. le tableau très éclairant p. 58-59) et les « capabilités » de Sen. Enfin, le troisième apport concerne « l’environnementalisme des pauvres » défendu par Martinez Alier[iv], qui a en outre remis dans le débat public la question de la dette écologique de l’Occident envers les pays pauvres.
Et surgit l’épineux problème de la valeur
On s’en doutait depuis le début du livre, les auteurs l’ayant laissé entendre : les principales controverses au sein de l’EE se structurent autour de la valeur de la nature, et ce problème fait l’objet des deux derniers chapitres formant la troisième partie de leur ouvrage. « Comment prendre en compte la valeur des éléments naturels appelés à être dégradés ou détruits ? » (p. 67). Pour avoir mis le focus sur ce problème dans des termes très différents de ceux que l’on trouve habituellement dans l’immense littérature qui lui est consacrée, le livre de D&P mérite d’être salué. Dans leur chapitre 4, ils détaillent l’approche néoclassique standard qui n’est pas exempte d’incohérences ou de contradictions.
La valeur économique totale de la nature a-t-elle un sens ?
Premièrement, l’analyse en termes de coûts/bénéfices est-elle capable de fournir une mesure de la « valeur économique totale » (VET) de la nature ? D&P reproduisent un schéma rassemblant les différentes composantes de cette VET (p. 69). Ce schéma est inspiré par un article de David Pearce datant de 1992 et qui fut repris dans le cadre du Millenium Ecosystem Assessment et en France par le Conseil d’analyse stratégique et le Commissariat général au développement durable[v].
Arrêtons-nous sur cette VET qui est la somme des dénommées « valeurs d’usage » (elle-même égale à valeur d’usage direct + valeur écologique + valeur d’option) et des « valeurs de non-usage » (comprenant valeur d’existence + valeur de legs). L’économie standard reconnaît que les questions éthiques, comme le fait d’accorder une valeur morale ou politique à l’existence d’un être vivant non humain, font partie de la définition du bien-être humain, mais, à ce moment-là, que vient faire cette « valeur » sous le vocable « valeur économique totale », englobant des éléments qui… ne sont pas économiques ? Les économistes néoclassiques croient se tirer de ce mauvais pas en avançant l’idée d’une valeur économique intrinsèque de la nature, c’est-à-dire une valeur économique… en soi. Mais cela équivaut à abandonner l’idée que l’économie relève de l’activité humaine. La théorie néoclassique évolue ici entre naturalisation des faits sociaux et fétichisme.[vi] Les choses naturelles, comme les choses produites d’ailleurs, auraient une valeur économique en soi, indépendamment du contexte social et culturel, indépendamment de la période historique considérée ; bref, on serait revenu à un stade pré-critique de l’économie politique dans lequel les catégories économiques, et notamment celles de valeur et de prix, auraient un caractère universel et intemporel. La seule façon cohérente, et peut-être même la seule façon éthique, de reconnaître une dimension éthique à la vie, traversant le temps et l’éphémérité de chaque vie humaine individuelle, est de lui conserver son caractère fondamentalement différent de l’acte économique de production : si la valeur éthique devient économique, ne cesse-t-elle pas du même coup d’être éthique pour être simplement contingente ? En réalité, si l’on attribue une valeur intrinsèque à la nature, elle est non économique ; et elle reste un attribut décerné par l’homme. En un mot, la catégorie « valeur », quel que soit le domaine où elle est appliquée, est une catégorie socio-anthropologique.
Au fond, en reprenant un concept de l’économie politique, celui de valeur d’usage, tous les courants de l’EE qui valident la notion de VET font subir au concept de valeur d’usage une torsion qui le vide de sens : parce qu’il n’a pas de mesure possible, il est incommensurable à quoi que ce soit. Dans le cas des ressources naturelles, une valeur calculée en faisant, si elle était possible, la somme des éléments [composant la VET] aboutirait à une valeur infinie s’il s’agit de ressources conditionnant la survie de l’espèce humaine, c’est-à-dire à une valeur proprement inestimable. Or, parler de valeur infinie vide de sens toute notion économique de valeur.[vii]
D&P montrent bien que, pour l’économie standard, « la valeur de la nature pour l’homme, comme pour la valeur de toute chose, quels que soient les motifs de valorisation, pourrait être exprimée dans cette métrique commune que serait la monnaie, conçue comme la meilleure expression d’une essence commune à tous ces motifs (l’utilité) » (p. 74). Les auteurs poursuivent : « Cet « universalisme » est également assis sur l’idée que l’argent a la même valeur pour tous les individus, quel que soit leur niveau de revenu. » (p. 74). C’est là-dessus que se fondent toutes les préconisations actuelles sur la notion de « service écosystémique » et celle de « paiement pour services écosystémiques ». La notion de service écosystémique, qui s’est imposée aujourd’hui dans toutes les publications d’économie de l’environnement est directement puisée chez Jean-Baptiste Say :
« Ainsi, lorsqu’on laboure et qu’on ensemence un champ, outre les connaissances et le travail qu’on met dans cette opération, outre les valeurs déjà formées dont on fait usage, comme la valeur de la charrue, de la herse, des semences, des vêtements et des aliments consommés par les travailleurs pendant que la production a lieu, il y a un travail exécuté par le sol, par l’air, par l’eau, par le soleil, auquel l’homme n’a aucune part, et qui pourtant concourt à la création d’un nouveau produit qu’on recueillera au moment de la récolte. C’est ce travail que je nomme le service productif des agents naturels. »[viii]
Il y a donc dans l’EE, version néoclassique, de la cohérence dans l’incohérence : le concept de valeur d’usage irréductible à celui de valeur économique nié à la manière de Say, les services écosystémiques assimilant le travail humain et le « travail » de la nature à la manière de Say, la confusion entre richesse et valeur à la manière de Say.
Si D&P ont raison de dire que « la question de la valeur de la nature est une question sensible en EE » (p. 83), peut-être auraient-ils pu en explorer davantage la profondeur en montrant que la « valeur d’usage » de l’EE, façon VET, est un contresens au regard de l’histoire de la pensée économique et un non-sens dès lors qu’elle est postulée mesurable en monnaie.
Retour à la critique de l’économie politique
C’est d’ailleurs ce qui ressort en filigrane du dernier chapitre de ce livre « la socioéconomie écologique » (SEE), que les auteurs avaient annoncé dans leur premier chapitre comme liée à l’économie politique, et dont « la critique de l’évaluation économique de la nature et les propositions de gouvernance alternative constituent incontestablement le centre de gravité de la SEE » (p. 84). Mais, là encore, le diable est dans les détails. Les limites de la marchandisation de la nature sont-elles seulement éthiques ? D&P ont raison de les souligner, à l’instar d’O’Neill et Spash (p. 85 et suiv.) mais ces limites ne sont-elles pas également logiques (notamment impossible définition de l’optimum en présence d’externalités, optimum influencé par la répartition, impossible évaluation de la nature par le marché), et méthodologiques (transposition de la physique newtonienne à l’économie[ix]) ?
Ces limites logiques et méthodologiques auraient méritées d’être précisées car les transformations du capitalisme financier conduisent aujourd’hui à une graduation inquiétante. En effet, le projet néolibéral ne consiste pas simplement à monétariser les biens naturels utilisés en économie en donnant un prix à cette utilisation (il est parfaitement normal de payer l’eau que nous consommons), mais il consiste à les marchandiser après les avoir privatisés (la distribution de l’eau pour reprendre cet exemple), puis à les financiariser, c’est-à-dire à en faire des sous-jacents à des titres financiers.[x] Ainsi, l’avertissement de Polanyi serait prémonitoire quand il signalait le risque de marchandiser le travail, la terre et la monnaie.[xi]
Autrement dit, il ne suffit pas d’affirmer, à l’instar de la SEE, l’incommensurabilité des valeurs, car un glissement de sens peut se produire, à cause de la polysémie du terme « valeur ». En réalité, il y a une double polysémie. La première se situe en économie : au mot valeur peut être accolé « d’usage », « d’échange », voire il peut être employé tout seul[xii]. Notre position a toujours été de défendre, en suivant l’intuition d’Aristote et comme l’économie politique de Smith et de Ricardo, comme Marx, l’idée que la richesse n’était pas réductible à la valeur économique, et donc que valeur d’usage et valeur d’échange n’étaient pas commensurables. La seconde polysémie du terme « valeur » apparaît lorsque, à côté du registre de l’économie, on introduit des valeurs philosophiques, éthiques ou politiques. Bien entendu, un second type d’incommensurabilité s’impose.[xiii] À notre connaissance, il n’existe pas de clarification conceptuelle satisfaisante sur ces plans dans la littérature de l’EE. Dommage que D&P s’arrêtent au bord d’une telle clarification et ne disent rien du bien-fondé du « dépassement de l’incommensurabilité » que cherchent Paavola et Adger (p. 93). Disons-le tout net : ce dépassement équivaut à vouloir aller à l’infini, c’est-à-dire dans une impasse épistémologique. « La mutidimensionnalité des représentations, des usages et des valeurs de l’environnement » (p. 106) est une précision très utile à condition qu’elle ne consiste pas à mettre sur un pied d’égalité – et donc de possible commensurabilité – ces éléments, car les uns appartiennent à la sphère étroite de l’économie, les autres à une sphère qui englobe et dépasse celle-ci.
Pourtant D&P sont tout près d’une telle clarification parce qu’ils terminent leur livre en abordant le lien entre l’EE et l’économie politique, ou plutôt la critique de l’économie politique, façon Marx. « Les problèmes écologiques ne sont pas des externalités « fortuites » de la production, mais la conséquence d’une dynamique qui porte en elle-même une logique d’exploitation et d’indifférence vis-à-vis de la nature. » (p. 96). « Dès ses premiers écrits, Marx parlait du travail humain comme condition universelle de l’ »interaction métabolique » entre l’humanité et la nature, ainsi que de l’impact négatif des rapports capitalistes dans l’agriculture sur la qualité des sols. » […] La catégorie marxienne du double caractère du travail humain trouve alors toute sa pertinence : procès de travail en général et procès de travail capitaliste. Le premier est producteur de choses utiles (valeurs d’usage) par la transformation de matière et d’énergie. Le second est producteur de valeur économique par sa transformation en travail abstrait par le capitalisme […] » (p. 97). C’est ce qui explique que « les relations entre SEE et marxisme écologique sont passées d’un antagonisme à une reconnaissance mutuelle de la nécessité d’un dialogue » (p. 96), notamment par les travaux cités par D&P de Burkett[xiv], Foster[xv], Altvater[xvi] et Harribey[xvii], en dépit du fait que Marx et Engels aient, selon certains, écarté la proposition de leur contemporain Podolinsky d’établir une liaison entre la valeur-travail et la dépense d’énergie.[xviii]
Conclusion
En conclusion, il faut se réjouir qu’un tel ouvrage soit offert aux chercheurs et étudiants en économie écologique (à ce niveau, on ne peut pas facilement faire un ouvrage grand public). Les connaisseurs trouveront toujours de quoi discuter tel ou tel point, mais l’ensemble est pleinement satisfaisant car il s’agit d’une belle synthèse, et pourquoi ne pas le dire, assez courageux, tellement le discours devient de plus en plus formaté sur des problèmes qui remettent au centre du débat scientifique et politique l’organisation sociale, aujourd’hui si malmenée par le capitalisme financiarisé.[xix]
Faisons le pari qu’un tel ouvrage contribuera à ce que se constitue en France, comme le souhaitent Ali Douai et Gaël Plumecocq, un réseau de recherche et d’enseignement autour d’une économie écologique pour « relever les défis que posent les rapports entre l’économie, le progrès et le développement des sociétés humaines et de leur environnement naturel qui leur rend des services et d’où elles tirent leurs ressources. » (p. 108).[xx]
Notes
[i] Les auteurs auraient pu ajouter que le facteur environnement fut aussi intégré par ces économistes dans des fonctions de production de type Cobb-Douglas à facteurs substituables. Pour la critique de cette démarche, voir J.-M. Harribey (1996), « Développement soutenable et réduction du temps de travail », Thèse de doctorat, Université Paris I-Sorbonne, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/ouvrages/index-ouvrages.html ; (1997) « La prise en compte des ressources naturelles dans le modèle néoclassique d’équilibre général : éléments de critique », Économies et sociétés, Série « Développement, croissance et progrès », F, n° 35, 4/1997, p. 57-70, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/orstom.pdf ; (1999), « La soutenabilité : une question de valeur(s) », HDR, Université Bordeaux IV, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/soutenabilite.pdf.
[ii] Peut-être les auteurs auraient-ils pu expliquer cette opposition sur la soutenabilité et ainsi marquer leur distance vis-à-vis de la notion de capital naturel.
[iii] T. Jackson (2009-2010), Prospérité sans croissance, La transition vers une économie durable, Bruxelles et Namur, De Boeck et Etopia. Pour une discussion de ce livre, J.-M. Harribey (2011), « Prospérité sans croissance et croissance sans prospérité », Note pour les Économistes atterrés, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/cr-jackson.pdf.
[iv] J. Martinez Alier (2014), L’écologisme des pauvres, Une étude des conflits environnementaux dans le monde, Paris, Les Petits matins, Institut Veblen.
[v] D. Pearce (1992), « Economic Valuation and the Natural World », Background for World Development Report 1992, October, http://documents.worldbank.org/curated/en/721891468764692718/pdf/multi0page.pdf. MEA (2003), Ecosystems and Human Well-Being. A Framework For Assessment, Washington D.C., Island Press ; CAS (2008), « La valeur du vivant : quelle mesure pour la biodiversité ? », Note de veille n° 89, 4 février, http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/noteveille89.pdf. CGDD (2010), « Donner une valeur à l’environnement : un exercice délicat mais nécessaire », La Revue du CGDD, décembre, http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0068/Temis-0068599/19001.pdf.
[vi] J.-M. Harribey (2014), « Sur la nature, éviter le fétichisme », Les Possibles, n° 3, printemps, https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-3-printemps-2014/dossier-l-ecologie-nouvel-enjeu/article/sur-la-valeur-de-la-nature-eviter.
[vii] Même P.A. Samuelson n’est pas si éloigné de cela lorsqu’il adopte « la convention de rendre infini le prix de tout bien qui n’est pas disponible » dans Les fondements de l’analyse économique, Paris, Gauthiers-Villars Editeur, 2e éd., 1971, tome 1, Théorie de l’équilibre et principales fonctions économiques, p. 199.
[viii] J.-B. Say, Traité d’économie politique, 1803, Institut Coppet, http://www.institutcoppet.org/wp-content/uploads/2011/12/Traite-deconomie-politique-Jean-Baptiste-Say.pdf, p. 44.
[ix] Voir R. Passet (1979) L’économique et le vivant, Paris, Payot, 2e éd. Economica, 1996 ; (2010), Les grandes représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire, De l’univers magique au tourbillon créateur, Paris, Les Liens qui libèrent.
[x] Voir R. Keucheyan (2014), La nature est un champ de bataille, Essai d’écologie politique, Paris, La Découverte, Zones.
[xi] K. Polanyi (1983), La grande transformation, Aux origines politiques et économiques de notre temps, 1944, Paris, Gallimard.
[xii] C’est ce que fait Marx dont la position se résume ainsi : la valeur d’usage est une condition de la valeur en tant que fraction du travail socialement validé, laquelle apparaît dans l’échange par le biais d’une proportion, la valeur d’échange qui est mesurée par la quantité de travail nécessaire en moyenne dans la société considérée.
[xiii] Virginie Maris (2014, Nature à vendre, Les limites des services écosystémiques, Versailles, Éd. Quae, p. 52) a une formule bien parlante : « Lorsque je prends une décision morale, je ne calcule pas, je délibère, ce qui est bien différent. »
[xiv] P. Burkett (2006), Marxism and Ecological economics. Towards a Red and Green Political Economy, Boston, Brill.
[xv] J.B. Foster (1997), Valuing Nature ? Economics, Ethics and Environment, Londres, Routledge ; (2000), Marx’s Ecology, Materialism and Nature, New York, Montly Review Press.
[xvi] E. Altvater (2007), « A marxist ecological economics », Monthly Review, vol. 58, n° 8, p. 55-64.
[xvii] J.-M. Harribey (2013), La richesse, la valeur et l’inestimable, Fondements d’une critique socio-écologique de l’économie capitaliste, Paris, Les Liens qui libèrent. Voir aussi (1996-1999), « Sustainable development and social justice : the tool of the réduction of the income inequalities », in D. Requier-Desjardins, C. Spash, J. Van Straaten, Environmental Policy and Social Aims, Dordrecht, Kluver Academic Publishers, p. 307-330, harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite.sustainability.pdf ; (2001), « Marxisme écologique ou écologie politique marxienne », in J. Bidet, E. Kouvélakis (sous la dir. de), Dictionnaire Marx contemporain, Paris, PUF, Actuel Marx Confrontation, p. 183-200, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/marxisme-ecologique.pdf.
[xviii] J. Martinez Alier (2014), op. cit., appuie cette idée. Mais elle est contestée par J. B. Foster (2011), Marx écologiste, Paris, Amsterdam. Sur ce dernier, voir J.-M. Harribey (2012), « La portée écologiste de l’œuvre de Marx selon Foster », Actuel Marx, n° 52, PUF, Deuxième semestre, p. 122-129, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/ecologie-marx-foster.pdf.
[xix] Le discours formaté se retrouve bien sûr dans tous les manuels sur ladite économie de l’environnement. Mais, à notre connaissance, le livre de D&P dépasse les essais se réclamant de l’économie écologique critique, par exemple, parmi les plus récents en français, le dossier de L’économie politique, « Une économie écologique est-elle possible ? », n° 69, janvier 2016, ou même celui d’Actuel Marx, « Marxismes écologiques », n° 61, PUF, premier semestre 2017.
[xx] L’un des mérites de D&P est d’avoir exploré une immense littérature, pour la plupart anglo-saxonne. Mais, en ce qui concerne le courant de l’EE qui les intéresse le plus parce qu’il est critique vis-à-vis de la théorie néoclassique, il existe aussi des sources en français qui mériteraient d’être davantage utilisées. Par exemple, il y a un auteur peu connu mais qui, dès les années 1990, parallèlement à notre propre travail, a porté une critique forte de la théorie néoclassique de l’environnement : Martin Angel (1995), « Calcul économique et politique environnementale, Limites de l’évaluation économique et de l’analyse coût-avantage », Cerna, Centre d’économie industrielle, École nationale supérieure des Mines de Paris, décembre ; (1998) La nature a-t-elle un prix ? Critique de l’évaluation monétaire des biens environnementaux, Paris, Les Presses de l’École des Mines. On peut lire aussi Jutta Kill (2015), L’évaluation économique de la nature, Donner un prix à la nature pour la protéger ? Une réflexion critique, Fondation Rosa Luxemburg, Bruxelles.