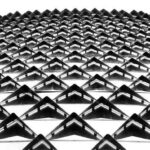La guerre de l’État contre les étrangers. Un extrait du livre de Karine Parrot
Karine Parrot, Carte blanche. L’État contre les étrangers, Paris, La Fabrique, 2019.

Présentation du livre
Qu’est-ce qu’un étranger ? Qu’est-ce qu’un « migrant économique » ? Que lire derrière tous ces noms – Schengen, Frontex, Dublin – et ces sigles, OFPRA, CRA, OQTF ? La réponse, on la lira ici : ce sont les pièces d’un masque derrière lequel l’État français organise et dissimule une lutte féroce contre les étrangers, les plus pauvres, les plus noirs, les plus arabes.
Du dernier commissariat jusqu’au Conseil d’État et à la Cour de cassation – plus question ici de séparation des pouvoirs – l’appareil d’État suit la loi quand elle l’arrange et la bafoue quand elle le gêne. Si c’est trop visible, la haute fonction publique prépare une nouvelle loi qui permet plus de contrôles, plus d’enfermements, qui donne carte encore plus blanche à l’exécutif dans cette lutte contre un ennemi décidément bien commode.
Un livre qui révèle les rouages méconnus de la machine répressive contre les étrangers.
Extrait
La machine à gaz Dublin
À la rubrique des mécanismes déloyaux déployés contre les pauvres qui arrivent jusqu’en Europe, le « système Dublin » est sans doute un des plus féroces et des plus élaborés. Il montre jusqu’où peut aller le fantasme gestionnaire des gouvernants, cette idée qu’il serait possible de traiter certaines personnes exactement comme des flux, alimentant des stocks à transférer, à se répartir, à tarir. À aucun moment dans le mécanisme Dublin, les personnes ne sont véritablement prises en considération, si ce n’est au prisme de leur volonté présumée de contourner les règles.
Ce « dispositif Dublin » germe dans l’esprit des dirigeants européens à la fin des années 1980, en parallèle du système Schengen qu’il est censé compléter : si on fait disparaître les contrôles aux frontières intérieures des États – système Schengen –, il ne faudrait pas que les demandeurs d’asile puissent en profiter pour, une fois déboutés dans un premier pays, tenter à nouveau, et indéfiniment, leur chance ailleurs dans cet espace de libre circulation.
À cette époque, les demandeurs d’asile sont déjà les indésirables que l’on connaît – des migrants économiques qui cherchent à abuser de la Convention de Genève – et c’est essentiellement à leur encontre que les États élaborent en même temps une barrière extérieure commune. L’idée vient donc de désigner un seul État européen responsable par demandeur d’asile et, en choisissant l’État par lequel l’étranger a pénétré le territoire européen, les dirigeants espèrent bien inciter les pays à exercer un contrôle efficace de la nouvelle enceinte commune.
Le premier texte dans la série « Dublin » est un traité international de type classique qui date de 1990. Dans son préambule, les États signataires justifient le mécanisme de répartition obligatoire par leur volonté de mettre les demandeurs d’asile à l’abri des incertitudes ; ils se déclarent « soucieux de donner à tout demandeur d’asile la garantie que sa demande sera examinée par l’un des États membres et d’éviter que les demandeurs d’asile ne soient renvoyés successivement d’un État membre à un autre sans qu’aucun de ces États ne se reconnaisse compétent pour l’examen de la demande d’asile ». En observant la réalité du dispositif Dublin, on peut prendre la mesure du cynisme de ceux qui prétendent nous gouverner.
Avec le temps, le dispositif contraignant se perfectionne. En particulier, puisque la thématique asile-immigration intègre le champ des compétences européennes (1997), l’Union européenne crée un fichier biométrique – EURODAC – censé collecter les empreintes digitales de tous les demandeurs d’asile, mais aussi de tous les étrangers interpellés alors qu’ils franchissent irrégulièrement la frontière européenne. En France, le préfet, qui enregistre toutes les demandes d’asile, recueille systématiquement les empreintes de l’étranger[1], puis interroge le fameux fichier EURODAC pour déterminer si l’intéressé n’a pas déjà laissé ses empreintes dans un autre pays membre, comme demandeur d’asile ou primo–arrivant irrégulier. Si tel est le cas, c’est la procédure Dublin qui s’enclenche, au moins aussi efficace pour se débarrasser du prétendant que la procédure accélérée. L’objectif officiel est de renvoyer le demandeur d’asile dans l’État « responsable » de sa demande d’asile ou de son expulsion.
C’est ainsi que le jeune Soudanais, qui vit dans la rue à Paris depuis des mois, au moment où il réussit à déposer sa demande d’asile, est placé par le préfet en « procédure Dublin » car ses empreintes ont été relevées en juin 2016, à Tarente, en Italie, dans un « centre d’accueil et d’identification » – un « hotspot » – où il a été enfermé alors qu’il débarquait de Libye. Comme beaucoup de ses compagnons d’infortune dans le camp italien, il a été battu et frappé à coups de matraques électriques par les policiers parce qu’il refusait de donner ses empreintes[2] (il voulait rejoindre l’Angleterre où vit son oncle).
À l’époque, l’Union européenne met une forte pression sur l’Italie pour qu’elle respecte ses obligations et alimente effectivement le fichier EURODAC avec les doigts des nouveaux arrivants sur son territoire : des agents de Frontex et du Bureau européen d’appui en matière d’asile sont dépêchés sur place pour « épauler » la police italienne. Mais l’Italie n’a aucune envie d’examiner les demandes d’asile de tous ces étrangers et, en pratique, son administration, ses juges de l’asile, ses centres d’hébergement et d’enfermement sont totalement saturés depuis longtemps. Si bien qu’après quatre jours passés dans le centre et quelques coups de matraque bien sentis, le jeune Soudanais est déposé dans une gare par la police italienne, abandonné à lui-même.
Le dispositif Dublin aurait donc pour objectif de le renvoyer manu militari de France vers l’Italie afin que sa demande de protection internationale soit traitée par l’État compétent. Mais qui, parmi les dirigeants et les technocrates européens, a pu un jour sérieusement croire que cette machine à gaz ubuesque allait véritablement fonctionner ? Que les pays européens contrôleraient toutes les entrées irrégulières et organiseraient efficacement le redéploiement continu de milliers de personnes à travers l’Europe en direction d’une poignée d’États qui traiteraient consciencieusement toutes les demandes de protection et, en dernier ressort, accueilleraient les réfugiés ?
Mis à part quelques « experts » payés pour cela, personne n’a jamais cru que le dispositif Dublin fonctionnerait et, de fait, il n’a jamais fonctionné au regard de son objectif officiel. L’échec était bel et bien programmé. D’abord, le dispositif a été construit sur un postulat totalement et manifestement faux, celui d’après lequel tous les systèmes d’asile des États membres seraient équivalents. Les dirigeants expliquent en effet avec assurance que, s’ils se permettent ainsi d’organiser des transferts mécaniques de demandeurs d’asile d’un État européen à un autre, c’est que cela n’affecte en rien les droits des personnes, ni leurs chances d’obtenir le statut de réfugié.
Pour accréditer cette thèse du transfert indolore, l’Union européenne se targue d’avoir instauré, en parallèle au système de répartition obligatoire, un « régime d’asile européen commun », c’est-à-dire un droit uniforme de l’asile couvrant la procédure, les conditions d’accueil des demandeurs et la qualification de réfugié. Mais en réalité, dans ces différents domaines, les textes européens sont en même temps peu protecteurs des personnes et peu contraignants pour les États. Ils se bornent à fixer les grandes lignes d’une protection minimaliste, laissant subsister de grandes disparités entre les systèmes d’asile étatiques.
Ces inégalités de (mauvais) traitement ont naturellement été accentuées par le système Dublin, qui tend à concentrer les exilés dans les pays limitrophes par lesquels ils arrivent en Europe. Le cas de la Grèce encore une fois est symptomatique (mais j’aurais pu aussi choisir l’Italie, Malte, l’Espagne ou la Hongrie). Depuis le début des années 2000, le nombre d’exilés qui arrivent en Grèce augmente tandis que leurs conditions « d’accueil » se dégradent, jusqu’à devenir littéralement inhumaines.
Avant même d’en arriver à la situation actuelle où certaines îles sont des prisons à ciel ouvert, dès les années 2000 les étrangers qui débarquent en Grèce, et ceux qui y sont transférés depuis un autre État en application de « Dublin », sont enfermés dans des centres surpeuplés, dans des conditions terribles. Une fois libérées, les personnes sont empêchées de demander l’asile : aucune information ne leur est fournie sur leurs droits, ni sur la procédure et les quelques guichets existants sont surchargés ou fermés. L’étranger qui parvient à faire enregistrer une demande s’enlise dans un parcours d’injustices et d’arbitraire ; même l’apparence de procédure n’y est plus : absence d’interprète, absence d’avocat, absence d’hébergement et d’allocation pour survivre, absence de traduction des décisions de refus, absence de recours suspensif, etc.
À cette époque, en Grèce, un demandeur d’asile sur mille obtient le statut de réfugié en première instance (alors qu’en Suède, par exemple, il y en a quasiment un sur deux)[3]. La déliquescence du système d’asile grec, le délaissement des exilés, les violences policières associées, les enfermements arbitraires dans des conditions inhumaines, tout cela s’installe et devient parfaitement connu de l’ensemble des dirigeants européens.
Entre 2006 et 2010, ce sont 23 rapports d’instances nationales et internationales, gouvernementales et non gouvernementales, qui décrivent et documentent en détail la situation apocalyptique et les violations graves et systématiques des droits des exilés et des demandeurs d’asile en Grèce[4]. Mais les dirigeants et les technocrates européens, par ailleurs si prompts à traquer les fraudeurs, peuvent se payer un mensonge international gros comme un pays. Et c’est ainsi que, pendant des années, ils continuent, en application du règlement Dublin, à renvoyer l’air de rien vers la Grèce les demandeurs d’asile qui y avaient transité jadis, sachant pertinemment le sort misérable qui leur est réservé là-bas.
Il a fallu une condamnation groupée de la Belgique et de la Grèce par la Cour européenne des droits de l’Homme en 2011[5] pour que cesse ce sale manège et que les États européens suspendent les « transferts Dublin » vers la Grèce, au vu des « défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ». Malgré les « efforts considérables » de la Grèce et les annonces incantatoires régulières de la Commission européenne, les transferts Dublin vers le pays demeurent encore aujourd’hui suspendus.
Clochardiser, enfermer, criminaliser
La pratique française du règlement Dublin confirme cette idée d’une machine à gaz destinée à se débarrasser mutuellement des exilés. Lorsque l’étranger qui arrive en France finit par obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande d’asile, les agents relèvent ses empreintes digitales pour les comparer avec celles figurant déjà dans EURODAC. S’il refuse de les donner, ou si elles sont illisibles, il est présumé fraudeur et sa demande est traitée-refusée suivant la procédure accélérée[6]. Si les empreintes apparaissent dans le fichier, déjà enregistrées par un autre État européen[7], la personne est placée « en procédure Dublin »[8] tandis que la préfecture adresse à l’État européen concerné[9] une demande de transfert la concernant. La personne peut tout à fait se retrouver dans la spirale Dublin alors que sa demande d’asile déposée à l’étranger a été définitivement rejetée. Dans cette hypothèse, elle est censée être transférée depuis la France vers un autre État européen afin que celui-ci procède à son expulsion vers son État d’origine[10]…
À nouveau, chaque étape du processus est pensée comme un piège, la complexité des règles applicables étant en soi un obstacle à part entière. D’après le règlement Dublin, la France, qui cherche à se débarrasser d’un étranger, dispose de trois mois pour saisir son homologue européen d’une demande de transfert – délai qui varie suivant le motif pour lequel l’étranger est fiché dans EURODAC (!). Ces derniers temps, le ministère de l’Intérieur français se bat contre certaines juridictions administratives qui acceptent de faire courir ce délai à partir du jour où l’étranger accède à la plateforme de premier accueil (et non à compter de son passage ultérieur en préfecture), ce qui conduit à l’annulation de certaines décisions de transfert pour saisine tardive de l’État étranger[11]. Voilà une illustration typique du contentieux hyper-technique mais décisif suscité par la procédure Dublin qui échappe nécessairement aux premières personnes concernées.
De son côté, l’État étranger, lorsqu’il est saisi, dispose en principe de deux mois pour s’opposer au transfert, mais là encore le délai est soumis à variation tandis que le silence de son administration vaut acceptation du transfert[12]. Enfin, et c’est là un point décisif, lorsque l’État français obtient l’autorisation de transfert, il a six mois pour expédier l’étranger, après quoi il devient lui-même l’État responsable et doit donc, selon les circonstances, examiner la demande d’asile de l’intéressé ou organiser son expulsion. Se joue par conséquent une simili course contre la montre pour expulser effectivement le « dubliné » dans le délai imparti, sous peine de devoir finalement en supporter la charge. D’autant que, dans l’attente de ce transfert-Dublin, l’étranger a le droit de séjourner en France et bénéficie en principe des mêmes sous-prestations que les demandeurs d’asile dont la France est « responsable ».
En 2015, face à l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile[13], la haute administration décide d’assigner à résidence les « dublinés » le temps d’organiser leur expulsion, ce qui est autorisé par la loi du 29 juillet 2015 réformant le droit d’asile. De nombreuses personnes sont ainsi placées en procédure Dublin et assignées par le préfet dans les Centres d’accueil et d’orientation (CAO) créés pour vider le camp de Calais (malgré les promesses publiques faites aux habitants du camp pour les inciter à monter dans les bus).
Parallèlement, l’État crée plusieurs milliers de nouvelles places d’hébergement d’urgence, essentiellement dans des hôtels Formule 1 désertés, et encourage les préfets à y assigner les demandeurs en attente de transfert[14]. Dans ces centres de seconde zone – les PRADHA – situés en périphérie des villes, les étrangers n’ont pas toujours le droit de recevoir des visiteurs et les journalistes ne sont admis que sur autorisation du ministère de l’Intérieur. « Les structures d’hébergement vont pour la première fois confondre officiellement la mise à l’abri – droit fondamental inconditionnel – et une forme de privation de liberté en vue d’un éloignement du territoire[15] », remarque le Défenseur des droits.
Mais l’assignation à résidence des « dublinés » n’est pas une fin en soi pour les gouvernants dont l’objectif n’est pas non plus de procéder absolument à leur transfert vers l’État responsable, transfert de toute évidence difficile, coûteux et largement vain. Outre le souci de contrôler les personnes, l’objectif de ces gestionnaires est avant tout d’éviter que ces pauvres ne s’installent à un titre ou un autre sur le territoire français.
Ainsi, l’assignation à résidence de l’étranger a d’abord pour effet de raccourcir le délai dont il dispose pour contester la décision de transfert. Assigné dans l’hôtel Ibis de la zone commerciale de Quimper, sans aucun accompagnement juridique, l’étranger a quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif contre la décision qui ordonne son transfert vers l’Allemagne. Autant dire qu’il est privé de tout recours. Mais ce n’est pas tout, le gouvernement a aussi développé une tactique inscrite en filigrane dans le règlement Dublin : le délai de six mois accordé à l’État pour exécuter le transfert est porté à dix-huit mois si le demandeur d’asile « a pris la fuite », ce qui au passage le prive également des « prestations d’accueil ».
Le « dubliné » en fuite est donc doublement intéressant pour l’État français déchargé pendant dix-huit mois d’un éventuel examen de sa demande d’asile, mais aussi de sa prise en charge quotidienne dans l’attente d’un hypothétique transfert. C’est ainsi que de très nombreux demandeurs d’asile « dublinés » se sont vus assignés dans des centres d’hébergement fantômes[16], surpeuplés ou difficiles d’accès[17], avec l’obligation corrélative de pointer plusieurs fois par semaine au commissariat ou à la préfecture la plus proche. Parce que rien ne leur est expliqué, parce qu’elles dorment dans la rue, parce que le commissariat est à plusieurs heures de marche, parce que les convocations sont envoyées tardivement ou rédigées de manière dissuasive, les personnes finissent en général par manquer un ou plusieurs rendez-vous, autorisant la préfecture à les déclarer « en fuite ».
À partir de là, elles quittent pour dix-huit mois le statut de demandeur d’asile[18] pour devenir des quasi-délinquants, condamnés à vivre dans la rue avec la peur des contrôles de police. Car tel est bien l’enjeu du règlement Dublin, faire sortir les demandeurs d’asile des radars officiels, les marginaliser, les chasser, si besoin les criminaliser.
Pour finir de s’en convaincre, on peut examiner le taux d’exécution des décisions de transfert qui, au regard de l’énergie administrative et policière déployée, est significatif. En 2017, plus de 40 000 personnes ont été placées en procédure Dublin par le préfet au moment où elles déposaient leur demande d’asile en France, ce qui représente un tiers des demandeurs d’asile. Sur les 40 000 requêtes correspondantes adressées à l’Italie, l’Allemagne, la Bulgarie ou l’Espagne, le ministère de l’Intérieur reçoit 30 000 réponses positives, ce qui permet aux préfets français d’édicter 30 000 décisions de transfert contre les demandeurs d’asile concernés.
Sur ces 30 000 personnes exclues durablement de la procédure d’asile française, seules 2 600 ont effectivement été renvoyées vers l’État européen « responsable » : 982 vers l’Italie, 869 vers l’Allemagne, 138 vers l’Espagne… Pendant ce temps, la France reçoit elle-même les « dublinés » que lui expédient ses camarades européens suivant les mêmes techniques – dans le jargon européen, il s’agit des « transferts entrants ». En 2017, la France a ainsi récupéré via le dispositif Dublin 1 600 étrangers expédiés par l’Allemagne, le Benelux, la Suisse, l’Autriche ou encore la Suède.
Bilan donc de la machine Dublin en 2017 : la France s’est officiellement délestée de 1 000 demandeurs d’asile, c’est d’ailleurs la première année que le solde est si « important » – l’année précédente, il s’élevait à 36 personnes. Autrement dit, le système Dublin ne fonctionne pas comme répartiteur des demandeurs d’asile, puisque les décisions de transfert restent – et cela vaut partout en Europe – largement inexécutées, mais il fonctionne à plein pour priver les personnes d’un accès à la procédure d’asile, les mettre en stand by ou, encore mieux, les assigner à un statut de fugitif tout en continuant à les surveiller. Car subrepticement, en 2015, le fichier EURODAC a été ouvert à la consultation d’Europol et des autorités nationales « chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière »[19].
Pour terminer sur les différents moyens de siphonner le droit d’asile comme voie d’accès au séjour, il faut dire quelques mots du système de non-accueil des candidats dont le dossier est examiné par la France, et des moyens de plus en plus coercitifs mis en place ici aussi pour sortir les personnes de la procédure d’asile.
Notes
[1] Si l’étranger refuse de donner ses empreintes, il est placé en procédure accélérée.
[2] Voir les témoignages recueillis par Amnesty international sur la situation dans plusieurs « hotspots » en Italie en 2016. Il est fait état aussi de violences à caractère sexuel, lire notamment sur le site de l’association, « Italie. Des expulsions illégales et des violences sont signalées alors que l’UE appelle à la fermeté avec les nouveaux arrivants », 3 novembre 2016, <https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2016/11/italy-beatings-and-unlawful-expulsions-amid-eu-push-to-get-tough-on-refugees-and-migrants>.
[3] Les chiffres sont ceux de l’année 2008. Le taux de reconnaissance du statut de réfugié en Grèce est alors de 0,1 % alors qu’il est de plus de 40 % en Suède. Mais pour autant, les demandeurs d’asile devraient accepter docilement de se faire expulser d’État en État.
[4] Les rapports émanent notamment du HCR, du Comité européen pour la prévention de la torture (organe du Conseil de l’Europe), d’une délégation d’une commission du Parlement européen, de Human Rights Watch, de la Cimade, du Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, de la Croix-Rouge autrichienne, d’Amnesty International et de la Commission nationale pour les droits de l’Homme. Leur référence se trouve dans l’arrêt de la CEDH 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 160, cité infra.
[5] CEDH, G.C., 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, req. n° 30696/09. L’affaire concernait l’expulsion par la Belgique d’un demandeur d’asile afghan vers la Grèce en application du règlement Dublin. À son arrivée en Grèce, le jeune Afghan est incarcéré dans un centre de rétention attenant à l’aéroport pendant trois jours dans des conditions abominables, puis libéré, livré à lui-même dans la rue, avant d’être à nouveau arrêté et détenu pour avoir tenté de fuir la Grèce, puis une nouvelle fois relâché dans la rue. La Cour condamne la Grèce pour les conditions de détention et d’existence imposées au requérant, les jugeant chacune contraires à l’article 3 de la Convention (qui interdit les traitements inhumains ou dégradants). La Grèce est également condamnée au titre de sa procédure d’asile, considérant le risque de refoulement arbitraire du requérant vers l’Afghanistan. Mais L’État belge est également condamné : au vu des très nombreux rapports d’ONG, la Cour européenne considère que les autorités belges « savaient ou devaient savoir » que le requérant n’avait aucune garantie de voir sa demande d’asile examinée sérieusement par les autorités grecques. C’est également en pleine connaissance de cause que les autorités belges ont exposé le requérant à des conditions de détention et d’existence constitutives de traitements dégradants.
En l’espèce – c’est assez rare – la Cour européenne des droits de l’homme avait demandé aux États européens de suspendre les transferts vers la Grèce dès le mois de septembre 2010, au moment de l’audience qui se tient devant elle. Alors que plusieurs États (le Royaume-Uni, la Suède, la Belgique, l’Islande, la Norvège et les Pays-Bas) annoncent se conformer à cette recommandation, la France continue imperturbablement de renvoyer des demandeurs d’asile en Grèce. C’est Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, qui est aux manettes. Certains juges des référés, notamment au tribunal administratif de Paris, ont été jusqu’à confirmer la légalité de ces décisions de transfert ou ont rejeté les référés-liberté intentés contre l’exécution de ces mesures. Pour les décisions et les détails, lire S. Slama, « La France suspend enfin les réadmissions vers la Grèce », sur le site internet Combats pour les droits de l’Homme, 6 mars 2011.
[6] Depuis la loi de 2016 relative au droit des étrangers, le refus de se soumettre à la prise d’empreinte est également devenu une infraction pénale qui peut valoir à l’étranger un an de prison, 3 750 euros d’amende et même, depuis la loi de septembre 2018, une interdiction du territoire français de trois ans.
[7] Deux précisions : certaines préfectures placent parfois les demandeurs d’asile en procédure Dublin sur la base des seules déclarations des intéressés relatives à leur parcours migratoire, mais c’est une pratique semble-t-il marginale. Par ailleurs, le fichier EURODAC n’est pas le seul à être interrogé, les empreintes de la personne étrangère sont également passées dans le fichier VISABIO, fichier des personnes ayant demandé un visa dans un État européen. Si l’étranger est parvenu en Europe grâce à un visa court séjour délivré par un autre État européen, d’après le règlement Dublin, c’est cet État qui est responsable de l’examen de sa demande d’asile. C’est lui qui a laissé entrer cette personne dans l’espace Schengen, c’est à lui d’en assumer la charge.
[8] À ce stade, la personne a droit à un entretien individuel au cours duquel elle peut faire valoir une série de raisons justifiant que la France accepte d’examiner sa demande d’asile bien qu’elle ne soit pas en principe l’État responsable. Cela peut tenir à la défaillance du système d’asile dans le pays en question, ou bien à des raisons humanitaires. En 2017, la France a accepté de traiter 4 000 dossiers d’asile alors qu’elle n’était pas l’État responsable d’après le règlement (ce qui demeure encore autorisé).
[9] En théorie, d’après le règlement, si l’étranger a laissé ses empreintes dans plusieurs États, la France devrait procéder, en fonction de la hiérarchie des critères, à la détermination de celui qui est en charge de l’étranger. Mais les préfectures envoient des requêtes de prise en charge tous azimuts pour multiplier les chances d’obtenir une décision positive.
[10] L’idée sous-jacente est ici d’encourager les États à expulser eux-mêmes rapidement leurs demandeurs d’asile déboutés, faute de quoi, ils risquent de leur revenir par la voie d’un transfert Dublin.
[11] La cour administrative d’appel de Bordeaux a ainsi accepté de faire courir le délai, qui varie entre deux ou trois mois, à compter du passage à la PADA – le ministère de l’Intérieur a saisi le Conseil d’État contre cette décision, l’affaire est en cours.
[12] Le délai dont dispose l’État sollicité pour s’opposer au transfert peut être de deux mois mais aussi d’un mois, voire de quinze jours suivant le motif pour lequel les empreintes de l’étranger ont été enregistrées dans le fichier (demande d’asile en cours, demande d’asile rejetée ou franchissement illégal de la frontière). Cela participe bien sûr de la complexité programmée et du caractère toujours incertain du droit applicable. En outre, la règle selon laquelle le silence vaut acceptation permet à certaines préfectures de se satisfaire d’un échange de mails avec le ministère de l’Intérieur pour justifier de la saisine et de l’accord de l’État étranger.
[13] . Jusqu’en 2007, 3 000 personnes sont placées chaque année en procédure Dublin. En 2014, leur nombre tourne autour de 5 000 et double ensuite chaque année (en 2015, 11 500 personnes sont placées en procédure Dublin, en 2016, elles sont 26 000 et 41 000 en 2017). Voir, sur le site de la Cimade, l’exploitation très claire des données officielles fournies par l’Europe (Eurostat) sur la base des informations elles-mêmes fournies par les États membres : Dubliné·e, vous avez dit Dubliné·e ?, guide pratique et théorique du règlement Dublin, novembre 2018, la Cimade : https://www.lacimade.org/dubline-vous-avez-dit-dubline.
[14] Voir l’Instruction du ministre de l’Intérieur relative aux objectifs et priorités en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, 20 novembre 2017, NOR : INT/V/17/30666/J. Elle incite les préfets à assigner les personnes en procédure Dublin à l’intérieur de ces nouveaux centres appelés « PRADHA », Programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, qui représentent 5 000 places créées en 2016.
[15] Défenseur des droits, Avis au parlement du Défenseur des droits sur la mission « immigration, asile et intégration », projet de loi de finances 2018, 16 octobre 2017, p. 5. Sur ces structures de contrôle qui ne disent pas toujours leur nom, lire Les nouvelles formes de contrôle des personnes étrangères : de l’accueil à l’enfermement, Actes du colloque de l’OEE, Rennes, 25 novembre 2017, OEE, 2018.
[16] C’est le cas de l’« hôtel Ribera » situé dans le 16e arrondissement de Paris où des centaines de « dublinés » sont assignés à résidence alors que le lieu ne comprend que 4 chambres.
[17] De très nombreuses places sont attribuées dans des hôtels « Formule 1 » situés parfois à plusieurs kilomètres d’un centre-ville, sans transport en commun accessible. C’est le cas par exemple en région Auvergne-Rhône-Alpes, où l’hôtel est situé à 4 km de la ville la plus proche ; à Lesquin, dans les Hauts-de-France, où le PRADHA est situé à une sortie d’autoroute, à proximité de l’aéroport ; à Bourges, où le centre est situé à 10 km du centre-ville, ou encore à Quimper où le centre se trouve dans une zone commerciale, à 5 km du centre-ville. Parfois, rien n’est organisé pour les repas des personnes hébergées. Dans ces conditions, comment rester ?
[18] Le délai de dix-huit mois, comme le délai de principe de six mois, court à compter de l’accord de l’État vers lequel la France souhaite renvoyer l’étranger. La date de cette autorisation de transfert donnée par l’État étranger figure en principe sur la décision de transfert notifiée par la préfecture à l’intéressé.
[19] Par l’effet du règlement européen n° 603/2013 du 26 juin 2013, entré en vigueur en juillet 2015.