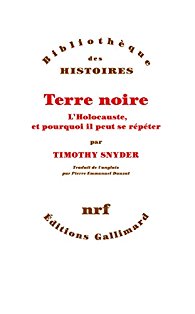
Dans ce texte, l’historien Enzo Traverso pointe non seulement les limites historiographiques du livre de Timothy Snyder Terre noire, mais montre également comment celui-ci utilise les horreurs de l’Holocauste pour prêcher des platitudes sionistes et néo-conservatrices.
Enzo Traverso est historien, auteur de nombreux ouvrages – dont La violence nazie (La Fabrique, 2002), Mélancolie de gauche (La Découverte, 2016), Les Nouveaux visages du fascisme (Textuel, 2016) – et articles, dont plusieurs sont parus sur Contretemps.
À propos de : Timothy Snyder, Terre noire. L’Holocauste, et pourquoi il peut se répéter, Paris, Gallimard, 2016.
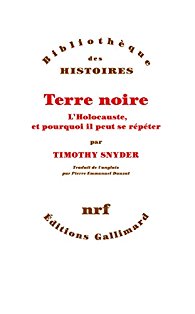
Il y a cinq ans, Timothy Snyder a publié Terres de sang, un ouvrage qui ancrait l’Holocauste dans le contexte des massacres de masse qui balayèrent l’Europe centrale et l’Europe de l’Est entre le début des années 1930 et la fin de la Seconde Guerre mondiale[1]. Cette violence se déroula dans ce que Snyder appelle les « terres de sang », un espace immense allant d’Odessa à Leningrad et englobant l’Ukraine, la Biélorussie, les pays Baltes, la Prusse orientale et les zones occidentales de la Russie. Selon ses estimations, au moins 14 millions de civils furent tués dans ces territoires entre 1930 et 1945, dont près de la moitié à cause de la famine provoquée d’abord par les politiques de Staline, puis par celles de Hitler. Ces terres furent le théâtre d’innombrables horreurs allant du cannibalisme aux chambres à gaz.
Cette violence se déroula en trois vagues successives : la première partit d’Ukraine, où la collectivisation de l’agriculture engendra 3,3 millions de victimes, et s’acheva avec la Grande Terreur, au cours de laquelle le NKVD soviétique exécuta près de 400 000 personnes. La deuxième, qui suivit le pacte Ribbentrop-Molotov, eut son épicentre en Pologne, qui fut systématiquement détruite par les puissances occupantes, allemandes et soviétiques. La troisième, qui fut de loin la plus mortifère, commença à l’été 1941, avec l’invasion allemande de l’Union soviétique. Les politiques d’extermination de cette vague – politiques allant de l’Holocauste à la famine imposée à la population slave – sont presque exclusivement le fait du nazisme.
Selon Snyder, l’opération Barbarossa – qui déboucha sur l’occupation de l’Ukraine par les Allemands et sur une guerre d’attrition qui dévasta les deux camps – révéla des erreurs de calcul fatales de la part d’Hitler et de Staline. Ce dernier savait que son alliance avec le dictateur allemand n’était que temporaire, mais il ne s’attendait à être agressé aussi tôt. Il négligea même les nombreux avertissements qu’il reçut au cours du printemps, en les mettant sur le compte de la propagande britannique. Hitler fut quant à lui dupé par sa propre idéologie : considérant les Slaves comme une « race inférieure », il croyait possible de détruire ce gigantesque ennemi en seulement trois mois.
D’après l’analyse de Snyder, l’échec de la première offensive allemande décida de l’issue finale du conflit tout entier. En lançant le Blitzkrieg, les nazis poursuivaient quatre buts fondamentaux : l’anéantissement rapide de l’Union soviétique ; la planification d’une famine qui affecterait 30 millions de personnes durant l’hiver 1941 ; un énorme programme de colonisation par l’Allemagne des territoires occidentaux de l’URSS vaincue, en particulier des contrées fertiles de l’Ukraine ; et la « Solution finale de la question juive », autrement dit le transfert massif des Juifs d’Europe vers les zones les plus éloignées des territoires occupées, où ils seraient progressivement éliminés.
Mais l’échec du Blitzkrieg obligea Hitler à revoir ses priorités : la « Solution finale », initialement prévue pour la fin de la guerre, devint soudain un but immédiat, dans la mesure où c’était le seul qui pouvait être réalisé à court terme. Puisque les Juifs ne pouvaient être évacués, ils furent massacrés, et les pays occupés systématiquement détruits. Selon Snyder, « le massacre fut moins un signe de triomphe qu’un substitut de victoire ».
Auschwitz, carrefour du réseau ferroviaire polonais, devait être le cœur de la colonisation allemande du Lebensraum, de l’« espace vital » : il devint le terminus pour les Juifs déportés et le lieu principal de leur extermination. Mais la grande majorité des victimes de l’Holocauste furent tuées à l’est d’Auschwitz, que Snyder replace dans le contexte plus large des « terres de sang » – ce territoire où les camps d’extermination se fondirent avec la guerre contre les partisans, la famine imposée aux Slaves et la lente annihilation de 2,6 millions de prisonniers de guerre soviétiques.
Bien que Terres de sang ne soit pas une histoire de l’Holocauste, il nous permet de mieux le comprendre en l’inscrivant dans un cadre élargi : le conflit mortel entre le national-socialisme et le stalinisme. Sa vision de l’Holocauste comme produit de la défaite allemande n’était pas entièrement neuve – Arno J. Mayer avait proposé une démonstration convaincante vingt ans plus tôt – mais il avait le mérite d’introduire de nouveaux éléments étayant cette hypothèse. Le nouveau livre de Snyder, Terre noire, est à la fois bien plus ambitieux et bien plus problématique.
Les deux écoles
Tandis que Terres de sang éclairait une dimension capitale de la Seconde Guerre mondiale – les massacres de masse en Europe centrale –, Terre noire fait de l’Holocauste une affaire purement est-européenne, ignorant par là des pans essentiels de son histoire.
Ainsi ses analyses des politiques nazies en Europe de l’Ouest et du Sud sont-elle d’une grande superficialité : c’est à peine s’il mentionne les Pays-Bas, la France, l’Italie et la Grèce – son modèle est exclusivement construit pour s’appliquer à la Pologne et à l’Ukraine. L’étroitesse de sa focalisation le conduit en outre à d’importantes distorsions. Par exemple, lorsqu’il évoque le catholicisme, il ne parle jamais du Vatican – sujet pourtant largement étudié –, mais presque uniquement les prêtres et fidèles polonais. Et il ignore purement et simplement les individus qui ont sauvé des vies ou les mouvements de résistance dans d’autres pays.
Depuis plusieurs décennies, l’historiographie de l’Holocauste se divise en deux grands courants, que Saul Friedländer a qualifiés d’intentionnalisme et de fonctionnalisme : le premier se concentre surtout sur la dimension idéologique de l’Holocauste, le second sur les aléas de sa réalisation, produit d’une série de décisions prises dans des circonstances particulières. Pour les historiens intentionnalistes, la Seconde Guerre mondiale a seulement créé l’occasion d’un projet génocidaire longtemps reporté et aussi vieux que l’antisémitisme même. En revanche, pour les historiens fonctionnalistes, la haine des Juifs ne suffit pas à expliquer un projet d’extermination inventé pour des raisons pragmatiques au milieu de la guerre.
L’ouvrage de Snyder relève de cette seconde tendance, même s’il tente de sortir de cette querelle dépassée en arrachant l’Holocauste au cadre étroit des Holocaust Studies. Mais à bien des égards, Terre noire fait un pas dans la mauvaise direction, en prenant congé des acquis de l’historiographie de l’Holocauste.
Les sans-État
La perspective de Snyder n’est ni allemande ni juive, mais polonaise. Il n’explique pas l’Holocauste exclusivement du point de vue de ses responsables et ne retrace pas les étapes de ce processus en adoptant le point de vue des victimes – deux approches complémentaires et adoptées avec succès par Raul Hilberg et Saul Friedländer. Il adopte pour sa part une perspective territoriale où la Pologne lui sert à la fois d’exemple privilégié et d’objet d’étude. Il choisit donc d’observer l’extermination des Juifs à partir de l’un des espaces où elle s’est déroulée, un espace qui ne fut ni le lieu où elle fut organisée ni le pays d’où venait la totalité des victimes. Dans sa reconstitution, l’Holocauste devient un événement historique global dans la mesure où, à partir de la Pologne, il rayonne vers l’ensemble de l’Europe. Mais dans Terre noire, cette approche devient un miroir brisé qui déforme la perspective historique.
Snyder cite Hannah Arendt, qui, dans Les Origines du totalitarisme, a longuement analysé l’émergence d’une masse de personnes sans État – d’abord à la fin de la Grande Guerre, avec la chute des empires multinationaux, puis avec l’avènement du national-socialisme et la promulgation de lois antisémites, qui transformèrent les juifs en parias dans de nombreux pays d’Europe. Selon Arendt, l’existence de cette masse de sans-État, privés de citoyenneté et rejetés par toutes les puissances occidentales, fut une précondition fondamentale de l’Holocauste. Mais chez Snyder, la notion de sans-État ne renvoie pas d’abord à des personnes, singulièrement aux Juifs, mais au contraire à des territoires. Selon son optique, les nazis pouvaient exterminer les Juifs parce qu’ils agissaient dans des territoires où toute structure étatique avait été détruite. Les pays qui avaient été occupés par l’URSS entre 1939 et 1941 ne pouvaient résister à la violence nazie : ils n’avaient plus d’appareil d’État, toutes les structures étatiques s’étaient effondrées, aucune barrière n’existait plus entre les agresseurs et leurs victimes. Ce qui amène Snyder à conclure que seules « la citoyenneté, la bureaucratie et la politique étrangères faisaient obstacle au désir des nazis d’assassiner la totalité des Juifs d’Europe ». Les exemples des Juifs d’Estonie et du Danemark – vivant, respectivement, dans un État détruit et dans un État préservé – « confirment le lien entre souveraineté et survie ».
Si les nazis ont détruit les Juifs par de multiples moyens bureaucratiques – de la Wehrmacht aux bataillons de police et des Einsatzgruppen aux camps d’extermination –, leur action était encore plus efficace là où il n’existait plus de bureaucratie nationale. Mais là où l’administration allemande coexistait avec, ou se superposait à un système étatique national encore fonctionnel, la vague annihilatrice fut retardée, contenue, limitée, diminuée et parfois empêchée. La plupart des Juifs furent tués en Pologne, en Ukraine, en Biélorussie et dans les pays Baltes, où les États nationaux s’étaient effondrés avant 1941. Là, les nazis purent réorganiser les territoires à leur guise et massacrer sans limites.
Les Pays-Bas et la Grèce étaient très proches de ce modèle est-européen d’absence d’État. En Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, encore plus en Europe de l’Ouest, au Danemark, en France ou en Italie – et même, selon Snyder, en Allemagne –, la permanence des institutions étatiques, des administrations et des systèmes juridiques firent objectivement obstacle à l’Holocauste. Cette explication est valable dans une certaine mesure. Le problème est qu’elle tend à justifier la vision apologétique du collaborationnisme, en en faisant une forme d’autodéfense ou d’autopréservation plutôt que de complicité avec la domination nazie. Dans de nombreux cas, la survivance des bureaucraties et des structures étatiques représenta un appui supplémentaire pour l’occupant. Il est vrai que Vichy distinguait les Juifs français des Juifs étrangers et tenta de protéger les premiers, mais la totalité des Juifs fut répertoriée par les autorités nationales, arrêtée par des policiers locaux et internée dans des camps de transits créés par l’administration française. En Italie, les forces de police de la République de Salo aidèrent activement l’occupant nazi à arrêter et à déporter les Juifs. L’inefficacité des structures étatiques fut parfois un obstacle, mais dans l’ensemble l’État italien facilita le processus d’extermination.
Les arguments de Snyder ne font que conforter un fait reconnu par tous les spécialistes de l’Holocauste : la domination nazie fut bien plus brutale, violente et destructrice dans les pays annexés par le IIIe Reich que dans les pays dirigés par des régimes autonomes, autoritaires et impliqués dans la collaboration. Cette différence ne découle pas du pacte Ribbentrop-Molotov – qui créa des territoires sans État – mais d’un choix politique, lié au projet colonial de conquête de l’« espace vital » allemand et de destruction de l’Union soviétique, État que les nazis identifiaient aux Juifs. L’extension de la notion de « sans-État » à des territoires n’apporte pas grand-chose à notre compréhension de l’Holocauste ou du projet colonial hitlérien.
Erreurs d’interprétation
Terre noire est peut-être une interprétation intéressante de l’Holocauste d’un point de vue polonais, mais l’auteur nourrit une ambition bien plus grande : il prétend révéler la signification universelle de cet événement historique. Malheureusement, l’ouvrage n’est pas à la hauteur de cette ambition.
Ainsi, quand Snyder se hasarde en dehors de l’Europe centrale, ses analyses deviennent superficielles, imprécises et parfois franchement bizarres. Ses incursions dans l’histoire idéologique sont presque toutes problématiques – par exemple, il définit à maintes reprises Hitler comme un « anarchiste biologique », ce qui ne nous aide en rien à comprendre la vision du monde du dictateur allemand mais en dit long sur sa compréhension approximative de l’anarchisme. À l’en croire, l’« anarchiste biologique » que fut Hitler avait pour principale source d’inspiration la pensée de Carl Schmitt, théoricien de l’État constitutionnel et philosophe politique qu’il n’a probablement jamais lu, dont la pensée conservatrice reposait, à l’exception de quelques textes écrits entre 1933 et 1936, sur l’idée d’État, non de race, et dont l’antisémitisme était d’ordre religieux, non racial.
Schmitt n’a pas réellement influencé les nazis ; il a plutôt tenté de légitimer leur politique a posteriori. De même, Snyder affirme à tort que le national-socialisme a inventé le concept d’« espace vital », alors que celui-ci était largement utilisé par le nationalisme et la géographie allemande et que son premier théoricien fut Friedrich Ratzel, en 1901 (Ratzel dont le nom n’apparaît pas dans l’index de Terre noire). Il se méprend aussi sur l’École de Francfort : selon lui, Horkheimer et Adorno – auteurs d’un ouvrage célébré, La Dialectique de la raison – étaient des obscurantistes invétérés, opposés au progrès et incapables de comprendre qu’Hitler n’était pas un défenseur mais un ennemi de la pensée des Lumières.
Cette inconsistance politique est caractéristique du livre dans son ensemble, qui explique aussi que les militants altermondialistes et les requins de Wall Street sont par essence interchangeables : « Au XXIe siècle, des mouvements contestataires anarchiques rejoignent l’oligarchie globale dans un joyeux désordre, où aucune partie ne peut souffrir puisque les premiers comme la seconde considèrent que l’État est le véritable ennemi. »
Le choc des civilisations
Dans la conclusion de son stupéfiant ouvrage, Snyder délaisse l’histoire pour entrer dans le domaine de la prophétie : « Comprendre l’Holocauste, explique-t-il, est notre chance, la dernière peut-être, pour sauver l’humanité. »
Hitler, nous dit-il, était davantage qu’un « anarchiste biologique » ; c’était aussi un stratège de l’écologie, dont le projet de construire un empire « aryen » reposait sur le calcul implacable des ressources naturelles disponibles en Europe continentale. Les Allemands ne pouvaient asseoir un règne millénaire sans s’approprier le maïs, le pétrole et les autres ressources d’Europe de l’Est. Cette affirmation est exacte : la conquête de l’« espace vital » présentait aussi des aspects « écologiques », dans la mesure où la domination raciale supposait un contrôle total de la démographie, de l’économie, des territoires et de leurs ressources naturelles.
Ces questions, explique Snyder, furent effacées après guerre par la « Révolution verte » qui permit à l’Allemagne de devenir une nation prospère sans avoir à conquérir l’URSS (et malgré la perte d’une grande part de ses anciens territoires). Mais les leçons de la « première mondialisation » (dont Hitler fut, toujours selon Snyder, « le rejeton ») retrouvent leur pertinence au début du XXIe siècle, où le contrôle des ressources naturelles décidera de l’avenir de notre planète. Cette lutte pourrait prendre un tour aussi violent que la bataille zoologique pour la sélection raciale conçue par Hitler voici près d’un siècle, conclut-il, et nous ne devons pas écarter la possibilité qu’elle ne devienne le motif de nouvelles guerres et de nouveaux génocides. Voilà pourquoi les enseignements de l’Holocauste conservent toutes leur importance : « La lutte contre les Juifs était d’ordre écologique » dans la mesure où « elle portait non sur un ennemi racial ou un territoire particulier, mais sur les conditions de la vie sur terre ».
En acceptant ces prémisses, on pourrait voir les premiers signes de ce scénario catastrophe dans les guerres occidentales contre l’Irak et la Lybie, par lesquelles les grandes puissances ont tenté de prendre le contrôle de sites essentiels de production pétrolière. Mais l’avertissement lancé par Snyder le Cassandre ne fait que réitérer les lieux communs du néo-conservatisme : l’avenir est au choc des civilisations et l’Occident doit se préparer à une nouvelle croisade. Ainsi, « l’Afrique démontre le risque de pénuries locales, la Chine évoque les problèmes posés par la puissance mondiale et l’inquiétude nationale, et la Russie montre que des pratiques des années 1930 peuvent apparaître comme des exemples positifs. En grande partie à cause de Moscou, la destruction d’États et la construction d’ennemis planétaires sont de nouveau en vogue en Europe. Au Moyen-Orient, les États ont tendance à être faibles, et les fondamentalistes musulmans ont longtemps présenté les Juifs, les Américains et les Européens comme des ennemis planétaires. »
La Russie, dont le leader a pris « la tête des forces populistes, fascistes et néo-nazies en Europe », a inventé un nouveau bouc-émissaire avec les homosexuels, mais, selon Snyder, les Juifs pourraient encore être les victimes d’un second Holocauste. Enfin il referme son argumentaire erroné en transformant son histoire territoriale des sans-État en une vigoureuse défense d’Israël. « Les sionistes de toute obédience avaient raison de penser qu’un État était essentiel à leur future existence en tant que nation » – mais Snyder oublie de dire que cette observation semble justifier l’exigence d’un État palestinien. À ses yeux, elle prouve au contraire que les Israéliens ont raison de contrôler les réserves d’eau de la Cisjordanie, tandis que les Palestiniens, par leurs griefs, ne sont pas sans rappeler les nazis : « Les musulmans pourraient rendre les Juifs responsables des problèmes locaux et de la crise écologique générale ; c’était, après tout, l’approche d’Hitler. »
Toujours dans la conclusion de Terre noire, Snyder exprime son admiration – mi-naïve, mi-dogmatique – à l’égard de Menachem Begin, Yitzhak Shamir et Benjamin Netanyahu, des leaders israéliens en qui il voit les nobles descendants de leurs ancêtres, les héroïques nationalistes polonais des XIXe et XXe siècles.
L’auteur de Terres de sang a sans doute fait une contribution importante à l’historiographie de l’Holocauste ; cinq ans plus tard, le prophète de Terre noire prêche des platitudes sionistes et néo-conservatrices, et obscurcit l’histoire plus qu’il ne l’éclaire.
Traduit de l’anglais par Nicolas Vieillescazes.
Illustration : Juifs Polonais déportés en 1939. Archives fédérales allemandes.
[1] Ce texte est paru initialement en anglais sur le site de la revue Jacobin.