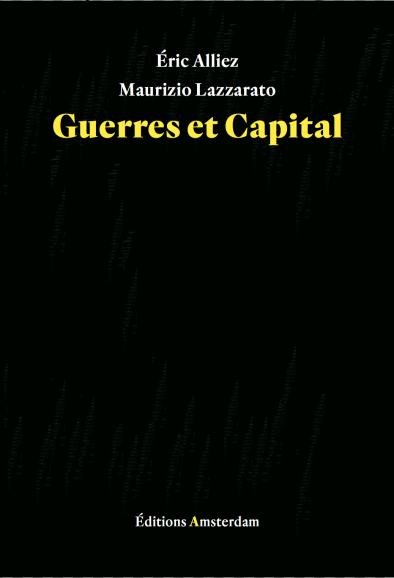
Éric Alliez et Maurizio Lazzarato, Guerres et Capital, Paris, Editions Amsterdam, 2016.
A lire ici l’introduction de l’ouvrage.
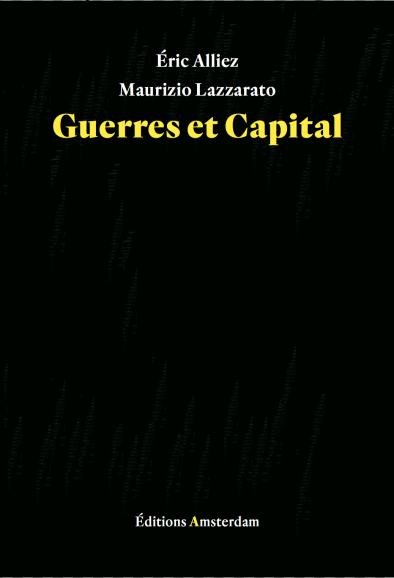
*
Étonnant objet que l’ouvrage Guerres et Capital. Un livre dont le titre nous est proposé en lettres jaunes sur le fond noir de la couverture, qu’on aurait pu dire unie si elle n’était par endroit striée de ce qui semble être des marques de griffures, comme si l’on avait tenté d’en gratter la surface. Dont les auteurs, Éric Alliez et Maurizio Lazzarato, sont philosophes. Que l’on sait tous deux tous deux liés, quoique de manière complexe, aux revues Futur Antérieur puis Multitudes – c’est-à-dire à un certain courant postopéraïste en France. Que l’on sait également (ou par conséquent) héritiers de la pensée de Deleuze et de Guattari ainsi que, plus en amont, de celle de Tarde. Que l’on sait enfin hantés par la défaite sur laquelle s’acheva la séquence ouverte par mai 68, qui fût également (entre autres) celle de la « pensée » qu’on y associe, selon l’expression devenue courante.
Ouvrage dont le titre, Guerres et Capital, est éloquent. Éloquent en ce qu’au Capital, envisagé au singulier depuis Marx (Das Kapital) sont juxtaposées les guerres, au pluriel celles-là. Qui suggère des relations de nature particulière (privilégiées?), entre des phénomènes d’accumulation et de désaccumulation étudiés de longue date par certaines figures et courant du marxisme (on pense notamment aux travaux d’Ernest Mandel) d’un côté, et de l’autre des phénomènes guerriers dont la pluralité est d’emblée posée comme suffisamment irréductible pour qu’on ne puisse opérer une réduction à l’Un telle que soit permis d’écrire Guerre, au singulier. Qui ne nous dit cependant rien de plus que son objet, en l’absence de tout sous-titre. Objet dont on sait là encore qu’une certaine tradition marxiste, depuis Rosa Luxembourg au moins, a produit une analyse (au moins partielle) en le désignant du nom d’impérialisme, de « guerres impérialistes » – analyses auxquelles on devine que ne souscrivent pas les auteurs du présent ouvrage, du moins pas intégralement.
Guerres et Capital (G&C) s’ouvre sur son sommaire, où l’on découvre sa division en douze sections numérotées, précédées d’une introduction sobrement intitulée « À nos ennemis ». Introduction vers la fin de laquelle on lit notamment (à cheval entre l’antépénultième et le pénultième « points » d’une série de trente numérotés à la Debord) :
« Les nouvelles générations écrivantes déclinent le « peuples qui manque » en rêvant d’insomnie et de processus destituants malheureusement à leurs amis. (…) Coupons court, en nous adressant à nos ennemis. Car ce livre n’a d’autre objet que de faire entendre, sous l’économie et sa « démocratie », derrière les révolutions technologiques et l’« intellectualité de masse du General intellect, le grondement des guerres en cours dans toute leur multiplicité. (…) En somme, il s’agirait de tirer les leçons de ce qui nous est apparu comme l’échec de la pensée 68 dont nous sommes les héritiers, jusque dans notre capacité à penser une machine de guerre collective à la hauteur de la guerre civile déchaînée (…). »
Où l’on voit explicité le champ polémique au sein duquel ce texte est destiné à intervenir. La défaite telle que décrite par les auteurs est en effet tant celle des « mouvements » à la jonction des années 1960 et 1970 que celle de leur pensée (de ce que ceux-ci pensaient, et qui ne leur a pas permis d’éviter cette défaite ; de ce qu’on en a pensé depuis, et qui ne nous a à l’évidence pas permis d’en sortir, la prolongeant, voire l’approfondissant indéfiniment).
Une thèse avancée par Alliez et Lazzarato consiste à situer cette panne stratégique dans un défaut de théorisation des liens qui unissent d’une part les processus de production et de reproduction du Capital, et d’autre par les guerres envisagées dans leur « multiplicité » : guerres interétatiques ou « interimpérialistes » certes, mais également guerres « civiles » : de genre, de race, de classe, de production des subjectivités. Mais laissons un moment de côté la « destination » pour interroger, suivant en cela la formule de Deleuze, par où commencent les auteurs de G&C. J’évoquais plus haut le découpage en douze sections de l’ouvrage, dont il me semble maintenant devoir préciser la physionomie. Celle si trouve sa singularité en ce que lesdites sections sont alternativement à dominante historique et théorique, alternance redoublée à l’intérieur de ces dernières.
Prenons un exemple. La première section, intitulée « État, machine de guerre, monnaie », consiste à mobiliser le premier cours de Foucault au Collège de France consacré à l’institution de la monnaie dans la Grèce antique d’une part, et d’autre part le diptyque Capitalisme et Schizophrénie de Deleuze et Guattari pour poser « le rapport étroit, constitutif, ontologique entre la forme la plus déterritorialisée du capital, l’argent, et la forme la plus déterritorialisée de la souveraineté, la guerre, (…) comme point de départ obligé pour repenser toute l’histoire du capitalisme ». La seconde, intitulée l’« accumulation primitive continuée » trouve au contraire son unité dans sa visée historiographique, qui correspond à une réactivation du débat sur la transition du féodalisme au capitalisme initié par Dobb et Sweezy dans les années 1950. Dans le sillages des théoriciens de l’économie-monde, Alliez et Lazzarato font de 1492 l’« An 01 du Capital » avec le début de la colonisation des Amériques, rejetant l’idée d’une accumulation qui serait à la fois non-capitaliste et pré-capitaliste. À la colonisation « externe » correspond, via un jeu constant d’effets de retour, une colonisation « interne » qui passe par une guerre contre les femmes (dont l’épisode le plus connu reste la « chasse aux sorcières ») et contre les pauvres (avec notamment la « guerre des paysans »). L’ensemble de ces guerres étant analysés comme autant de manières de créer, autant que les « conditions de vie » (la monnaie et l’État), les « modes de subjectivations » (sexiste, raciste, etc.) et les savoirs afférents à même d’œuvrer à la (re)production continuée du Capital.
Il faut toutefois noter que ce travail révision historiographique procède essentiellement de la discussion critique et de la subsomption (ou de la « lecture symptomale », selon les cas) d’œuvres à forte teneur philosophique, ou du moins théorique : les travaux de Silvia Federici sur la matrice coloniale du sexisme, ceux de Matthieu Renault sur John Locke, ou encore ceux de David Harvey sur l’« accumulation par dépossession » – les auteurs reprochant par exemple à ce dernier la faiblesse de ses « propositions politiques », qu’ils situent dans le maintien d’une opposition entre capital industriel et capital financier qui le conduirait à trouver des « aspect positifs » aux effets du premier. Inutile de multiplier les exemples dans une entreprise qui ne ferait que diluer la densité des analyses proposées par Alliez et Lazzarato : l’important ici me semble d’insister sur le caractère fondamental de la tension qui traverse l’ouvrage entre un travail de clarification théorique d’une part et la volonté de production d’une nouvelle intelligibilité d’une série de séquences historiques d’autre part.
Arrêtons-nous un instant sur ces dernières : du processus d’appropriation par l’État de la « machine de guerre » (comprendre ici de l’armée) aux révolutions françaises et haïtiennes, des guerres napoléoniennes à celles de colonisation du XIXe siècle, de l’émergence du monde et des combats ouvriers aux « guerres totales » du XXe siècle jusqu’à la guerre froide et aux « guerres fractales du Capital » contemporaines (titre de la dernière de douze sections évoquées), les auteurs déploient leur analyse dans une direction qui les conduit à envisager le Capital comme produit/producteur des guerres au même titre que l’État. D’où la centralité dans le développement de l’ouvrage de la discussion de ce qu’on pourrait rassembler de manière schématique dans deux ensembles d’auteurs : les « libéraux » (Locke, Smith, un certain Foucault) d’un côté, les théoriciens « de l’ordre et de sa rupture (toujours-déjà à conjurer) » de l’autre (Clausewitz et Schmitt, mais également des militaires contemporains) – ces ensembles prenant place aux côtés de ceux correspondant aux marxistes (Lénine, Luxembourg, Mao) et à la « pensées 68 ».
Un des pivots de la réflexion menée d’Alliez et Lazzarato consiste en l’analyse de la formule de Clausewitz, qui dans l’ouvrage De la guerre décrit cette dernière « simple continuation de la politique par d’autres moyens ». Or les auteurs montrent que « la guerre » telle que décrite par Clausewitz, soit une pratique limitée a priori (subordonnée aux fins de la politique telle qu’envisagée jusqu’au XVIIIe siècle, c’est-à-dire essentiellement comme lutte interétatique pour la souveraineté sur des territoires) ne correspond qu’à un type spécifique de phénomènes guerriers, qui plus est historiquement situé. Les révolutions françaises et haïtiennes n’ont pas fait que rompre l’idée téléologique d’un retour à l’équilibre comme horizon indépassable de la guerre : elles ont permis une nouvelle compréhension des guerres comme conflits illimités ayant pour enjeu l’appropriation (l’ex-propriation, la dés-appropriation) de l’ensemble des ressources, y compris subjective. Nouvelle compréhension que résume dans un premier temps le retournement de la formule de Clausewitz opéré par Foucault notamment, qui envisage la politique comme continuation de la guerre (« civile ») – retournement lui-même interrogé par Alliez et Lazzarato, à partir de l’abandon par Foucault lui-même du concept de « guerre » au profit de ceux de pouvoir et de « gouvernementalité », dans la seconde moitié des années 19701
Si ce geste n’est en soit pas suffisant, Lazzarato et Alliez en ont conscience, qui lui adjoignent un autre consistant à restituer le déroulement desdites guerres, à reconstruire les logiques qui y président et les stratégies auxquelles elles donnent lieu. Un détour me semble ici nécessaire. Si l’on revient un moment sur l’équilibre général de l’ouvrage, on remarque que l’introduction et les 6 premières sections occupent à peine plus du tiers de l’ouvrage. Ce qui place en son centre les sections 8 et 9, intitulées respectivement « Les guerres totales » et « Les jeux de stratégie de la guerre froide ». Autrement dit, le cœur de G&K peut être situé dans l’analyse proposée par les auteurs de la période qui court de 1914 à la séquence initiée par mai 68. Certes, les auteurs visent à l’intelligibilité « des guerres » historiquement consubstantielles à la modernité entendue dans un sens élargi (c’est-à-dire postérieures à 1492). Ils n’en demeure pas moins que l’âge des guerres totales (1914-1945) représente une rupture qualitative, qui voit « de profondes transformations pour le Capital et l’État dans la totalisation illimitée de la guerre ». Pour le dire autrement, le passage de la « subsomption formelle » à celle « réelle » , que certains théorisent comme l’apanage d’une postmodernité ultérieure aux années 1970, est ici déplacé (au moins en puissance) dans la première moitié du XXe siècle, lorsqu’on assiste à l’« appropriation de la machine de guerre par le Capital, qui intègre et reformate l’État comme une de ses composantes ».
L’assujettissement au Capital de l’administration et de l’armée, du keynésianisme de guerre à la mobilisation générale (nationale), ouvre en effet un nouveau chapitre de la stratégie militaire qui voit s’accélérer le processus d’interpénétration entre colonisations « internes » et « externes » (déjà à l’œuvre dans l’usage par l’armée française en 1848 de méthodes directement importées de la guerre coloniale en Algérie) entre guerres « intérieures » et « extérieures ». Alliez et Lazzarato nous donnent à voir une dynamique de totalisation vertigineuse à l’œuvre : alors que l’illimitation consubstantielle au Capital trouve une expression dans la « militarisation de l’économie » (Kalecki), l’État intensifie les guerres (disciplinaire comme biopolitique) des subjectivités menée par Capital au profit de ce dernier. Ils l’observent spécifiquement aux États-Unis dans les années d’après-Guerre, lorsque le complexe militaro-industriel travaille à l’explosion des techniques d’optimisation managériales et gestionnaires – la « militarisation logistique de l’ensemble de la société » – favorisant un « nouveau régime d’endocolonisation », tandis que la poursuite de la guerre industrielle se poursuit sous l’égide des parapluie nucléaires conjurant toute possibilité de paix.
Le terme de « guerre dans la population » n’apparaît en réalité que plus tard, repris de l’analyse qu’en proposent des généraux, Sir Rupert Smith et Vincent Desportes. Ceux-ci l’envisagent comme « antithèse » du paradigme de la « guerre industrielle » mis en échec depuis la fin du XXe siècle (en réalité depuis la guerre du Vietnam), de manière concomitante à l’affaiblissement des État-nations. Stade en quelque sorte ultime de la gouvernementalité néolibérale correspondant aux mutations géopolitiques, technologiques et urbaines contemporaine, la guerre dans la population (et dans le public) représente dorénavant « l’instrument principal de contrôle, de normalisation et de disciplinarisation de la force de travail globalisée », qui vise « le contrôle du territoire et notamment de la ville, puisque cette dernière constitue le milieu ou l’environnement de la population et de la pauvreté globalisée ». Où l’intervention militaire se dilue comme moyen parmi d’autres dudit contrôle. Here we are.
Ce bref aperçu laisse en friche de nombreux éléments de l’ouvrage : la discussion du concept d’anthropocène ; celle, parfois explicite mais le plus souvent en sourdine d’Empire de Toni Negri et Michael Hardt ; celle de la lecture de l’impérialisme proposée par Carl Schmitt, l’analyse de la politique du Welfare, etc. Si le caractère de somme que ses auteurs ont indéniablement conféré à G&C invite de facto les spécialistes des différents thèmes de recherche par eux évoqués à venir discuter « scientifiquement » la pertinence des différentes interprétations dont on a ici esquissé la présentation, la centralité en son sein de la question stratégique et son actualité tant théorique que directement politique laissent entrevoir la possibilité d’une discussion plus large des thèses qui y sont avancé ou qui le sous-tendent, ainsi que des problèmes qu’il soulève. Je me contenterai pour terminer d’en évoquer deux, qui n’ôtent à mon sens pas grand-chose à la portée de l’ouvrage mais invitent à en prolonger la lecture depuis un certain point de vue.
Le premier réside, je crois, dans un défaut de prise en compte des rivalités entre les différentes fractions du capital. Les raisonnement se succèdent en effet comme si l’unité stratégique de celles-ci n’était jamais remise en cause. Approche du Capital en terme d’unité qui rejaillit sur celle de l’État qui en apparaît comme épuré de nombre des contradictions qui le traversent, à l’heure pourtant où une génération entière redécouvre notamment l’œuvre de Nicos Poulantzas et sa conceptualisation de l’État comme « condensation matérielle d’un rapport entre les classes et les fractions de classes ». Le second, plus angoissant peut-être, réside dans l’ontologie même des rapports sociaux que nous proposent les auteurs. Ontologie qui semble parfois exclure la possibilité même de la paix, visée toujours-déjà à reconquérir face à des interpellations guerrières tant macro que micropolitiques incessantes et protéiformes, parfois diffuses. Qui nous jette sur un plan d’immanence, lequel invite certes à la construction de « nouvelles machines de guerre » mais ne nous en livre aucun plan, sinon sur le mode de la déprise – dont on devine bien que les auteurs l’estiment insuffisante, qui l’affirmaient dès l’introduction. Peut-être un second tome annoncé (Capital et Guerres ? Guerre et Capitaux ?) en post-scriptum à cette dernière et présente comme une étude des contre-révolutions nous apportera-t-il des éclairages concernant ces éléments.
références
| ⇧1 | La (re)lecture de l’œuvre foucaldienne occupe une telle place (au sens propre comme figuré) dans l’ouvrage qu’il s’agit en quelque sorte d’un « livre dans le livre », dont il m’est difficile d’estimer le degré de centralité (par moments, il semble que l’effort des auteurs soit en réalité tout entier tendu vers la production d’une interprétation originale de son œuvre, plus que vers celle des données historiques). Une des douze sections évoquées, intitulée « Les limites du libéralisme de Foucault », est d’ailleurs consacrée essentiellement à la critique des deux dernières leçons du cours donné par ce dernier au collège de France en 1978-1979 sous l’intitulé Naissance de la biopolitique. Alliez et Lazzarato y décèlent notamment l’« idéation d’une « société civile » neutralisant à la fois l’État, la guerre (et la guerre civile) et le Capital [qui] ne passe pas la moitié du XIXe siècle ». Ils mettent en outre le doigt sur l’eurocentrisme inhérent à la généalogie du racisme d’État telle que proposée par Foucault dans le cours de 1975-1976 intitulé Il faut défendre la société. |
|---|