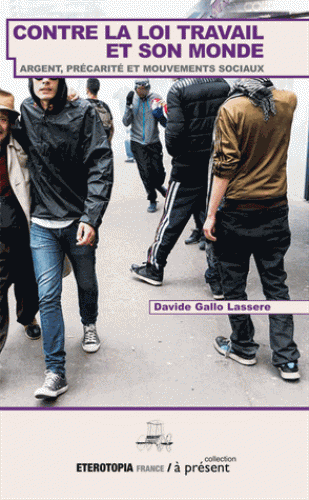
Davide Gallo Lassere, Contre la loi travail et son monde. Argent, précarité et mouvements sociaux, Paris, Eterotopia, 2016.
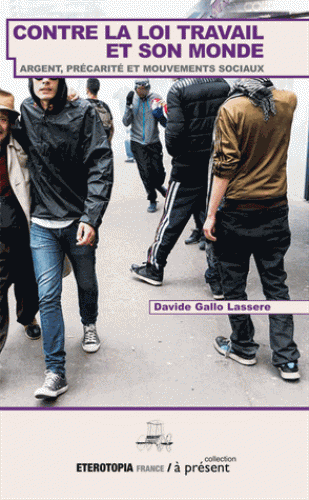
Après une année marquée par les tueries de janvier et de novembre et par l’imposition de l’Etat d’urgence, la mobilisation contre la Loi Travail du printemps 2016, avec ses blocages de lycées et d’universités, ses cortèges de manifestants, ses Nuits debout et ses grèves syndicales, change le climat politique. Cet ouvrage parcourt les moments topiques qui ont scandé la mobilisation, en montrant comme le « long mars français » puise ses racines dans une histoire récente qui le précède et qui le dépasse. Les événements du printemps 2016 doivent ainsi être situés dans une perspective transnationale qui va de 1968 jusqu’aux luttes globales de 2011, en passant par le déclenchement de la crise en 2007-08. Cette approche permet à l’auteur d’élaborer une vision d’ensemble de la crise en cours et des protestations qui l’ont accompagnée en mettant en lumière l’articulation entre le plan national français et celui de la gouvernance européenne. Les réformes néolibérales opérées par les gouvernements socialistes entrent en effet en forte résonance avec les normes en vigueur dans les différents contextes nationaux, même si les formes d’opposition et de résistance mises en place reflètent les spécificités françaises. Attentif à la composition subjective de la contestation, l’essai avance enfin une proposition passible d’alimenter le débat politique dans les mois à venir : la socialisation du revenu et son lien avec les luttes antiraciales.
« Que reste-t-il du premier opéraïsme, dont Ouvriers et capital n’a été que l’une des expressions ? Certaines choses, vous les dites vous-mêmes dans la présentation de la rencontre de Nanterre : il reste le point de vue partiel à partir duquel regarder le Tout, il reste une conception conflictuelle des rapports sociaux, il reste la subjectivité des luttes qui impose à l’adversaire le terrain de l’initiative. Mais ce qui reste surtout, pour moi, c’est une lecture politique de la lutte de classe, l’anti-économisme, l’anti-sociologisme, l’anti-idéologisme. Ce qui m’amène aujourd’hui à soutenir l’idée suivante – une idée de « pensée extrême » : pour abattre la menace de la centralité ouvrière, le capitalisme a dû abattre la centralité de l’industrie, avec la conséquence que l’on sait : une nouvelle forme d’ordre capitaliste fondé sur le désordre financier, quand ce n’est plus la crise périodique qui interrompt le développement permanent mais au contraire le développement périodique qui interrompt la crise permanente. Quand je dis cela, je vois les yeux des économistes néolibéristes, post-keynésiens ou pseudo-marxistes, peu importes, devenir ronds. C’est vrai ? Ce n’est pas vrai ? Ça ne m’intéresse pas. Je ne cherche pas la vérité historique, objective, bonne pour les intellectuels dis-organiques. Je cherche une idée-force, une idée politique, qui puisse me servir pour construire un front de conflit qui plonge à la racine des divisions sociales actuelles » (Mario Tronti, Rome, 11 juin 2016).
0. READY : CECI N’EST PAS UN DÉBUT
« Paris, debout, sou-lève-toi ! Paris, debout, sou-lève-toi ! Paris, debout, sou-lève-toi ! » : ce chant saccadé, que l’on entend revenir puissamment à chaque manif, rythme l’avancée des 2 000 personnes qui, samedi 9 avril à 22h30, de Nuit debout se sont dirigées vers rue Keller, pour un joyeux « apéro chez Valls ». Après les blocages à répétition des cours dans les facs et les lycées, et suite aux quatre imposantes manifestations du 9, du 17, du 24 et du 31, le mois de mars a enfin débouché sur l’occupation symbolique de la Place de la République, laquelle a ratifié le débordement du cadre de la contestation – contre la Loi Travail et son monde – en essayant d’attribuer une forme inédite à la convergence des luttes depuis si longtemps convoitée. Inévitable, donc, que les personnes réunies sur la place contre vents et marées, tôt ou tard sentent le besoin d’aller faire leur fête à l’incarnation quintessentielle du nouvel extrémisme du centre, leur voisin Monsieur Manuel Valls. Interclassiste et libératoire, le slogan exprime à fond le caractère de la mobilisation qui a connoté ce printemps passionnant et passionné : la volonté largement inclusive de se soulever ensemble et de repartir après une année horrible, celle de 2015, qui a commencé avec les tueries de janvier et qui s’est achevée en automne, entre les attentats du 13 novembre, l’institution de l’état d’urgence et la répression des opposants à la COP21.
Le but que nous nous sommes fixés avec cet essai est de parcourir brièvement les moments topiques qui ont scandé la mobilisation et de poser, dans le chapitre 3, un point de fuite afin de tracer des perspectives passibles d’alimenter ultérieurement le débat politique lors de l’automne prochain. Pour accomplir une telle tâche, nous tenterons tout d’abord de réinscrire les événements français – avec leurs spécificités, à savoir l’articulation entre les protestations contre la Loi Travail (qui ont vu impliqués en première ligne étudiants, travailleurs et syndicalistes) et Nuit debout (dont la composition est plus mixte) – à l’intérieur des coordonnées spatiales et temporelles de la crise globale déclenchée en 2007-08 et du cycle de lutte qui l’a accompagnée (séquence grecque, printemps arabes,
Indignados, Occupy Wall Street, révoltes brésiliennes, turques, etc.). Ce sera l’enjeu du chapitre 1. Ensuite, dans le chapitre 2, nous essaierons de contextualiser la mobilisation dans un cadre plus large, en montrant pourquoi « le long mars français », si on veut le définir ainsi en détournant une belle formulation de Giovanni Arrighi[1], est tel car il puise ses racines dans une histoire récente qui le précède et qui le dépasse. En particulier, pour ce qui est de la France, nous croyons que deux phénomènes ont joué un rôle véritablement crucial dans ce qui a devancé les protestations contre la Loi Travail : les revendications syndicales de l’automne 2015, et la chape qui a étouffé l’espace public national – et parisien notamment – après les attaques de janvier et de novembre.
D’un côté, il nous semble que les quatre manifestations qui ont cadencé la phase expansive du mois de mars ont fourni une forme collective et presque-unitaire aux conflits sectoriels de Goodyear, de Continental, d’Air France, etc., en donnant lieu à une sorte de climax ascendant culminant avec la journée du 31 mars – journée qui a vu descendre sur les places un million et demi de personnes (dont un million à Paris) et qui a ensuite inauguré les Nuits debout. À ce propos, l’enthousiasme avec lequel la pétition contre la proposition de Loi El Khomri a été souscrite entre fin février et début mars constitue un moment de jonction emblématique. De l’autre, ce qui a été vraiment remarquable avec Nuit debout, c’est la transformation qu’elle a imprimé au débat et à l’espace public français. Jacques Rancière l’a souligné lucidement[2] : Place de la République est passée de lieu de la souffrance et du deuil collectifs, d’une jeunesse blessée et impuissante, à espace de discussion et d’action politique, à point de condensation sociogéographique d’une subjectivation politique qui vise à remettre en cause non seulement la Loi Travail, mais des pans entiers du présent (bien que cette sensation d’excédent ait déjà été bien présente lors des Assemblées Générales interluttes et interprofessionnelles qui ont constellé le mois de mars). Il nous semble que, là aussi, le collectif #OnVautMieuxQueCa et son site http://www.onvautmieux.fr/, devenu viral vers la moitié de février, ont représenté une sorte de pont, dans la mesure où, en lien avec la montée de la contestation dans les lieux de travail, ils ont impulsé le passage d’une narration des expériences vécues axées autour de la douleur pour les victimes, du chagrin et de la peur du terrorisme vers le récit des discriminations quotidiennes concernant les abus et les mauvais traitements sur les postes de travail, les injonctions extracontractuelles, les horaires excessifs, les vexations, les salaires ridicules, les discriminations racistes et sexistes, etc., en promouvant cette prise de parole, si répandue à Nuit debout, qui a produit une volonté d’action commune.
Cette double petite considération montre que l’effervescence printanière n’a pas surgi de nulle part : beaucoup d’éléments, en effet, – qui ne configuraient certes pas une trame, mais qui ont sans doute préparé l’atmosphère – étaient déjà-là. Le film même de Ruffin, Merci patron !, qui a catalysé les débats pour un certain temps, a commencé à être projeté vers la mi-février. Ce documentaire, celui de Françoise Davisse, Comme des lions, les luttes syndicales et les vidéos de #OnVautMieuxQueCa représentent autant d’épisodes de revanche (que l’on se souvienne de l’ébranlement de la chemise du DRH d’Air France !), chacun paradigmatique à sa manière, qui ont su injecter un désir de révolte capable d’éloigner le sentiment d’impuissance qui dominait largement durant 2015 en France.
Rappeler ces facteurs de continuité (pour ce qui est du monde du travail) et cette évolution de la Place et du sentiment citoyen (de l’étouffante unité nationale de l’après Charlie Hebdo et du relatif bon accueil réservé à l’état d’urgence, à la désillusion à l’égard du système politique en vigueur) n’est pas innocent. La montée de la conflictualité syndicale et la politisation d’une partie de la citoyenneté connotent la mobilisation française, en mettant en lumière la forte action réciproque qui a subsisté entre luttes salariales et remise en cause plus générale de l’existant ; entre critique de l’exploitation et critique de la domination ; entre, au fond, critique du capital et critique de l’État, sous sa double veste de critique de la représentation et de critique des violences policières – devenue toujours plus centrale celle-ci au fur et à mesure que la répression s’aiguisait.
C’est cette action réciproque, justement, qui a constitué le véritable fil rouge de la contestation contre la Loi Travail et son monde. Elle était à l’œuvre entre le caractère de masse et de plus en plus résolu des manifestations et l’occupation – symbolique ou moins – des places (à Paris, par exemple, l’on a presque toujours cherché un accord avec la préfecture). À notre avis, les manifestations ont représenté une des conditions politiques décisives de la durée et de la reproduction de Nuit debout, tandis que Nuit debout s’est configurée comme une des principales conditions matérielles de la reprise des manifestations (surtout à Paris, où il y a une flagrante pénurie d’espaces sociaux partagés). Nuit debout, donc, comme lieu social et géographique vers lequel canaliser les énergies afin de continuer à se rencontrer, à débattre, à se confronter, à s’organiser et à lancer des initiatives ultérieures : des actions de solidarité matérielle contre les expulsions de logement, des actions de destruction des cages qui empêchent la construction des campements des migrants, des actions de soutien aux occupations des théâtres effectuées par les intermittents et les précaires, des actions d’entrave et de dérangement des meetings des politiciens, des actions de blocage de la logistique, des lieux de production, de consommation, etc. Mais cette action réciproque nous l’avons vue opérer aussi pour ce qui relève du rapport 1) entre cortège de tête et base syndicale et 2) entre base syndicale et centrales dirigeantes. D’un côté, plus le cortège de tête se montrait combatif et plus la base syndicale le rejoignait ; mais plus la base syndicale participait au cortège de tête et plus celui-ci se renforçait et acquérait du courage. De l’autre, plus la base syndicale ressortait aguerrie et plus les sommets du syndicat relançaient la mobilisation ; mais plus les sommets du syndicat soutenaient les grèves et les blocages, et plus la base syndicale devenait réfractaire à tout type de compromis, en dépassant – lors des manifs – les services d’ordre érigés par les sommets pour s’installer dans le cortège de tête. Malgré les différences de composition sociale et de perspectives politiques, et en dépit de la pluralité des pratiques en présence, entre le 9 mars et le 14 juin nous avons assisté à une montée en puissance commune des sujets impliqués dans la lutte issue de cette action réciproque entre, au final, « autonomie » et « organisation ».
Or, la constatation du fait que non seulement cette cohabitation de sensibilités et d’orientations normalement inconciliables n’ait existé vertueusement que pour un court battement de cil, mais, surtout, le fait qu’elle n’ait pas réussi à arracher quoi que ce soit au gouvernement et au Medef devra faire l’objet d’un bilan social et politique à la fois réaliste et douloureux – bilan qui va bien au-delà des taches de ce petit pamphlet. Ce que nous essayerons de faire ici consiste tout d’abord dans l’ébauche de quelques éléments de réflexion qui puissent aider à l’élaboration, forcément collective, d’un tel bilan socio-politique. À présent, ce que nous voudrions articuler c’est tout simplement une modeste tentative de lecture de la tendance afin d’anticiper la prochaine phase, comme les classes dominantes ont su le faire à leur manière à elles depuis longtemps. Si après Lénine, ce fut le moment de Keynes, et si après Mai 68 ce fut le moment de Thatcher&Co., cette fois-ci c’est à nous de renverser le problème, d’en changer le signe, et de repartir du commencement ; et le commencement c’est : la mobilisation contre la Loi Travail et son monde !
[1] Cf. G. Arrighi, The Long Twentieth Century, Verso, Londres et New York, 1994
[2] Cf., https://forum.nuitdeboutlyon.fr/t/entretien-jaques-ranciere-surnuit-debout/1200.