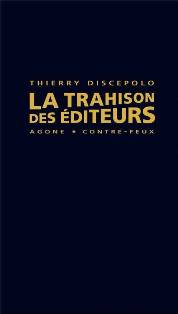
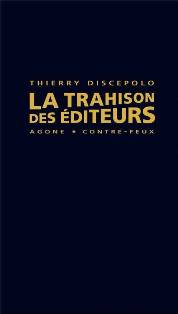
A propos de La Trahison des éditeurs, Thierry Discepolo, coll. Contre-feux, Agone, 2011, 208 pages, 15 euros.
Qu’y a-t-il de commun entre la grande distribution, promettant plaisir et bonheur aux millions de consommateurs que nous sommes, et les maisons d’édition, grandes ou petites, qui assurent la publication des ouvrages rangés sur les étagères de nos bibliothèques ? A priori, rien. Le monde de l’édition bénéficie de l’aura presque sacrée qui entoure le livre, considéré comme le vecteur par excellence de la culture. Mais derrière cette légende dorée se cache une autre réalité, faite de fusions/acquisitions, de mensonges et parfois de bénéfices faramineux. La charge de Thierry Discepolo contre le monde éditorial est vigoureuse, bien informée et met le doigt là où ça fait mal. Bien sûr, l’on peut considérer que l’auteur ne fait ni plus ni moins que défendre son beefsteack, sa propre structure, Agone, et partant, ses propres parts de marché. C’est sans doute pour cette raison qu’il a pris la précaution de faire figurer cette citation de Bourdieu en exergue : « Ce n’est pas parce qu’on a une raison objective de découvrir une vérité que cette vérité n’existe pas ». Sage précaution, car l’argumentation ne fait pas dans la dentelle, et tout le monde ou presque en prend pour son grade.
Le livre : une marchandise comme une autre ?
Les dernières années ont vu un certaines nombres d’opérations de concentration capitalistique dans le monde de l’édition. Alors que de telles manoeuvres dans le domaine des médias conduisent à la dénonciation de la concentration de l’information dans les mains d’un petit groupe de patrons, les entreprises d’édition bénéficient généralement d’un traitement de faveur, pour ne pas parler d’une forme d’aveuglement collectif. L’auteur a raison de souligner le fossé qui sépare par exemple la réception très favorable des thèses d’André Schiffrin, sur les conséquences des concentrations dans le secteur éditorial et la réalité quotidienne. Il passe en revue la situation des principales maisons d’édition et leurs liens avec des structures financières plus ou moins grosses : « Hachette – Lagardère », « La Martinière – Chanel »… Il montre très bien également, citations à l’appui, la pénétration de plus en plus importante de la novlangue néolibérale dans des milieux que l’on pouvait penser plus à même de lui résister : « Chez Actes Sud, explique Françoise Nyssen, on “ bannit le terme « groupe », lui préférant « ensemble ». Pas de « filiales » mais des « maisons associées », aucun « rachat d’entreprises » mais des « rencontres » ». […] Françoise Nyssen expose “ce style nouveau dans le monde de l’édition” : “Nous sommes attentifs à utiliser un autre vocabulaire. Nous réfléchissons au concept d’ »entreprise humaine ». Il existe d’autres voies que celle de l’économie classique”. » (p. 79). Discepolo a donc parfaitement raison de dénoncer les discours qui se sont généralisés chez les éditeurs sur les économies d’échelle, les facilités de gestion, la soi-disant indépendance que garantirait l’appartenance à un grand groupe : « Ce qui est une loi du genre partout où règne le pouvoir du capital ne s’appliquerait pas ici ? » (p. 29). Il est probable que la réponse soit dans la question. Deux annexes bien faites permettent de se repérer facilement dans l’historique des groupes d’éditions et dans leur composition actuelle. Des graphiques permettront également au lecteur de mieux visualiser la répartition du prix d’un ouvrage, ainsi que les circulations de flux entre les différents composants de la chaîne éditoriale : éditeur, diffuseur, distributeur, libraire, imprimeur…
Rentabilité à tous les étages !
Les évolutions décrites par Discepolo ne concernent pas le seul monde de l’édition, mais touchent toutes les entreprises du secteur. Les éléments avancés sur les méthodes d’Amazon par exemple sont très inquiétants concernant l’avenir de la librairie indépendante en France. Cette entreprise, dont l’ambition est de faire basculer l’ensemble de l’édition sur internet, impose des marges exorbitantes aux éditeurs sans effectuer le moindre travail équivalent à celui d’un libraire. Ce marketing agressif était celui de la Fnac dans les années 1970, qui a conduit à la mise en place du prix unique du livre, contre lequel peste aujourd’hui un humaniste comme Michel-Edouard Leclerc (p. 40). Et le comparatif avec la situation de la librairie en Angleterre, où le marché a été libéralisé, n’est pas fait pour rassurer ! Par ailleurs, les quelques éléments chiffrés avancés dans l’argumentation semblent démontrer le rôle irremplaçable de la librairie indépendante dans la découverte, la curiosité et donc dans les possibilités de diffusion de nouveaux ouvrages, là où la grande distribution n’a pour seul rôle que d’accentuer les tendances tout en les uniformisant.
Ayant travaillé plusieurs année en librairie à la Fnac, j’avais été frappé par l’évolution d’un distributeur qui se plaisait à mettre systématiquement en avant son identité d’ « agitateur ». A force de s’agiter, il en est rendu aujourd’hui à élargir son offre en vendant des poêles à frire et des machines à café. Lorsque sous l’impulsion de Denis Olivennes, la Fnac a mis en place de grandes réorganisations, les syndicats de l’enseigne dénonçaient déjà une logique de rentabilisation qui détruisait les métiers pour ne conserver qu’un seul principe : le profit à tout prix. La question de l’objet vendu, et donc du métier qui va avec, passait complètement à la trappe, permettant de transformer en passant des salariés avec une forte identité professionnelle, des libraires par exemple, en opérateurs interchangeables, grâce aux systèmes de gestion informatique. Mais les avertissements des syndicalistes n’ont pas été pris au sérieux. L’idée de vendre des poêles à frire à côté des derniers volumes de la Pléiade faisait sourire : à la Fnac, jamais ! Les directeurs, la main sur le cœur, juraient leur grands dieux que tous ces plans n’avaient qu’un seul objectif : préserver notre métier de libraire ou de disquaire. La centralisation informatique, l’obligation de positionner tel titre à tel endroit, la pression à la vente des best-sellers, le déstockage ? Il ne s’agissait soi-disant que de simples mesures d’économies, visant à garantir la survie de l’entreprise. On voit où conduit une telle logique1. Au rythme où vont les choses, la Fnac se lancera l’année prochaine dans les motoculteurs et le matériel de jardinage !
Et du côté de l’anticapitalisme ?
Au cours de la décennie écoulée, les publications critiques (pour prendre un terme large) ont connu un nouveau dynamisme. Les maisons d’édition se sont multipliées, comme les revues, et les grandes maisons ont-elles aussi créé des collections ad hoc. Lorsque cette situation est évoquée, c’est bien souvent pour s’en réjouir. Voire… Car les choses pourraient être moins favorables qu’il n’y paraît. Passons sur le pedigree d’un Joseph E. Stiglitz, dont on vante tellement les livres aujourd’hui (p. 118). L’engagement est peu coûteux à l’âge de la retraite, une fois parvenu au dernier barreau de l’échelle. Ce qui interpelle à juste titre, ce sont ces ouvrages de critique du capitalisme, comme ceux de Susan George, publiés chez… Hachette/Lagardère. Ou encore l’injonction d’Hervé Kempf, Pour sauvez la planète, sortez du capitalisme : « On lui demande, puisqu’il en appelle, sabre au clair, à sortir du capitalisme, pourquoi il n’a pas choisi un éditeur indépendant ? Hervé Kempf n’aime pas beaucoup la question » (p. 91). N’est-ce pas faire des idées anticapitalistes des marchandises comme les autres, éditées tant qu’elles sont profitables ? L’exemple des livres d’Attac, publiés un temps par Hachette/Lagardère, est éloquent (p. 100). Et Discepolo démonte de façon convaincante l’argument de la diffusion, qui justifie le recours à de grands groupes par le fait qu’il faudrait permettre aux ouvrages d’être présents dans le maximum de lieux. Pour certains éditeurs, l’expérience de la grande distribution s’est révélée douloureuse, comme ce fut le cas pour José Corti. Suite à des commandes générées automatiquement par informatique, l’éditeur dut fournir des centaines d’exemplaires à la grande distribution, dont l’écrasante majorité, invendue et abîmée, a fini au pilon (p. 35).
Il interpelle également intellectuels et militants se réclamant de l’anticapitalisme : est-il raisonnable de publier des ouvrages se donnant comme perspective la transformation de la société capitaliste chez des éditeurs appartenant à des multinationales du secteur ? Les exemples précédents font sans doute assez facilement accord. Mais à partir du moment où nous sommes directement concernés, là, les choses se corsent. Car non seulement Discepolo met directement les pieds dans le plat, mais il n’a pas vraiment pris le temps de les essuyer sur le paillasson. Petit florilège : « Suivant une ligne politique moins rectiligne, Textuel commence comme « éditeur de presse pour les entreprises ». Propriété du groupe de marketing et publicité BDDP France, spécialisé dans les consumers magazines – Fnac (Epok), France TGV, EDF, Michelin, Leclerc, Novotel, etc. -, dont la mission est, selon le PDG Gilles About, d’ « aider les gens à mieux consommer ». Inévitablement, le catalogue du pôle livre de Textuel comprend le « philosophe de la vitesse » Paul Virilio. On ne voit rien qui interdise d’ajouter François Dubet et Julia Kristeva au bestiaire. Mais on ne voit pas du tout avec la collection « La Discorde », lancée en 1999 par le philosophe et militant trotskiste Daniel Bensaïd, où sont parus des titres aussi peu stimulateurs de consommation que Les Irréductibles. Théorèmes de résistance à l’air du temps. » (p. 86) ; « Muni d’une loupe, on peut découvrir, dans les livres de Zones, au bas de la page des copyrights, celui d’un autre éditeur : La Découverte. Bon, Zones ne serait pas un éditeur mais une marque ? Un peu comme Franprix pour Casino ? » (p. 107) ?
« Enrichir d’une manière ou d’une autre un fonds de pension ou une multinationale de la communication avec la vente de livres contestataires serait-il une contradiction majeure ? » (p. 108). On peut reprocher à Thierry Discepolo son ton provocateur et un brin de mauvaise foi, mais on ne peut lui reprocher qu’il sait viser juste. N’y a-t-il pas un paradoxe effectivement à publier par exemple, un recueil de textes concernant le mouvement des Indignés, chez Zones2, qui en définitive est une filiale d’une multinationale de l’information, le groupe Planeta ? Si l’on considère que le mouvement des Indignés s’oppose également au système des médias, centralement détenus par de grands groupes, se préoccupant principalement de défendre et légitimer ce système d’oppression et d’exploitation, la question est somme toute assez légitime. Il n’y a sans doute pas de solution immédiate, mais à plus ou moins long terme, le débat est inévitable.
Quelles alternatives ?
L’auteur met en avant quelques exemples de structures qui sont parvenues à résister au rouleau compresseur de la concentration, comme Le Dilettante (éditeur d’Anna Gavalda) ou encore Cheyne, éditeur du désormais célèbre Matin Brun, courte nouvelle de Franck Pavloff. Il relate également la fronde organisée pour de nombreux auteurs lors du rachat du Serpent à plumes (p. 87). Mais il ne s’agit que de quelques exemples épars. Si faiblesse de l’ouvrage il y a – le texte étant avant tout un réquisitoire – c’est en terme de perspectives. Comment parvenir à reprendre la main, collectivement, face aux logiques de concentration à l’œuvre ? Chaque élément de résistance, chaque structure collective, chaque coopérative qui parvient à exister est une bonne nouvelle. Dans cette situation, les initiatives individuelles ou de petites équipes sont importantes. Est-il envisageable cependant d’aller plus loin, en collectivisant un certain nombre de moyens ? Et quid de l’imprimerie – qui est un maillon non moins essentiel de la chaîne éditorial, n’en déplaise aux tenants du tout numérique ? (Soit dit en passant, le bouquin de Discepolo est imprimé par une Scop).
Car les enjeux auxquels nous allons devoir faire face sont considérables. Le dynamisme actuel de l’édition comme des revues se réclamant de la gauche radicale ne doit pas cacher l’ampleur des difficultés sur le terrain, en particulier dans les milieux populaires. Au cours des deux dernières décennies, bien des bibliothèques ouvrières ont été liquidées, par la fermeture de sites, bien entendu, mais pas seulement. Marcel Durand, après avoir fait le récit de la disparition de la bibliothèque de Peugeot Sochaux, termine par ces mots : « Il faudrait placer une stèle à l’endroit originel de la bibliothèque. Et surtout y graver cette épitaphe : “Un ouvrier qui lit est dangereux.” »3. Ce n’est pour rien que les plus éminentes figures du mouvement ouvrier ont toujours mis l’accent sur l’importance de l’étude et de la lecture : Fernand Pelloutier, Emile Pouget, Pierre Monatte ou encore Marcel Martinet. Et le fronton de la Librairie du Travail, qui avait pris la succession de la petite échoppe liée à la revue La Vie Ouvrière, affichait fièrement cette maxime : « La vie invente, le livre précise ». Une position que nous faisons nôtre aujourd’hui, sans restriction.
références
| ⇧1 | Un témoignage complémentaire concernant cette logique d’entreprise est cité dans le dossier du n° 55 de Fakir, mai à juillet 2012, p. 24. |
|---|---|
| ⇧2 | #indignés ! D’Athènes à Wall street, échos d’une insurrection, Zones, 2012. |
| ⇧3 | Marcel Durand, Grain de sable sous le capot, Agone, 2006, p. 357-358. |