
Yves Sintomer est professeur de science politique à l’université Paris 8 ; outre ses travaux sur la sociologie allemande, ses recherches portent sur les théories de la démocratie et sur les expériences de démocratie participative et délibérative à l’échelle locale, ainsi que sur la représentation politique. Il revient dans cet entretien pour Contretemps sur les enjeux démocratiques à partir d’une réflexion sur les institutions et les limites des systèmes démocratiques aujourd’hui en exercice.

La réponse ne peut être que nuancée. Pour les budgets participatifs, il y a d’énormes différences en fonction des expériences.
Prenez le budget participatif parisien : il draine tout de même des sommes non négligeables qui, comparées au budget total de la ville, sont certes modestes mais qui, comparées à ce qu’on peut faire à l’échelle d’un quartier ou d’un projet demandé par des associations, représentent quelque chose qui permet de réelles actions. D’autant plus que l’on sait que les collectivités territoriales — tout comme l’État — sont contraintes sur une part très importante de leurs dépenses. Sur ce qui est possible d’engager à l’échelle locale, c’est donc significatif.
En même temps, les grandes orientations sont rarement discutées dans ce cadre-là. Prenons l’exemple de la Ville de Paris — qui est sans doute en France l’un des exemples les plus sérieux de budget participatif aujourd’hui —, elle expérimente des choses scrupuleusement mais elle ne soumet pas à référendum les grands projets structurants tels que la municipalisation du service des eaux, la construction de tours au-delà des plafonds légaux auparavant établis ou la fermeture des voies sur berges. On est dans un entre-deux dans lequel on donne du pouvoir d’un côté mais on en conserve beaucoup sur des projets structurants de l’autre.
Pour ce qui concerne des responsables politiques actuels, et en particulier ceux qui sont candidats à l’élection présidentielle, on est dans des jeux d’un autre d’ordre : il ne s’agit pas de politiques publiques menées réellement mais d’images, de campagnes et de promesses électorales qui n’engagent que ceux qui les croient. Il faudra juger sur pièce ensuite dans quelle mesure elles sont mises en avant et sous quelles formes.

La réponse n’est pas la même pour les femmes et les classes sociales.
Presque partout en Europe, les femmes participent davantage que les hommes, non seulement dans les budgets participatifs mais aussi dans beaucoup de démarches de proximité. On peut faire l’hypothèse que cet échelon public de proximité est vécu comme dans une relation de continuité avec l’espace considéré comme domestique, qui s’oppose à un espace plus lointain qui est celui de la politique professionnelle, encore largement dominée par les hommes. Du coup, il n’est pas sûr que cet appui sur le local entraîne ensuite mécaniquement un renforcement de la participation des femmes à la politique professionnelle élective. Dans les représentations, il ne s’agit pas du même espace. C’est sans doute l’un des facteurs qui peut y contribuer, mais il ne saurait être le seul.
Pour les classes sociales, la réponse est encore plus nuancée. D’un côté, on a une inégalité sociale qui est nettement moins prononcée dans les démarches participatives que dans la politique institutionnelle. Aujourd’hui, il n’y a quasiment plus d’ouvriers ou d’employés au Parlement – 2%, c’est ridicule. Cela est moins caricatural dans les démarches participatives, et notamment les budgets participatifs mais en général, la participation des classes populaires n’y reflète cependant pas leur poids dans la population. Les classes moyennes et surtout les fractions supérieures participent d’avantage.
C’est vrai que de ce point de vue-là, le contraste est très frappant entre l’écrasante majorité des dispositifs participatifs européens — notamment français — et leurs homologues latino-américains. En Amérique latine, la participation « non conventionnelle », les nouveaux espaces de participation, sont d’abord des instruments des pauvres, de ceux qui sont en règle générale complètement exclus du système politique officiel et qui ne bénéficient qu’à la marge des politiques publics (et même si les choses ont un peu évolué avec les gouvernements de gauche des 15 ou 20 dernières années, ces expériences gouvernementales atteignent des limites évidentes). Cet espace est investi par les pauvres, et ce pour deux raisons. D’une part parce que l’un des objectifs officiellement proclamé est d’inverser les priorités sociales. Il est traduisible en actes parce que dans les budgets participatifs, il y a une sorte d’action affirmative en faveur des plus démunis qui est incorporée dans les règles du jeu. Quand on est dans un quartier populaire et que l’on demande quelque chose, on va recevoir plus que si on est dans un quartier de classes moyennes. Du coup, c’est incitatif car les gens s’aperçoivent que cela se traduit par des résultats réels, et les classes populaires se saisissent de ces dispositifs. Or, en Europe, dans l’écrasante majorité des cas, la participation n’amène pas grand-chose de plus sur le plan social. Quelquefois, elle apporte un petit peu mais par rapport à une politique classique de la ville, les chiffres sont très faibles. Cela ne sert pas à ça.
Est-ce que cela pourrait changer ? Sans doute, mais ce n’est pas facile. D’abord parce que s’est malheureusement affaiblie une tradition de mobilisation des classes populaires qui étaient organisées à travers les syndicats, les partis, les associations locales. Elle n’a pas disparu complètement mais elle s’est très largement effritée. Le tissu associatif dans les quartiers difficiles n’est pas en très bon état : on a du mal à y trouver des associations qui pèsent, qui restent dans la durée, qui marquent le paysage politique d’un côté et des politiques publiques suivies par les municipalités de l’autre.
Comment faire ? Un rapport a été proposé par l’universitaire Marie-Hélène Bacqué et le dirigeant d’ACLEFEU Mohamed Mechmache qui, à la tête d’une commission composée d’associatifs, d’universitaires, d’élus et de journalistes, proposait une stratégie d’empowerment des couches populaires de ces zones[1]. Il s’agissait d’aider celles-ci à s’organiser pour peser et agir indépendamment de l’autorité politique locale. Ce rapport a été ignoré pour l’essentiel et s’est seulement traduit par la mise en place de conseils citoyens, dont la qualité est extrêmement contrastée. Dans les pays anglo-saxons, en Amérique latine, dans le Sud global, cette stratégie d’empowerment compte de façon non négligeable dans la mobilisation des couches populaires. Ce qui pourrait jouer aussi, mais c’est de l’ordre institutionnel, ce serait que ces dispositifs soient conçus eux-mêmes pour servir à de la redistribution, comme en Amérique latine. Et ce n’est généralement pas le cas ou alors seulement à la marge.
Vous y allez peut-être un peu fort ! Pas de société civile indépendamment de l’État en France, je trouve que c’est exagéré. Mais il est vrai qu’il y a en France, plus qu’ailleurs, une tradition d’activité ou d’organisation qui dépend des financements étatiques ou en tout cas des financements de l’échelon politique institutionnel auquel correspond l’association ou la mobilisation. Nous n’avons guère réussi jusque-là à faire ce que faisaient auparavant les syndicats dans le cadre du lieu de travail et ce que font les organisations de développement communautaires — dans le sens de communauté locale parfois ethnique — dans le monde Anglo-saxon ou les pays du Sud Global. Il y a eu les communautés ecclésiastiques de base au Brésil et dans beaucoup de pays d’Amérique latine, mais jamais en France – ou maintenant, elles sont présentes sous une forme réactionnaire à travers « la manif pour tous ». Et c’est aussi quelque part une société civile organisée en dehors de l’État. Effectivement, en France, le paternalisme d’État pèse globalement de façon forte sur le monde associatif.
C’est vrai qu’il y a des choses qui nous frappent. L’argument se retrouve aussi dans des textes grecs anciens. Évidemment, les contextes sont totalement différents mais en même temps, cette capacité des élites à dire qu’elles sont meilleures que le bas peuple, que les petits, que les sans-grades, que les sans-voix, est saisissante. Il y a un peu d’amertume à penser que des choses qui pouvaient se dire dans la Florence de la fin du XVe siècle peuvent se dire aujourd’hui d’une façon presque similaire. Il est vrai qu’une telle phrase pourrait se retrouver dans des bouches d’aujourd’hui. D’un autre côté, il ne s’est pas rien passé. À l’époque, même ceux qui protestaient contre les élites, faisaient partie d’un cercle de citoyenneté relativement restreint par rapport à l’ensemble des habitants d’une cité : les femmes n’en faisaient pas partie, ni la majorité des travailleurs manuels. Il ne faut pas exagérer, des progrès ont été faits.
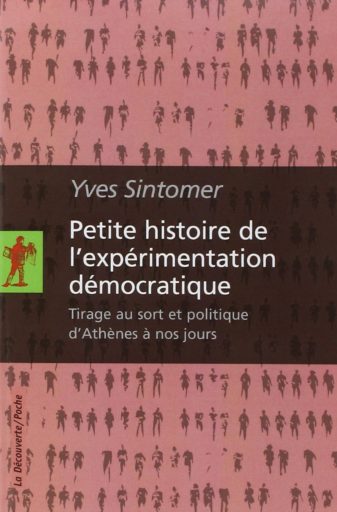
Il faut aussi prendre en compte le fait que les classes dominantes, les élites, ne sont pas toujours faites du même bois. Il faut distinguer les élites dominantes qui « se servent » de leur position mais qui, en même temps, ont une vue pour développer leur pays ou leur communauté politique, et d’autres qui sont simplement prébendières et qui se servent le plus et le plus vite possible avant de laisser la place à d’autres qui feront la même chose. Ce n’est d’ailleurs pas une affaire de régimes officiellement démocratiques ou officiellement autoritaires, où il y aurait d’un côté des bonnes classes dirigeantes se préoccupant aussi du bien commun, et de l’autre une élite simplement prébendière. En Chine, par exemple, vous avez une classe dirigeante qui se sert largement — il n’y a aucun doute là-dessus — mais qui, en même temps, entend développer vraiment le pays, pour X et Y raisons, alors que dans bien des pays démocratiques, ce n’est pas forcément le cas. Aujourd’hui notre classe politique est particulièrement non pas corrompue au sens de l’argent qu’elle se mettrait directement dans les poches, mais particulièrement obnubilée par des intérêts de carrière et des intérêts entre amis, en reléguant bien en arrière le développement à long terme du pays.
Évidemment, c’est une question de définition. Quand je dis cela, ce n’est pas pour faire de l’étalage d’érudition. C’est plutôt pour dire que la démocratie — comme beaucoup d’autres mots, pensez à justice, à égalité, à liberté, à fraternité— fait partie de ces concepts essentiellement contestés pour lesquels on ne peut pas se mettre d’accord et pour lesquels on note une controverse permanente — et c’est bien qu’il en soit ainsi ! — sur la définition, sur la finalité, sur les interprétations. Toute définition que l’on donne n’est pas la vérité sur ce qu’est la démocratie dans son essence mais plutôt une prise de partie sur la façon dont on l’entend. Evidemment, il y a des utilisations qui sont totalement rhétoriques et idéologiques et il y en a d’autres qui sont plus cohérentes. Mais même en se restreignant à ces dernières, plusieurs perspectives contradictoires peuvent être défendues.
Alors, la démocratie qu’est-ce que c’est ? Quelle définition peut-on essayer de proposer ? Prenons parti justement. La version libérale dit que la démocratie, ce sont les élections libres et l’Etat de droit. Si la démocratie n’est que cela, nous vivons dans des démocraties pleines et entières. Mais il s’agit d’une vision minimaliste qui n’était pas du tout celle des pères fondateurs des régimes représentatifs modernes, qui pensaient qu’ils instauraient des régimes représentatifs mais pas des démocraties. Ils opposaient ces régimes à ceux de l’Athènes classique ou de l’Italie médiévale et renaissante.
Une seconde définition serait étymologique. Comme disaient les grecs : « la démocratie, c’est le pouvoir du grand nombre ». Le grand nombre aujourd’hui… on ne peut pas dire que l’on soit dans un pays où le grand nombre décide réellement des choses. Le grand nombre élit un petit nombre qui bénéficie du pouvoir réel de décision. Et encore, ce petit nombre décide-t-il en fonction de la communication électorale avec le peuple ou en lien avec des acteurs privés tels les marchés, les lobbies des grandes entreprises transnationales, ou encore en délégant sans guère de contrôle à des organisations technocratiques ? On peut se poser la question !
Une autre définition de la démocratie, la plus connue à l’échelle internationale, est celle d’Abraham Lincoln au moment de la guerre civile américaine : « Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Elle a été reprise dans notre constitution. Là, il n’y a pas de doute, nous ne vivons pas dans une démocratie. Il y a des éléments démocratiques dans notre système et notre vie politique — il n’y a pas de doute non plus — mais on ne peut pas dire que nous correspondons, même de loin, à l’idéal de cette démocratie.

Tout d’abord, cela ne peut pas sortir tout droit de la tête d’intellectuels ou de responsables politiques. Une démocratisation, c’est un mouvement réel qui transforme en profondeur l’ordre des choses existant, pour paraphraser Marx, qui fait surgir des inventions et de nouveaux imaginaires dans lesquels sont repris des éléments plus techniques, travaillés de façon conceptuelle et abstraite, juridique ou philosophique… Il n’y a pas un modèle qui serait là et qu’il n’y aurait qu’à implanter par en haut avec un législateur à la Rousseau qui, d’un seul coup, permettrait la mise en place d’une constitution et d’une société idéales. Cependant, cela n’empêche pas d’y penser à l’avance, de réfléchir sur les expériences qui se font réellement, présentes et passées, et d’imaginer, à partir de là les voies les plus intéressantes pour développer la démocratie. Il faut en sus garder en tête qu’il n’y a jamais un seul modèle et que des choses différentes se jouent en fonction des cultures et des traditions locales. Prenons un exemple : si l’on disait à des citoyens français lambda, « Vous avez une feuille blanche, vous rédigez la constitution idéale.», est-ce qu’ils mettraient les partis de professionnels tels qu’on les a aujourd’hui dans cette dernière ? Il y a peu de chance ! Et en même temps, aujourd’hui, les partis politiques sont là, on est bien obligé de faire avec. Il est possible de diminuer leur rôle, de les déprofessionnaliser en partie, mais de là à les abolir complètement… Si on le faisait, on risquerait fort d’aller dans des directions peu démocratiques. Prenez de l’autre côté les chinois, posez-leur la même question, est-ce qu’ils mettraient un parti unique ? Il est également peu probable qu’il y ait une majorité pour cette option ! Et pourtant, ils ont à faire avec un parti unique et donc beaucoup essayent de penser la démocratisation dans un tel contexte alors que nous la pensons sur la base d’une tradition de partis de professionnels en compétition électorale pour le pouvoir.
Une première réponse, fondamentale, est de dire qu’il ne faut pas réduire la démocratie aux élections, qu’il faut au contraire la pluraliser. De facto, aujourd’hui, la gouvernance réelle inclut les élus mais aussi beaucoup d’autres acteurs qui ne sont pour la plupart pas démocratiques : des grandes entreprises, des lobbies, des corps technocratiques, des organisations internationales, des agences de notation. Or, il faut imposer le pouvoir citoyen à l’intérieur de ce réseau de gouvernance.
Comment ? D’une part grâce à des mécanismes institutionnels. Il faut plus de démocratie directe ! Après tout, l’exemple suisse n’est pas très loin. C’est un pays qui va bien. Parfois, le peuple se trompe sans doute, mais plus souvent encore, les élites se trompent aussi. La satisfaction des citoyens suisses à l’égard de leur régime politique est relativement exemplaire pour l’Europe. C’est le seul pays où les gens répondent en majorité qu’ils en sont satisfaits. Et cela ne s’explique pas seulement par la richesse due à l’argent des banques. Entrent en compte le fédéralisme, une moindre professionnalisation de la politique, mais aussi la démocratie directe, avec le pouvoir pour les citoyens de lancer des processus de référendums d’initiative populaire qui viennent du bas et pas simplement de se prononcer à l’occasion de processus qui viennent par en haut, lorsqu’un dirigeant veut se faire plébisciter à travers un référendum comme dans d’autres traditions, dont la française. Or, il y une tendance marquée au développement de la démocratie directe à l’échelle internationale. La France est de ce point de vue très en retard.
Deuxièmement, il s’agit de développer des dispositifs participatifs qui concernent moins des grandes décisions que le fonctionnement au quotidien des administrations et des services publics. Là encore, on constate une tendance non négligeable, à l’échelle internationale, à la multiplication de ces dispositifs. Cependant, leurs ambitions, leur fonctionnement et leurs effets très contrastés. Souvent, il s’agit de faire participer sur des détails pour faire oublier les choses importantes.
Une troisième voie consiste à réutiliser le tirage au sort à côté de l’élection. Cette procédure avait été dans l’histoire démocratique républicaine occidentale l’un des moyens les plus importants pour désigner des responsables de charges publiques. Au-delà des expériences de niches actuelles, il y aurait intérêt à l’utiliser de nouveau et de façon beaucoup plus massive qu’aujourd’hui. Tout d’abord pour ses effets démocratiques : si on tire au sort, on établit une égalité radicale entre les citoyens concernés. Ensuite pour ses effets d’élargissement du cercle de la décision au-delà du cercle de professionnels de la politique issus d’un tout petit cercle social : un mini-public tiré au sort constitue un échantillon représentatif ou au moins diversifié du peuple dans son ensemble, il permet une prise en compte beaucoup plus complète des expériences sociales lorsqu’il s’agit de discuter et de décider sur des questions d’intérêt général. Enfin, le tirage au sort a des vertus d’impartialité : on a aujourd’hui beaucoup trop de gens qui sont en politique pour faire carrière, pour leurs intérêts personnels et de parti et dont la compétition n’a pas grand-chose à voir avec l’intérêt général ou le bien public. Le tirage au sort, en introduisant un élément d’incertitude et des non-professionnels, réduit cette compétition pour le pouvoir.
Enfin, il faut développer des stratégies d’empowerment qui permettent à ceux qui dans la société normale pèsent moins parce qu’ils n’ont pas le pouvoir, parce qu’ils n’ont pas l’argent, parce qu’ils n’ont pas les capitaux culturels… de s’organiser pour peser davantage, d’avoir à la fois plus de pouvoir personnel sur leur propre vie et de pouvoir collectif pour s’organiser et pour transformer les structures sociales. C’est ce qu’a fait le mouvement ouvrier durant des décennies, et cela a permis des acquis sociaux considérables. Il faut reproduire cela à une autre échelle aujourd’hui. C’est seulement en allant dans cette direction que les mouvements de masse qui se sont soulevés contre l’hégémonie du capitalisme financier pourront par exemple peser durablement et permettre l’affirmation d’un projet contre-hégémonique.
Tout cela est bien sûr plus facile à dire qu’à faire…
Le constat est impressionnant : les cinquante plus grands partis européens ont dû perdre environ la moitié de leurs adhérents en l’espace de 20 ou 30 ans, et plus encore d’adhérents actifs et d’audience dans la société. Avec leurs limites, pour le meilleur et pour le pire, ces partis faisaient fonctionner le système politique, ils contribuaient puissamment à l’organisation de la société, à la communication entre citoyens et décideurs et à l’articulation des différentes demandes sociales. Or, aucun parti politique nouveau en Europe ne s’est hissé à la hauteur de ce qu’ont été la social-démocratie, les partis communistes et les partis chrétiens-démocrates dans les décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale. Les nouveaux partis sont relativement faibles. Prenez Podemos et Syriza, leur base sociale et leur organisation sont beaucoup moins massives que celles de leurs prédécesseurs.
Que peut-on faire face à cette situation ? Il faut d’abord renoncer à l’idée que l’on aurait une instance qui permettrait de faire la synthèse générale et autour de laquelle tout se jouerait. Dans les partis, il y avait – très fortement théorisée pour certains, inconsciemment revendiquée pour d’autres – l’idée que si des choses importantes se jouaient dans la société, c’était au Parti qu’il revenait de faire la synthèse entre les différentes demandes et d’élaborer un projet politique national faisant sens et dépassant les micro-clivages, avec comme horizon la prise du pouvoir d’Etat. Cette vision est obsolète, on ne peut plus avoir de parti qui soit le centre de tous les mouvements de la société.
Cependant, contrairement à ce que pensent certains du côté des courants libertaires ou mouvementistes, tout ne peut se jouer dans les assemblées du type Nuit Debout, Indignés espagnols ou Occupy Wall Street. De telles mobilisations, avec leurs formes de coordination horizontales, constituent un fort élément de renouveau, mais elles ne constituent que l’une des réponses à la crise politique actuelle, qui doit entrer en interaction avec d’autres. L’empowerment et l’organisation durable des groupes subalternes, si importantes, ne se produisent que peu dans un mouvement comme Nuit Debout. Et même dans des mobilisations beaucoup plus importantes quantitativement – comme celle des Indignés espagnols – il a fallu ensuite d’autres expériences pour que les choses se transforment. Inversement, si les organisations de la société civile (ONG, associations, syndicats) sont fondamentales, l’action pour la transformation ne peut s’y réduire.
Il faut donc se résoudre à avoir une dynamique dans laquelle il n’y a pas un centre mais plusieurs. Il faut notamment espérer avoir des partis plus démocratiques, plus ouverts… Les primaires constituent une voie dans cette direction, mais avec une portée limitée lorsqu’il s’agit des présidentielles, à savoir la pire des élections à laquelle on puisse songer : l’élection d’un monarque républicain, avec une personnalisation de la vie politique poussée à l’extrême et une explosion des ambitions personnelles. On peut encore citer la réduction drastique du cumul des mandats, une piste connue mais qui n’a pas encore fait de progrès qualitatif en France.
Il existe d’autres expériences de démocratisation des partis : on peut citer Morena au Mexique, le second parti de gauche de ce pays, où les cercles élisent une liste restreinte de personnes qui peuvent aspirer à candidater aux élections pour le parti et ensuite, un tirage au sort est organisé pour sélectionner celles et ceux qui seront vraiment candidat. Cela diminue les conflits de personne et permet de faire arriver sur le devant de la scène des personnes qui n’y seraient pas arrivées autrement.
Il faut aussi se préoccuper à nouveau de la présence des couches populaires dans les partis politiques. De gros progrès ont été faits en ce qui concerne la participation des femmes : on est loin d’avoir l’égalité mais comparé aux années 1970, la situation n’a rien à voir. Mais à l’inverse, dans les années 1960 et en partie dans les années 1970, de nombreuses personnes venues des classes populaires participaient à la politique officielle dans des positions de responsabilité. Cela s’est effondré au niveau national, voire au niveau local, et c’est une catastrophe.
Il faut aussi essayer d’inventer des formes de codécision en se servant des nouvelles technologies pour que ce ne soit pas les appareils ou ceux qui sont au centre qui prennent des décisions et fassent la synthèse des contributions, mais le chemin est long !
Cela a d’abord été — il faut le redire contre toutes les critiques potentielles — un souffle d’air frais dans un paysage qui était assez sombre. Les seules choses dont on parlait, c’était la sécurité, l’immigration, le terrorisme… Avec la mobilisation contre la loi sur la réforme du contrat de travail, Nuit Debout a remis sur le devant de la scène — au moins pour un temps — des thèmes comme la justice sociale et la démocratie, et ce en dehors des structures politiques traditionnelles. Des dirigeants et des militants politiques ont été présents, mais sur le fond, ce mouvement s’est fait de façon très largement indépendante des organisations politiques ou syndicales traditionnelles. C’est quelque chose de tout à fait positif. Des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes ont fait une expérience militante intense, se sont formées, ont expérimenté des formes politiques différentes. C’est énorme.
Nuit Debout a promu en France – à une échelle que l’on n’avait pas connue jusque-là – des formes de démocratie directe où une grande attention est portée à la prise de parole en assemblée, à la prise de décisions par consensus, où la méfiance par rapport aux porte-parole auto-proclamés ou élus est grande. Si la démocratie ne se réduit pas à cela, cette dynamique de démocratie directe en est une composante. C’est même l’un des cœurs de la démocratie. Il faut cependant rester réaliste ! Mes collègues calculent qu’il y a eu environ 7 à 8 millions de personnes qui, en Espagne, à un moment ou à un autre, ont participé aux actions du 15 M., le mouvement des Indignés espagnols. Nous n’avons pas de comptes précis pour Nuit Debout, mais même en additionnant avec les Nuits Debout de province, si on arrive à quelques centaines de milliers, c’est vraiment un maximum. L’ordre de grandeur n’est pas le même, d’autant que c’est surtout à Paris que s’est concentrée la mobilisation dans la durée. En province, elle a été plus ponctuelle. C’est donc une mobilisation non négligeable mais qui n’a pas eu l’ampleur de masse extraordinaire que les Indignés espagnols ou les mobilisations de Hong Kong, du Caire, de Taiwan, ont pu avoir.
Deuxièmement, la diversité sociale y était également beaucoup moins grande. Il n’y avait pas que des gens qui habitaient à Paris, contrairement à ce qui a été dit de façon un petit peu négative pendant un moment, mais les couches populaires et la banlieue n’étaient pas massivement présentes. Il y avait beaucoup de personnes appartenant à la jeunesse éduquée et précarisée, beaucoup de gens dont le capital intellectuel était important mais dont les revenus et le capital économique n’étaient pas énormes, beaucoup de militants de gauche ou d’extrême gauche dégoutés de la politique traditionnelle. Le mouvement n’a par contre pas pris dans les banlieues. De la même manière, pour les personnes qui habitent dans les campagnes populaires ou les petites villes de province, c’était très loin. Cela reflète cependant aussi l’état d’un pays à un moment donné. Ce n’était pas la faute du mouvement, mais il faut en prendre la mesure.
Après, il y a des débats stratégiques qui n’ont pas été résolus par Nuit Debout, mais on voit mal comment ils auraient pu l’être. Ceux qui affirment que Nuit debout n’a pas eu de « traduction politique », sous-entendant que le mouvement n’était pas en lui-même politique, se trompent. Il l’était profondément, bien plus que les querelles politiciennes et les compétitions de leaders qui font ordinairement la une des médias. Mais comment articuler un mouvement de masse spontané qui, par définition, ne peut pas s’inscrire dans la durée, et une structuration plus durable d’organisations ou d’associations qui militent sur des revendications similaires ? Les réponses qui ont été données à cette question ont divergé.
Que va-t-il se passer ensuite ? Rien n’est décidé. Dans d’autres pays, une partie des personnes qui s’étaient mobilisées est passée à l’action politique institutionnelle. Est-ce qu’on va avoir la même chose pour celles et ceux qui étaient actifs à Nuit Debout ? D’autres personnes, qui n’étaient pas organisées, vont-elles en nombre significatif monter des associations? Là encore, il est difficile de le savoir. Nous manquons de recul. En tout cas, si Nuit Debout n’a pas fait basculer l’axe de gravité du débat politique, qu’il soit institutionnel ou de l’espace public plus large, il a constitué un moment important qui s’inscrit dans une dynamique plus globale. Nuit debout a probablement jeté des graines qui, demain, pourraient fleurir. Fleuriront-elles vraiment ? Seul l’avenir nous le dira.

Réformer les modes de scrutin représenterait effectivement une dimension importante qui pourrait, sans bouleverser le système représentatif, en modifier de manière non négligeable la dynamique. Une des possibilités, c’est de donner aux citoyens les moyens de faire un vote différencié qui ne soit pas pour une seule personne ou une seule liste, d’avoir en sorte plusieurs voix. Prenez un pays comme l’Allemagne : les modes de scrutins municipaux sont décidés au niveau des Länder, des régions. Dans la plupart des Länder, aujourd’hui, on a comme en France un scrutin de listes pour les municipales. Simplement, si vous avez 60 conseillers municipaux dans une ville, vous avez 60 voix et vous les répartissez comme vous le voulez. Vous pouvez les mettre toutes sur la liste du parti dont vous êtes le plus proche dans l’ordre qui a été indiqué. Vous pouvez modifier complètement cet ordre, faire remonter des candidats que vous appréciez, ne voter que pour des femmes, etc. Vous pouvez répartir, panacher vos voix en en mettant 20 par-ci, 10 par-là … Cela contribue à une véritable démocratisation du système électoral. C’est quelque chose qui est aussi traditionnel en Suisse. Seulement, c’est une solution qui vaut dans certains contextes mais pas dans d’autres. Prenez par exemple le Brésil, le fait de pouvoir panacher et modifier l’ordre des listes, qui existe depuis la nouvelle Constitution de la fin des années 1980 est l’un des grands outils de clientélisme et de corruption : les conseillers municipaux potentiels vont voir les gens en leur proposant des investissements en échange de faire voter pour eux dans leur communauté. La logique était un peu la même en Italie il n’y a pas si longtemps, quand il y avait le système dit « des préférences ».
Le raisonnement vaut pour d’autres réformes potentielles. Prenez la proportionnelle intégrale. A l’évidence, elle permet, davantage que le vote au scrutin majoritaire à deux tours que l’on connait, de refléter la diversité d’opinion de la société. On sait qu’elle favorise une présence plus grande des groupes sous-représentés – les femmes, les couches populaires, les personnes issues de l’immigration. Mais on sait aussi que dans certains contextes, ce sont les petits partis charnières qui vont se vendre au plus offrant, faisant et défaisant les majorités, ce qui n’est pas très démocratique. On peut aussi avoir le scrutin proportionnel à l’allemande, où les partis sont amenés à faire des coalitions majoritaires au-delà du clivage droite-gauche. Mais il faut être prêt à faire cela pour que la proportionnelle ait du sens.
On peut aussi expérimenter le système de vote dans lequel on peut mettre des cartons rouges. Cela favorise des candidats plus consensuels. Avec ce système, Sarkozy n’aurait sans doute pas été élu. Mais cela a tendance à favoriser des candidats consensuels et donc du centre, et à défavoriser des perspectives de changement radical.
Je ne pense donc pas qu’il y ait une modalité de scrutin qui serait la solution magique. On peut dire en revanche sans problème que notre système de scrutin uninominal à deux tours pour les législatives et les présidentielles est un très mauvais système. Le système anglais où il n’y a qu’un seul tour est encore pire, mais ce n’est pas parce qu’il y a pire que nous qu’il faudrait se réjouir.
La question de l’échelle est tout à fait fondamentale, il n’y a aucun doute là-dessus. Cela ne signifie pourtant pas qu’il y aurait une échelle qui serait démocratique par excellence. L’idée que le local favorise la démocratie est contestable. Si l’on pense à des communautés qui sont pour l’essentiel autonomes socialement et économiquement, on peut les penser comme autonomes politiquement sans que cela pose problème. Cela a été vrai pour les sociétés de chasseurs-cueilleurs, même s’ils avaient des échanges avec d’autres sociétés. Ces échanges étaient beaucoup moins contraignants que ceux que l’on connait aujourd’hui, où l’essentiel des produits que l’on consomme provient d’une division du travail à moyenne ou grande échelle. Retourner à des petites communautés autonomes néo-rurales peut être intéressant comme expérimentation, mais cela ne peut être une solution à l’échelle de l’humanité. Cela ne résoudra pas le défi climatique ou les immenses injustices sociales à l’échelle de la planète.
Plus généralement, le local est une échelle importante, mais cela ne peut pas être la seule. Cependant, des fédérations de villes pourraient dans certains cas contribuer davantage à la lutte contre le réchauffement climatique que certains États. On peut sur ce plan comparer l’inaction de l’État français, malgré ses grandes proclamations, à une ville comme Paris, qui est plus dynamique et semble mettre en place des dispositifs comme une fédération de villes afin de donner un contenu effectif à cette lutte dans les dix ans à venir. Il ne faut pas négliger ces possibilités d’association. Ensuite vient l’échelle nationale, qui n’est devenue centrale pour l’expérience démocratique qu’avec l’avènement des gouvernements représentatifs et des grands États-nations. Les démocraties se sont coulées dans ce cadre pendant un ou deux siècles. Aujourd’hui, cette échelle perd en pertinence. Elle reste un échelon important, mais insuffisant pour fonder une démocrate active à un moment où le local et les interconnexions locales prennent de l’importance, et face à une mondialisation changeant les enjeux, les dynamiques, les rapports de pouvoir. A l’échelle nationale, on peut certes jouer sur les modes de scrutins et de désignation des responsables, on a un appareil législatif en partie opérant pour déterminer les politiques publiques. Les partis politiques sont actifs à cette échelle pour l’essentiel.
Mais sur le fond, est-ce que la démocratie est particulièrement adaptée à cette échelle nationale, de façon essentielle, transhistorique ? Je ne le pense pas puisqu’à l’échelle locale, les hiérarchies sociales pèsent moins qu’à la nationale alors que l’influence des citoyens ordinaires pèse généralement davantage. Par contre, la redistribution des richesses se joue davantage à l’échelle locale qu’à l’échelle nationale. Vient ensuite l’échelle internationale, qui est difficilement démocratique en raison du manque de mécanismes de contrepoids démocratique face à l’influence exorbitante des entreprises multinationales, des grandes organisations intergouvernementales (Banque mondiale, FMI, OMC), d’États hégémoniques (USA, Chine et dans une moindre mesure l’UE). Les logiques du capitalisme financier et du néolibéralisme se sont à l’évidence déployées avec plus de force encore à cette échelle qu’aux autres, et il en est résulté un fort rétrécissement de la marge d’action pour des politiques sociales.
Il est peu probable de pouvoir transformer la gouvernance globale à travers une ONU qui serait une sorte de « gouvernement représentatif international » proposée par certains — même s’il serait bon que cette organisation gagne en puissance et connaisse une démocratisation de son organisation interne. Les limites des réunions intergouvernementales sont de plus en plus patentes et prennent souvent le pas sur les objectifs fixés, comme on a pu le voir autour de la question du réchauffement climatique après Rio.
Dans le réseau que constitue la gouvernance mondiale, une voie prometteuse est celle d’un rééquilibrage au profit des associations et des organisations de la société civile, pour compenser le poids des multinationales, des marchés, des tribunaux d’arbitrage privés qui étendent le règne de la lex mercatoria, des organisations internationales technocratiques… Sylvain Laurens a étudié à l’échelle de l’UE[3] — mais on pourrait généraliser à d’autres domaines et organisations — la régulation de la mise sur le marché des produits chimiques. La fédération des produits chimiques européenne a dix fois plus de permanents experts à Bruxelles que la plus grosse ONG, Greenpeace, qui, elle, doit de plus s’occuper de tous les secteurs autres que celui de la chimie. On a un rapport de un à cent au détriment de Greenpeace alors qu’en face, nous avons des lobbyistes mais aussi des experts produisant de la connaissance et des propositions législatives et réglementaires. Il faut rééquilibrer cela au profit des organisations citoyennes, sinon tout est déjà joué en amont. On ne peut pas compter uniquement sur les partis politiques qui doivent faire campagne et ne sont de toute manière pas forcément au fait du côté technique de ces grands choix.
Enfin, une autre voie passe par les grands mouvements sociaux qui, de l’extérieur, font pression sur et font entendre leurs revendications à « la forteresse assiégée du pouvoir » – comme disait Jürgen Habermas.
Au total, l’importance de l’échelle globale, semble rendre délicate une plus forte démocratisation, mais qui aurait cru en 1788 qu’il y aurait une révolution fondamentale un an plus tard ? Qui pensait à la fin du XIXe siècle qu’après des crises extraordinaires, un État social serait mise en place un demi-siècle plus tard ? Qui pouvait penser dans les années 1960 qu’une femme, Angela Merkel, serait un jour la personnalité politique la plus importante d’Europe ? Ce qui est inconcevable un jour ne l’est pas forcément le lendemain.
D’un côté, il faut saisir le caractère salutaire de cette provocation. Aujourd’hui, les historiens économiques calculent que les États européens jusqu’au XIXe siècle consacraient environ 90% de leurs ressources publiques à faire la guerre. En comparaison, l’État chinois, parce qu’il avait unifié un territoire grand comme le continent européen, ne dépensait que 50 % de ses ressources à cette finalité : c’était en quelque sorte un État social avant l’heure ! Par rapport à une vision enchantée de l’État garant de l’intérêt général et permettant la pacification des pays, il est impératif de relativiser.
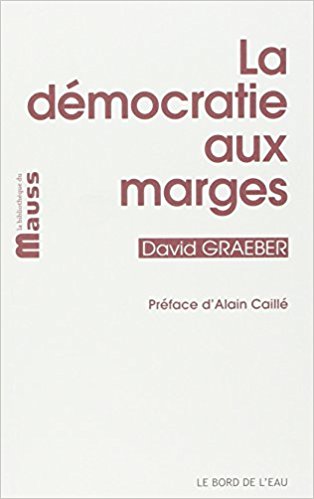
Mais du côté inverse, la vision proposée par Graeber n’est pas convaincante non plus : ces petites communautés « démocratiques », par leur organisation interne étaient souvent des communautés très hiérarchisées qui connaissaient de nombreuses inégalités en leur sein — notamment dans le rapport hommes – femmes — et étaient très souvent en guerre permanente les unes avec les autres, avec de récurrents phénomènes de prédation. L’État a une double face. La première est une fonction agressive et guerrière à l’extérieur, ainsi que de maintien de l’ordre au profit des puissants et des privilégiés. Cette face est toujours présente : l’État français fait, depuis les années 1960, une intervention armée en Afrique tous les ans et demi. Ne parlons même pas des États-Unis, de l’ex-URSS ou de la Russie actuelle. La seconde face est une fonction d’institution qui, dans certains contextes, assure la paix civile sur un territoire donné, y redistribue des richesses, y organise des services publics ne pouvant être disponibles à des niveaux micro-locaux.
De plus, les États sont actuellement potentiellement l’un des acteurs qui peuvent contrebalancer le poids d’acteurs globaux que sont les grandes multinationales. Dans un univers composé uniquement de petits groupes locaux autonomes, comment pourrait-on imposer des régulations à Google, à Facebook, à Uber, etc., à ces acteurs globaux du capitalisme international ? L’État est l’un des acteurs — mais pas l’unique — nécessaire à une démocratisation, à une désoligarchisation partielle du système. Ces deux faces de l’État doivent être considérées, au même titre que les deux faces des partis ou des assemblées. Prenons l’exemple de Nuit Debout. C’était un souffle d’air comme expérimentation démocratique et comme mise sur l’agenda de thèmes comme la justice sociale et les méfaits de la globalisation capitaliste, mais le mouvement connaissait aussi des exclusions (il y avait peu de jeunes des banlieues populaires) et des hiérarchies souterraines ou informelles : tout ne peut pas se régler dans la spontanéité.
J’apprécie beaucoup ce travail de Manuel Cervera-Marzal et partage très largement sa démonstration. Je partage aussi l’idée que la démocratie fait partie de ce que l’ancien président de l’association américaine de sociologie Erik Olin Wright — dont le livre vient d’être traduit en français[6] — appelle « les utopies réalistes. » Il s’agit d’un idéal que l’on peut essayer de définir ou d’un horizon qu’on ne pourra jamais atteindre mais vers lequel on peut d’ores et déjà se diriger aujourd’hui. Dans cette perspective, la désobéissance civile est quelque chose de tout à fait important. L’un des mérites de ce livre que d’en montrer toute la gamme. D’autres livres auparavant, par exemple des libéraux radicaux ou des sociaux-démocrates comme John Rawls et Habermas, en parlent aussi, et Habermas parle par exemple de la désobéissance civile comme un test clé pour l’ordre démocratique.
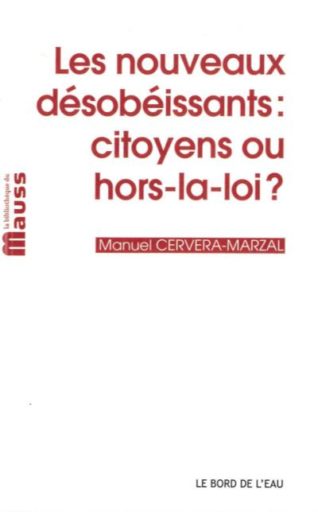
Mais la valeur ajoutée de ce livre est de montrer, en s’inscrivant dans une tradition de démocratie radicale où l’on compte des auteurs comme Balibar, que contrairement aux visions libérales les plus répandues, la désobéissance civile ne s’inscrit pas simplement comme un mouvement réformiste devant se borner à simplement titiller, sur des points particuliers, un ordre pour l’essentiel démocratique. Elle a été et peut continuer d’être une dynamique proprement révolutionnaire qui transforme complètement les régimes politiques et les équilibres sociaux et économiques en place. Pensez aux actions de Gandhi ou Martin Luther King. Quelle est la spécificité de ces désobéissances civiles par rapport à la révolution classique, à l’insurrection armée?
Cette idée forte de non-violence, qui n’est pas absolue mais qui est tout de même un des ressorts fondamentaux sur lesquels repose la désobéissance civile. Celle-ci ne passe pas d’abord par l’affrontement armé, même s’il peut y avoir certains moments dans un processus historique large qui soit de ce type. La désobéissance civile implique aussi l’idée d’une action qui est justifiée par des principes démocratiques universalistes et de ce point de vue, il peut y avoir une convergence avec un penseur comme Habermas. Il s’agit d’une revendication au nom d’un horizon démocratique constitutionnel et pas simplement d’un pur rapport de force. De ce point de vue, il y a des différences capitales entre les mouvements que l’on peut qualifier de désobéissance civile et des mouvements de lobbying comme celui des Bonnets Rouges. Mais la désobéissance civile n’est pas nécessairement réformiste, elle peut au contraire être révolutionnaire, au sens où elle provoque ou renforce un mouvement qui bouleverse l’état des choses existant. Et c’est cette dimension révolutionnaire que Manuel Cervera-Marzal met bien en évidence.
Rappelons que les institutions ont deux faces : celle qui permet à des acteurs des couches subalternes de se saisir, lorsque ces institutions sont partiellement démocratiques, des dispositions ou des réglementations en vigueur pour faire valoir leurs intérêts et leurs valeurs afin de transformer les choses ou réparer des dommages. Et l’autre face, des organisations et des dispositifs qui peuvent être modelés ou utilisés davantage par les puissants afin de reproduire l’ordre existant (il s’agit des mêmes institutions, la plupart du temps, qui font l’objet d’une lutte pour l’hégémonie toujours ouverte). Confrontée à cette seconde face, la désobéissance civile vise à transformer de l’extérieur ces rapports de force.
A l’échelle internationale, Greenpeace me semble constituer — on peut par ailleurs sympathiser ou non avec son action — une réponse assez complète dans le jeu sur les deux tableaux. En tant qu’acteur primordial de la société civile, Greenpeace participe aux négociations sur le réchauffement climatique tout en organisant des actions de désobéissance civile pouvant être extrêmement radicales, et qui sont devenues sa marque de fabrique. Toute association ou mouvement n’a pas à jouer sur les deux aspects mais on ne peut penser un changement radical sans avoir ces deux aspects combinés.
À l’évidence, il y a des forts liens entre économie et politique. Pour l’instant, nous avons parlé pour l’essentiel de la sphère politique comme si elle était isolée du reste alors que ce n’est absolument pas le cas. N’étant pas un spécialiste de l’économie, je renâcle à m’avancer à en parler de façon directe autrement qu’en termes extrêmement généraux. En revanche, j’ai des réticences à postuler un lien constant et univoque entre capitalisme et démocratie. Les libéraux défendent la thèse inverse de celle de Husson et prétendent que la démocratie et le capitalisme développent des affinités électives.

J’ai des réticences à faire des thèses trop générales indépendamment des expériences historiques réelles. Que peut-on affirmer en regardant l’histoire ? Une première chose est sûre, c’est que la démocratie ne nécessite pas le capitalisme, comme le prouve le système athénien qui contenait des éléments capitalistes mais n’était pas une société capitaliste. Inversement, le capitalisme ne nécessite pas la démocratie, comme en attestent un grand nombre de dictatures cohabitant fort bien avec un régime capitaliste. Mais affirmer que capitalisme et démocratie s’opposent par nature, c’est nous renvoyer à des notions de démocratie et de capitalisme figées et anhistoriques.
Ce qui est aussi sûr, c’est que dans les pays capitalistes, il y a eu des dynamiques démocratiques extrêmement fortes. Les deux derniers siècles en Europe occidentale, en Amérique du Nord mais aussi dans les pays du Sud global, ont vu prospérer ce type de dynamique démocratique coexistant avec le système capitaliste. Certes, le capitalisme sauvage du XIXe siècle et le capitalisme financier actuel sont aux antipodes de la démocratie. Cependant, l’État social, le suffrage universel masculin puis féminin, les capacités d’auto-organisation des syndicats et associations, l’État de droit, à savoir des dimensions fondamentales pour tout modèle démocratique, ont été en tension mais pas incompatibles avec un certain type de capitalisme. Au total, la tension entre capitalisme et démocratie est évidente et s’exprime fortement en ce moment, ce qui invalide les grands récits libéraux qui faisaient du développement démocratique une conséquence logique de celui de l’économie capitalisme.
Cependant, il est difficile d’affirmer que cette tension serait si forte que les deux pôles antagoniques ne pourraient pas coexister de façon conflictuelle. Il semble cependant clair que pour l’épanouissement de la démocratie, il faudrait un développement d’une économie non capitaliste, fondées sur les communs, comme l’ont à juste titre théorisé Dardot et Laval. Cela signifie-t-il cependant l’abolition complète du capitalisme ? En tout cas, la variante libertaire, défendue par exemple par Graeber, d’une simple association de communautés autogérés et autosuffisantes ne me semble pas crédible en terme d’inégalités nationales ou internationales. Et la vision communiste traditionnelle, qui pensait la société émancipée en termes d’abondance et d’un au-delà de la démocratie et de la justice sociale, est peu crédible à l’heure où la crise écologique nous permet de mieux mesurer les limites du « progrès ».
Ce qui est clair, c’est que nous aurons toujours besoin d’institutions permettant de régler les conflits et de peser les valeurs en discussion, et que nous n’aurons jamais une société qui serait régulée par une simple « administration des choses », pour reprendre une formule malheureuse d’Engels.
À l’évidence, les luttes sociales ont constitué une contribution décisive à l’émergence de l’Etat social. Même si c’est un raisonnement contrefactuel, il est peu probable que sans les régimes communistes, les pays occidentaux auraient développé leurs États sociaux comme ils l’ont fait. Il est plausible de penser qu’une partie au moins des concessions qui ont été faites dans les pays capitalistes occidentaux l’ont été par crainte d’une révolution communiste. Est-ce à dire qu’il faudrait de nouveau une révolution communiste ? Il y a peu d’acteurs qui vont dans ce sens, surtout en raison du bilan globalement négatif du socialisme réellement existant. On n’a pas aujourd’hui de mouvement de masse qui, à une échelle significative, demanderait une révolution communiste classique. Quelques intellectuels jouent cette carte depuis leurs lieux privilégiés, leurs universités d’élite, mais cela n’est pas très sérieux… Ne peut-on penser qu’au XXIe siècle, des mouvements de transformation d’une ampleur similaire à celle du siècle passé, mais tirant le bilan de l’échec du communisme autoritaire, pourraient contrebalancer le poids du capitalisme financier et en relativiser l’hégémonie? Fautes d’alternatives crédibles, je n’imagine guère, en tout cas, du moins à l’échelle de quelques générations, une disparition du capitalisme, mais je crois qu’il est jouable de lutter pour qu’il ne constitue plus qu’un élément dans un ensemble plus complexe, où coexisteraient une économie publique étatisée, une économie marchande et des communs.

Entretien réalisé par Sarah Kilani et Thomas Moreau.
Photo : Cyrille Choupas.
[2] Yves Sintomer, Petite histoire de l’expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours, Paris, La Découverte, 2011.
[3] Voir l’entretien de Contretemps avec Sylvain Laurens ici et un extrait de son ouvrage Les courtiers du capitalisme ici.
[4] David Graeber, La démocratie aux marges, Lormont, Le Bord de l’eau, 2014.
[5] Manuel Cervera-Marzal, Les Nouveaux Désobéissants : Citoyens Ou Hors-la-loi ?, Lormont, Le Bord de l’eau, 2016.
[6] Erik Olin Wright, Vers les utopies réelles, Paris, La Découverte, à paraitre en août 2017.
[7] Michel Husson, Le capitalisme en dix leçons. Petit cours illustré d’économie hétérodoxe, Paris, La Découverte, 2012.