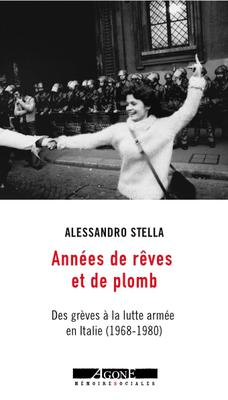
Alessandro Stella, Années de rêves et de plomb Des grèves à la lutte armée en Italie (1968-1980), Marseille, Agone, 2016.
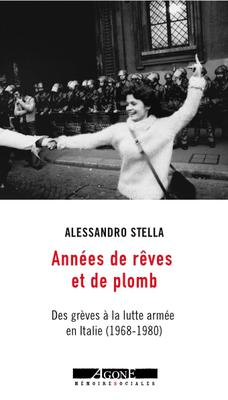
Comme tant d’autres, la révolte ouvrière chez Marzotto et cette image de la statue du patron démolie m’avaient marqué : ce n’est probablement pas un hasard si la première fois que je suis allé à une manif avec des molotov dans la crainte d’une charge de la police, c’était à Valdagno, le 19 avril 1973. Ce jour-là avait été organisée une manif à l’occasion du cinquième anniversaire de ce symbole de la révolte ouvrière. J’y étais allé avec Alfio et d’autres camarades de Potere operaio de Vicence. Nous avions imprimé et diffusé une grande feuille sur les luttes des travailleurs du textile, reproduisant sur une demi-page la photo de la statue du comte Marzotto à terre, et nous avions défilé en rangs serrés au cri de : « On aime davantage Marzotto la tête en bas ! »[1].
Dans la première moitié des années 1970, porté par la vague de luttes ouvrières toujours plus radicales et antisystème, « l’emploi de la force » – comme on disait – était en train de passer du débat théorique et stratégique à une pratique diffuse. Un climat s’installait, qui traversait tous les groupes à la gauche du PCI, comme tant de comités d’usine, de collectifs d’étudiants et de groupes de quartier ou de village. Après de longues années, des lustres durant lesquels les travailleurs syndiqués, les militants de la gauche socialiste, anarchiste, communiste, avaient été victimes de la répression fasciste, puis démocrate-chrétienne, certains décidèrent que cela suffisait, qu’il fallait cesser d’être toujours les victimes et commencer par se défendre, les armes à la main si nécessaire. Derrière ce tournant, il y avait au moins 200 ouvriers et paysans tués au cours de manifestations entre la fin de la guerre et les années 1970, la cruelle litanie des « massacres d’État »[2] qui avaient causé la mort de 150 autres personnes, l’impunité conférée aux hommes de main des services secrets parallèles, aux loges maçonniques golpistes et, plus généralement, aux forces de l’ordre dont le commandement nommé par le régime fasciste avait été maintenu et confirmé après 1945[3]. Il y avait la rancune inspirée par l’amnistie qu’avaient octroyée De Gasperi et Togliatti aux fascistes dès 1946, jamais apaisée, et la frustration de l’insurrection bloquée par la direction du PCI en 1948[4] suivie de la dure répression imposée par le ministre Scelba : de 1948 à 1950, 62 militants et dirigeants syndicaux furent tués, plus de 3 000 furent blessés au cours de manifestations, et plus de 90 000 protestataires furent arrêtés[5]. Mais même muselée, la mémoire de la répression des Scelba et des Tambroni[6], le souvenir des espoirs nés à la Libération et trahis par Togliatti et le PCI, s’étaient transmis d’une génération à l’autre de militants communistes.
Dans la province de Vicence, et dans le Haut-Vicentin en particulier, la mémoire révolutionnaire charriait des noms, des faits, des dates dont on entretenait soigneusement le souvenir. Depuis les « cercles ouvriers » (circoli operai) jusqu’aux sièges du parti en passant par les maisons des ouvriers communistes, on se souvenait de figures tutélaires, d’antifascistes, de résistants qui avaient lutté et combattu à Schio, et pour certains aussi en Espagne, en France, en Amérique latine, garibaldiens du xxe siècle. Certains se rappelaient Pietro Tresso, ami d’Antonio Gramsci et d’Amadeo Bordiga, l’un des fondateurs du Parti communiste d’Italie en 1921, à Livourne, puis de la IVe Internationale trotskiste en 1938, tué en 1943 dans les montagnes du Massif central français par un groupe de résistants staliniens. D’autres racontaient les hauts faits de Germano Baron, dit « le Turc », ou de Ferruccio Manea, dit « le Tar », héros mythiques de la résistance dans les montagnes de Schio.
Certains connaissaient et faisaient le récit de la vie d’Igino Piva, alias « Romero », un révolutionnaire internationaliste[7]. Né en 1902 dans une famille ouvrière d’une bourgade de Schio, militant socialiste à l’adolescence, puis communiste, il dut émigrer en 1923, à 21 ans, en Amérique latine pour se soustraire à la répression fasciste. À Rio de Janeiro, comme ensuite en Argentine et en Uruguay, il n’eut de cesse de participer aux luttes politiques et syndicales, des dockers en particulier, ce qui lui valut arrestations et nouveaux exils jusqu’à son expulsion d’Argentine vers l’Italie, en 1933. En 1936, en compagnie de son frère Eugenio, Igino Piva partit pour l’Espagne rejoindre les Brigades internationales ; il participa aux batailles de Guadalajara et de Madrid où il fut blessé, et quitta la Catalogne pour la France avec les derniers républicains, dans la terrible retraite de l’hiver 1939. Interné à Argelès-sur-Mer pendant un an, il fut livré en 1940 par la police française aux autorités italiennes, qui l’envoyèrent sur l’île pénitentiaire de Ventotene. Libéré après l’éviction de Mussolini, en 1943, il retourna à Schio, où il organisa un groupe de résistance, combattant jusqu’à la fin de la guerre dans les montagnes, puis dans d’autres zones de la Vénétie et de la Lombardie, à la tête d’une brigade Garibaldi. Comme d’autres résistants communistes de Schio et d’ailleurs (en particulier en Émilie-Romagne), à la Libération, en avril 1945, il considéra que, si la guerre contre l’occupant allemand était terminée, celle contre les fascistes italiens ne l’était pas encore. Il fut accusé d’avoir organisé l’exécution de 54 membres du parti fasciste précédemment arrêtés et détenus à la prison de Schio, une justice sommaire menée par un groupe de résistants dans la nuit du 6 au 7 juillet 1945. Abandonnés par Togliatti et un parti communiste qui voulait se donner une posture d’ordre étatique, traités par L’Unità (quotidien du PCI) de « provocateurs trotskistes », les résistants en armes qui ne furent pas arrêtés durent prendre le chemin de l’exil. Igino Piva rejoignit d’abord l’Istrie et les partisans de Tito, avant de gagner Prague et la Tchécoslovaquie, en 1948, où il vécut jusqu’en 1974. De 1961 à 1963, il était à Cuba où, désormais sexagénaire, il voulait aider la nouvelle patrie de la révolution. Finalement amnistié après une vie passée aux quatre coins du monde à militer pour la révolution et à travailler comme ouvrier chauffagiste, il retourna à Schio en 1974, où il vécut jusqu’à sa mort en 1981.
J’entendais parler de ces héros par les camarades plus âgés, qui avaient milité au PCI et se faisaient un honneur d’avoir connu qui l’un, qui l’autre des vieilles figures de la Résistance. Ils en parlaient sur le ton de la confidence, du partage de photos et de secrets de famille, sans cacher un sentiment de fierté et d’admiration pour ces vieux révolutionnaires. Même si je ne comprenais pas bien, à l’époque, les différences idéologiques et les raisons stratégiques qui avaient déterminé le destin de ces hommes, j’avais été fort étonné, incrédule, d’apprendre que les « Pragois » n’avaient pu rentrer en Italie qu’au début des années 1970, plus de vingt ans après les épisodes de la guerre civile qui suivirent la Libération. Cela me paraissait injuste, incompréhensible.
On peut émettre l’hypothèse que ce qui s’est passé en Italie au cours de la première moitié des années 1970, c’est que les injustices jamais reconnues, les rancœurs et les refoulements que traînaient les mouvements ouvrier et communiste depuis la Libération, ont rencontré le courant révolutionnaire libertaire de 1967-1968. Les uns après avoir crié en vain la douleur d’être victimes, les autres après avoir rêvé le paradis sur terre, ouvriers communistes et « fils des fleurs » se sont trouvé un destin commun dans la révolution sociale. Comme tant d’autres, le même Mario Moretti, leader des Brigades rouges à qui on a taillé une veste de marxiste-léniniste orthodoxe, avait vécu dans une « commune » de Milan avec sa femme et son fils avant d’entrer en clandestinité.
Il est difficile de l’expliquer, de le comprendre sans l’avoir vécu. Si l’analyse des facteurs du recours à la violence est compliquée, quiconque ayant fréquenté le mouvement ouvrier et étudiant au début des années 1970 sait qu’on y respirait un air insurrectionnel, que pour des millions d’Italiens la révolution était à l’ordre du jour, et que celle-ci n’était « pas un dîner de gala, mais un acte de violence » (comme disait Mao). Nous allions peu à peu nous en convaincre en pensant aux révolutions française, russe, chinoise et, enfin, cubaine. On entendait comme un son de tam-tam, de plus en plus fort et diffus, d’appel aux armes.
En ces années-là, la voie vers la guérilla se nourrissait d’événements qui avaient eu un impact énorme en Italie. En premier lieu, il y eut le massacre de la Banque de l’agriculture de la place Fontana à Milan, le 12 décembre 1969, fait emblématique de ce qui serait appelé la « stratégie de la tension ». Ce jour-là, une bombe déposée dans le hall de la banque avait causé la mort de 16 personnes et blessé une centaine d’autres, attentat aussitôt attribué par la police aux anarchistes, alors qu’il s’agissait de fascistes. Pour instiller la peur dans la population et justifier le recours à un pouvoir fort, les services secrets « parallèles » commandés par certains hommes politiques au pouvoir, liés aux États-Unis et à la CIA, utilisaient des groupes de fascistes et de paramilitaires (regroupés dans une structure secrète appelée Gladio) pour répandre la terreur tout en annonçant le chaos et la prise du pouvoir par les communistes ou, pire, les anarchistes. Le mouvement ouvrier italien, alors très fort, réagit par des grèves et des manifestations massives, au cours desquelles on criait que le massacre de la place Fontana était un « massacre d’État », que les anarchistes arrêtés étaient innocents et que Pinelli avait été « suicidé » par le commissaire Calabresi. Combien de millions de personnes ont crié dans la rue « Calabresi assassin, tu le paieras ! », avant qu’un groupe armé ne le tue ? Les trois individus qui participèrent à cet homicide, le 17 mai 1972, étaient convaincus de mettre à exécution la sentence exprimée par des millions de personnes. C’est là une évidence historique : le commissaire Luigi Calabresi fut accusé par des millions d’Italiens d’avoir « défenestré » le cheminot anarchiste Giuseppe Pinelli, injustement arrêté et accusé d’avoir mis une bombe place Fontana. Dario Fo et Franca Rame en avaient fait un spectacle théâtral très en vogue, les murs de l’Italie tout entière étaient recouverts de graffitis contre Calabresi, le quotidien Lotta continua avait martelé dans ses articles pendant deux ans que ce commissaire de police était un assassin, et dans les manifs on demandait ouvertement sa mise à mort. Puis, un jour, un groupe de personnes décida de mettre à exécution ce que tant de gens réclamaient. Qui était coupable ? Les juges et la jurisprudence refusèrent d’envisager quelque responsabilité collective que ce soit, s’en tenant au principe de droit de la responsabilité individuelle, mais du point de vue historique les choses étaient à l’évidence bien différentes.
Outre les craintes, confuses et intuitives, concernant la CIA, les services secrets « parallèles », les loges maçonniques golpistes et les tentatives de coup d’État, l’imaginaire collectif de cette époque se nourrissait de mythes et de héros anciens et nouveaux. On considérait les résistants italiens qui avaient combattu le fascisme comme les pères fondateurs d’une pensée de guérillero. Dans la province de Vicence, en particulier, des groupes de résistants n’avaient pas rendu les armes, les avaient utilisées contre les fascistes à la fin de la guerre et les avaient ressorties en juillet 1948, après l’attentat contre Togliatti. Ce n’est pas un hasard si, comme tous les autres groupes armés des années 1970, nous avons reçu les premières armes des mains d’anciens résistants. Comme un passage de témoin.
Outre les résistants, les travailleurs morts au cours des grèves et manifestations réprimées par l’État, dans les années 1950-1960, de Battipaglia à Avola en passant par Reggio Emilia, à la mémoire desquels on chantait des chansons, remplissaient notre album de mythes fondateurs. S’y ajouta la figure de Giangiacomo Feltrinelli, éditeur guévariste, mort en mars 1972 dans l’explosion de la bombe qu’il était en train de poser sur un pylône à haute tension de la périphérie de Milan.
En 1973, un événement fondamental était venu donner davantage de crédit à la nécessité de prendre les armes : le coup d’État militaire au Chili. Si à la voie démocratique au socialisme, préconisée par les réformistes italiens du PCI comme par Salvador Allende, les fascistes et les impérialistes répondaient par les chars et le coup d’État militaire, alors il était clair pour les révolutionnaires que la seule voie possible était d’employer le même langage, celui des armes.
« Et alors, que veux-tu de plus, camarade, pour comprendre qu’est arrivée l’heure du fusil ? », chantaient des milliers de personnes dans les défilés en reprenant la chanson de Pino Masi L’Ora del fucile. La légitimité morale du recours à la violence était alimentée, outre les écrits classiques – de Lénine et Bakounine à Bertolt Brecht –, par la musique et le cinéma. Le film Il était une fois la Révolution de Sergio Leone ou la chanson La Locomotive de Francesco Guccini faisaient partie d’un flux puissant de justifications de la violence au nom d’un idéal socialement juste. Peu à peu, poussés par la « stratégie de la tension », nous nous sommes convaincus que la fin justifiait les moyens. C’est seulement a posteriori que nous avons compris le piège de cette formule, en constatant que l’emploi des armes nous éloignait petit à petit de l’objectif d’émancipation et nous rapprochait aussi imperceptiblement qu’inexorablement de la mentalité de ceux que nous voulions combattre.
La réflexion visant à considérer comme juste l’emploi de la violence (de la « force », disions-nous pour la positiver) n’était pas seulement alimentée par des événements nationaux ou internationaux. La tension, l’escalade dans l’affrontement social étaient palpables dans le plus petit coin d’Italie, comme par exemple à Torrebelvicino, un village près de Schio où, le 12 mars 1970, un homme de main des patrons de l’entreprise métallurgique Chioccarello avait tiré plusieurs coups de feu sur les ouvriers qui tenaient un piquet de grève devant l’usine, blessant sept grévistes.
À part l’autodéfense dans les manifs et les affrontements avec les fascistes, nos premières actions illégales dans le Vicentin furent des appels aux armes, avec des pochoirs apposés nuitamment sur les murs de Schio et de Valdagno vantant la lutte armée et les Brigades rouges. Car outre la culture libertaire, le courant communiste révolutionnaire et le message guévariste, était né en Italie au début des années 1970 un modèle national auquel on pouvait s’identifier : les Brigades rouges. Ils avaient dix ans de plus que nous et avaient connu directement 1968 ; pendant que nous regardions passer les défilés des ouvriers, ils marchaient avec eux. Leurs premières actions exemplaires, comme la mise au pilori du directeur du personnel de Siemens ou de Magneti Marelli, avaient fasciné bien des jeunes aspirants révolutionnaires. Le lien évident entre les luttes ouvrières et les actions de propagande armée menées par les Brigades rouges durant la première moitié des années 1970, faisait apparaître ce mode de lutte comme une suite logique permettant d’atteindre les mêmes objectifs avec d’autres moyens. Entre les « foulards rouges » de chez Fiat, qui occupaient l’usine de Mirafiori à Turin en 1973, et les groupes combattants qui s’en prenaient à la hiérarchie de l’entreprise, les complicités idéologiques autant que factuelles étaient flagrantes.
Ainsi, au cours de la première moitié des années 1970, les Brigades rouges, les GAP (Groupes d’action partisane) ou le groupe de Gènes appelé 22 Octobre, s’organisaient en tant que groupes armés clandestins, pendant que les groupes de la gauche extra-parlementaire formaient leur propre « service d’ordre » ou des embryons de « bras armé ». C’est dans les années charnières 1974-1976 qu’une myriade de groupes, comités, collectifs formés dans les réseaux de Lotta continua et de Potere operaio, prendront décidément une orientation politico-militaire, donnant naissance à Prima linea et aux groupes de l’Autonomie ouvrière[8]. Contrairement à une certaine réécriture de l’histoire effectuée par d’anciens leaders des groupes extra-parlementaires de l’époque (et, malheureusement, par le film Nos meilleures années de Marco Tullio Giordana[9]), qui fait se terminer le cycle des luttes sociales en 1976, niant donc continuité et parenté entre celles-ci, le mouvement de 1977 et l’explosion de la guérilla dans la deuxième moitié des années 1970. Tant les théories que la masse documentaire (des chroniques de journaux aux procès-verbaux des tribunaux, de la presse militante aux biographies et mémoires des protagonistes) témoignent d’une continuité de pensée et d’action. La spécificité italienne[10], comparée à l’évolution du mouvement révolutionnaire dans les autres pays occidentaux après 1968, réside justement dans le fait que les luttes sociales anti-système ont perduré sur une longue décennie, et qu’une partie significative des jeunes militants – à la différence de l’Allemagne, de la France ou des États-Unis, où le phénomène resta marginal – prit le chemin des armes. Il n’y a pas eu une bonne et une mauvaise jeunesse, c’était la même, à des dates et dans des circonstances différentes.
On peut attribuer un rôle important dans la connotation négative donnée à la lutte armée – donc probablement dans son échec –, entre autres à travers les termes utilisés (« terrorisme », « années de plomb »), à ce que l’on peut définir comme « la trahison des clercs », à savoir l’attitude adoptée par certains intellectuels une fois arrêtés. Ils avaient assumé le rôle symbolique de chefs, de théoriciens, de leaders du mouvement révolutionnaire, et par leurs écrits ils avaient sinon influencé (certains livres étaient parfaitement incompréhensibles à la plupart des militants…), du moins offert des arguments de légitimation à la révolte et poussé des ouvriers, des étudiants, des prolétaires à faire la révolution par tous les moyens possibles, au besoin par les armes. Puis, au moment d’assumer avec cohérence leurs propres responsabilités, certains ont fait marche arrière, prenant leurs distances avec les militants des groupes armés et se proclamant totalement étrangers à la dérive militariste. Ce qui n’empêcha pas les juges de les condamner. Mais la dissociation d’avec ceux qui avaient été leurs camarades, et parfois leurs amis, porta un coup fatal à l’image des groupes armés. Ceux-ci se retrouvèrent orphelins, sans généalogie dans le mouvement ouvrier et révolutionnaire, rejetés dans la « mauvaise jeunesse » que l’État pouvait légitimement punir. Au contraire, entre nous, nous avions établi une règle éthique qui se voulait la base d’une morale communiste : peu importe qui fait ceci et qui fait cela, qui est ouvrier à la chaîne et qui est universitaire, qui écrit et qui fait feu, qui rédige des tracts et qui fabrique des molotov, les rôles n’ont pas d’importance car nous faisons partie d’un même projet, d’une même organisation, dont nous assumons chacun et collectivement toutes les responsabilités.
Parmi d’autres facteurs déterminants de la défaite du mouvement des années 1970, il faut sans doute évoquer le fait que l’appel aux armes contient en lui-même le germe d’une dérive négative. Une sorte de loi d’airain, inexorablement reproduite au cours des siècles et des révolutions. La dynamique psychique et relationnelle introduite par l’emploi des armes peut parvenir rapidement à corrompre des âmes nobles, à rendre impitoyables des personnes autrefois douces et aimables, et finalement à bouleverser leurs valeurs de départ. Sans parler du fait que l’appel aux armes fait accourir des gens qui ne sont pas animés par de bonnes intentions mais fascinés par la violence, le pouvoir que les armes donnent sur autrui. Ce n’est probablement pas un hasard si les plus infâmes des mouchards, les plus célèbres parmi les « repentis » des Brigades rouges et de Prima linea, Patrizio Peci, Antonio Savasta, Roberto Sandalo, Michele Viscardi, tous ayant avoué plusieurs homicides, tous graciés et récompensés par l’État italien pour leurs services, étaient connus comme bagarreurs, violents et passionnés par les armes. Quand Michele Viscardi (« l’assassin aux yeux de glace ») fit le tour de l’Italie après son arrestation en compagnie des carabiniers, leur indiquant les bases de Prima linea et envoyant en prison même celui qui lui avait un jour sauvé la vie, le portant sur ses épaules, blessé, après un conflit armé[11], les journaux rapportaient que pour passer le temps en voiture il discutait aimablement d’armes et de balistique avec les carabiniers de l’escorte.
L’emploi des armes n’est pas anodin et a une incidence profonde sur celui qui s’en sert. Le sentiment de puissance que donne le fait de pointer un pistolet sur quelqu’un, la panique tremblante et paralysante, on les lit dans les yeux de celui qui subit la menace. Une fois enclenché, le mécanisme conduit inévitablement au durcissement des sentiments, au calcul froid, voire à un certain cynisme. Chez le militant révolutionnaire, cela finit par provoquer des changements de références et d’habits, au sens propre comme au figuré : combien de personnes, moi compris, sont-elles passées de la parka à la veste, de l’imperméable genre inspecteur Colombo au costume cravate au moment de la clandestinité ! La transformation n’était pas seulement de façade, car l’habit fait bien le moine, et la critique du paraître bourgeois et des comportements qui s’ensuivaient (l’une des nombreuses raisons de notre révolte), nous la sacrifions sur l’autel de la nécessité et de l’efficacité. Finalement, l’emploi des armes, dont on sait aujourd’hui qu’il conduit jusqu’à la folie une partie des soldats engagés dans toutes les guerres, peut se révéler déterminant dans la défaite d’un mouvement guérillero.
Nous l’avons appris dans nos propres chairs : l’emploi des armes donne la possibilité d’intimider, de blesser ou de tuer, mais aussi d’être tués. C’est arrivé aux compagni de Thiene, comme quelques années plus tard à un autre camarade et ami, Pietro Greco, dit « Pedro ». Émigré à Padoue de sa Calabre natale, à la fin des années 1960, il avait fait des études de statistiques et travaillé dans n’importe quoi pour gagner sa vie mais passait en réalité le plus clair de son temps à militer. À partir de 1968, il était présent à n’importe quelle grève, occupation, manifestation qui se déroulait à Padoue ou dans la Vénétie : le militantisme, les camarades, c’était toute sa vie. Et même quand il était devenu clair, en 1985, que l’expérience avait touché à sa fin, il ne voulait pas se résigner. De Paris, où il avait échoué comme tant d’autres naufragés au cours de la première moitié des années 1980, il décida de rentrer en Italie, pour ne pas lâcher, par un sentiment de devoir de résistance. Ainsi, par un matin pluvieux, le 9 mars 1985, en sortant de l’appartement de Trieste où il était hébergé, il tomba nez à nez avec les policiers de la Digos[12] qui l’avaient repéré et l’attendaient dans le hall de l’immeuble. Pedro était recherché depuis des années ; il ne voulait pas finir en prison et, fougueux comme il était, il tenta de s’enfuir, se dégageant en agitant le parapluie qu’il avait dans la main. Les policiers lui tirèrent dessus à bout portant. Blessé, il se mit à courir dans la rue en criant : « Ils veulent me tuer ! ils veulent me tuer ! » Les policiers lui tirèrent encore plusieurs coups de pistolet dans le dos jusqu’à ce qu’il tombe entre le trottoir et les voitures stationnées. Ils lui passèrent les menottes dans le dos alors qu’il était en train de mourir. Pedro n’était pas armé, il ne menaçait personne, il fut tué parce qu’il avait l’étiquette de terroriste accolée à son nom, et cela était suffisant pour les forces de l’ordre, en ces années-là, pour pouvoir tuer impunément[13].
L’appel aux armes, auquel nous avions répondu de façon « romantique », s’était finalement révélé être une tragédie et un piège. Mais tant que le mouvement montait en puissance, tant que la sympathie qui entourait l’illégalité de masse comme celle des groupes armés était diffuse et légitimante, on ne voyait pas ces choses-là, ou on faisait semblant de ne pas les voir. Nous nous sentions tous des camarades, croyant que les différences d’approche théorique, politique ou militaire n’étaient que des nuances passagères, excusables et récupérables dans une dynamique ascendante, sans comprendre que ces attitudes étaient fondamentales, discriminantes et finalement déterminantes.
[1] « Ci piace di più Marzotto a testa in giù ! » en version originale.
[2] On entend ici par « stragi di Stato » (« massacres d’État ») les attentats aveugles perpétrés à coups de bombes dans des banques, des trains, des places remplies de manifestants, commis afin de propager la peur de la subversion et favoriser la mise en place d’un État autoritaire.
[3] Lire Cesare Bermani, Il nemico interno. Guerra civile e lotte di classe in Italia (1943-1976), Rome, Odradek, 1997, p. 308 et suivantes.
[4] Alcide de Gasperi, démocrate-chrétien, fut le premier président du Conseil de la République italienne, de 1946 à 1953. Palmiro Togliatti, l’un des fondateurs du Parti communiste d’Italie en 1921, secrétaire général du PCI au sortir de la guerre, fut victime d’un attentat le 14 juillet 1948, ce qui déclencha dans toute l’Italie un mouvement insurrectionnel réprimé dans le sang par l’État démocrate-chrétien et stoppé par le dirigeant communiste lui-même, qui prônait la voie électorale pour accéder au gouvernement et rejetait l’insurrection et la guerre civile.
[5] Lire Fabien Archambault, « On a tiré sur Togliatti ! La difficile interprétation de l’attentat du 14 juillet 1948 », Cahiers de l’Institut d’histoire de la Révolution française, n° 1, 2012.
[6] Mario Scelba fut l’homme fort de la DC au cours des deux décennies suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale, au poste de ministre de l’Intérieur ; anti-communiste déclaré, il réprima brutalement les grèves et les manifestations ouvrières de ces années-là. Fernando Tambroni, lui aussi démocrate-chrétien, fut président du Conseil en 1960, formant un gouvernement avec l’appui des héritiers du fascisme, le Movimento sociale italiano (MSI).
[7] Lire Emilio Franzina et Ezio Maria Simini, « Romero ». Igino Piva, memorie di un internazionalista, Odeon Libri, Schio, 2001.
[8] Lire Mario Moretti, Carla Mosca, Rossana Rossanda, Brigate rosse. Una storia italiana, Baldini & Castoldi, Milan, 2004 ; Sergio Segio, op. cit. ; Nanni Balestrini et Primo Moroni, L’orda d’oro, SugarCo edizioni, Milan, 1988 ; Sergio Bianchi et Lanfranco Caminiti, Gli autonomi. Le storie, le lotte, le teorie, vol. 1, DeriveApprodi, Rome, 2007 ; Isabelle Sommier, La Violence politique et son deuil. L’après-68 en France et en Italie, PUR, Rennes, 2000.
[9] En italien La Meglio gioventù, film sorti en 2003.
[10] Outre la note précédente, lire Prospero Gallinari, Un contadino nella metropoli. Ricordi di un militante delle Brigate rosse, Bompiani, Milan, 2006 ; Luigi Manconi, Terroristi italiani. Le Brigate rosse e la guerra totale, 1970-2008, Rizzoli, Milan, 2008.
[11] Lire Sergio Segio, op. cit., p. 137.
[12] Digos : sigle définissant ce qu’en Italie on appelait familièrement la squadra politica (littéralement : « équipe politique »), équivalent des Renseignements généraux français.
[13] Après de multiples protestations, pétitions, interrogations au Parlement, la cour d’assises d’appel de Trieste, par sentence du 14 juin 1988, reconnaissait que les agents de la Digos avaient tué Pedro volontairement, qu’ils avaient tiré sur lui avec l’intention de le tuer, mais « pour avoir agi en état de légitime défense putative, à savoir dans la conviction erronée d’avoir couru le risque d’une agression », ils furent condamnés à des peines très légères et rapidement amnistiés.