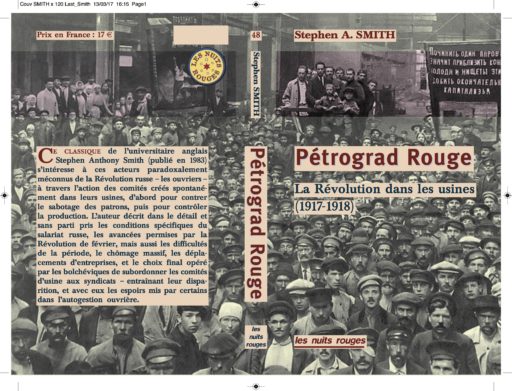
Stephen A. Smith, Pétrograd Rouge. La Révolution dans les usines (1917-1918), éd. les Nuits Rouges, 2017, 17€.
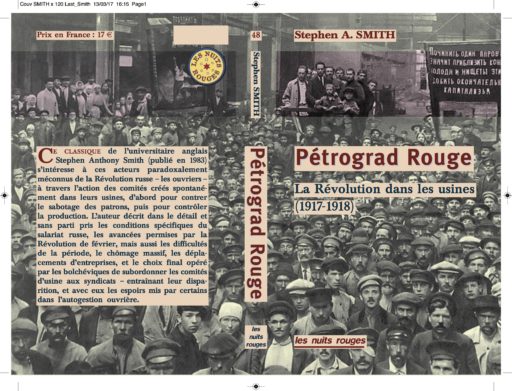
Ce livre explore l’impact de la révolution de 1917 sur la vie des usines dans la capitale russe. Il retrace les tentatives des travailleurs de prendre le contrôle de leurs vies de labeur depuis la Révolution de février jusqu’à juin 1918, lorsque les bolchéviques nationalisèrent l’industrie. Bien que son souci premier ne soit pas les développements politiques de la révolution, ce livre montre que la sphère de la production industrielle fut un lieu crucial du conflit tant politique qu’économique.
Après avoir examiné la structure et la composition de la main d’œuvre pétrogradoise avant 1917 ainsi que les salaires et les conditions de travail sous l’ancien régime, le Dr Smith montre comment les travailleurs vécurent le renversement de l’autocratie comme l’occasion de démocratiser les usines et d’améliorer leur sort. Après avoir décrit la création et les activités des comités d’usine, il analyse les relations des différents groupes ouvriers avec le nouveau mouvement ouvrier, et évalue le degré de démocratie qui y régnait effectivement.
Le thème central du livre est la mise en œuvre par les comités du contrôle ouvrier sur la production. Smith rejette l’interprétation occidentale dominante qui juge ce mouvement comme « anarcho-syndicaliste », montrant que ses perspectives idéologiques étaient proches, sinon toujours identiques, à celle défendue officiellement par le Parti bolchévique. Dans les faits, le contrôle ouvrier fut une tentative pratique de maintenir la production et de préserver les emplois dans une situation de chaos économique grandissant. Arrivant au pouvoir en octobre, les bolchéviques envisagèrent d’abord une extension du contrôle ouvrier, tandis que les comités poussaient à la nationalisation de l’industrie et à la gestion ouvrière. Toutefois, l’effondrement de l’industrie et la réticence des employeurs convainquit la direction bolchévique que ce moyen de restaurer l’ordre dans l’économie n’était pas approprié, ce qui les conduisit à placer les comités sous la tutelle des syndicats en 1918.
Smith montre bien jusqu’à quel point le programme réellement révolutionnaire des bolchéviques fut entravé par leur propre idéologie ainsi que par les conditions économiques et sociales dans lesquelles la révolution avait surgi. Au-delà, il replace la lutte dans les usines dans une perspective internationale comparative. Ce livre s’adresse non seulement aux historiens de la Russie et de la révolution de 1917, mais aussi à tous ceux qui étudient l’histoire ouvrière et la théorie révolutionnaire.
(…) Cet ouvrage est consacré aux rapports entre le pouvoir de la classe tel qu’il se manifestait dans le monde du travail et le processus d’ensemble de la Révolution russe. Il tente de mesurer son impact dans les usines de Pétrograd au cours de l’année 1917. Son thème central est la lutte des ouvriers pour abolir l’ordre autocratique de l’usine tsariste, leurs efforts pour imposer le contrôle ouvrier de la production et leurs tentatives tâtonnantes d’organiser la vie dans les usines sur de nouvelles bases. Nous ne nous intéresserons pas particulièrement à l’émergence d’une conscience politique révolutionnaire parmi les ouvriers pétrogradois, et par conséquent les événements, les partis politiques et les personnalités qui sont au cœur d’autres récits de la révolution resteront ici à l’arrière-plan. Néanmoins, en mettant au premier plan les activités des ouvriers concernant leur travail et la production, nous espérons projeter de nouvelles lumières sur l’ensemble des développements de 1917, en particulier en démontrant que la sphère de la production était elle-même un important lieu de conflit tant politique qu’économique.
Bien que la séparation de l’économie et de la politique soit une marque distinctive de la société capitaliste moderne, l’inégale distribution du pouvoir à l’intérieur de la sphère productive est essentielle au maintien d’un pouvoir de classe dans la société au sens large. Si l’on peut définir le pouvoir comme la capacité d’un groupe social à contrôler l’environnement physique et social, et donc à faire prévaloir ses intérêts sur ceux des autres groupes, alors il est clair que les directeurs et les ouvriers ne jouissent pas d’un pouvoir égal dans le processus de production. Les deux parties n’ont pas le même accès aux ressources et le même pouvoir de nuisance, qu’il soit matériel ou idéologique. En 1917, l’inégale répartition du pouvoir dans la production fut un souci majeur des ouvriers de Pétrograd, et leurs luttes pour augmenter leur pouvoir dans ce domaine eurent des conséquences majeures dans la balance des forces sociales au sein de la société au sens large et dans l’établissement final d’un nouveau pouvoir d’Etat.
Cette perspective n’est pas sans incidences sur notre analyse de l’activité de la classe ouvrière en 1917, car elle indique que nous devons abandonner toute dichotomie simpliste entre les luttes « économiques » et les luttes « politiques » des ouvriers – c’est-à-dire entre les luttes qui se placent dans la sphère de la production et celles qui se déroulent sur le terrain de l’Etat. Dans le discours marxiste, cette dichotomie apparaît en filigrane de la distinction léniniste entre les luttes « trade-unionistes » et les luttes « sociales-démocrates ». Bien qu’il n’ait pas été toujours constant dans cette conception, la doctrine de Lénine tendait à démontrer que les luttes spontanées des ouvriers pour l’amélioration de leurs salaires et de leurs conditions de travail ne pouvait déboucher que sur une conscience « trade-unioniste », dont les particularités majeures sont l’économisme et le localisme, et que c’est seulement par l’intervention d’un parti révolutionnaire que les ouvriers pourront susciter une conscience révolutionnaire des réalités de la société capitaliste. L’expérience de 1917 suggère que cette rigide dichotomie doit être assouplie. En cette année, dans un contexte de crise économique, les luttes sociales intenses pour la défense du niveau de vie et des emplois conduisirent « spontanément » les ouvriers, dans une large mesure, à voir dans les options révolutionnaires proposées par les bolchéviques la solution « naturelle » à leurs problèmes immédiats. Bien plus, les thèses léninistes ouvraient des perspectives de pouvoir et de contrôle de la production. Dans beaucoup de cas, on rencontrait des résistances ouvrières à l’autorité des employeurs, de sorte que (…) le périmètre du contrôle ouvrier était en mouvement continuel.
Un léniniste orthodoxe pourrait dire que de tels conflits autour de la maîtrise du processus de travail ne sont que des variantes des combats économiques, dans la mesure où ils ne font qu’empiéter sur le pouvoir de la direction, sans la supplanter. Mais, même lorsqu’ils se placent dans un cadre défensif, de tels conflits témoignent de la volonté des ouvriers d’imposer leurs points de vue dans une situation donnée. L’expérience de 1917 montre une nouvelle fois que lorsque le pouvoir étatique est relativement inopérant, de telles luttes ouvrières défensives pour contrôler la production peuvent rapidement devenir offensives et viser à prendre le pas sur le pouvoir des directeurs ; et aussi que ces luttes ont de profondes implications quant à la répartition des pouvoirs dans la société dans son ensemble. Ce sont les luttes des ouvriers et l’activité des organisations agissant sur les lieux de travail, tels que les comités d’usine et les syndicats, qui furent d’une importance centrale dans le développement de la conscience révolutionnaire en 1917. Ce qui ne veut pas dire que cette conscience se soit développée seulement à partir des luttes menées dans les usines. En 1917, le sentiment révolutionnaire a grandi en réponse aux nombreux problèmes qu’avait à résoudre le peuple russe – problèmes créés par la guerre, l’incapacité gouvernementale et la crise dans les campagnes. Ce qui ne veut pas dire non plus que cette conscience révolutionnaire ait crû sous une forme purement « spontanée ». L’agitation bolchévique a joué un rôle crucial dans l’articulation de cette conscience. Mais les bolchéviques ne l’ont pas créée à eux seuls ; elle s’est développée avant tout à partir des tentatives des ouvriers de résoudre leurs problèmes de survie. (pp. 12-14). (…)
Le mot d’ordre du contrôle ouvrier surgit « spontanément » parmi les ouvriers de la ville au printemps 1917. Les bolchéviques n’y étaient pour rien et, à supposer qu’il y eut un géniteur idéologique, il tenait plutôt à l’anarcho-syndicalisme qu’à la sociale-démocratie. On trouve sa genèse dans les écrits de socialistes utopiques du xixe siècle tels que Charles Fourier et Robert Owen qui voyaient dans les coopératives de petits producteurs le moyen d’échapper à l’aliénation de la société industrielle. Ce thème trouvera un écho plus tard dans l’œuvre de Pierre Kropotkine, particulièrement dans son Champs, usines et ateliers (1898). C’est en France, cependant, dans la dernière décennie de ce siècle que les ouvriers qualifiés, qui luttaient pour défendre la maîtrise de leur travail contre leurs employeurs, forgèrent le mot d’ordre de « contrôle ouvrier ». Les syndicalistes-révolutionnaires avaient développé une praxis qui rejetait les partis et les luttes politiques au profit de la primauté de la lutte de la classe ouvrière, devant l’amener au moyen des syndicats et des bourses du travail, jusqu’à la grève générale qui ferait s’effondrer l’Etat et le grand capital. La société future ne serait pas dirigée par un Etat centralisé mais constituée de petites unités économiques régies par les producteurs eux-mêmes. Les socialistes comme De Leon et les wobblies en Amérique, ou le mouvement des Guild Socialists en Grande-Bretagne, approfondirent cette notion de contrôle ouvrier. Il est difficile de savoir laquelle de ces influences fut déterminante dans l’introduction de cette notion en Russie. Quelques groupes anarcho-syndicalistes apparurent durant la Révolution de 1905, principalement à Odessa et à Pétersbourg, mais antérieurement à 1917 on n’a pas d’indications que le contrôle ouvrier ait pu compter parmi les revendications ouvrières ; et lorsqu’il apparut au printemps 1917, il n’était pas formulé dans les termes du discours syndicaliste ou anarchiste.
Ces deux tendances donnèrent des renseignements remarquablement différents quant à leur influence respective au cours de la Révolution russe. L’anarcho-syndicaliste G. Maksimov et l’anarchiste A. Berkman l’ont grandement exagérée, hors de toute proportion avec leur importance numérique. Maksimov, qui fut pendant une courte période membre du Conseil central des comités d’usine de Pétrograd, prétend que leur idéologie était proche de l’anarcho-syndicalisme. Mais d’autres anarchistes, cependant, ayant également pris part aux événements de 1917, voyaient les choses tout à fait autrement. Voline, futur éditeur de Golos Trouda (La Voix du Travail), premier journal de cette tendance à Pétrograd, raconte qu’à son retour des Etats-Unis à l’été 1917, « les anarchistes n’étaient qu’une poignée d’individus sans influence » et se rappelle qu’à sa grande surprise, « au cinquième mois d’une grande révolution aucun journal anarchiste, aucune voix anarchiste ne se faisait entendre dans la capitale [face à] l’activisme sans limite des bolchéviques ». En novembre, un périodique libertaire de Pétrograd affirmait : « Jusqu’à présent, l’anarchisme n’a eu qu’une influence extrêmement limitée sur les masses, ses forces sont faibles et insignifiantes, et l’idée elle-même en est corrompue et déformée. » Qui doit-on croire ?
Fidèle à sa philosophie peut-être, l’anarchisme comme force politiquement organisée était donc extrêmement faible. Au moment de la Révolution de février, on comptait seulement 200 membres d’organisations anarchistes, et, à la fin 1917, 33 groupes et 21 journaux pour toute la Russie. A Pétrograd, des groupes anarchistes réapparurent dans les arrondissements de Vyborg, de Narva et de Moskovski au cours de la guerre mais ils ne comptaient qu’un nombre infime de membres. Le plus important appartenait à la tendance anarcho-communiste, dont l’idéologie était empruntée à Kropotkine, et coexistait avec d’autres courants anarcho-syndicalistes moins influents. Tous ne rassemblaient que peu de militants et de ressources organisationnelles. Au cours de 1917, la marée montante du chaos économique combinée avec l’impuissance gouvernementale renforça l’attrait politique et émotionnel de l’anarchisme dans certaines couches ouvrières, et particulièrement parmi les marins et les soldats. Ils admiraient la bravoure dont ces militants avaient fait preuve lors de la prise de l’imprimerie du journal de droite Rousskaïa Volia (La Volonté de la Russie) le 5 juin ou lors du raid contre la prison des Kresty deux semaines plus tard. A peu près à la même époque, l’expulsion des anarchistes de la villa Dournovo renforça la sympathie publique pour la cause et fut aussi l’un des facteurs déterminants de l’explosion populaire des Journées de juillet. Les anarchistes s’exprimaient rarement sous une forme un peu plus recherchée ou argumentée. Des slogans sommaires comme « Volez les voleurs ! » ou « Exterminez la bourgeoisie et ses larbins ! » faisaient mouche parmi les ouvriers désespérés et frustrés. Ils pouvaient séduire aussi les ouvriers qui regardaient par ailleurs avec sympathie les bolchéviques. Mais alors que la politique officielle de ce parti tendait à canaliser la colère et la frustration ouvrière, les anarchistes s’efforçaient de nourrir cette colère, dans le but de déclencher une explosion populaire dont l’onde de choc balaierait le gouvernement Kérenski et le système capitaliste. A la fin juin, et plus tard en octobre, les bolchéviques perdirent presque le soutien de ces groupes d’ouvriers mécontents, du fait de leur politique prudente et retenue ; et ce fut en partie le danger de les voir passer aux anarchistes qui convainquit Lénine que la prise du pouvoir ne pouvait plus être remise différée. Il reste que l’attrait des anarchistes chez les ouvriers de Pétrograd fut minoritaire et qu’à l’intérieur du mouvement ouvrier organisé leur influence était très limitée.
Lors des conférences des comités d’usine de Pétrograd, les anarchistes furent toujours très minoritaires. A la première d’entre elles, tenue à la mi-mai, une résolution anarchiste modérée, présentée par I. Jouk, le président du comité du chantier naval de Chlisselbourg, recueillit 45 suffrages contre 290 pour la résolution bolchévique. A la IIe Conférence, la résolution bolchévique présentée par Milioutine fut adoptée avec 231 voix contre 26 et 22 abstentions ; celle présentée par Voline ne recueillant qu’à peine 8 voix. A la Ière Conférence nationale d’octobre, la résolution de Milioutine eut 65 voix, celle de Jouk, 5 seulement. Toutefois, Milioutine crut nécessaire de prendre la peine de réfuter la motion anarchiste sur la saisie des usines par les ouvriers, ce qui laisse supposer qu’à la base l’influence de ce courant était peut-être en expansion. Cela est confirmé par une source menchévique qui regrettait que 18 000 ouvriers aient voté pour des candidats anarchistes lors des élections des comités d’usine de Pétrograd en octobre, encore qu’on ne voit pas très bien à quelles élections précises cette source se référait.
Bien qu’on dispose de preuves du rayonnement croissant de l’anarchisme à l’automne 1917, il n’apparaît pas que ses conceptions aient été hégémoniques au sein du mouvement des comités d’usine, que ce soit à son sommet ou à sa base. Voline définissait « l’idée anarchiste » comme la transformation des bases économique et sociale de la société, sans devoir recourir à un Etat politique, à un gouvernement ou à une dictature quelconque. C’est-à-dire faire la Révolution et régler ses problèmes non par des moyens politiques ou étatistes, mais par l’activité naturelle et libre des associations de travailleurs eux-mêmes, une fois renversé le dernier gouvernement capitaliste.
Rien n’indique que ce fut l’aspiration de plus d’une poignée d’ouvriers de Pétrograd. Presque rien dans la pratique des comités ne montre qu’ils avaient rejeté les concepts de pouvoir d’Etat, de lutte politique ou d’économie planifiée et centralisée. William Rosenberg a sûrement raison lorsqu’il affirme que « la masse écrasante des ouvriers russes n’avait aucune idée de ces perspectives [syndicalistes], tout comme les organisations, les publications et les militants susceptibles de les développer ». Nous espérons démontrer maintenant que le mouvement pour le contrôle ouvrier, loin d’être animé par une utopie anarchiste projetée sur les comités d’usine, fut, dans ses débuts au moins, plus préoccupé par le but beaucoup plus prosaïque de limiter les perturbations dans l’économie, de maintenir la production et de sauver les emplois. (pp. 197-201). (…)
On ne peut comprendre le processus révolutionnaire de 1917 indépendamment de la détérioration rapide de l’économie. Les historiens occidentaux ont été tellement « fascinés » par les événements stupéfiants de cette annus mirabilis qu’ils n’ont pas vu jusqu’à quel point cette situation a pu accroître la crise politique, ou jusqu’à quel point le combat pour assurer les besoins matériels de base fut la force motrice sous-jacente à la radicalisation des ouvriers et des paysans. On eut dès 1916 des signes alarmants d’une prochaine calamité économique, mais ce ne fut pas avant l’été 1917 que la crise se manifesta pleinement sous la forme de pénuries de nourriture, de combustible et de matières premières. Les productions de charbon, de fer et d’acier s’étaient effondrées et même le combustible et les matières premières que l’on pouvait produire n’atteignaient pas les centres industriels du fait de la défaillance du système de transports. Pétrograd était particulièrement touchée parce qu’isolée sur la côte ouest de l’Empire, bien loin des puits de pétrole et des gisements de minerais du Sud. En septembre, la production de biens manufacturés avait chuté de 40 % par rapport à ce qu’elle était au début de l’année. Les pénuries de toutes sortes, la montée en flèche des coûts de production, la productivité déclinante du travail et l’accélération des conflits sociaux décourageaient les industriels, de plus en plus réduits à devoir choisir entre la faillite et le dépôt de bilan.
Le contrôle ouvrier de la production fut d’abord et surtout une manière pour les comités d’usine d’endiguer la vague du chaos qui déferlait sur l’industrie. Il obéissait à une impulsion qui, loin d’être idéologique, était surtout d’ordre pratique au début. Ce fut le comité de Poutilov qui prit l’initiative de convoquer une conférence des comités d’usine en mai. Il en discuta d’abord avec le comité de la direction de l’Artillerie, mais comme l’argent manquait pour financer l’événement, on alla chercher la somme nécessaire auprès du comité d’usine bolchévique de chez Parviainen. Le but de la conférence fut précisé lors du discours d’ouverture du socialiste-révolutionnaire V. M. Lévine :
Tous les ateliers et les usines de Pétrograd sont en crise, mais les directions ne font pas assez d’efforts pour fournir leurs établissements en quantités suffisantes de matières premières et de combustibles. De sorte que les travailleurs se retrouvent au chômage, à la merci du tsar Famine. En conséquence, ce sont les travailleurs eux-mêmes qui doivent y remédier, puisque les employeurs ne font rien. Seule l’organisation unifiée des comités d’usine à travers toute la Russie, et pas seulement à Pétrograd, pourra le faire. Il est clair que pour cela il doit y avoir partout des organisations de travailleurs qui agiront de concert pour intervenir dans la vie industrielle d’une manière organisée.
La conférence discuta de l’état de la production à Pétrograd, de son contrôle, de sa régulation et de sa continuité ; des tâches des comités d’usine ; du chômage et de la reconversion de l’industrie de guerre ; du rôle des comités d’usine au sein du mouvement syndicaliste ; de leur relation avec les bureaux de placement et les coopératives et, finalement, de la création d’un centre économique unifié, rattaché au Bureau central des syndicats. La IIe Conférence des comités d’usine (7-12 août) fut marquée par les mêmes préoccupations économiques pratiques, bien qu’on y parlât aussi politique. A l’ordre du jour figuraient trois questions : a) la situation économique des entreprises (carburant, matières premières, ravitaillement alimentaire et niveau de la production) ; b) la situation générale et les fonctions du contrôle ouvrier ; c) le chômage, l’évacuation des usines et la reconversion de l’industrie.
Des historiens, tels que F. I. Kaplan, prétendirent que ce qui se disait à la Conférence était une chose et que ce que faisaient les comités en était une autre. Dans la majorité des cas, et dans les premiers temps, leur principale préoccupation était de préserver l’emploi plutôt que d’instituer l’autogestion ouvrière. Le 8 novembre, le comité de l’usine mécanique Franco-Russe envoya à la direction une lettre qui commençait ainsi : « La production et le cours normal de la vie à l’usine sont la tâche et la préoccupation majeure des comités. » De son côté, son homologue de la manufacture d’armes Sestroretsk affirmait : « Dès le début, nous avons été soutenus par l’idée que notre but principal doit être de maintenir la production dans l’usine coûte que coûte. » Pour établir que, pour beaucoup de comités d’usine, le contrôle ouvrier était une question de survie plutôt qu’une aspiration utopique, il vaut la peine d’examiner en détail deux domaines où les comités exercèrent d’abord leur « contrôle », à savoir l’utilisation du combustible et celle des matières premières.
La pénurie de combustible touchait tous les établissements de Pétrograd, mais les grandes usines étaient particulièrement affectées. La IIe Conférence des comités d’usine de Pétrograd tout comme la Ière Conférence panrusse des comités d’usine qui se tint en octobre traitèrent de cette situation, mais ce fut à la base que se prirent les mesures les plus effectives. Dès mars et avril, les comités de Vulcain et de Poutilov s’employèrent à trouver du combustible. Aux chantiers navals Nevski, la direction protesta contre la surveillance officieuse de la production exercée par le comité d’usine, mais le 10 mai elle lui fit part néanmoins de son intention de fermer certains ateliers, à moins que l’on puisse trouver de nouveaux approvisionnements en carburant. Le comité accepta alors de se lancer dans cette recherche. Depuis le début de l’été, les comités de l’Usine de tubes, de l’Arsenal, de Rosenkrantz et d’autres sites commencèrent à envoyer des « prospecteurs » (tolkatchi) dans le Donbass et dans d’autres régions du Sud en quête de combustible. Chez Poutilov, la pénurie était particulièrement aiguë ; le comité d’usine créa une commission ad hoc qui envoya lui aussi des prospecteurs dans les régions productrices, mais ils revinrent bredouilles. A l’automne, la production de l’usine était tombée à un tiers de son niveau habituel. En conséquence, le comité créa une commission technique pour alimenter les fours en bois de chauffage. Le 20 octobre, le comité écrivit à la Commission spéciale de défense, demandant des informations sur le combustible disponible à Pétrograd et proposant de se charger des livraisons, mais la Commission n’avait pas grand chose à lui offrir. Puis, le Conseil central des comités d’usine annonça qu’il réquisitionnerait le carburant de toute usine qui détiendrait plus de trois mois de réserves afin de le donner aux centrales électriques, aux stations d’alimentation en eau potable et aux moulins, là où il était le plus nécessaire.
La plupart des comités d’usine contrôlaient activement les stocks de matières premières et leurs mouvements. En avril, le comité de la Cartoucherie demanda que l’on pèse les matériaux entrant sur le site. Le 7 avril, une assemblée générale du personnel de la fabrique de bâches Kebké décida de lancer une enquête sur des toiles enlevées par la direction. A l’usine du cuir Paramonov, le comité contrôlait tous les biens qui entraient et sortaient de l’usine. A la Compagnie de construction de wagons, le comité interdit à la direction de faire sortir des planches de sapin des locaux. Chez Rosenkrantz, la direction nia posséder encore des pièces détachées lorsque le Comité des industries de guerre en fit la demande, mais le 14 juillet, le comité d’usine découvrit 4 000 pouds (65,5 tonnes) de métal ; il les offrit à des usines à l’arrêt.
A l’été, les comités d’usine étaient donc occupés à se partager le peu de carburant et de matières premières qui restaient. Leur Conseil central participa à diverses commissions gouvernementales pour obtenir des renseignements sur l’état des stocks et en assurer une distribution équitable. Il pouvait ainsi aider les comités d’usine locaux à obtenir quelques fournitures. Aux ateliers Brenner, le comité se vit refuser un prêt par le ministère du Travail destiné à acheter des matières premières. Il se tourna alors vers le comité des délégués d’atelier de Triangle, qui accepta de leur allouer 15 000 R tirées de sa caisse de grève ; le comité de Poutilov donna aussi quelques pièces détachées. Le comité ouvrier de Rosenkrantz offrit un peu de laiton aux usines Baranovski et Ekval. Celui de Sestroretsk reçut un peu d’acier auto-durcissant de la part de Poutilov.
A l’automne, les comités d’usine étaient sur leurs gardes contre les tentatives camouflées des directions de saboter la production. Alors que leurs usines étaient menacées de fermeture par manque de métaux, les directions de chez Duflon, de l’usine de fabrication de boîtes Markov et de l’usine de transformation des métaux et du bois Nevski vendirent les stocks de métal restants à des prix exorbitants, avant de tenter de mettre la clé sous la porte. Mais elles en furent empêchées par leurs comités respectifs. Chez Bezdek, une fabrique de friandises, le comité dénonça son patron aux autorités pour commerce spéculatif de sucre.
Les activités des comités d’usine visant à « contrôler » les stocks de carburant et de matières premières étaient, on le voit bien, dictées par la nécessité pratique de maintenir la production plutôt que par celui de s’emparer des entreprises. Cependant, comme la crise économique s’approfondissait, et que la lutte des classes s’intensifiait, les formes du contrôle ouvrier devenaient toujours plus ambitieuses et le mouvement plus révolutionnaire et contestataire. Pour résumer, dans les sept mois qui séparent février et octobre, d’essentiellement passifs, défensifs et cantonnés dans une position d’observation, les comités d’usine devinrent actifs, offensifs et interventionnistes. Après ne s’être occupés que de la supervision de la production, le contrôle ouvrier évolua vers l’intervention active dans la production et la limitation draconienne de l’autorité du capital. Il est difficile de préciser les moments-clés de cette trajectoire, car le rythme suivant lequel les diverses entreprises s’orientèrent vers un mode plus actif et agressif de contrôle ouvrier variait selon les conditions spécifiques à chacune d’entre elles. On peut distinguer néanmoins quatre phases, chacune reliée aux successives conjonctures économiques et politiques du processus révolutionnaire. Dans la première période, de mars à avril, le contrôle ouvrier fut confiné pour l’essentiel dans les entreprises d’Etat. Les comités d’usine tentèrent partout d’y imposer un contrôle des embauches et des licenciements, dans le cadre d’une action plus vaste visant à introduire la démocratie dans les entreprises. Les employeurs étaient optimistes et enclins à faire des concessions. Dans la seconde phase, comprise entre mai et juin, beaucoup de comités d’usine commencèrent à surveiller les fournitures en matières premières et en carburant, et à s’assurer que leurs usines fonctionnaient de manière efficace. C’est au cours de cette période que les bolchéviques devinrent hégémoniques dans le mouvement. Dans la troisième phase, entre juillet et août, la crise économique éclata et la lutte des classes s’approfondit. Les employeurs passèrent à l’offensive et tentèrent de contrer les pouvoirs des comités d’usine, lesquels créèrent alors des « commissions de contrôle » pour superviser tous les aspects de la production, dont la gestion des commandes et la comptabilité. Dans la quatrième période, qui s’étend de septembre à octobre, ces évolutions se précipitèrent dans le contexte de la crise économique et politique sévère qui exacerbait les conflits de classe. Quelques employeurs tentèrent de fermer leurs usines et dans trois cas les comités prirent alors effectivement la direction de leurs établissements. L’implication de plus en plus active des comités dans la bataille pour donner le pouvoir aux soviets et pour imposer le contrôle ouvrier, en réponse aux difficultés économiques, s’entremêlait ainsi à leurs aspirations à la démocratisation des entreprises, et à celles plus tâtonnantes à l’autogestion ouvrière. (pp. 201-207) (…)
Tout au long de 1917, le contrôle ouvrier avait visé principalement à minimiser les conséquences de la désorganisation capitaliste de l’industrie, mais il n’était pas animé que par cela : il visait aussi à démocratiser les relations sociales à l’intérieur des entreprises et à fonder de nouvelles manières de travailler par lesquelles les travailleurs pourrait prendre un maximum d’initiatives, de responsabilités, et faire preuve de créativité. En dehors de cela, émergeait une volonté d’autogestion ouvrière, qui devint évidente après octobre. Bien que des références explicites à l’autogestion (samo-oupravlenié) fussent assez rares dans le discours des comités d’usine, le concept était au cœur de leurs pratiques. Lorsque les travailleurs évoquaient l’entreprise « démocratique », ou parlaient de prendre l’usine « en main », ils parlaient bien d’autogestion. Après octobre, bien que les comités d’usine plaidaient pour une économie planifiée, possédée par l’Etat, ils ne croyaient pas que le transfert de la propriété des entreprises, du privé vers l’Etat prolétarien, suffirait à lui seul à mettre fin à l’assujettissement et à l’oppression des travailleurs. De manière vague et incohérente, les dirigeants des comités reconnaissaient qu’à moins que ce transfert s’accompagne d’un transfert de pouvoirs au niveau de l’atelier, l’émancipation du travail restera une chimère. Au cours de l’hiver 1917-18, les comités célébrèrent dans leur discours, et surtout dans leur pratique, l’initiative directe des producteurs directs dans la transformation du processus productif. Ce qui apparaît comme une accélération de l’ « anarchisme » dans le mouvement pour le contrôle ouvrier après octobre est, dans une large part, une reconnaissance que les relations hiérarchiques de domination et d’autorité à l’intérieur des entreprises devaient être remises en cause, si les rapports de production capitalistes au sens large devaient être abolis. Cette reconnaissance, cependant, restait confuse et ne fut jamais formulée dans la perspective d’une transition vers le socialisme différente de celle de Lénine et de la majorité de la direction bolchévique. » (chap 9, pp. 311-312)
Dans quelle mesure le contrôle ouvrier s’était-il transformé en gestion ouvrière au moment où le gouvernement nationalisa toutes les entreprises à la fin juin 1918 ? La réponse est difficile car il est impossible de tracer une nette séparation entre contrôle et autogestion. A Pétrograd, la gestion ouvrière semble avoir été confinée dans une minorité d’entreprises. L’historien soviétique M. N. Potekhine a calculé qu’au 1er avril, 40 entreprises étaient nationalisées ; 61 étaient gérées temporairement par les comités d’usine ; 270 étaient sous contrôle ouvrier et 402 étaient toujours dirigées par leurs propriétaires ; ces dernières étant, dans leur écrasante majorité, des petits ateliers. Par conséquent, dans les grandes usines, le contrôle ouvrier était toujours la norme. En pratique, cela signifiait que la direction officielle coexistait avec le comité d’usine, et que ses décisions étaient soumises à sa ratification ou à celle de sa commission de contrôle. Les organes de contrôle veillaient à l’exécution des diverses tâches, examinaient l’état des machines, des finances, des commandes, de la comptabilité, des combustibles et des matières premières. De plus, les comités étaient compétents en matière de licenciements, de discipline, productivité et conditions de travail. Dans les entreprises dont ils avaient la responsabilité complète, on considérait généralement cette situation comme provisoire, un arrangement de circonstance jusqu’à ce que le gouvernement les nationalise formellement et nomme une nouvelle direction. Les modes de gestion des entreprises officiellement nationalisées variaient grandement. Dans les anciennes entreprises d’Etat, les directions furent progressivement réorganisées. Ainsi, la nouvelle direction mise en place à l’usine Oboukhov, le 20 janvier, comprenait huit ouvriers, deux membres du personnel technique, l’ingénieur en chef et un représentant des employés. Dans certaines entreprises privées nationalisées, le conseil d’administration comprenait des ouvriers et des techniciens, des représentants du syndicat et du sovnarkhoze. Cependant, souvent, la commission de contrôle restait en fonction, le seul changement étant qu’un commissaire responsable devant le VSNKh avait été désigné pour superviser strictement la production. Dans quelques cas, l’ancienne direction était maintenue, mais sous le contrôle d’un commissaire du VSNKh. C’est pourquoi, dans l’ensemble, les situations variaient considérablement, bien qu’on pouvait observer depuis octobre une évolution significative dans la participation ouvrière à la direction des entreprises. (chap. 10, pp. 330-331) (…)
Il est possible de comprendre le cruel dilemme auquel furent confrontés les bolchéviques en 1918. Ils avaient l’intention de créer un socialisme démocratique mais leur priorité devint la reconstruction des forces productives et particulièrement la restauration de la discipline au travail. A court terme, l’utilisation limitée des formes de contraintes, l’application en particulier des méthodes capitalistes de discipline et d’intensification du travail étaient certainement inévitables. Pour autant, la plupart des dirigeants bolchéviques ont semblé ne pas avoir réalisé les dangers que posait au socialisme démocratique l’utilisation sur le long terme de méthodes qui sapaient l’auto-activité des ouvriers dans la production. C’était une conséquence du cadre idéologique à l’intérieur duquel ils concevaient les problèmes de la construction du socialisme. Ce cadre – que, pour une bonne part, ils avaient hérité de la IIe Internationale – interprétait les forces productives d’une façon étroite et techniciste ; et concevait la productivité et l’organisation du travail engendrées par la société capitaliste comme intrinsèquement progressistes. De plus, à l’intérieur de ce cadre conceptuel, il n’y avait pas de notion d’activité autonome ouvrière dans la sphère de production comme élément constitutif de la transition au socialisme. La chose était particulièrement frappante.
Si les bolchéviques s’étaient montrés plus critiques envers les conceptions de la IIe Internationale, ils auraient peut-être été plus conscients des dangers d’utiliser, même à titre exceptionnel, des méthodes coercitives pour rétablir les forces productives épuisées. Qu’une telle compréhension aurait pu empêcher la dégénérescence de la révolution socialiste démocratique sur le long terme, comme le suggérait Charles Bettelheim, semble cependant douteux, étant donné la persistance de la guerre, de l’isolement économique et de l’arriération culturelle. L’expérience déprimante des sociétés socialistes montre que les impératifs du développement économique et social dans les sociétés sous-développées nécessitent ce type de coercition qui, en dernière instance, entre en conflit avec l’établissement de relations sociales libres. En d’autres termes, même si le gouvernement bolchévique avait été plus perspicace quant aux dangers que comportaient les méthodes qu’il avait été forcé d’adopter, il semble probable que les circonstances objectives auraient eu finalement le dessus pour vider le socialisme de ses composantes démocratiques. Ainsi, inconscient des risques qu’il courait, le gouvernement fut rapidement forcé de suivre un chemin qu’il n’avait jamais envisagé d’emprunter en octobre 1917. Et, dès 1921, les bolchéviques n’incarnaient plus un socialisme de liberté, mais de pénurie, dans lequel les aspirations à la libération individuelle et humaine étaient fermement subordonnées aux exigences du développement économique. » (pp. 359-361)
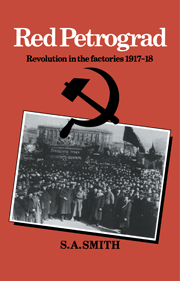
*
Image en bandeau : « Soviet de Petrograd », via Wikimedia.