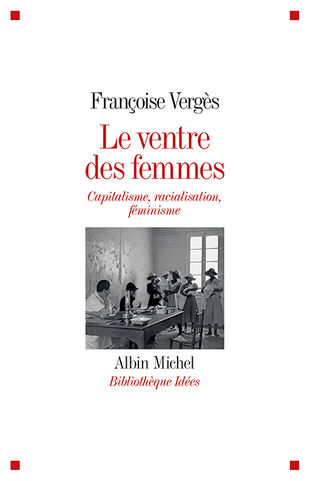
Françoise Vergès est historienne, auteure de nombreux ouvrages dont Abolir l’esclavage. Une utopie coloniale, les ambiguïtés d’une politique humanitaire (Albin Michel, 2001), L’Homme prédateur, ce que nous enseigne l’esclavage sur notre temps (Albin Michel, 2011) et, tout récemment, Le ventre des femmes. Capitalisme, racialisation, féminisme (Albin Michel, 2017).
Elle est par ailleurs titulaire de la Chaire Global South(s) au Collège d’études mondiales (FMSH, Paris), pour laquelle elle a développé plusieurs plateformes, dont l’une avec le Pr. Marcus Rediker autour de l’esclavage et une autre « L’Atelier » avec des artistes, des activistes et des chercheurs ; elle a reçu en résidence l’artiste et réalisatrice féministe Trinh Minh-ha et l’artiste Antariksa (Java). Elle publie en français et en anglais sur les mémoires de l’esclavage, le féminisme décolonial et la colonialité du pouvoir.
Dans cet entretien en deux parties, elle revient tout d’abord sur l’histoire coloniale et postcoloniale du capitalisme français et la situation faite aux femmes colonisées, puis dans une 2nde partie – à paraître très bientôt – sur les enjeux contemporains du féminisme.
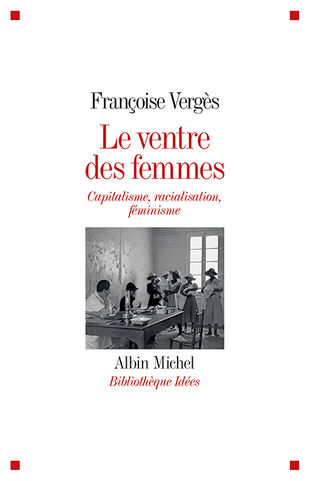
Françoise Vergès – La genèse de ce livre est la suivante : d’une part, pour répondre à l’effort d’intégrer à l’analyse de la colonialité républicaine française ce qu’on appelle les « outre-mer » car ils en concentrent de manière symptomatique nombre d’éléments dont certains se retrouvent en France – exclusion, important taux de chômage, économie « informelle », racialisation du pouvoir, formes de ségrégation – qui aident à comprendre comment le capitalisme libéral et l’État reconfigurent le social et le culturel, comment marche « l’intégration », comment le capitalisme affecte ces zones « jetables ». D’autre part, je suis frappée par l’absence des luttes des femmes dans ces « outre-mer » dans les récits des luttes des femmes en France, même chez les chercheur-e-s « postcoloniaux ». C’est comme si on ne savait pas où les mettre, ou alors en utilisant la grille de lecture des années 1960 comme si rien n’avait changé.
L’histoire qui est racontée dans cet ouvrage – des milliers de femmes avortées et stérilisées sans consentement à l’île de La Réunion de la moitié des années 1960 à 1970, les raisons de cet abus de pouvoir, le silence d’un féminisme « blanc », l’indifférence ou l’ignorance de la gauche française aux singularités des outre-mer, l’application de grilles de lecture dépassées – font écho aux débats actuels sur le racisme structurel, les nouvelles formes de capitalisme, la destruction racialisée de l’environnement, le féminisme blanc et « de couleur » (utiliser « non-blanc » est problématique car le « non » indique un négatif, « de couleur » est rarement utilisé en français, « noir » n’a pas encore le sens politique qu’il a acquis en Angleterre par exemple (indiquant les racisé-e-s), bref on voit la difficulté. Je choisis « de couleur » faute de mieux), et les impasses de la gauche française. Mais aussi, les outre-mer nous enseignent quelque chose sur les formes de pacification, l’idéologie du multiculturalisme, du « métissage » ou de la « diversité », la culturalisation des contradictions, et les impasses des politiques identitaires.
J’insiste sur le fait qu’il faut analyser la « postcolonialité » spécifique aux pays qui furent colonisateurs, ici la France. L’effet-boomerang dont parlait Aimé Césaire – la contamination des structures et des institutions par le colonial/racial – est plus que jamais visible. Comment penser le processus de décolonisation de la société française, plus que jamais urgent (pour les peuples anciennement colonisés d’Asie, d’Afrique, du Proche orient, des Caraïbes ou des Amériques, la question de la décolonisation se pose aujourd’hui autrement) ? Le processus de décolonisation ne signifie pas dans ce cas chasser un occupant, le colon, puisqu’il s’agit du pays des colons, mais identifier comment les siècles de colonisation, les guerres coloniales, les expositions coloniales, les récits de voyage, le cinéma, la littérature, l’art, les disciplines de l’histoire, anthropologie, philosophie, le droit, l’école, ont été traversées, influencées, « contaminées » par le colonial/racial, comment s’est insinuée, dans les pratiques et les imaginaires, une vision de la France et du monde dont la construction n’a pas été indépendante des politiques coloniales. Les principes d’égalité, de liberté et de fraternité n’ont cessé d’être bafoués en France et dans l’empire colonial, mais dans l’empire colonial, il faut reconnaître la dimension racialisée de ces violations.
La France s’enorgueillît de ne jamais avoir eu de lois explicitement « raciales », de lois de ségrégation (le mot « Noir » apparaît dans le titre du « Code noir » mais pas dans ses articles et pourtant c’est un code aux effets raciaux), d’avoir accueilli des artistes Noirs américains fuyant les lois Jim Crow, d’avoir été le lieu de naissance de la Négritude, et cela l’aveugle sur des pratiques, des politiques, des décrets aux effets clairement racistes. Des régimes républicains ont lancé des guerres de conquête, justifié des massacres, des dépossessions, des déportations. La mission civilisatrice de la IIIème République était une idéologie de la suprématie raciale. Tout ça ne s’efface pas comme ça. Genre, sexualité, travail, droits civiques, ont été affectés par l’idéologie inégalitaire qui divisait le monde entre « civilisés » – blancs, européens, chrétiens – et « non civilisés » – tous les autres. Le racisme a entravé l’essor des luttes ouvrières, des luttes féministes, gays, queer, et même des luttes des subalternes. En 2017, les luttes de l’antiracisme politique dérangent profondément car elles insistent sur la manière dont le racisme structure la classe, le genre. En face, l’essor d’un mouvement raciste d’extrême droite, le succès d’ouvrages racistes dont les auteurs sont invités par les médias, le renversement incroyable qui fait que les victimes de racisme deviennent ceux qui le pratiquent ! On entend encore souvent que « c’est du passé », que la république est « métissée », tout cela pour ne pas admettre le racisme et développer une éducation antiraciste. Pourtant, même des institutions gouvernementales démontrent que les discriminations basées sur le nom, la couleur de peau, la religion, l’origine, affectent quotidiennement des milliers de personnes. Malgré tout cela, l’idée que le racisme est une attitude que la moralité condamne continue à dominer. Et l’existence d’une extrême droite raciste permet à la droite et à la gauche de demeurer dans la posture de la dénonciation « ah c’est mal ! » Que le racisme soit structurel, qu’il croise la classe et le genre, qu’il se soit insinué dans les institutions, reste difficile à faire admettre. Il y a des moments où on désespère : vingt fois, cent fois, il faut donner des chiffres, des faits.
Pour construire une société « post-raciste », il faut s’attaquer à ces pratiques, déracialiser les institutions. La « race » n’existe pas, n’arrête-t-on pas de nous dire, certes, mais le racisme oui. Le processus de décolonisation ne concernera pas que la déracialisation des pratiques et des institutions, il réclame de déconstruire les liens de dépendance dans lesquels l’État maintient les outre-mer, de s’attaquer au capitalisme prédateur et destructeur, aux inégalités, aux nouvelles formes de dépossession. Ce n’est pas une politique exclusivement culturelle – changer les mentalités, les imaginaires – mais une politique de justice sociale, de solidarité et d’internationalisme.
La république française pose un cas particulièrement intéressant de postcolonialité au « Nord », en Occident, d’une part, pour son attitude défensive par rapport à son passé colonial – la notion de repentance par exemple, inventée pour ne pas répondre aux demandes légitimes de réparation – d’autre part, parce que c’est un des rares régimes démocratiques européens à contrôler encore directement autant de territoires ayant appartenu à son empire colonial esclavagiste et post-esclavagiste. Cette coexistence de sociétés, chacune avec son histoire, ses langues, ses mémoires, ses cultures, son inscription dans une région du monde, son organisation sociale, ses mythes, avec un État qui fut esclavagiste et colonisateur, qui adhère au capitalisme néo-libéral financier, qui est impérialiste, mérite d’être analysée profondément. Mais aussi l’analyse des mouvements de solidarité de colonie à colonie, d’outre-mer à outre-mer, d’outre-mer à des mouvements en France : qui, comment, pourquoi, quelles contradictions ?
Pour moi, il y a un pays, la « France » et un régime républicain, une république précise, la Vème, née des tensions produites par la guerre en Algérie lancée elle-même par une république, la IVème. La Constitution de la Vème fut écrite par Michel Debré, grand partisan de la colonisation, et même si elle a été modifiée quelque peu depuis 1958, elle posait les bases d’une république « postcoloniale » – adieu les départements coloniaux d’Algérie, empire colonial « disparu » mais maintien des outre-mer – reconfigurant son espace avec « l’Hexagone » (notion inventée en 1962), ou la « métropole », et les « outre-mer ». Cet espace est toujours celui dans lequel nous vivons.
Pourtant, 1962 reste dans les mentalités françaises le moment d’une coupure nette dans son histoire coloniale et sans diminuer sa signification (d’abord pour le peuple algérien et pour ce qu’on appelait alors le « Tiers Monde ») il faut questionner cette périodicité. La république française ayant « perdu » l’Algérie, il n’était pas question qu’elle « perde » d’autres territoires qui lui assuraient une présence militaire, scientifique, économique, culturelle et politique dans le Pacifique, l’Océan indien, les Caraïbes et l’Amérique du sud, qui lui donnaient le statut de second empire maritime, et qui garantissaient des marchés captifs pour ses compagnies de BTP, de commerce, de distribution et des terres où envoyer des fonctionnaires. Elle engage alors une politique répressive (Ordonnance Debré, assassinats, répression violente, fraude électorale systématique, censure, emprisonnements, assignations à résidence..) et une politique d’intégration. Dès les années 1950 en fait, les contours de la politique dans les DOM et TOM sont tracés. Et c’est dans les années 1960-1980 qu’elle se déploie avec force.
On est donc dans un vrai cas de postcolonialité, non pas « là-bas » – la postcolonie dans une ancienne colonie – mais « ici », dans la république. Il s’agit d’analyser les formes de colonialité dans la république. Un État ne peut avoir colonisé pendant des siècles – avec ses juristes établissant des codes d’exception, ses magistrats appliquant des lois iniques, ses administrateurs, ses troupes, et ses missionnaires exploitant et massacrant – sans que cela n’ait d’influence sur sa propre formation culturelle, juridique, économique, culturelle et politique. C’est tout cela qui fait retour aujourd’hui de manière si visible dans « l’Hexagone » : le racisme, l’islamophobie, la violence policière, les discriminations, mais ces politiques et pratiques ont été développées en outre-mer où taux de chômage, déni d’accès au foncier, racisme, non-développement existent depuis des décennies. L’indifférence ou l’ignorance d’événements qui ont compté dans les « outre-mer », qui ont eu des conséquences dont les effets perdurent, est grande. Peu de personnes en France connaissent les noms de Gerty Archimède ou d’Isnelle Amélin, figures politiques communistes et féministes; les morts de 1952 en Guadeloupe, les morts à La Réunion, victimes des gendarmes ou de milices privées; l’Ordonnance Debré de 1960 qui décapita les mouvements syndicaux et politiques anticoloniaux en exilant leurs leaders; les révoltes de mai 1967 en Guadeloupe à la suite d’une attaque raciste suivies par les trois morts des législatives de 1968; la répression des grandes grèves des ouvriers des plantations à La Réunion et aux Antilles; les conséquences des essais nucléaires dans les terres françaises du Pacifique; les poursuites judiciaires, les assignations à résidence contre les leaders politiques ou les intellectuels… Tout ça fut accompagné de fraudes électorales systématiques, de censure, de répression culturelle…. Il faut mesurer ce qui fut mis en place dans les années 1960-1980 pour maintenir un vaste territoire dominé et dépendance à travers les océans.
L’impérialisme français, ce sont certes les interventions militaires en Afrique et au Proche-Orient, l’immixtion des grandes compagnies françaises dans des pays souverains, la corruption encouragée, une politique culturelle souvent hégémonique, mais pourquoi séparer cette analyse de celle de la république postcoloniale ? Pouvons-nous éviter de reprendre l’analyse transversale que faisaient les anticolonialistes dans les années 1960-1970 en les adaptant aux nouvelles configurations de pouvoir ? Il me semble que nous restons figés dans des analyses qui ne répondent pas aux défis actuels.
FV – La question de la maîtrise de la reproduction a toujours été au cœur des luttes des femmes : ne pas être accablée par des maternités successives non désirées, que le ventre des femmes ne soit pas à la merci de politiques capitalistes (produire de la main d’œuvre corvéable) ou nationalistes (le ventre au service de la Nation). Ces deux politiques peuvent se croiser mais pas toujours, elles peuvent être en contradiction. Le capitalisme a besoin à la fois d’immobiliser la main d’œuvre et de la rendre mobile (plus précarisée). L’État en général veut fixer la main d’œuvre pour mieux la contrôler et mieux développer ses politiques publiques. Je dis là des choses qui ont été analysées depuis longtemps.
Mais dans cette chaîne, comment penser la question de la reproduction ? Ce qui m’a interrogée en premier lieu, c’est l’absence des femmes africaines dans l’étude des circuits de commerce d’être humains, de trafic de main d’œuvre. Il fallait bien que cette reproduction soit assurée pendant les siècles de traite : les soutes de chaque bateau négrier qui quittait les rivages africains devaient être remplies d’êtres humains, n’est-ce pas ? Il leur fallait donc penser qu’il y aurait une reproduction locale de corps à acheter et déporter. De manière qui n’était jamais dite explicitement, les négriers « comptaient » sur la reproduction par des femmes africaines (et malgaches). J’ai quand même pas mal lu sur la traite et pourtant, je n’ai jamais rien lu là-dessus. L’invisibilisation du ventre des femmes noires dans la chaîne de l’esclavage colonial m’a interrogée. Le travail immense de Sylvia Federici[1] a été très important pour ma réflexion mais il manquait toujours le rôle du « ventre » des femmes africaines.
Les liens entre esclavage et capitalisme ont été étudiés par de nombreux historiens, économistes et politologues. On connaît le travail pionnier d’Eric Williams dont la thèse en partie contestée a été reprise récemment notamment par Edward E. Baptist dans The Half Has Never Been Told : Slavery and the Making of American Capitalism, où l’auteur montre comment dans les décennies après l’indépendance des USA, les innovations économiques visent à rendre l’esclavage plus profitable pour l’économie moderne, industrielle, et capitaliste. C’est une erreur de penser que l’esclavage a été pré-moderne. Pas d’industrie sans coton, pas de coton sans esclavage, écrit Marx. Et Cedric Robinson d’ajouter que le capitalisme moderne est racial car il se développe dans une Europe où les processus de racialisation sont déjà présents. Je résume ici très rapidement toutes ces thèses. Mais pourquoi, dans cette chaîne, l’oubli des femmes africaines ? Les millions d’Africains et d’Africaines jeté-e-s dans le maelstrom de la traite ont tous/toutes été porté-e-s par une femme ! Des femmes ont, pendant ces siècles, eu des enfants qui, devenus des êtres parlants et pensants, pouvaient être jetés dans le circuit de la traite. La prédation sur le ventre des femmes africaines fut essentielle à l’avènement du capitalisme moderne. Il fallait à chaque voyage d’un navire négrier trouver des êtres humains (des hommes surtout, au cours des siècles de traite, 2/3 des captifs étaient des hommes) pour répondre aux besoins des planteurs des Amériques, Caraïbes et Océan indien, entre 300 à 500 personnes par bateau ! Je montre en outre que cela ne s’arrête pas avec la fin de la traite et de l’esclavage colonial puisque la ponction continue à être organisée pour servir l’impérialisme post-esclavagiste : des millions d’Asiatiques sont transportés d’une colonie à l’autre, et il ne faut pas oublier le travail forcé. Des femmes ont donc continué à porter des enfants qui une fois devenus aptes furent jetés dans le circuit global d’une main d’œuvre mobile, racialisée et genrée.
Mais, au sortir de la Seconde guerre mondiale, après avoir pratiqué une politique racialisée de prédation du ventre des femmes, l’Occident décide que les femmes du Sud global font trop d’enfants et qu’elles sont donc la cause de la pauvreté et du « sous-développement ». Ni le colonialisme, ni l’impérialisme, ni le capitalisme ne sont en cause, seul le ventre des femmes. Car le besoin d’une main d’œuvre mobile de colonie à colonie, d’empire à empire, n’a plus la même nécessité pour l’Occident. Les empires coloniaux sont démantelés, les USA installent le leur, les besoins du capitalisme changent. Les pays du Nord ont besoin d’une main d’œuvre plus facilement exploitable que la main d’œuvre « nationale » pour contribuer à la construction d’un nouveau capitalisme dans le contexte de guerre froide, de décolonisation, de construction de nouvelles institutions au service du capitalisme (OMC, etc.) ; d’autre part, l’Occident veut freiner l’essor des pays nouvellement indépendants. L’invention de la « surpopulation » comme danger et menace que les femmes du Tiers monde feraient peser sur la paix et la sécurité du monde vient à point : elle déplace les causes des problèmes de la pauvreté, ignore les besoins des femmes, donne aux institutions internationales et aux États le contrôle des politiques de reproduction. Il faut, dans cette analyse des liens entre migrations, main d’œuvre mobile, genrée et racialisée, introduire d’autres éléments : accroissement du nombre de femmes des Sud dans cette main d’œuvre mobile, genrée et racialisée, pour répondre aux besoins de l’industrie du « care » (enfants, personnes âgées), de domesticité chez les classes moyennes du Nord et des Sud, de nouvelles industries (prêt-à-porter), ou de l’industrie du sexe en rapport dans les années 1970 avec les bases militaires installées à travers le monde par les puissances impérialistes[2] et avec la militarisation globale aujourd’hui.
Pour revenir à l’État français, il s’agissait de justifier l’absence de politiques publiques pour le développement des DOM (dès 1947, ses experts déclarent que leur développement est impossible et prônent l’organisation de l’émigration et le contrôle des naissances) et d’instituer des politiques de reproduction qui faisaient une différence entre femmes blanches et de couleur : qui a le droit de donner naissance et qui ne l’a pas. Les femmes là-dedans n’avaient évidemment rien à dire. En France, avortement et contraception étaient criminalisés mais pour les DOM, une autre politique était envisagée : contraception librement distribuée, avortement encouragé. Ces politiques seront pleinement mises en œuvre dans les années 1960. C’était une politique nationale qui s’inscrivait dans une politique globale de pacification du Tiers monde en contrôlant son taux de naissance. Je précise s’il le fallait que je suis pour le droit des femmes à la contraception et à l’avortement et que ces décisions doivent rester entre leurs mains. Je parle ici de politiques étatiques, de la démographie comme discipline au service de l’impérialisme, du capitalisme ou de politiques nationales masculinistes. La manière dont le ventre des femmes est instrumentalisé, il est nécessaire de repolitiser cette question surtout dans le contexte actuel de productivisme multiplié, de destruction de l’environnement, de militarisation, de guerres, de retrait des États de la santé, de l’éducation, de la privatisation des terres, de l’eau, et des rapides progrès dans la biotechnologie et les technologies de surveillance. Quelles sont les politiques féministes qui répondent à ces défis et parlent de la reproduction ?
Dans les DOM, le rôle des grandes entreprises françaises dans les politiques antinatalistes n’a pas été direct. Ce qu’elles veulent : la garantie d’un marché captif, la garantie d’une main d’œuvre à leur merci dans l’Hexagone et les outre-mer, la garantie que l’État les soutient en organisant lui-même les émigrations de travailleurs immigrés et travailleurs des outre-mer (lois, décrets). Comme c’est l’État qui met en œuvre les politiques d’émigration et de contrôle des naissances, ça profite d’abord à des fonctionnaires et des experts dans les DOM et en France, (les fonctionnaires étaient souvent d’anciens militaires des colonies recyclés), aux services de l’État et indirectement à des entreprises françaises (aux compagnies de transport aérien ou maritime qui amenèrent les émigrés des DOM en France ; à celles qui construisirent hôpitaux, écoles, routes, aéroports, cliniques, centres commerciaux…). Ce que je veux dire, c’est que ce ne sont pas ces grandes entreprises qui ont été à l’origine de ces politiques, mais ces politiques de l’État leur ont permis d’avoir accès à de nouveaux marchés. Pour sa part, le capital local s’est appuyé sur ces politiques pour investir dans de nouveaux marchés – spéculation immobilière, commerce de biens de consommation… D’un DOM à l’autre, la réorganisation sociale a ses singularités. Elle a permis l’accès à la richesse de nouveaux groupes. Certes, dans les DOM, les descendants des grands esclavagistes disposaient plus qu’aucun autre groupe d’un énorme capital foncier et bancaire, ils se recyclèrent dans la distribution, investirent ailleurs, et spéculèrent mais la transformation sociale autorisa aussi l’accès à la richesse de personnes de couleur qui acquièrent des fortunes dans les années 1970 (immobilier, commerce, transports). Je le répète, ces transformations sont à étudier d’un outre-mer à l’autre : la formation dans les années 1960-1970, d’une classe moyenne locale dont les revenus ne viennent pas de la terre, l’affaiblissement de la classe ouvrière et paysanne avec la fermeture d’usines, la concentration des terres, et le chômage structurel qui s’installe… Tout un faisceau d’intérêts trouve sa place dans ces nouveaux dispositifs.
FV – Dans les années 1950, les fonctionnaires locaux organisent de grandes grèves dans les DOM pour réclamer l’extension des privilèges dont bénéficient les fonctionnaires coloniaux : prime de déplacement, d’installation, salaires plus élevés, voyage de « retour » en métropole… Des grèves générales autour de ces revendications immobilisent les DOM. Aimé Césaire les défend à l’assemblée nationale. Le discours raciste de l’État qui justifie la venue de fonctionnaires blancs pour pallier aux manques locaux – après plus de 300 ans de colonisation, les nouveaux DOM sont dans un état de grande misère et manquent d’écoles, d’hôpitaux, d’enseignants, de médecins, d’infirmières, de fonctionnaires pour les services techniques… – légitime les grèves. Les fonctionnaires locaux gagnent et leurs revendications sont satisfaites. Ce qu’il faut souligner, c’est qu’au nom de l’égalité, ils ont réclamé l’extension de privilèges coloniaux et non leur abolition. Cela va avoir un énorme impact sur l’organisation sociale car cet apport dans leurs revenus va garantir leur accès à la consommation, à la propriété, et à un statut social et culturel. Peu à peu, une part importante de cette classe se détache de ses origines et défend l’assimilation. Depuis, l’argument de vie chère justifie ce privilège qui se justifie par l’argument de vie chère, bref, le serpent se mord la queue. Assez rapidement cela crée de grandes inégalités entre public (bien payé) et privé (moins bien payé), une syndicalisation des fonctionnaires qui se focalise sur la défense des privilèges, des gouvernements qui, malgré rapports et études démontrant l’effet pervers de ces mesures, les maintiennent.
Car quand l’État organise le départ des jeunes des DOM avec le BUMIDOM pour « soulager » le marché du travail local et répondre à la « surpopulation », il continue à faire venir des milliers de fonctionnaires français blancs. Les arrivées dépassent souvent les départs. On observe donc une nouvelle forme de colonisation avec installation, ouverture de commerce, d’entreprises, diffusion de formes culturelles, suprématie blanche mais tout ça « dans » la république, donc avec le « principe d’égalité » qui nie le racisme structurel. Il y a très peu de chômage parmi ces Français et qui ne sont pas des « expats » dans des pays avec leurs lois, mais en « France », et qui bénéficient de privilèges. Aujourd’hui, être fonctionnaire d’État dans les outre-mer garantit des revenus impensables en France, ce qui crée inévitablement des mentalités « coloniales » : comment justifier autrement que l’on bénéficierait de tels privilèges ? Tout s’enchaîne : le maintien de cette sur-rémunération, la vie chère, les inégalités, les privilèges sociaux et raciaux, l’évidence d’être là dans un pays dont on n’a pas besoin de connaître la langue, l’histoire, la culture, puisqu’on est « en France ». Ce que nous appelons « zoreys » à La Réunion ce sont ces femmes et ces hommes qui profitent de ces privilèges sans se poser une seule fois la question de ce qu’elles/ils font dans un pays qui n’a pas la même langue, histoire, etc. Ils s’appuient sur le fait que les DOM ont voulu rester « français » et vivent des allocations familiales, RMI, RSA et autres, donc « profitent » ; mais ce n’est que justice que ces miettes soient garanties puisque l’État a tenu à maintenir ces pays en dépendance.
Tous les programmes de « rattrapage » ont échoué car la logique productiviste et du Capital n’a aucun intérêt à aider ces sociétés. Pour moi, nous sommes pris dans un nœud coulant qui nous tient et nous étrangle. L’extension de droits ne répondra pas aux problèmes accumulés depuis des décennies ni aux défis actuels. Il faut refaire une analyse politique de cette république postcoloniale qui tienne compte de tous ces éléments : racisme en France et dans les outre-mer ; capitalisme et dépendance ; environnement, genre, reproduction, féminisme, situation régionale…
En résumé, faire l’analyse sociale des DOM, c’est faire l’analyse des classes dominées, mais dans ces classes, de celles qui ont acquis quelques privilèges et de celles, constituant la majorité, qui sont maintenues dans l’exclusion. L’analyse sociale requiert de nouveaux outils pour comprendre l’installation du FN, le déclin des forces politiques des années 1960, l’oubli des luttes de ces années, de nouvelles aspirations culturelles, les formes de politique identitaire, l’invention de traditions, les formes d’économie dite « informelle », les circuits de la drogue, du tourisme sexuel, les nouvelles pratiques associatives et cultuelles… À La Réunion, après l’avoir âprement combattue, la droite trouve de l’intérêt à établir une autonomie, de droite bien sûr, mais le désir de s’affranchir d’une trop grande dépendance est là : volonté d’établir des liens économiques et culturels directs avec les pays de la région, d’attirer des investissements de ces pays. Si dans des outre-mer, la population est vieillissante (les deux Antilles sont les régions de France où on compte le plus grand nombre de personnes âgées), dans d’autres les migrations continuent à transformer la société (Mayotte, Guyane). En résumé, une réécriture de l’histoire est nécessaire, tout comme un effort théorique.
Propos recueillis en juillet 2017 par Elsa Boulet.
[1] Surtout Caliban et la sorcière, Editions Entremonde, 2014, où elle fait le lien entre répression des sorcières, organisation de la traite et capitalisme). Lire ici à propos de ce livre.
[2] Voir sur ce sujet, par exemple Cynthia Enloe, Bananas, Beaches and Bases : Making Feminist Sense of International Politics, University of California Press, 2000.