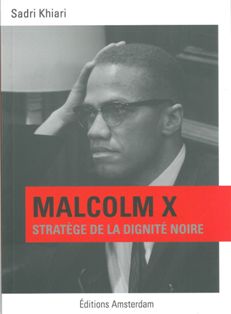
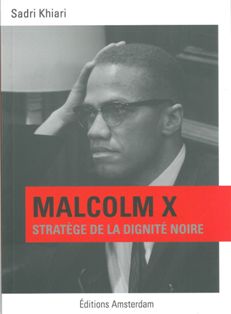
A propos de H. Bouteldja et S. Khiari, Nous sommes les Indigènes de la république, Paris, Amsterdam, 2012 ; S. Khiari, Malcolm X. Stratège de la dignité noire, Paris, Amsterdam, 2013 .
Lorsqu’il y a quelques mois, a été annoncée la publication prochaine d’un essai sur Malcolm X signé Sadri Khiari (MX dans la suite du texte) aux Éditions Amsterdam, il nous est immédiatement apparu qu’il serait opportun de rapporter et confronter cet ouvrage aux thèses et positions exprimées par le mouvement, né en 2005 et devenu en 2010 parti, des Indigènes de la république (PIR) dont notre auteur est l’un des membres fondateurs et l’une des principales plumes, et dont un recueil d’articles et interventions, accompagné d’un long entretien, a été publié par la même maison d’édition à l’automne 2012 sous le titre : Nous sommes les Indigènes de la république (NSIR dans la suite du texte). La question qu’il nous paraissait important de soulever était la suivante : dans quelle mesure et de quelle manière les mouvements noirs américains radicaux constituaient-ils une source d’inspiration et de réflexion pour le PIR ? Cette question, simple et en apparence très convenue, nous semblait néanmoins être un moyen de donner un peu d’air au pesant débat entourant les Indigènes de la république en libérant, fût-ce momentanément, la question de la « France postcoloniale » de la perspective et du langage dans lequel elle est généralement formulée, et pour une part enfermée.
À cette question, le recueil des Indigènes apportait déjà des éléments de réponse quoiqu’il s’agissait alors plutôt de railler l’appropriation « gauchiste » dont avait pu faire l’objet en France des mouvements tels que celui des Black Panthers (perçu exclusivement en tant qu’ « organisation marxiste-léniniste, maoïsante ») que de retracer une filiation positive ou indiquer des affinités électives. Reste que cette piste paraissait fort prometteuse. Or, force est d’avouer que la lecture du Malcolm X de Sadri Khiari nous a tout d’abord laissés perplexes quant au bien-fondé de cette interrogation ; non pas parce qu’elle en aurait révéler l’inanité, mais tout au contraire parce que la corrélation était si manifeste, si explicite, que prétendre dévoiler des « relations cachées » était tout simplement absurde. Khiari l’affirme du reste dès son introduction :
« Je suis convaincu en effet que l’expérience du mouvement noir américain et, plus particulièrement, les leçons et les questionnements qu’en a tirés Malcolm, peuvent être d’un grand intérêt pour nos propres combats en France. Bien plus que l’expérience des luttes anticoloniales dans les anciennes colonies. Avec les Noirs américains, nous avons en partage une histoire et un présent, une histoire qui est toujours notre présent. […] Nous sommes des “colonisés de l’intérieur”, des indigènes de la république, comme nous disons en France » (MX, pp. 13-14).
Il y a, ajoute Khiari, « identité substantielle — au sens fort du terme — entre les Noirs américains et les populations issues de l’immigration. […] Si ce livre échoue à faire percevoir cette homologie, c’est donc un mauvais livre » (MX, pp. 15-16). Instaurer un dialogue entre les situations et combats politiques du « monde noir américain » et du « néo-indigénat français », tel est donc la tâche que s’assigne Khiari tout au long de son ouvrage : mission accomplie. Quant à nous, nous pourrions nous arrêter là afin d’éviter de verser ensuite dans la paraphrase.
S’il nous paraît néanmoins utile d’aller un peu plus loin, c’est que le livre de Khiari n’est pas seulement une étude des « problématiques stratégiques développées par Malcolm X (stratégies que l’on pourrait tout au plus « mettre en parallèle » avec celles mises en œuvre par le PIR), il participe lui-même, pour ainsi dire en tant que moment théorique, de l’effort de construction d’une stratégie politique. De ce point de vue, si cette interprétation est profondément nourrie et informée par les expériences de lutte et les réflexions menées depuis 2005 par les Indigènes de la république, elle peut également être conçue comme un « pas en avant » dans le développement de la stratégie décoloniale du PIR. Or, ce pas, il nous semble déterminé par l’approfondissement et l’aiguisement d’un problème devenu fondamental depuis (au moins) la mutation du mouvement des Indigènes de la république en parti. Ce problème, ce n’est rien d’autre que le problème du pouvoir, problème éminemment politique qui ne peut manquer de déranger et de désorienter ceux et celles qui préfèrent affronter les Indigènes sur les seuls terrains culturel, postcolonial et racial… afin de mieux pouvoir leur reprocher leur « culturalisme », leur « postcolonialisme » et leur « racialisme ». C’est cette problématisation du pouvoir que nous nous proposons ici d’interroger, afin d’ouvrir une autre réflexion et certainement pas pour la clore, ce qui nous reconduira à notre question initiale dans la mesure où rendre compte des stratégies politiques de Malcolm X, c’est pour Khiari analyser comment ont été pensées les conditions de la formation d’un pouvoir noir (Black Power) afin de contribuer aux réflexions stratégiques sur l’émergence et l’organisation d’un pouvoir indigène (décolonial).
Le problème du pouvoir n’a en réalité jamais été absent des préoccupations des Indigènes de la république. Au contraire, depuis la naissance du mouvement, ceux-ci n’ont d’une certaine manière cessé d’affirmer que « la race, c’est le pouvoir », formule ambivalente qui est la nôtre et que nous allons tâcher d’expliciter. Si la race, c’est le pouvoir, c’est avant tout parce que les races ne sont rien d’autre que l’effet d’un rapport de forces, d’une relation de pouvoir ; ce sont, comme aiment à le rappeler les Indigènes, des races sociales. Lorsque Sartre affirmait il y a plus de soixante ans que « c’est l’antisémite qui fait le Juif », cela signifiait pour lui (et plus généralement pour ceux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale allait, sous l’égide de l’UNESCO, participer à la lutte contre le racisme) qu’ « il n’y a pas de race, il n’y a que du racisme ». Ce que disent les Indigènes, ce qui était déjà la position de Fanon, c’est que c’est précisément parce qu’il y a du racisme, qu’il y a de la race. Certes, le « clivage racial » ne présuppose pas les termes qu’il divise ; mais il les produit bel et bien ; son mode de production, c’est la racialisation, laquelle ne peut manquer d’affecter, à part égale et toutes choses égales par ailleurs, les deux termes du clivage, en quoi il n’y a aucune raison de s’émouvoir que les Indigènes utilisent la catégorie « Blancs » si l’on considère légitime qu’ils parlent d’ « Arabes » et de « Noirs » — comme si l’on disait (et on le sous-entend du reste parfois) : « oui, parlons des prolétaires, mais ne prononçons jamais le mot de “bourgeois” » (cela risquerait de choquer). L’on pourrait aller jusqu’à affirmer que pour les Indigènes de la république, les races sont le rapport racial de pouvoir lui-même ; car sur le papier, la solution n’est pas compliquée : supprimez ce rapport de pouvoir, et le problème de la race disparaît de lui-même ; ce qui implique négativement, que là où il y a racisme, l’on ne peut prétendre que celui-ci est purement « gratuit », dégagé de tout privilège social. Qu’il n’y ait de races qu’au sein de rapports de pouvoir, la perspective de résistance des indigènes en témoigne également : « Pour le PIR, la race existe, les races sociales existent. La preuve, c’est qu’elles luttent » (NSIR, p. 379).
Qu’est-ce à dire sinon que plutôt que s’éterniser sur les méandres de l’imaginaire racial (NSIR, pp. 282-306), sur l’ambivalence des représentations du Noir, de l’Arabe, du (post-)colonisé à travers l’histoire, il est bien plus urgent d’interroger et de combattre les rapports inégaux de pouvoir qui sont leurs conditions d’existence ? Le problème des approches « spirituelles » de la race, c’est que si elles n’ont le plus souvent guère de difficulté à accorder que les catégories raciales et leurs attributs puisent leur racines dans des expériences très concrètes de domination (esclavage et colonisation pour le dire simplement), elles présupposent généralement que ces catégories sont susceptibles ensuite de mener une vie indépendante, de croître et de se reproduire d’elles-mêmes, de telle manière que l’enjeu premier devient de lutte contre ces « idées fausses », lutte qui elle-même doit se situer sur un plan essentiellement idéel. Or, dire que la race est (l’effet d’un) rapport de pouvoir, c’est tout simplement prendre le contre-pied de cette approche ; c’est affirmer la primordiale matérialité de la race, une matérialité qui, faut-il encore le rappeler, n’a rien de biologique-corporelle et qui n’est rien d’autre que celle du conflit lui-même ; une matérialité qui, à contrecourant des idées reçues, déplace le problème de la race sur un terrain a priori bien plus dégagé de tout fantasme racial que celui qu’investissent les critiques de la « race imaginaire ».
Le problème, c’est bien sûr que défaire les rapports raciaux de pouvoir (les détruire, les renverser, les subvertir, peu importe la formule pour le moment) est une tâche pour le moins complexe et de longue haleine. C’est que ces rapports de pouvoir sont intrinsèquement des rapports entre pouvoirs ; plus précisément, ce sont, dans un premier temps (qui peut durer très longtemps), des rapports entre un pouvoir, le pouvoir blanc, et un non-pouvoir (indigène) ; des rapports donc de domination en un sens très classique, et à vrai dire peu en vogue dans les milieux académiques. Mais qu’est-ce que le pouvoir blanc et comment s’exerce-t-il ? Les Indigènes le répètent à l’envi : le pouvoir blanc, c’est l’ensemble des privilèges statutaires garantis aux Blancs en tant que Blancs et qui leur assurent une supériorité (économique, politique, culturelle, etc.) sur les non-Blancs. C’est un pouvoir qui produit la suprématie blanche en reproduisant indéfiniment la hiérarchie raciale (NSIR, p. 274). C’est un pouvoir qui, enfin, ne se perpétue qu’en tant qu’il s’incarne dans des structures politiques qui ne sont rien d’autre que les structures étatiques, d’où la nécessité de substituer à l’antiracisme « moraliste et humaniste » qui reconduit immanquablement le racisme à un problème individuel de « mentalités », un antiracisme politique en lutte contre ce qu’il faut bel et bien appeler un racisme d’État.
N’imaginons cependant pas qu’avec la ruine du pouvoir racial, chacun se jetterait dans les bras de son prochain dans un esprit de réconciliation débarrassé de tout ressentiment. Non, il y a aurait certainement encore et pour un long moment toutes sortes de préjugés et de stéréotypes, peut-être de la rancœur et de la haine ; mais ce ne serait plus à proprement parler du racisme. Pourquoi ? Tout simplement parce que parler de « racisme sans pouvoir » est une contradictio in adjecto. C’est pourquoi la notion de racisme antiblanc est privée de toute signification :
« Quand un Arabe dit « les Blancs sont tous des salauds », on considère ça comme du racisme au même titre qu’un Blanc qui dirait : « Tous les Arabes sont des salauds ». Cette mise en parallèle montre à quel point la hiérarchisation entre Blancs et non-Blanc est occultée. Évidemment, ils ne sont pas du tout égaux car l’un a la puissance politique de l’État avec lui, et l’autre n’a que la force de ses petites résistances et colères. C’est pour cela qu’il ne peut pas exister de racisme antiblanc » (NSIR, p. 342).
Cette analyse, Sadri Khiari ne manque pas de la prolonger dans son interprétation de Malcolm X, lequel a plus d’une fois essuyé les accusations de racisme antiblanc. Certes, jamais n’a-t-il cherché à masquer la « haine des Blancs » qui l’animait, mais il ne s’en défendait pas moins « de prôner un quelconque racisme anti-Blancs » (MX, p. 42) : « Malcolm sait qu’interpréter, selon les mêmes catégories, le discours de l’oppresseur et le discours de l’opprimé, même quand ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau, ne fait sens que du point de vue de l’oppresseur » (MX, p. 43). S’il y a un racisme noir contre lequel il faut lutter, c’est bien plutôt celui que produit la « haine noire du Noir », la haine du dominé « envers lui-même et ses semblables », une haine qui résulte de « la médiation d’un pouvoir réel, celui qu’exerce le Blanc sur lui » (MX, p. 47). La haine du Blanc, quant à elle, n’est, affirme Malcolm X lui-même, que « la réaction d’un être humain qui cherche à se défendre et à se protéger » (MX, p. 43) ; c’est la réaction d’un homme qui se débat et maudit celui qui cherche à le pendre (MX, 45). « J’aimerais savoir, dit-il encore, comment l’homme blanc, qui a le sang du peuple noir sur les mains, peut avoir l’audace de demander aux Noirs s’ils le haïssent. C’est vraiment gonflé » (MX, p. 42).
De ce point de vue, la haine du Blanc relève déjà bel et bien selon Malcolm X d’un « pouvoir de résistance », un contre-pouvoir opposé au pouvoir blanc, fût-il « infecté, comme tout contre-pouvoir, par le pouvoir auquel il s’oppose » (p. 45). S’il faut rester prudent et ne pas convertir les affinités (entre les positions des Indigènes de la république et les interprétations proposées dans Malcolm X) en identités, il n’en reste pas moins que le passage d’une négation critique de la notion de racisme antiblanc rejetée en tant que non-sens, à l’affirmation d’un (contre-)pouvoir de la haine, instituée chez Malcom X en véritable « utopie de libération » (MX, p. 49 sq.) se révèle décisive dans la réflexion stratégique menée par les Indigènes en vue de la constitution d’un pouvoir décolonial.
Il n’est donc pas suffisant de dire que les « relations raciales » sont le produit de rapports de pouvoir(s) ; il faut ajouter que, du point de vue des indigènes, la lutte des races sociales est d’emblée une lutte pour le pouvoir. Cette lutte, elle n’est néanmoins pas lutte pour la conquête d’un pouvoir conçu simplement comme quelque chose que l’on a ou que l’on n’a pas, quelque chose qui serait donné et défini par avance et qu’il « suffirait » de prendre (en l’état) et d’exercer. Il ne peut en être question dans une situation dans laquelle « le caractère essentiel de l’indigénat, c’est d’être désapproprié de tout pouvoir politique : c’est l’exclusion du champ politique, de ses mécanismes, de la définition de ses normes et de ses institutions » (NSIR, p. 224). Le pouvoir, c’est d’abord, pour ceux et celles qui en sont fondamentalement privés, quelque chose qu’il faut faire pour ainsi dire ex nihilo, qu’il faut construire, qu’il faut même (ré)inventer, en fonction des rapports de force effectifs. C’est pourquoi il ne saurait être question de rejeter ses configurations embryonnaires, dussent-elles prendre la forme de la haine, sous prétexte que les groupes dont le pouvoir est déjà bien établi (même lorsqu’ils ne sont pas « au pouvoir »), les jugeraient inconvenantes.
C’est donc comme un processus, ou plus exactement comme une puissance susceptible de croître ou de décroître, que le pouvoir indigène doit être conçu. Bien plus que substantif, ce pouvoir est d’abord verbe ; la stratégie du PIR est d’une certaine manière gouvernée par une question centrale : « que pouvons-nous ? ». Et la réponse à cette question ne peut aller sans la revendication et l’expression d’un pouvoir d’agir en son nom propre, lequel se présente d’abord comme pouvoir de parler, pouvoir de se dire, pouvoir de se nommer. En témoigne l’Appel fondateur du mouvement : « Nous sommes les Indigènes de la république ! ». En témoigne également le parcours de Malcolm X lequel, rejoignant la Nation of Islam (NOI), se défait du nom hérité du maître blanc pour endosser le « fameux “X” anonyme, le nom de celui qui n’a pas de nom » (MX, p. 25) ; « souci de l’autodésignation » qui n’en concerne pas moins chez lui « les Noirs comme entité collective » : répudiant le terme « Nègres » (Negroes) qu’il réserve à ceux qu’il désigne comme des « Oncle Tom », Malcolm X lui oppose celui de « Noirs » (Blacks) avant de lui substituer à son tour celui d’Afro-Américains (Afro-Americans). Or ce qui se joue fondamentalement ici, et plus généralement dans le désir de se connaître et/pour se reconnaître, c’est la quête d’une dignité qui est au cœur du projet politique de Malcolm X et qui s’identifie au pouvoir noir lui-même :
« La dignité noire est dans le cœur des masses noires. Elle est aussi dans leur action. Condition de la résistance noire, elle en est aussi le mobile et la fin. La dignité est un levier pour l’action, elle est un but qui s’accomplit dans l’action, elle est le but de l’action. […] Si l’on voulait résumer en une phrase le propos de Malcom, on pourrait dire ceci : la dignité, c’est le pouvoir noir » (MX, p. 37).
Cette dignité en tant que pouvoir, elle se situe non moins au cœur des préoccupations et des revendications des Indigènes de la république : « ce qui nous caractérise c’est notre détermination à rester sur le terrain politique et sur celui de la dignité humaine » (NSIR, p. 313). Qu’on ne se méprenne pas, cette dignité n’est pas, dans les termes de Fanon, la « dignité de la “personne humaine” » considérée abstraitement (une abstraction qui, singulièrement, revêt très souvent la couleur blanche). La dignité humaine des indigènes, leur « égale dignité », doit d’abord être une dignité indigène, une dignité qui s’affirme à partir même de ce que le racisme s’acharne le plus à dévaloriser et à diaboliser ; en ce sens, c’est très largement parce que l’islamophobie constitue de nos jours l’arme la plus redoutable du racisme, que l’islam est devenu un élément proprement central dans la quête de dignité.
Si les Indigènes se révèlent si sévères envers l’ « antiracisme universel » (l’ « antiracisme traditionnel de la gauche ») et les stratégies intégrationnistes qui l’accompagnent comme son double, c’est précisément parce que ceux-ci ont sans cesse œuvré à contenir le pouvoirdes indigènes. L’exemple le plus explicite en est très certainement celui du fameux slogan de SOS Racisme : « Touche pas à mon pote » : « il met en scène un Blanc qui parle à un autre Blanc. C’est un Blanc-pas-raciste qui parle à un Blanc raciste et qui lui dit : “Tu ne touches pas à mon pote-l’Arabe ou à mon pote-le-Noir.” Dans cette discussion, l’indigène est celui qui n’est pas acteur de sa vie » (NSIR, p. 128). Ajoutons que si la situation s’envenime, ce « pote » pourra peut-être soutenir celui qui le défend… mais qu’il ne s’avise pas de prendre l’initiative de son autodéfense, on ne lui pardonnerait pas de s’être rendu capable de déterminer de lui-même ce qui était le mieux pour lui-même. De même et sans aucunement dénier l’importance de la lutte pour les sans-papiers, les Indigènes n’hésitent ainsi pas à souligner que son « succès » n’est certainement pas étranger au fait que cette lutte concerne une population caractérisée par une extrême « vulnérabilité » et qui n’a guère d’autre choix que d’accepter les conditions définies par ceux qui les défendent.
Ce que reprochent les Indigènes à la gauche et l’extrême-gauche française, c’est donc de n’être jamais parvenu à dépasser l’attitude paternaliste faisant des indigènes des « victimes », de n’avoir jamais accepté que ceux-ci puissent être des sujets politiques à part entière ; c’est d’avoir en somme œuvrer à une très problématique silenciation des luttes indigènes indépendantes. « Si vous voulez vous battre, nous dit-on, faites-le dans le cadre de la grande maison de la gauche. Nous n’oserons pas ajouter qu’à gauche, on nous a toujours réservé la chambre de bonne » (NSIR, p. 351). Où l’on en vient à la question fondamentale de l’autonomie des luttes indigènes qui est inséparablement autonomie du PIR à l’égard du « champ politique blanc » :
« Il s’agit d’une autonomie politique qu’il faut comprendre comme autonomie de la problématique portée par le mouvement en ce qu’elle reflète la singularité des discriminations que subissent les postcolonisés. L’autonomie renvoie donc à l’oppression spécifique qui unifie ces populations et surdétermine leurs rapports aux autres antagonismes qui les croisent comme ils clivent toute la société ». (NSIR, p. 73)
Disons-le ainsi, l’autonomie, c’est à la fois la condition de possibilité et l’expression du pouvoir indigène en tant que pouvoir d’agir collectif : « notre autonomie consiste à nous revendiquer d’abord et avant tout de nos luttes propres » (NSIR, p. 36). « Autonomie » ne signifie donc rien de moins que « conquête par les indigènes de leur liberté de pensée, de décision et d’action » (NSIR, p. 254). À cet égard, les accusations de « séparatisme » qui sont régulièrement (et très répétitivement) venues s’opposer à une telle exigence d’autonomie sont pour ainsi dires coupables d’une faute logique : elles confondent la possibilité (le pouvoir) et le fait. Car l’autonomie, ce n’est rien d’autre que le pouvoir de se déterminer par soi-même, le pouvoir de « se séparer »… mais aussi le pouvoir de ne pas le faire. L’autonomie, ce n’est pas la négation de l’alliance, c’est sa limite (NSIR, p. 35).
C’est très précisément ce que dit Malcolm X à une époque où le mot de « séparatisme » avait une signification bien plus concrète qu’aujourd’hui, où il n’est souvent qu’un substitut à la vague notion, instrumentalisée politiquement, de « communautarisme ». Ce qu’avait d’abord défendu Malcolm X, en tant que membre de la NOI, c’est une stratégie séparatiste au sens de la conquête d’un territoire propre sous la forme d’un État séparé au sein des États-Unis (séparation dont l’idée avait également été soutenue par le Parti Communiste américain). Si la séparation n’a jamais réellement été « pensée comme une perspective qu’il s’agirait vraiment de réaliser » (MX, p. 76), reste que cette perspective s’est révélée fondamentale pour la genèse du « principe de l’autonomie politique noire ». En effet, c’est l’effort pour « résoudre les apories du séparatisme sans renoncer à son inspiration libératrice qui permet [à Malcolm] de le dépasser » (MX, p. 77). La solution, la « stratégie alternative au séparatisme », c’est pour lui la formation d’un « pouvoir politique autonome » : un « pouvoir noir dans le cadre même des Etats-Unis ». En résulte la définition suivante de l’indépendance : « Quand vous êtes indépendant de quelqu’un, vous pouvez vous séparer de lui. Si vous ne pouvez pas vous séparez d’eux, ça veut dire que vous n’êtes pas indépendant d’eux ». Et Khiari d’en conclure par ces mots qui n’en valent pas moins pour les Indigènes de la république : être indépendant, être autonome, c’est tout simplement « avoir la maîtrise de son destin collectif » (MX, p. 78).
À partir de ces « prémisses », et uniquement à partir d’elles, peut se dégager l’horizon d’une conquête du pouvoir en son sens à présent le plus ordinaire : « nous ne voulons plus être en dehors de la politique, nous ne voulons plus qu’on décide à notre place, nous voulons participer au pouvoir pour engager ce pays dans une politique décoloniale » (NSIR, p. 260). Participer au pouvoir, tel est l’enjeu qui a présidé à la mutation du mouvement des Indigènes de la république en parti politique. Il s’agit dès lors d’ « aller à la conquête […] d’un pouvoir dont nous sommes exclus » (NSIR, p. 307), d’ « être parties prenantes du pouvoir » (NSIR, p. 321), d’être « au cœur même des centres de pouvoir » (NSIR, p. 323), de « construire une force politique organisée, représentative, puissante, qui soit capable d’accéder au pouvoir » (NSIR, p. 319). Il s’agit en d’autres termes d’être dans le pouvoir tout en constituant un « contre-pouvoir autonome » rompant avec les « processus de reproduction des rapports raciaux » (NSIR, p. 395) ; être dans le pouvoir pour substituer au « pouvoir reproducteur de la hiérarchie raciale » un « pouvoir qui, au contraire, fissurerait cette hiérarchisation raciale » (NSIR, p. 274) ; être dans le pouvoir pour décoloniser le pouvoir. Cela ne pourra se faire seul, l’horizon ne pouvant qu’être le suivant : « autonomie politique et organisationnelle indigène, et alliance avec les forces non indigènes intégrant la question décoloniale et antiraciste » (NSIR, p. 362). L’objectif, c’est en définitive pour les Indigènes de la république la formation d’un gouvernement décolonial (NSIR, p. 320).
Matthieu Renault est docteur en philosophie politique, chercheur postdoctoral à la London School of Economics and Political Science et chercheur associé au Centre de Sociologie des Pratiques et des Représentations Politiques (CSPRP, Université Paris VII Denis Diderot). Il est l’auteur de : Frantz Fanon. De l’anticolonialisme à la critique postcoloniale, Paris, Amsterdam, 2011.
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.