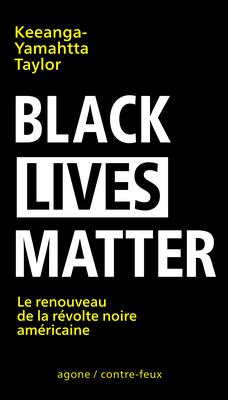
Keeanga-Yamahtta Taylor, Black Lives Matter. Le renouveau de la révolte noire américaine, Marseille, Agone, 2017, traduit de l’américain par Celia Izoard.
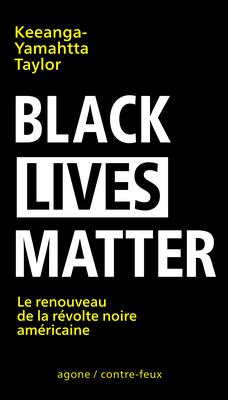
« Le meurtre de Mike Brown par un policier blanc a marqué un point de rupture pour les Afro-Américains de Ferguson (Missouri). Peut-être était-ce à cause de l’inhumanité de la police, qui a laissé le corps de Brown pourrir dans la chaleur estivale. Peut-être était-ce à cause de l’arsenal militaire qu’elle a sorti dès les premières manifestations. Avec ses armes à feu et ses blindés, la police a déclaré la guerre aux habitants noirs de Ferguson. »
Comment le mouvement Black Lives Matter a-t-il pu naître sous le mandat du premier président noir ? L’auteure revient sur l’ »économie politique du racisme » depuis la fin de l’esclavage, le reflux des mouvements sociaux des années 1960 et l’essor d’une élite noire prompte à relayer les préjugés racistes et anti-pauvres. Elle défend le potentiel universaliste de BLM : afro-américain et tourné contre les violences policières, il peut parfaitement rallier d’autres groupes et s’étendre à une lutte générale pour la redistribution des richesses.
***
« Ce qui est arrivé à ma fille est une injustice. C’est injuste. C’est vraiment injuste. J’ai ressenti tout ce qu’il est possible de ressentir à ce sujet. Mais comme l’ont dit les autres mamans, je ne m’arrêterai pas tant que je n’aurai pas de réponses. » (Cassandra Johnson, mère de Tanisha Anderson, tuée par la police de Cleveland en 2014 [i]).
Tout mouvement a besoin d’un catalyseur, d’un événement qui fait écho aux expériences des individus et les sort de leur isolement, rassemblant une force collective assez puissante pour transformer les conditions sociales. Peu de gens auraient pu prévoir que le meurtre par balle de Mike Brown par le policier blanc Darren Wilson allait déclencher une révolte dans une petite banlieue inconnue du Missouri, Ferguson. Pour des raisons qui resteront peut-être mystérieuses, la mort de Brown a marqué un point de rupture pour les Afro-Américains de Ferguson – mais aussi pour des centaines de milliers de personnes noires aux États-Unis.
Peut-être était-ce à cause de l’inhumanité de la police qui, après le meurtre, avait laissé le corps de Brown pourrir dans la chaleur estivale pendant quatre heures et demie, tout en maintenant ses parents à distance avec des armes à feu et des chiens. « Ils nous ont traités comme si on n’était pas des parents, témoigne le père de Mike Brown. C’est ça que je ne comprends pas. Ils ont lâché des chiens sur nous. Ils ne nous ont pas laissés identifier son corps. Ils ont braqué leurs armes sur nous [ii]. » Peut-être était-ce à cause de l’arsenal militaire qu’a sorti la police dès les premières manifestations. Avec ses blindés, ses mitraillettes et son stock inépuisable de gaz lacrymogène, ses flash-balls et ses tonfas, la police de Ferguson a déclaré la guerre aux habitants noirs et à tous ceux qui les soutenaient.
Depuis lors, il y a eu des centaines d’autres révoltes. Au moment où les États-Unis célèbrent plusieurs cinquantenaires de luttes de libération noire des années 1960, la vérité sur le racisme et la violence de la police a percé le voile qui la dissimulait au public. Par le passé, certaines ruptures ont parfois interrompu la quiétude nationale : le passage à tabac de Rodney King, la sodomie d’Abner Louima, l’exécution d’Amadou Diallo. Ces violences et ces meurtres n’ont pas débouché sur un mouvement national, mais ils n’ont pas été oubliés.
« J’ai fait ma première manif en 1999, quand Amadou Diallo a été tué par la police, explique Zakiya Jemmott, manifestante à Ferguson. Depuis, les choses n’ont pas évolué, et ma vision de la police non plus [iii]. »
Pourquoi Ferguson ? Question peut-être futile, peut-être sans réponse, de même qu’il est impossible de calculer précisément à partir de quel moment la coupe est pleine. Le fait que le meurtre de Mike Brown, d’un crime policier, se soit transformé en lynchage a certainement pesé dans la balance. L’écrivain Charles Pierce exprime un sentiment largement partagé :
Les dictateurs laissent les cadavres dans la rue. Les petits satrapes locaux laissent les cadavres dans la rue. Les seigneurs de guerre aussi. Voilà les cas où on laisse les corps dans la rue, pour servir d’exemple, pour signifier quelque chose, parce qu’on n’a pas de quoi les évacuer et les enterrer, ou parce que tout le monde se fiche qu’ils soient dans la rue ou non [iv].
Quelques heures après que le corps de Mike Brown a enfin été évacué, des habitants improvisent un monument décoré d’ours en peluche et un petit autel mémorial à l’endroit où la police l’a laissé. Un policier d’une brigade canine laisse un chien uriner sur le monument. Plus tard, Lesley McSpadden, la mère de Brown, écrit ses initiales en pétales de rose ; une voiture de police passe en trombe, écrase l’autel et disperse les fleurs [v]. Le soir suivant, Lesley McSpadden et quelques proches retournent sur le site pour le fleurir d’une douzaine de roses. À nouveau, une voiture de police fonce sur les fleurs [vi]. Le soulèvement commencera plus tard le même soir.
Face à la révolte, la police a voulu réprimer et punir la population pour avoir osé défier son autorité. Comment interpréter autrement le recours disproportionné aux gaz lacrymogènes, aux flash-balls, et les menaces constantes de violences contre une population civile sans armes ? Les policiers de Ferguson – des hommes blancs à 95 % – masquaient leurs badges pour dissimuler leur identité ; ils arboraient des brassards sur lesquels on pouvait lire : « Je suis Darren Wilson » ; et ils pointaient leurs armes sur de simples civils manifestant en toute légalité. La municipalité s’est comportée en État voyou : elle a pris des arrêtés arbitraires pour interdire les manifestations et a brutalement tenté de discréditer les médias, autant à des fins de représailles que pour dissimuler ses exactions. Douze jours après la mort de Brown, on dénombrait 172 arrestations, dont 132 pour « non-dispersion après sommation ». Pendant les manifestations, un policier de Ferguson braque un fusil d’assaut semi-automatique AR-15 sur un groupe de journalistes en criant : « Je vais tous vous crever ! » Quand quelqu’un lui demande : « Quel est votre nom, monsieur ? », il hurle : « Va te faire foutre ! [vii] » Pendant une courte période, les violences quotidiennes subies par les noirs de Ferguson sont exposées au monde entier.
Les manifestants noirs sont parvenus à révéler la kleptocratie qui sous-tend l’activité de la police de Ferguson, à montrer que ses services, dirigés par le maire et le conseil municipal, ciblent la population noire sur laquelle ils font pleuvoir arrestations, convocations au tribunal, amendes, frais et pénalités en tous genres, dont les recettes représentent la deuxième source de revenus de la ville. En 2013, les amendes pour infractions routières ont représenté 21 % du budget, soit « l’équivalent de plus de 81 % des salaires de la police, en excluant les heures supplémentaires [viii] ». Le fait de ne pas payer ou de ne pas se présenter au tribunal débouche automatiquement sur un mandat d’arrêt. Dans leurs échanges de courriers électroniques, les administrateurs de la ville demandent explicitement que ces sanctions soient durcies. En mars 2013, le directeur financier écrit à l’administrateur municipal : « Les frais de justice doivent augmenter d’environ 7,5 %. J’ai demandé au chef si le PD [police department] pouvait aller jusqu’à 10 %. Il a dit qu’il essaierait [ix]. » En décembre 2014, les services de police ont délivré le nombre effarant de 16 000 mandats d’arrêt, la plupart pour des délits mineurs [x]. 95 % des contrôles routiers concernent des conducteurs noirs. Comme l’indique le rapport du département de la Justice, « les pratiques de la police de Ferguson sont directement déterminées et entretenues par les préjugés raciaux [xi] ». La population noire de Ferguson vit presque totalement sous la domination de la police.
La violence et l’illégalité croissantes de la police de Ferguson face aux manifestations devenues quotidiennes semblent bel et bien motivées par la frustration de ne pas arriver à soumettre les hommes et les femmes noirs de la ville. Pour Quentin Baker, 19 ans, habitant de Saint-Louis, « tout ça, c’est à cause des provocations des policiers. Ce qu’ils veulent, c’est imposer leur volonté [xii]. » Mais de même que les habitants reconstruisent les autels en hommage à Mike Brown en quelques heures à chaque fois que la police les détruit, chaque jour, les manifestants contre lesquels la police a fait usage de ses gaz lacrymogènes et de ses flash-balls la veille sont à nouveau dans les rues. Johnetta Elzie, militante de Ferguson, décrit comment les pratiques des manifestants évoluent, alors même qu’ils sont confrontés à un niveau de violence policière « inimaginable » :
De manifestante pacifique, je suis devenue plus active. J’avais l’impression que le fait de donner de la voix pour crier des slogans au milieu des autres suffisait – mais ça ne suffisait pas. J’ai décidé de crier directement sur la police. J’ai décidé de mettre les policiers au défi de regarder les visages des bébés et des enfants sur lesquels ils lâchent si facilement leurs chiens. Et plus les gens ont commencé à les regarder bien en face et à leur crier leurs doléances, plus ça les a mis en rage [xiii].
Dontey Carter, un autre manifestant, raconte :
« J’y suis depuis le premier jour. […] On a tous ressenti la même tristesse et la même colère. On s’est tous rassemblés ce jour-là. […] Ils nous massacrent, et ils n’ont pas le droit [xiv]. »
L’attitude de Carter répond à l’urgence d’un été qui tourne à la saison de chasse. Quelques semaines avant la mort de Mike Brown, le monde a pu voir dans une vidéo le policier new-yorkais Daniel Pantaleo étouffer Eric Garner à mort. Quatre jours avant le meurtre de Brown, la police frappe dans une banlieue de Dayton (Ohio) : John Crawford III, Afro-Américain non armé de 22 ans, est tué dans un rayon de supermarché alors qu’il téléphonait à la mère de ses enfants. Il portait un faux pistolet. Alors même que l’État de l’Ohio autorise à porter une arme de façon visible, la police municipale ouvre le feu sur John Crawford après une vague sommation [xv]. Deux jours après le meurtre de Mike Brown, la police de Los Angeles tire trois fois dans le dos d’Ezell Ford, qui était étendu à plat ventre sur le sol, sans arme. Le lendemain, ailleurs en Californie, Dante Parker, Afro-Américain de 36 ans, décède pendant sa garde à vue après avoir reçu plusieurs tirs de taser [xvi]. Pour la population noire du pays, la révolte de Ferguson est devenue le point de fixation d’une colère qui montait peu à peu.
Pendant presque tout l’automne, le mouvement de Ferguson se concentre sur l’inculpation de Darren Wilson. Les procureurs tentent de repousser la réunion du grand jury le plus longtemps possible, en espérant que le froid finira par vider les rues. À l’évidence, étant donné le niveau de violence de la répression, l’intensité des manifestations du mois d’août ne peut pas être maintenue dans la durée. Mais les actions se poursuivent malgré tout grâce à la ténacité de certains militants et au soutien d’individus actifs ailleurs dans le pays. Fin août 2014, Darnell Moore et Patrisse Cullors, de Black Lives Matter, organisent un Freedom Ride1. Darnell Moore décrit l’ampleur de cette mobilisation :
Plus de 500 personnes venues de tous les États-Unis et du Canada ont apporté sous diverses formes leur soutien aux militants locaux de Ferguson. Ceux qui ont fait la route avec nous incarnent un contingent nouveau et hétérogène de militants noirs. Il y avait une diversité d’âges et de visions politiques. Tout le monde n’était pas hétérosexuel, tout le monde n’avait pas de papiers ou un casier judiciaire vierge. Certains étaient transgenres, handicapés, bisexuels [xvii].
Les militants organisent des veillées, des piquets devant le commissariat et des blocages de l’Interstate 70 qui traverse Ferguson, maintenant une pression obstinée sur les pouvoirs publics locaux afin d’obtenir l’inculpation de Wilson. Paradoxalement, le harcèlement constant de la police contribue aussi fortement à la continuation du mouvement. Fin septembre, l’autel en hommage à Mike Brown est arrosé d’essence et incendié. Les flammes font repartir la mobilisation : plus de 200 personnes se rassemblent pour une manifestation houleuse pendant laquelle 5 personnes sont arrêtées [xviii].
Quand les dirigeants locaux commencent à laisser filtrer que la décision du grand jury sera rendue en octobre, la mobilisation reprend autour de Ferguson. Un concert de l’orchestre symphonique de Saint-Louis est interrompu par une action multiraciale pendant laquelle les militants se lèvent pour chanter « Justice for Mike Brown », sur l’air de Which Side Are You On2 ? Les manifestants sortent en scandant « Black Lives Matter » sous les applaudissements d’une bonne partie du public – et de certains musiciens. Le 8 octobre, un policier de Saint-Louis qui n’est pas en service tire dix-sept fois sur un adolescent noir, Vonderrit Myers, qui décède après avoir reçu huit balles. Quelques jours après sa mort, 200 étudiants partent de Shaw, son quartier, pour en rejoindre des centaines d’autres et occuper l’université de Saint-Louis. Pendant plusieurs jours, comme pendant le mouvement Occupy, plus d’un millier d’étudiants occupent le campus [xix]. Cette occupation coïncide avec le « Ferguson October », action au cours de laquelle des centaines de personnes se rendent à Ferguson – en solidarité avec le mouvement local, mais aussi pour affirmer leurs propres revendications. « Chaque personne ici représente la famille d’une victime, ou une personne qui a été blessée, assassinée, arrêtée, expulsée », explique Richard Wallace, manifestant venu de Chicago [xx]. Bien que les dirigeants de Ferguson continuent de retarder le verdict, la résilience du mouvement de Ferguson fait des émules bien au-delà du Midwest.
Je ne trouve pas les mots pour exprimer ce qui se passe à Ferguson, écrit l’historienne Donna Murch. Sous le nom de Mike Brown, une belle tempête noire contre la violence d’État s’est mise à tourbillonner avec une telle intensité qu’elle a […] attiré des gens de tous les États-Unis, quittant les métropoles qui concentrent la richesse et les privilèges pour cette ville qui a connu ses années fastes il y a un siècle. Elle vise explicitement la police […], mais aussi les guerres impérialistes au Moyen-Orient […]. Le slogan le plus répété est l’appel de Stokely Carmichael :
« Organize, Organize, Organize. » Et ce mouvement de jeunes en plein essor est pénétré de la douceur de son héritage ancestral. Pour reprendre les mots d’un militant et chanteur de hip-hop local, « nos grands-parents seraient fiers de nous [xxi] ».
Une bataille oppose militants, leaders des droits civiques, élus et agents de l’État fédéral quant à la signification du mouvement de Ferguson. Pour les militants et les noirs de Ferguson, l’enjeu de la lutte est d’obtenir justice pour Mike Brown, ce qui implique de continuer à manifester. Obtenir l’inculpation de Wilson donnerait une légitimité aux stratégies et aux tactiques qui suscitent souvent l’hostilité des leaders historiques, lesquels multiplient les appels au calme et semblent plus empressés à critiquer les manifestants que les circonstances qui les poussent à agir.
Les organisations historiques des droits civiques, les membres du Congrès et les agents de l’État fédéral s’accordent pour plusieurs raisons. Les membres du CBC semblent surtout se soucier d’augmenter le nombre de leurs électeurs par des campagnes d’inscription sur les listes, et de canaliser la colère de la rue vers une victoire démocrate aux élections de mi-mandat. Les organisations historiques des droits civiques, tout en se retrouvant parfois en concurrence entre elles, poursuivent des objectifs similaires. Le NAACP, à la notoriété en berne, s’efforce de prendre la direction du mouvement de Ferguson pour redorer son blason. Le célèbre pasteur Jesse Jackson Senior s’est retrouvé isolé et marginalisé parce qu’il gravite en dehors de l’orbite de la Maison-Blanche d’Obama et qu’il a été supplanté par le révérend Al Sharpton dans le rôle de figure nationale des droits civiques. Pendant des années, des familles ont interpellé Sharpton pour lui demander du soutien et des ressources face aux meurtres de leurs enfants par la police. Sharpton, qui en a les moyens, leur a procuré ces deux choses – asseyant ainsi sa réputation de relais vers les communautés noires. Il se rend à Ferguson peu après la mort de Mike Brown, suivi quelques jours plus tard par le département de la Justice, dirigé par Eric Holder, ex-procureur général. Sur place, ils travaillent de concert à rétablir « la loi et l’ordre » et la crédibilité de l’État fédéral en tant qu’arbitre de conflits locaux insolubles par d’autres moyens.
Mais Sharpton arrive trop tard. Les jeunes noirs ont déjà subi deux confrontations avec la police qui se sont terminées par des tirs de gaz lacrymogène et de flash-ball. Les gens sont furieux. Ces tactiques de harcèlement ont élargi l’enjeu de ces manifestations bien au-delà de l’affaire Mike Brown. La bataille qui agite les rues de Ferguson est alimentée par un profond sentiment d’injustice chez les jeunes de la ville, dont l’avenir est compromis par le cycle infini des amendes, pénalités, mandats d’arrêt et interpellations. Ils luttent pour avoir le droit d’être dans la rue sans être pris dans l’étau de la police de Ferguson. Ils ont découvert leur force collective et leur détermination a été renforcée par leur capacité à tenir tête à la police. La peur s’est éloignée. Et ils ne sont pas prêts à reculer ou à laisser Sharpton officier en porte-parole d’un mouvement local déjà solidement constitué.
Le conflit est presque immédiat. Sharpton organise un meeting le jour de son arrivée. Dans son premier discours, il accuse les manifestants des violences sur lesquelles se sont focalisés les principaux médias.
Je sais que vous êtes en colère. […] Je sais que c’est monstrueux. En voyant la photo [de Brown gisant à terre], j’ai été soulevé par l’indignation. Mais nous ne pouvons pas être plus en colère que ses propres parents. S’ils arrivent à réagir dignement, nous pouvons réagir dignement. […] Devenir violent au nom de Michael Brown, c’est trahir le géant au cœur tendre qu’il était. Ne trahissez pas Michael Brown [xxii].
Tout juste débarqué en ville, plein de morgue et de condescendance, Sharpton se permet de décrire le caractère de Mike Brown à ses propres amis et camarades. Son discours accorde crédit aux comptes rendus des dirigeants de Ferguson, qui font peser la responsabilité des violences sur les manifestants alors même que la police, à l’évidence, tente de les priver de leur droit de réunion. Mais Sharpton voit bien plus loin que Ferguson : s’il arrive à éteindre cet incendie, sa cote politique montera en flèche. L’enjeu est de taille pour l’administration Obama, étant donné l’attention croissante que le pays porte aux violences policières. La venue de l’ex-procureur général Holder le confirme. Alors, comme les rassemblements se poursuivent malgré l’arrivée de Sharpton, ce dernier amplifie ses critiques des manifestants « violents », tentant de les dissocier des « pacifiques ».
Dans un discours prononcé aux funérailles de Brown, Sharpton réserve ses semonces les plus sévères aux jeunes manifestants noirs qui se sont défendus contre les violences et les provocations policières :
[Les parents de Michael Brown] ont dû interrompre leur deuil pour demander aux jeunes d’arrêter les pillages et les émeutes. […] Il faut imaginer leur souffrance – ils ont perdu leur fils, qui a été sali et marginalisé. Et ils sont obligés d’interrompre leur deuil pour vous demander de maîtriser votre colère, comme si vous pouviez être plus en colère qu’eux. […] Être noir n’a jamais rien eu à voir avec le fait d’être un bandit ou un voyou. Être noir, c’est rester debout, aussi bas qu’on puisse nous enfoncer. […] Être noir, c’est ne jamais renoncer à la quête de l’excellence. Quand l’accès à certaines universités nous était interdit, nous avons construit des facultés noires. […] Nous n’avons jamais baissé les bras. […] Aujourd’hui, au xxie siècle, nous accédons enfin à certains postes de pouvoir. Et vous décidez que réussir n’est plus un truc de noirs. Maintenant vous voulez vous appeler « nègres » entre vous, vous voulez dire que votre « meuf » est « bonne ». Vous avez perdu vos racines. Il faut qu’on fasse un grand ménage dans notre communauté pour pouvoir faire un grand ménage aux États-Unis d’Amérique [xxiii].
Dans un seul et même mouvement, Sharpton, non content de condamner les jeunes de Ferguson, accumule les stéréotypes. Chez les nouveaux militants, cela confirme l’intuition que Sharpton et ses semblables les prennent de haut ; et ils sont travaillés par une interrogation tacite : « Qui sont Sharpton, Jackson, le NAACP ou le département de la Justice pour venir nous expliquer comment il faudrait répondre à la violence de la police de Ferguson ? Que connaissent-ils des humiliations quotidiennes vécues par les habitants ? Qu’ont-ils fait, ces dirigeants, pour faire cesser les violences et les crimes policiers ? »
Si les jeunes de Ferguson ont le plus profond respect pour la mémoire du mouvement des droits civiques, ses représentants actuels leur semblent déconnectés de ce qu’ils vivent au quotidien. « Ce que je ressens au fond de moi, c’est qu’ils nous ont abandonnés », dit Dontey Carter à propos des leaders des droits civiques. « C’est à cause d’eux qu’on en est là. Ils ne nous représentent pas. C’est pour ça qu’on est là pour former un nouveau mouvement. Et on a des guerriers ici [xxiv]. » À son arrivée à Ferguson, Jesse Jackson a été pris à partie par un militant local : « Combien de temps vas-tu continuer à nous trahir pour servir tes intérêts ? On ne veut pas de toi ici à Saint-Louis, Jesse [xxv] ! » Sans aller aussi loin, d’autres militants ont noté que les jeunes noirs qui avaient été propulsés à la tête de la mobilisation de Ferguson étaient aussi les plus directement touchés sur le terrain.
« C’est important que les jeunes dirigent ce mouvement, constate Johnetta Elzie, parce que c’est notre tour. Ça fait si longtemps que les anciens reprochent à notre génération de ne pas se battre ou de ne pas se soucier de ce qui se passe dans le monde. Nous leur avons montré qu’ils se trompaient [xxvi]. »
À mesure que le mouvement prend forme, cette division entre la « vieille garde » et la « nouvelle génération » se creuse. Au cours d’un meeting pendant le « Ferguson October », on frôle l’explosion quand les organisateurs invitent des représentants historiques des droits civiques, qui ne sont venus ni dans la rue ni aux actions quotidiennes, à débattre de l’état du mouvement. Pendant le discours du président du NAACP, Cornell William Brooks, plusieurs jeunes de l’auditoire se lèvent et lui tournent le dos. Le chanteur de hip-hop Ted Poe lance à la cantonade : « Ce n’est pas le mouvement des droits civiques de papi et mamie, ici », avant de décrire le mouvement tel qu’il est, composé des filles et des garçons qu’on voit dans la rue avec des bandanas, qui se retrouvent en première ligne au lieu d’être en classe. Depuis le public, il interpelle le NAACP et consorts : « Et vous étiez où, pendant ce temps ? […] Bougez vos culs et rejoignez-nous [xxvii] ! »
Du point de vue des dirigeants politiques, Sharpton avait pour lui sa capacité à maintenir l’attention des mobilisations sur un cas isolé, ou du moins autour de la seule thématique de la « responsabilité de la police ». Mais le conflit entre les jeunes militants et les « institutionnels » se durcit à mesure que les autorités de Ferguson retardent la décision d’inculper ou non Wilson. Les jeunes veulent faire monter la pression, tandis que la « vieille garde » répète qu’il faut patienter et laisser l’affaire suivre son cours. D’autres tensions apparaissent. Les jeunes militants commencent à donner un sens politique général à la récurrence des violences policières et à développer une analyse systémique du maintien de l’ordre : nombre d’entre eux se sont mis à l’articuler à une critique bien plus large qui resitue l’action de la police dans la question du racisme et des inégalités aux États-Unis et au-delà. Ashley Yates, du collectif Millennials United in Action, constate que « les jeunes ont su très tôt quelque chose que la génération précédente ignorait. Nous savions que le système avait échoué avant même qu’ils ne commencent à s’agiter publiquement. On savait non seulement que le meurtre de Mike Brown était injustifié, mais aussi que c’était encore un exemple de la manière dont les systèmes en place rendent acceptable le fait de nous faire taire par les armes. Nous sommes la génération qui a été mise en action par le meurtre de Trayvon Martin ; nous avons cru en un système judiciaire qui nous a trahis publiquement et délibérément [xxviii]. » Elzie remarque :
« Grâce à Twitter, j’avais vu des photos de Gaza plusieurs semaines avant, et je me sens émotionnellement liée aux gens de là-bas. Je n’aurais jamais cru que le petit comté de Ferguson, ce coin reculé du Grand Saint-Louis, allait devenir Gaza. »
Le clivage générationnel est bien réel, comme souvent quand émerge une nouvelle génération de militants qui n’est ni encombrée par le poids des défaites passées ni habituée à une forme particulière de pensée ou d’organisation. Elle impulse de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et, souvent, un nouveau souffle aux schémas et aux rythmes du militantisme. Le mouvement prenant de l’ampleur, certains activistes ont eu tendance à encenser la jeunesse et à dénigrer l’âge et l’expérience. Mais ces tensions ne signifient pas que plusieurs générations ne peuvent cohabiter au sein des mouvements et du militantisme en général. Dans les années 1960, Ella Baker, icône des droits civiques, avait beau être nettement plus âgée et plus expérimentée que les jeunes fondateurs du SNCC, elle n’en inspirait pas moins un respect immense qui reflétait le respect dans lequel elle-même tenait ses jeunes alliés. Dans un texte qui décrit certaines de ses conceptions de l’action et du pouvoir pendant le mouvement des sit-in de 1960, elle écrit :
Le désir d’être soutenus par des leaders adultes et la communauté adulte était […] tempéré par l’appréhension qu’ils ne tentent de « kidnapper » le mouvement étudiant. Les étudiants voulaient être rencontrés sur des bases d’égalité et ne toléraient aucune manipulation ou domination. Ce penchant pour le leadership du groupe, par opposition au leadership d’un individu sur le groupe, était effectivement rafraîchissant pour ceux qui ont connu les anciennes organisations et portent les cicatrices de la bataille, les frustrations et la désillusion éprouvées quand il s’avère que le leader prophétique était un colosse aux pieds d’argile [xxix].
Bien que l’on s’émeuve sans cesse d’un soi-disant « clivage générationnel », il y a une grande fluidité de relations entre les jeunes et les Afro-Américains plus âgés, qui sont souvent les parents des jeunes que tue la police. Le clivage générationnel s’est surtout exprimé par rapport à l’orientation politique du mouvement. La flexibilité tactique et stratégique des jeunes activistes est le fruit d’une forme de politisation qui ne se réduit pas à un programme étroit d’inscription des électeurs ou à une simple stratégie électorale. À Ferguson, cette politisation a été incarnée par l’émergence des jeunes femmes noires, devenues une force centrale du mouvement.
La plupart des meurtres de noirs commis par l’État restent inconnus du public et tus par les grands médias. Les rares cas – comparativement au nombre de tués – qui apparaissent sur le devant de la scène concernent souvent des hommes ou des garçons noirs. C’était le cas à Ferguson et à Baltimore. Ce n’est pas étonnant, puisque quand la police tire sur quelqu’un pour le tuer, elle vise le plus souvent des hommes afro-américains. Mais celles avec qui ils partagent leur vie, avec qui ils ont des enfants, leurs proches parentes, souffrent aussi de la violence subie par ces hommes et ces garçons noirs. L’invisibilisation de l’impact spécifique des crimes policiers sur les femmes noires minimise la profondeur et l’étendue des dégâts causés par les abus du système policier. Quand des hommes noirs tombent sous le coup de la justice pénale, cela a des effets destructeurs sur l’ensemble de leur famille et de leur quartier. Le statut d’ancien détenu augmente la probabilité d’être pauvre ou sans-emploi et empêche de bénéficier des programmes d’aides fédérales destinés à limiter les pires effets de la pauvreté, comme les allocations logement ou les prêts étudiants. Ces politiques n’affectent donc pas seulement les hommes noirs, mais aussi celles qui vivent avec eux.
Les femmes noires peuvent aussi être directement victimes du système policier, y compris des violences policières et de l’incarcération. Si le nom de Trayvon Martin est désormais connu de tous, personne ou presque n’a jamais entendu parler de Marissa Alexander, une femme noire victime de violences conjugales. Après avoir tiré un coup de feu pour tenir son agresseur à distance, elle s’est défendue en invoquant la loi Stand Your Ground régissant le droit à faire usage d’une arme en cas de légitime défense. Alors que George Zimmerman, qui a tué Trayvon Martin, a utilisé cette ligne de défense avec succès, Marissa Alexander a été condamnée à vingt ans de prison. Même si elle a été ensuite libérée, ce contraste est un rappel saisissant de la justice à deux vitesses qui prévaut aux États-Unis3.
Et la police tue aussi des femmes noires. Les noms de Rekia Boyd, Shelly Frey, Miriam Carey et Alberta Spruill sont moins connus que ceux de Mike Brown et Eric Garner, mais ce sont les mêmes mécanismes de déshumanisation qui sont à l’origine de leur meurtre. La police considère les femmes noires avec la même suspicion que les hommes noirs et accorde une moindre valeur à leurs vies. Elles sont donc plus souvent tuées ou brutalisées. On fait assez peu de cas du viol ou du meurtre d’une femme noire par un agent des forces de l’ordre – parce qu’elles sont généralement perçues comme moins féminines ou moins vulnérables. Citons l’exemple du policier Daniel Holtzclaw, de Tulsa (Oklahoma), condamné pour le viol de treize femmes noires pendant son service. Il semble qu’il s’en soit pris à elles en raison de leur « statut social inférieur » – qui les rend moins dignes de foi et d’attention [xxx]. Les crimes de Holtzclaw ont suscité un intérêt très limité dans la presse nationale.
Si les femmes noires ont toujours été victimes des violences policières et du système pénal, les luttes ont presque toujours été représentées par des hommes. Quand les affaires prennent une dimension nationale, on retrouve le plus souvent au premier plan un avocat, un pasteur ou un leader des droits civiques – comme Al Sharpton. Bien sûr, on entend la voix des mères et des femmes proches de la victime (en général un homme), mais l’impression qui domine est que ces mobilisations ont été portées par des hommes – jusqu’à Ferguson.
En l’occurrence, les médias se sont montrés particulièrement sensibles au rôle central joué par les « femmes de Ferguson » pour transformer « une série de manifestations en un mouvement, passant naturellement du rôle de pacificatrices à celui d’agitatrices, militantes de terrain et porte-parole » [xxxi]. De fait, les femmes qui ont assuré la tâche de maintenir la cohésion du mouvement de Ferguson pendant l’été et jusqu’au début de l’hiver étaient conscientes d’être indispensables, comme le fait remarquer Brittney Ferrell :
Les médias ont oublié de dire que sans les femmes, il n’y aurait pas eu de mouvement. C’est grâce à notre sérieux que les choses en sont là aujourd’hui, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas aussi des hommes qui font le boulot, car il y en a. Mais les femmes sont là depuis le premier jour, et nous sommes prêtes à donner nos vies pour continuer la lutte sans le soutien de quiconque ou d’une quelconque organisation, d’où la nécessité de construire la nôtre [xxxii].
Se demander pourquoi les femmes noires ont été au cœur de ce mouvement serait partir du principe qu’elles ont tenu un rôle secondaire dans les précédents. Il devrait pourtant aller de soi que les femmes noires ont toujours joué un rôle central dans tous les aspects du mouvement de libération noire. Qu’il s’agisse d’Ida B. Wells, qui a risqué sa vie pour dénoncer la pratique du lynchage dans les États du Sud, ou des mères des « garçons de Scottsboro [i] »4, qui ont fait une tournée mondiale pour obtenir la libération de leurs fils, les femmes noires ont été en première ligne de chacune des grandes campagnes pour les droits et la libération des noirs. Ella Baker, Fannie Lou Hamer, Diane Nash et bien d’autres, innombrables et inconnues, ont joué un rôle clé dans l’essor du mouvement des droits civiques, bien qu’il continue d’être principalement associé à des leaders masculins.
Mais aujourd’hui, le visage du mouvement Black Lives Matter est largement queer et féminin. D’où cela vient-il ? Peut-être est-ce tout simplement le résultat de la répression profondément raciste dont sont victimes les hommes à Ferguson. Selon le Bureau du recensement des États-Unis, Ferguson compte 1 182 femmes afro-américaines âgées de 25 à 35 ans, contre seulement 577 hommes afro-américains de la même classe d’âge. Plus de 40 % des hommes noirs dans les tranches d’âge 20-24 ans et 35-54 ans manquent à l’appel [xxxiii]. Cela donne un exemple concret de l’impact de l’orientation ultra-agressive de l’activité policière à Ferguson.
Ferguson n’a rien d’exceptionnel. Sur l’ensemble des États-Unis, 1,5 million d’hommes noirs sont « manquants » – arrachés à la société par une peine d’emprisonnement ou une mort prématurée. Pour le dire encore plus clairement, « plus d’un homme noir sur six qui devrait aujourd’hui avoir entre 25 et 45 ans a disparu de la vie quotidienne » [xxxiv]. Cela ne signifie cependant pas que si les 40 % d’hommes noirs de Ferguson réapparaissaient, ils joueraient le même rôle que les femmes dans la construction, la diffusion et la pérennisation du mouvement. Il est plus probable que ces femmes ont pris des responsabilités dans le mouvement à cause des effets absolument dévastateurs de l’action et des violences de la police sur la vie de la population noire en général. Mais quelles qu’en soient les raisons, leur présence a apporté beaucoup plus que la parité.
Les femmes noires qui sont à la tête du mouvement contre les violences policières ont travaillé à faire comprendre au grand public tout ce que ces violences impliquent pour les quartiers noirs. Question parfois articulée avec la revendication explicite d’une reconnaissance publique que la police s’en prend particulièrement aux femmes noires. « Les médias excluent le fait que les violences et le harcèlement de la police dans nos quartiers touchent aussi bien les femmes que les hommes, témoigne Zakiya Jemmott, qui ajoute : Ils mettent en avant les vies des hommes noirs et laissent de côté toutes ces femmes noires tuées par la police. Je veux que les médias comprennent que les vies de toutes les personnes noires comptent [xxxv]. » Mais les femmes noires sont aussi intervenues pour appuyer la nécessité de resituer le rôle des violences policières dans un système d’oppression bien plus large qui structure les vies de toutes les personnes noires des classes populaires. Charlene Carruthers, du collectif Black Youth Project 100, explique :
Cela nous tient vraiment à cœur de défendre la liberté et la justice pour toutes les personnes noires, quand trop souvent les femmes ou les LGBTQ sont laissées en marge. Parler sérieusement de libération implique d’inclure toutes les personnes noires. C’est aussi simple que ça. Et dans mon expérience, les questions de justice de genre et de justice pour les LGBTQ ont été ou bien traitées de façon secondaire ou bien évacuées [xxxvi].
Les femmes noires qui ont créé le hashtag #BlackLivesMatter – Patrisse Cullors, Opal Tometi et Alicia Garza – expriment très clairement les dominations croisées que subissent les femmes et les hommes noirs dans leur lutte pour la justice et la fin des violences policières. Dans un texte qui met l’accent sur le caractère multidimensionnel de leur oppression et montre l’impossibilité de limiter le combat à la question des violences policières, Alicia Garza écrit :
C’est reconnaître que la pauvreté et le génocide des noirs sont une violence d’État. Reconnaître que dans ce pays, le fait qu’un million de noirs sont enfermés dans des cages – soit la moitié de tous les prisonniers – est une violence d’État. Reconnaître que les femmes noires font les frais d’une offensive ininterrompue sur nos enfants et nos familles, et que cette offensive est une violence d’État. Le fait que les queers et les trans noirs portent un fardeau exceptionnel dans une société hétéro-patriarcale qui nous jette comme des déchets tout en nous fétichisant et en faisant du profit sur notre dos est une violence d’État ; le fait que 500 000 noirs aux États-Unis sont des migrants sans papiers et marginalisés est une violence d’État ; le fait que les femmes et les hommes noirs handicapés ou dotés de capacités différentes sont victimes des expériences darwiniennes sponsorisées par l’État pour nous faire rentrer de force dans des petites cases de normalité prédéfinies par la suprématie blanche est une violence d’État [xxxvii].
Dénoncer une « violence d’État » correspond à un décrochage stratégique par rapport à l’analyse conventionnelle qui réduit le racisme aux intentions et aux actions des individus directement impliqués. Parler de « violence d’État » légitime la revendication corollaire d’une « action d’État ». Exigeant plus que la révocation de tel agent ou des remontrances à tel service de police, cela attire l’attention sur les forces systémiques qui permettent aux individus d’agir en toute impunité. En outre, ces militants et militantes ont une approche « intersectionnelle » des luttes sociales – partant du constat basique que l’oppression des Afro-Américains est multidimensionnelle et doit être combattue sur différents fronts. L’amplitude de leurs analyses est la véritable cause des tensions entre la « jeune » et la « vieille garde ». D’une certaine façon, cela démontre que les militantes et militants actuels sont confrontés à des questions semblables à celles que se posaient les radicaux noirs à l’ère du Black Power : des questions liées à la nature systémique de l’oppression des noirs dans le capitalisme états-unien, qui déterminent également les formes d’organisation de la lutte.
Le fait d’insérer les violences policières dans un maillage plus vaste d’inégalités est largement absent des orientations politiques plus étroites de l’establishment libéral des droits civiques, tel que le National Action Network (NAN) de Sharpton, qui s’est plus intéressé à résoudre telle ou telle affaire qu’à bâtir un discours plus général sur la nature systémique de la violence policière. Les organisations des droits civiques privilégient les approches légalistes, à la différence des militantes et militants qui relient les violences policières aux autres problèmes sociaux qui touchent les quartiers noirs. Bien sûr, cette approche légaliste n’a pas été totalement dédaignée à Ferguson : le mouvement s’est aussi beaucoup concentré sur l’inscription sur les listes électorales et l’augmentation du nombre d’Afro-Américains dans les instances de pouvoir. Mais le mouvement a également donné raison à ceux qui défendent une vision bien plus large en montrant comment l’activité de la police est indissociable des niveaux élevés de pauvreté et de chômage et des répercussions des amendes, pénalités et mandats d’arrêt qui enferment la population noire dans un cycle d’endettement infini. La gravité de la situation des communautés noires, qui découle souvent de ces rencontres désastreuses avec la police, justifie la nécessité d’une analyse globale. Cela permet de relier les violences policières au constat plus général que les fonds publics alloués à la police sont autant d’argent en moins consacré à d’autres services, et de se demander pourquoi.
Par ailleurs, non seulement les analyses de la « jeune garde » diffèrent nettement de celles de la « vieille garde », mais il en va de même pour l’organisation de la lutte. En plus d’être dirigée par des femmes, la jeune garde est décentralisée et organise largement le mouvement à partir des réseaux sociaux. On est très loin d’organisations nationales comme le NAACP, le NAN ou même l’« Opération Push [ii] » de Jackson, où des dirigeants – en majorité des hommes – prennent des décisions assez peu élaborées ou orientées par la base. Cette stratégie ne découle pas simplement du fait que ces dirigeants soient des hommes, mais d’un modèle antérieur, qui privilégiait à l’action de la rue la constitution d’un réseau et de relations au cœur du pouvoir institutionnel – même s’il pouvait utiliser la rue pour asseoir son influence au sein de ce pouvoir. Étant donné leur nouveauté, la mobilisation de Ferguson et le mouvement naissant contre les violences policières n’ont pour l’instant pas permis ce genre de récupération politique.
Le 24 novembre 2014, à Ferguson, le grand jury décide de ne pas inculper Darren Wilson pour le meurtre de Mike Brown. Dès l’annonce de cette décision, au milieu de la nuit, de violentes manifestations éclatent dans la banlieue. Des rangées de policiers anti-émeute protègent l’hôtel de ville et le commissariat, laissant l’incendie ravager le quartier commercial noir de Ferguson. Cette décision ne surprend guère, mais l’épilogue de ce lynchage juridique est insupportable. Sur les ondes, le Président Obama prêche à nouveau la patience et le respect de la loi : « Notre pays est un État de droit », rappelle-t-il. Mais ce concept n’a-t-il pas été vidé de son sens par la manière dont, des mois durant, la police de Ferguson a bafoué la loi [xxxviii] ? Obama exhorte les manifestants à exprimer leurs griefs de manière « constructive » et non « destructrice », mais les séquences diffusées en split screen par plusieurs chaînes, où l’image du Président est accolée à celles des flammes dans la nuit de Ferguson, montrent à quel point ses paroles sont prononcées en pure perte. Pourtant, ces flammes n’annoncent pas un retour du mois d’août précédent, lorsque les incendies avaient fait naître un mouvement contre les violences policières ; ce sont désormais celles de la résignation et de l’épuisement.
Mais comme cela s’est produit si souvent en 2014, au moment où la vague de mobilisation commence à refluer, la police fait une nouvelle victime, comme pour jeter de l’huile sur le feu. Le 22 novembre, deux jours avant l’annonce de la non-inculpation de Wilson, la police tue par balles le jeune Tamir Rice, âgé de seulement 12 ans, sur une aire de jeu de Cleveland (Ohio). Il jouait avec un pistolet en plastique. Neuf jours auparavant, le 13 novembre, Tanisha Anderson, autre habitante de Cleveland, perd la vie suite à une « prise de judo » administrée par un policier qui, voulant la plaquer au sol, lui heurte la tête contre le béton [xxxix]. Le 3 décembre, un grand jury de Staten Island prononce un non-lieu dans l’affaire Daniel Pantaleo, le policier qui a étouffé Eric Garner. Alors que la décision de Ferguson semblait mettre un point final à des mois de mobilisation locale, ces nouvelles victimes et ce non-lieu ouvrent un nouveau chapitre. La poursuite des manifestations est cependant fragilisée par des tensions sur la stratégie à adopter pour passer « du moment au mouvement [xl] ».
Le 1er décembre, Obama organise une rencontre avec certaines figures militantes de Ferguson et du reste du pays pour discuter des violences policières. « Nous apprécions que le Président ait voulu nous rencontrer, commente James Hayes, délégué du syndicat étudiant de l’Ohio, mais il doit maintenant prendre des mesures adéquates. Nous appelons tous ceux pour qui les vies des noirs comptent à rester dans la rue jusqu’à ce que les choses aient vraiment changé dans nos quartiers [xli]. » Le simple fait qu’une telle rencontre ait été organisée démontrait qu’il ne s’agissait plus seulement de Ferguson. La classe dirigeante du pays s’efforçait de contenir le mouvement.
Ce n’était pas une rencontre ordinaire : le Président, le vice-président et le procureur général des États-Unis étaient présents. Mais alors qu’ils tentent d’endiguer la colère de Ferguson, deux jours plus tard, le non-lieu prononcé pour Daniel Pantaleo soulève des manifestations encore plus importantes que celles qui ont accueilli la non-inculpation de Darren Wilson. Partout aux États-Unis, des dizaines de milliers de personnes bloquent des rues, écœurées, furieuses qu’on refuse à nouveau de punir un policier blanc pour la mort d’un noir qui n’était pas armé. Dans le cas de Garner, les preuves sont pourtant irréfutables. Des centaines de milliers de gens ont visionné la vidéo dans laquelle il supplie et répète onze fois : « J’étouffe », pendant que Pantaleo le comprime à mort. Mais le grand jury n’y trouve rien à redire. Suite au non-lieu, Obama remise ses discours sur « l’État de droit » pour annoncer la création d’un nouveau groupe de travail chargé de proposer « des recommandations spécifiques sur la manière de renforcer la relation entre les forces de l’ordre, les communautés de couleur et les minorités qui se sentent discriminées [xlii] ».
Mais les militants ne veulent pas attendre. Des vagues de manifestations déferlent sur le pays, et les toutes premières manifestations nationales contre les violences policières sont programmées le 13 décembre 2014 dans les villes de New York et de Washington. La première est organisée via Facebook par des activistes ; la seconde par le National Action Network de Sharpton. L’apparition d’un mouvement national s’accompagne immédiatement du retour des tensions apparues à Ferguson. Sharpton a prévu de piloter l’ensemble de l’événement dont il sera le principal orateur. Les militantes et militants de Ferguson qui ont fait le déplacement à Washington découvrent, consternés, une tribune pleine de personnalités sans liens organiques avec le mouvement. Des vigiles exigent même des badges VIP pour accéder à l’estrade où ont lieu les prises de paroles avant le départ de la marche. Johnetta Elzie est furieuse : « Quand on est arrivés, deux personnes du NAN nous ont dit qu’il fallait un passe VIP ou une carte de presse pour s’asseoir autour des tribunes. Depuis quand exige-t-on des badges VIP pour prendre la parole dans une manifestation [xliii] ? » Quand Sharpton s’avance vers l’estrade, il taxe les militants de Ferguson, qui demandent à prendre la parole, de « provocateurs ». Mais l’hostilité entre Sharpton et les militants endurcis de Ferguson ne tient pas uniquement à des problèmes de badges ou à des manques d’égards. « Je pense que c’est en partie parce que les gens ne se sentent pas représentés par lui, observe Charles Wade, un jeune organisateur du mouvement. Nous avons été exclus des organisations traditionnelles, et nous avons construit notre propre truc [xliv]. » Les deux manifestations connaissent un succès phénoménal, rassemblant des dizaines de milliers de personnes et donnant pour la première fois une dimension nationale au mouvement, mais les divergences sur la marche à suivre sont de plus en plus claires.
Plusieurs jours après la marche, Sharpton signe un article qui témoigne autant de l’ampleur des pressions qu’il subit que de sa vision extrêmement vague de la manière dont le mouvement pourrait « réformer le système » :
Dans dix ou vingt-cinq ans, on ne se souciera pas de savoir qui a reçu le plus de publicité ou d’applaudissements pendant un rassemblement. […] Ne nous laissons pas aller aux mesquineries ou à l’émotion, car le vrai changement est à nos portes. C’est ce qu’on lisait sur les visages de ceux qui ont défilé et chanté samedi, et c’est ce qu’on voit à Washington où nos représentants prennent des mesures pour réformer un système qui depuis trop longtemps laisse trop de gens sur la touche. […] Il est littéralement palpable dans l’air – le changement est à l’horizon. Il faut le saisir dès aujourd’hui pour écrire l’histoire ensemble [xlv].
Voilà qui détonnait avec la petite excursion arrogante de Sharpton à Ferguson. Mais l’emploi des termes « publicité » ou « applaudissements » est révélateur de ses préoccupations. Sa vision du « changement » est succincte : les deux « grandes » réformes qu’il évoque se limitent à des caméras-piétons sur les policiers et à des procureurs indépendants pour enquêter sur les bavures policières.
La timidité de ses revendications illustre parfaitement l’écart entre la « vieille garde » et la révolte montante de la jeunesse. Il ne parle ni de racisme, ni d’incarcération de masse, ni d’aucun des problèmes qui ont amené les militants plus jeunes à des positions bien plus tranchées. Sur cette question, Jesse Jackson a lui aussi son mot à dire :
Pour passer de la protestation au pouvoir, il faut des manifestations, des projets de loi et des actions en justice. […] Les sprinters s’épuisent très vite. Ces jeunes doivent se préparer à une course d’endurance. Et cela doit prendre la forme d’un regroupement intergénérationnel. Un mouvement mature a besoin d’hommes d’église, d’hommes de loi et de parlementaires. On ne mène pas une lutte avec une seule corde à son arc [xlvi].
Bien que nettement moins sévère que Sharpton, Jesse Jackson diverge avec le mouvement sur l’identité et les préoccupations qu’il devrait endosser. Il alimente en outre l’idée selon laquelle les nouveaux militants seraient hostiles aux « vieux », ce qui n’a jamais été démontré. Dans une interview, Alicia Garza clarifie ce point :
Nous avons appris de nos erreurs et de nos aînés qui ont le courage de partager avec nous tout ce qu’ils savent. Je pense que l’important est de mener des discussions courageuses sur le monde que nous voulons construire et sur la façon de le faire, et d’aller chercher de l’aide quand on rencontre des difficultés [xlvii].
La coalition « d’hommes d’église, d’hommes de loi et de parlementaires » préconisée par Jackson a lamentablement échoué au cours des quarante dernières années. Conseiller aux jeunes de reprendre à leur compte une stratégie en faillite n’a fait que renforcer l’impression que la « vieille garde », hors de son élément, était dépassée. Et la frustration de Sharpton face à la remise en cause de son autorité et de son rôle de porte-parole de l’Amérique noire finit par exploser. Plusieurs semaines après les marches de décembre, il compare la « jeune garde » à des « maquereaux » et ses partisans à des « prostituées » :
Et pendant que vous êtes tous là, à Ferguson, à vous disputer sur les jeunes et les vieux, il y a une élection et pas un candidat dans la course. Tout ça parce que vous êtes trop occupés à vous prendre la tête avec maman et papa pendant qu’ils réélisent un maire et un procureur. Ils réussissent à vous enferrer dans des disputes sur qui va se trouver en tête de cortège – les vieux ou les jeunes – pendant qu’ils sabrent le budget municipal. Ne soyez pas si bêtes ! […] C’est en vous divisant qu’ils arrivent à casser le mouvement. Et ils jouent sur votre ego : « Vous êtes jeunes et dans le coup, vous en voulez. C’est vous la nouvelle icône. » Ils savent bien que tout ce baratin vous monte à la tête. C’est comme ça que les maquereaux parlent aux prostituées [xlviii].
Ce laïus effarant de Sharpton porte un coup fatal à sa légitimité de leader autoproclamé de l’Amérique noire.
Dans les jours qui suivent les grandes manifestations de décembre, Ferguson Action, collectif regroupant les diverses initiatives militantes de Ferguson ou inspirées par Ferguson, publie un communiqué auquel sont associés certains militants et militantes qu’on a empêché de s’exprimer à Washington. Intitulé « À propos de ce mouvement », sa largeur de vue et son optimisme font paraître le caprice de Sharpton encore plus mesquin :
Ce mouvement est constitué par et pour toutes les personnes noires – femmes, hommes, transgenres et queers. Nous réunissons les jeunes et les aînés sur la base des possibilités que de nouvelles tactiques et des stratégies inventives peuvent offrir au mouvement. Il y a parmi nous des nouveaux venus, mais beaucoup d’entre nous mènent des luttes depuis des années. Nous nous sommes rassemblés au nom de Mike Brown, mais nos racines plongent aussi dans les rues inondées de la Nouvelle-Orléans et dans les stations maculées de sang de la Bart d’Oakland5. Nous nous retrouvons sur Internet et dans les rues. Nous sommes décentralisés, mais coordonnés. Surtout, nous sommes organisés. Pourtant, nous ne sommes probablement pas de bons noirs respectables. Nous nous tenons les uns à côté des autres, sans hiérarchie. Nous ne poussons aucun d’entre nous vers les marges afin de nous approcher de ce qui passe pour des lieux de pouvoir. Parce que ce n’est qu’ainsi que nous gagnerons. Nous étouffons. Et nous ne nous arrêterons qu’une fois libres [xlix].
En décembre 2014 et en janvier 2015, « Black Lives Matter » est devenu un cri de ralliement repris de toutes parts. Une semaine après l’abandon des poursuites contre le meurtrier d’Eric Garner, plusieurs centaines d’attachés parlementaires du Congrès, noirs pour la plupart, cessent le travail en signe de protestation [l]. Des athlètes noirs portent des t-shirts arborant le slogan « J’étouffe ». Lycéens et étudiants adoptent sans tarder la même tenue. Des milliers d’entre eux, et même certains collégiens, quittent tous ensemble les cours, organisent ou rejoignent des marches et des die‑in6, entre autres formes d’actions publiques [li]. À l’université de Princeton, plus de 400 étudiants et enseignants prennent part à un die-in. La plupart des participantes et participants sont des étudiants afro-américains, mais un certain nombre de blancs, d’Hispaniques et d’Asiatiques se joignent à l’action. Les étudiants de Stanford bloquent le pont de San Mateo qui traverse la baie de San Francisco. Dans 70 facultés de médecine, les étudiants organisent des die-in et scandent : « Des blouses blanches pour les vies noires » [lii]. Des avocats commis d’office et leurs confrères7 organisent à leur tour des die-in [liii].

Alicia Garza souligne l’importance de ces actions :
Actuellement, le mouvement s’amplifie. Nous tissons des relations et des réseaux, expérimentons des formes d’organisation démocratiques, de nouvelles tactiques, et apprenons de l’expérience de nos aînés – tels que Bayard Rustin, Diane Nash, Linda Burnham, Assata Shakur et Angela Davis – qui ont participé à des mouvements sociaux avant nous [liv].
On se mobilise dans le pays entier, et la classe politique peine à ne pas se laisser distancer. La présidentiable Hillary Clinton, qui n’avait jamais prononcé publiquement le nom de Mike Brown, n’a d’autre choix que de dire à son tour « Black Lives Matter » lors d’un discours à New York trois jours après la manifestation de décembre [lv]. Même Barack Obama commence à changer de discours. Quand il parle des jeunes afro-américains, il se montre moins moralisateur, « se concentre plutôt sur les injustices dénoncées par les Afro-Américains qu’il qualifie de “membres de la famille américaine” – ce qui rend extrêmement difficile de les étiqueter comme des enfants à problèmes qui auraient besoin d’être aimés avec sévérité [lvi] ».
Forts de cette dynamique nettement favorable, les leaders du mouvement devaient se donner les moyens de pousser leur avantage. Sharpton et l’establishment des droits civiques avaient fourni un repoussoir commode, dont il était facile de se démarquer par les idées, les stratégies et les tactiques. Mais comment les nouveaux militants, tels que les signataires de la plateforme de Ferguson Action, voyaient-ils la construction à venir du mouvement ? Après l’explosion de Sharpton et dès lors que l’expression « Black Lives Matter » était passée dans le langage quotidien des Afro-Américains, le pays s’intéressait à eux. Or, le net contraste entre les formes d’organisation intersectionnelles, démocratiques et horizontales de la « jeune garde » et la structure très hiérarchisée des groupes historiques des droits civiques avait contribué à masquer des divergences importantes entre les nouveaux militants eux-mêmes. Certains s’étaient lancés dans la constitution d’organisations telles que Black Youth Project 100 (BYP 100), #BLM, Dream Defenders, Million Hoodies et Hands Up United, tandis que d’autres n’en voyaient pas l’utilité et considéraient les réseaux sociaux comme la meilleure façon d’organiser le mouvement. Deux des militants les plus visibles et influents du mouvement, Johnetta Elzie et DeRay Mckesson, étaient peu investis dans la construction d’organisations.
La plateforme de Ferguson Action reflète cette approche en décrivant un mouvement « coordonné » et « organisé » mais « décentralisé ». D’une certaine façon, le caractère superflu d’une organisation a été démontré par le succès prodigieux des actions et manifestations lancées au pied levé. Pendant plusieurs mois, les réseaux sociaux tels que Twitter ont prouvé leur efficacité. La marche du 13 décembre 2014 à New York a été lancée sur Facebook par deux militants relativement novices ; en quelques heures, des milliers de personnes ont posté des « Likes » et se sont engagées à venir. Le rassemblement a réuni 50 000 personnes. Mais comment passer des actions directes, die-in, blocages d’axes routiers et débrayages à une société enfin débarrassée des violences policières sans créer des espaces pour se rencontrer, élaborer des stratégies et mettre en œuvre des processus de décision démocratiques ? Compte tenu des revendications et de la « vision » mises en avant par Ferguson Action – en finir avec le profilage racial et l’emprisonnement de masse, réaliser le plein emploi, etc. –, il est impossible d’imaginer que cela puisse se produire uniquement par Internet.
Ces débats sur les formes d’organisation ont des traits communs avec les tendances hostiles à la formalisation qui se sont fait entendre lors du mouvement Occupy à partir de 2011. Dans les deux cas, l’absence de formalisation d’une structure et du pouvoir est perçue comme un moyen de « permettre à chacun de s’exprimer » : s’il n’y a pas d’organisation, personne ne peut prendre le pouvoir. C’est ce que défend DeRay Mckesson : « ce qu’il y a de nouveau avec Ferguson […], ce qui fait que c’est très important, c’est que contrairement aux luttes antérieures, il n’y a pas de porte-parole. Qui est le porte-parole ? C’est la population. De façon très démocratique, les gens deviennent la voix de la lutte [lvii]. » Mckesson est l’une des personnalités les plus visibles du mouvement, et ses idées rencontrent une large adhésion.
Ce n’est pas que nous sommes anti-organisation, analyse-t-il. Certaines structures se sont formées dans la foulée de la mobilisation, et elles sont devenues importantes. C’est juste qu’on n’a pas eu besoin de ces structures pour démarrer le mouvement. Vous avez le pouvoir de lancer un mouvement. De simples individus peuvent se retrouver autour de constats d’injustice partagés. Et ils peuvent initier des changements. Vous pouvez vous engager corps et âme dans la lutte ; vous n’avez pas besoin d’un passe VIP pour lutter. C’est ce que Twitter a permis. […] Pour moi, nous sommes en train de constituer une nouvelle communauté radicale de lutte qui n’existait pas avant et que Twitter a permis de créer. Nous sommes maintenant dans une phase de construction de cette communauté. Oui, nous devons nous occuper des politiques à mener, nous occuper des élections ; nous devons nous occuper de toutes ces choses. Mais pas avant d’avoir constitué une communauté forte [lviii].
Tout le monde peut participer aux actions – mais comment fait-on pour en mesurer le succès et pour amener de simples participants à s’investir durablement dans la lutte ? En deux mots : comment passe-t-on du moment au mouvement ? L’historienne Barbara Ransby analyse ce problème :
Si certaines formes de résistance peuvent être de l’ordre du pur réflexe – quand on nous pousse trop fort d’un côté, on pousse de l’autre, même en l’absence de programme ou d’espoir de victoire –, organiser un mouvement est une chose différente. Ce n’est ni spontané, ni instinctif, et ce n’est jamais facile. Penser que nous pourrons tous nous « libérer » en résistant individuellement ou à travers des petits collectifs non coordonnés, c’est se faire des illusions [lix].
Tout le monde ne nie pas la nécessité de s’organiser. La lutte contre la terreur policière a conduit à la constitution de multiples organisations et réseaux. Lors d’un meeting dans l’église historique de Riverside8, à New York, Asha Rosa, du Black Youth Project 100, parle avec éloquence de la nécessité d’être à la fois radical et structuré :
Les organisations durent plus que les actions, plus que les campagnes, plus que les moments. Ce sont les organisations qui vont nous permettre de construire des structures qui reflètent nos valeurs, et des communautés sur lesquelles on peut s’appuyer et qui alimentent notre travail. Nous avons eu 60 000 personnes dans les rues de New York [en décembre 2014] [et] ça ne m’étonnerait pas qu’on ne revoie plus un tel nombre de gens dans la rue avant le retour du beau temps, et ce n’est pas grave. […] Les mouvements connaissent différentes phases. Nous devons tenir dans la durée et faire en sorte qu’il y ait des organisations auxquelles les gens puissent se raccrocher [lx].
Entre le BYP 100, Dream Defenders, Hands Up United, Ferguson Action, Millennials United et la plus connue, Black Lives Matter, cette nouvelle ère a produit une large constellation d’organisations militantes. BLM, à ce jour le groupe le plus important et le plus visible avec au moins vingt-six antennes locales, se définit comme « un réseau décentralisé visant à construire la capacité d’action et le pouvoir de la population noire ». Selon Patrisse Cullors, ses membres agissent « au sein des quartiers dans lesquels ils vivent et travaillent. Ils déterminent leurs objectifs et les stratégies les plus efficaces pour les atteindre. […] Nous avons délibérément choisi une approche prudente et collaborative pour développer une stratégie nationale afin de prendre le temps d’écouter, d’apprendre et de construire[lxi]. » BLM a repris à son compte la méthode Occupy, qui considère les actions « sans leaders » et décentralisées comme plus démocratiques, permettant aux participants et aux participantes de mener leurs propres initiatives sans être gênés par une intervention extérieure. Mais dans une période où ceux qui cherchent un point d’entrée pour militer contre la police sont nombreux, cette forme particulière d’organisation peut en réalité s’avérer difficile d’accès. Paradoxalement, cette décentralisation peut finir par restreindre les possibilités d’implication démocratique de bon nombre de personnes, car elle favorise plutôt la collaboration entre initiés.
Autant de questions qu’il reviendra à BLM de résoudre, en tant qu’organisation principale et la plus influente du mouvement : ses choix seront déterminants et auront des implications plus larges. L’autonomie des collectifs et la décentralisation amènent à s’interroger sur la manière de coordonner les actions et d’arriver à canaliser les forces de l’ensemble du mouvement pour combattre les institutions ciblées. Les problèmes se posent différemment selon les lieux : comment alors tisser les actions locales en un mouvement social cohérent et éviter de démultiplier les manifestations disparates et isolées ? Si chaque ville, collectif et individu choisit d’incarner le mouvement à sa manière, comment transformer cette kyrielle d’actions locales efficaces en mouvement national ? Dans certaines situations, des collectifs multiples ont réussi à se coordonner, par exemple lors de la campagne #SayHerName visant à faire connaître l’impact des violences policières sur les femmes noires. Reste que plus le mouvement s’amplifiera, plus la coordination sera nécessaire.
Si le succès du mouvement peut se mesurer à la prise de conscience qu’il a suscitée d’un bout à l’autre des « États-Unis de la violence policière », on peut aussi l’évaluer à l’aune des soutiens financiers que certains collectifs du mouvement ont réussi à mobiliser9. Seuls certains groupes rattachés au mouvement sont des organisations non gouvernementales, mais même ceux qui n’ont pas ce statut ont obtenu des fonds de la part de fondations influentes et de personnalités fortunées. Globalement, le mouvement Black Lives Matter a suscité l’intérêt de la galaxie des fondations et des philanthropes, comme les fondations Ford et George Soros mais aussi Resource Generation, qui se présente comme une « association de personnes fortunées de moins de 35 ans qui soutiennent les initiatives progressistes [lxii] ». Il existe même des réseaux philanthropiques entièrement consacrés à faire pression sur les fondations pour qu’elles soutiennent certains mouvements. À l’occasion d’une conférence d’été où se sont retrouvés tous les collectifs de Black Lives Matter, le National Committee for Responsible Philanthropy a lancé un appel aux autres fondations :
Une transformation profonde du tissu social, économique et politique qui marginalise nos communautés noires depuis des décennies est possible. Le rassemblement de ce mouvement pour les vies des personnes noires sera une étape majeure vers cette transformation. Toute fondation engagée en faveur d’une véritable égalité et du démantèlement du racisme doit y voir une occasion d’exercer sa responsabilité en participant [lxiii].
La déclaration remerciait ensuite « des soutiens tels que le Fonds Evelyn and Walter Haas Jr., la Fondation Levi Strauss, la Fondation Barr » d’avoir « fait de l’investissement dans le développement de l’initiative leur priorité ».
Ces seuls faits ne doivent pas conduire à déprécier les nombreux collectifs qui bénéficient de ces fonds. Presque toutes les organisations du mouvement des droits civiques ont été financées par des fondations, y compris le SNCC, le CORE et le SCLC. La Highlander Folk School – où nombre de militants des droits civiques, dont Rosa Parks et Martin Luther King, ont été formés à la désobéissance civique et à diverses techniques de lutte – était en grande partie financée par la Fondation Field. Les associations qui luttent pour la justice sociale font, à juste titre, appel à toutes sortes de sources de financement. Mais si les militantes et militants sont seulement à la recherche de quelques précieux dollars pour continuer à se mobiliser, il est en revanche douteux que des fondations multi-milliardaires agissent pour des raisons purement altruistes. L’historien Aldon Morris raconte la collusion de ce genre de fondations avec l’État pour mener un travail de sape des organisations des droits civiques :
La situation financière du SNCC s’améliore à l’été 1962 grâce aux fonds de la Fondation Taconic, de la Fondation Field et du Fonds familial Stern. Toutes ces fondations collaborent étroitement avec l’administration Kennedy et partagent avec elle l’idée que les militants noirs doivent surtout concentrer leur énergie sur l’inscription des noirs du Sud sur les listes électorales. […] Suite aux tumultueux Freedom Rides, l’administration Kennedy a ouvertement tenté d’orienter toutes les organisations des droits civiques vers des campagnes d’inscription des électeurs plutôt que vers une agitation contestataire. L’administration Kennedy s’opposait à tout prix à une généralisation de la désobéissance civique [lxiv].
Aldon Morris cite ensuite James Farmer, dirigeant du SNCC, qui relate comment « l’administration Kennedy a tenté de “calmer le jeu” » : « Bobby Kennedy a réuni le CORE et le SNCC dans son bureau […] et a dit : “Pourquoi ne pas arrêter toutes ces conneries, les Freedom Rides et tous ces sit-in pour se concentrer sur la formation des électeurs […] ? Si vous faites ça, je vous obtiendrai une exemption d’impôts.” [lxv] » Les organisations qui dépendent de financements extérieurs peuvent se retrouver en difficulté si les bailleurs de fonds se mettent à critiquer leur orientation politique. « Le système non lucratif permet aux fondations d’exercer une influence et un contrôle démesuré sur les actions des associations et des collectifs », met en garde Umi Selah, président de Dream Defenders. Une ancienne salariée d’un des principaux soutiens des causes noires fait également remarquer que les subventions s’accompagnent souvent d’un « cahier des charges qui fixe la manière dont les choses doivent être faites sur le terrain [lxvi] ».
Pour réduire leur dépendance aux financements extérieurs, certains groupes font désormais cotiser leurs membres et lancent des campagnes de dons auprès du grand public. S’il est périlleux de préjuger de l’influence des bailleurs de fonds et du « complexe industriel non lucratif » sur la suite du mouvement, elle sera certainement déterminante et rend d’autant plus nécessaire l’autonomie financière de ses organisations [lxvii]. Par exemple, la Fondation Ford cherche à devenir l’un des bailleurs de fonds du mouvement alors que, malgré ses intentions affichées, elle est connue pour avoir instrumentalisé de nombreux mouvements aux États-Unis et à l’étranger. Arundhati Roy analyse son influence délétère en Inde :
La Fondation Ford a une idéologie très claire et définie et travaille en lien étroit avec le département d’État américain. Son projet de démocratisation et de « bonne gouvernance » fait partie intégrante du schéma de Bretton Woods visant à standardiser les modèles économiques et à promouvoir un libre-échangisme efficace. […] C’est sous cet angle qu’il faut envisager les millions de dollars investis en Inde par la Fondation Ford – ses subventions aux artistes, réalisateurs et militants, ainsi que ses généreux financements de programmes universitaires et de bourses d’études [lxviii].
Comme bien d’autres, la Fondation Ford propose des subventions, mais produit aussi « livres blancs », séminaires et conférences dans lesquels elle met en avant des perspectives et des stratégies politiques pour orienter l’action de ses bénéficiaires.
Analysant les relations entre le NAACP et l’American Fund for Public Service – connu sous le nom de Fonds Garland –, la politologue Megan Francis montre que cet organisme ne s’est pas contenté de fournir d’importantes ressources au NAACP dans les années 1950, mais a usé de son influence pour orienter les stratégies militantes de l’organisation noire :
Pourquoi le NAACP s’est-il détourné de son action contre la violence raciale au profit d’une action centrée sur l’éducation ? Pour une seule raison : l’argent. Si le Fonds Garland a eu une telle emprise sur le programme du NAACP, c’est parce qu’il pouvait en offrir autant à cette organisation à court de liquidités. Pendant la négociation d’une subvention, il est rapidement apparu que les dirigeants noirs du NAACP étaient favorables à une action pour les droits civiques explicitement centrée sur la violence raciale. […] Mais face au risque de perdre une source de financement essentielle, le NAACP s’est conformé à contrecœur aux exigences du Fonds Garland. Au cours des années suivantes, le NAACP a mis de côté les questions de violence raciale pour se concentrer sur l’éducation, qui restera sa mission phare tout au long du xxe siècle [lxix].
En définitive, fondations et organismes philanthropiques divers tendent à réduire les perspectives militantes à la promotion de « réformes » pour aménager le système existant.
L’argent des fondations a également pour effet de « professionnaliser » les mouvements, favorisant le carriérisme et l’idée selon laquelle le militantisme peut être subventionné de l’extérieur. En réalité, la majorité des activités militantes sont bénévoles et l’argent est collecté directement auprès des participants et non grâce à l’expertise de spécialistes des dossiers de subvention. Au sein du mouvement Black Lives Matter, les organisations les plus solides financièrement ont tendance à occulter l’activité de nombreux collectifs de base. Des comités locaux plus modestes se sont constitués pour lutter sur des affaires spécifiques ou pour porter des revendications liées aux différents contextes urbains du pays.
Ainsi, à Madison (Wisconsin), le collectif Young, Gifted and Black (« Jeunes, talentueux et noirs ») s’est constitué pour obtenir justice pour Tony Robinson, jeune noir tué par la police au printemps 2015. À Cleveland, des militants locaux se sont alliés à des prêtres, des universitaires et au Council for American Islamic Relations pour exiger l’arrestation des deux policiers responsables de la mort de Tamir Rice [lxx]. Depuis Chicago, un nouveau collectif dénommé We Charge Genocide s’est rendu à Genève pour interpeller les dirigeants internationaux afin qu’ils fassent pression sur le gouvernement états-unien pour faire cesser les violences et les crimes policiers contre les noirs. À Philadelphie, au cours de l’hiver 2014 et d’une grande partie de l’année 2015, un collectif réunissant des quartiers de toute la ville, la Phillie Coalition for REAL Justice, a réuni une soixantaine de personnes deux fois par semaine pour lutter contre les violences policières. Cette coalition a réussi à rassembler plusieurs milliers de personnes au cours de l’année 2015 [lxxi]. À Dallas (Texas), Mothers Against Police Brutality a non seulement contribué à une mobilisation essentielle contre les violences policières, mais a aussi tenté activement de construire des ponts entre ces mouvements et les réseaux de défense des migrants. Quelques jours avant le rassemblement du 1er mai, des manifestants issus des deux mouvements ont convergé, brandissant des pancartes proclamant « Black Lives Matter » et scandant « À bas, à bas, les expulsions ! Vive, vive, vive l’immigration [lxxii] ! » Ce genre d’initiatives, souvent considérées par les bailleurs de fonds comme « non professionnelles », existent dans l’ensemble du pays et permettent aux citoyens ordinaires d’intégrer les mouvements.
Faute d’organisation indépendante représentant le mouvement, ses revendications sont restées peu audibles. C’est en partie lié à la difficulté de la tâche. La violence policière est inscrite dans l’ADN des États-Unis. Comme je l’ai montré précédemment, il n’y a jamais eu d’âge d’or de la police, la violence et le racisme ayant toujours eu un rôle central dans son action. Mais le système policier peut tout de même être endigué. On trouve sur le site Internet de Ferguson Action une compilation exhaustive des revendications du mouvement, notamment la démilitarisation des services de police, une législation contre le profilage racial et une enquête documentant l’ensemble des abus de la police [lxxiii]. À Ferguson et à Saint-Louis, Hands Up United appelle à la « suspension immédiate et sans solde des policiers coupables ou complices d’usage excessif de la force [lxxiv] ». BLM demande au procureur général de rendre publics les noms des policiers impliqués dans la mort de personnes noires au cours des cinq dernières années – « pour qu’ils soient traduits en justice – si cela n’a pas encore été fait [lxxv] ».
Si les revendications du mouvement se rejoignent, comment les défendre concrètement en l’absence d’une structure de coordination ? Comment évaluer de manière systématique si elles ont été en partie satisfaites ou s’il faut les redéfinir ? La force du mouvement actuel est de relier les violences policières aux conséquences plus générales du racisme institutionnel, mais il court aussi le risque de noyer des revendications atteignables dans une lutte bien plus large visant à transformer l’ensemble de la société. En d’autres termes, revendiquer la « liberté » ne dit rien des étapes nécessaires pour y parvenir.
Tout exiger à la fois est aussi inopérant que de ne rien exiger, car cela brouille les nécessités concrètes et quotidiennes de la lutte. Cela peut aussi s’avérer démoralisant : quand on vise la totalité, comment être attentif aux acquis parfois minimes dans lesquels tout mouvement puise son énergie ? Il ne s’agit pas de réduire ses prétentions ou d’abandonner la lutte pour une transformation radicale des États-Unis ; il s’agit de distinguer la lutte pour des réformes possibles aujourd’hui et l’objectif révolutionnaire, qui est un projet à plus long terme. Les deux sont nécessairement liés. Tenter de réformer un certain nombre d’aspects de la société existante améliore la vie des personnes ici et maintenant ; et c’est en le faisant qu’on apprend à lutter et à s’organiser. Ce sont les briques qui peuvent s’assembler pour bâtir des combats plus vastes et plus ambitieux. Dans l’intervalle, les personnes qui participent au mouvement se forment politiquement, acquièrent de l’expérience, de l’expertise, et s’initient au rôle de leaders. On ne passe pas d’un seul coup de l’inactivité à la révolution mondiale.
Bon nombre des femmes et des hommes noirs radicalisés dans les années 1950 pendant les luttes contre Jim Crow ne se seraient probablement pas reconnus une décennie plus tard. Bien des personnes qui ont commencé à militer contre le racisme en affichant des revendications limitées ont fini par conclure qu’un État fédéral structurellement raciste ne pourrait jamais rendre justice à la population noire. C’est ce qu’illustre le parcours des militants historiques de la SNCC, qui arrivèrent en 1964 à la convention nationale démocrate d’Atlantic City dans l’espoir de faire élire les candidats noirs de leur parti démocrate alternatif, le Mississippi Freedom Democratic Party, en tant que délégués du Mississippi. L’enjeu était de jeter l’opprobre sur le parti démocrate national, qui tolérait une délégation du Mississippi uniquement composée de blancs, tout en sachant pertinemment que les noirs étaient violemment marginalisés dans cet État. Les militants du SNCC croyaient que, s’ils l’emportaient, ils pourraient briser le monopole des dixiecrates – le parti démocrate blanc des États du Sud – sur le processus électoral du Sud. Mais Lyndon Johnson et le parti démocrate n’étaient prêts en aucun cas à compromettre les voix des électeurs blancs du Sud en accédant aux revendications des militants des droits civiques. En fin de compte, Lyndon Johnson les accula à un accord qui permit de laisser intactes la convention et l’aile suprémaciste du parti démocrate. James Forman, président du SNCC, analyse ainsi cette défaite :
La leçon d’Atlantic City a été déterminante. […] Elle a mis fin à l’espoir […] que l’État fédéral change la situation dans le Sud profond. La contradiction ténue entre les gouvernements des États et l’État fédéral, sur laquelle nous nous étions appuyés pour construire notre mouvement, s’était résorbée. Désormais, les véritables adversaires de la lutte étaient face à face : le peuple contre les États, État fédéral inclus [lxxvi].
Restreindre les mots d’ordre du mouvement pour préserver sa dynamique ne revient pas à en restreindre les ambitions. Ce qui fait du slogan « Black Lives Matter » une belle trouvaille, c’est la façon dont la formule condense les aspects déshumanisants du racisme anti-noirs aux États-Unis. Sur le long terme, la force du mouvement dépendra de sa capacité à toucher le plus grand nombre en reliant la question des violences policières aux autres aspects de l’oppression des personnes noires.
Cette dynamique est déjà à l’œuvre, car la « jeune garde » a travaillé à établir ces liens. Le meilleur exemple est la lutte des travailleurs pauvres pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure. 20 % des employés de la restauration rapide sont noirs et 68 % d’entre eux gagnent entre 7,26 et 10,09 dollars de l’heure [lxxvii]. À Chicago et à New York, les salariés du secteur comptent respectivement 46 % et 50 % de noirs [lxxviii]. 20 % des 1,4 million de salariés de Walmart sont afro-américains, ce qui en fait le plus gros employeur de noirs américains. Il y a un lien logique entre les campagnes des travailleurs pauvres et le mouvement Black Lives Matter. C’est parce qu’ils sont sur-représentés parmi les classes populaires que les Afro-Américains sont les cibles de la police, qui vise avant tout les pauvres. Les prolétaires noirs et hispaniques ont également plus de chances d’être pénalisés par le poids croissant des amendes et des pénalités en tous genres. Mwende Katwiwa, du collectif BYP 100 de la Nouvelle-Orléans, analyse cette articulation entre justice économique et raciale :
Les jeunes noirs se retrouvent souvent prisonniers d’un récit personnel sur leur parcours qui occulte la situation sociale et économique. […] Le mouvement Black Lives Matter ne se contente pas de demander la fin des violences et des crimes policiers contre les personnes noires – il exige qu’elles aient le droit de survivre, mais aussi de vivre. Dire que la vie des noirs vaut quelque chose, c’est dire que les personnes noires devraient pouvoir jouir du respect de leur dignité fondamentale sur leur lieu de travail – en particulier les jeunes, qui subissent le chômage de façon disproportionnée et sont sur-représentés dans les emplois peu rémunérés [lxxix].
Aujourd’hui, le mouvement est en bien meilleure position que les organisations historiques des droits civiques pour nourrir les luttes de plus en plus nombreuses de travailleurs pauvres et développer des liens avec elles. Depuis des années, Walmart et McDonald’s soutiennent généreusement le CBC, le NAACP et le NAN [lxxx]. Lors de la sauterie organisée pour le soixantième anniversaire d’Al Sharpton à l’hôtel Four Seasons de New York, les grandes entreprises étaient encouragées à faire des dons à son organisation, le NAN. Il y avait plusieurs niveaux de contributions possibles. La firme de téléphonie AT&T a fait une contribution « militante » en s’achetant une pleine page de publicité dans le programme de la soirée, tandis que Walmart et GE Asset Management se sont contentés d’encarts d’une demi-page. McDonald’s et Verizon occupaient les pages du fond. Sharpton n’a pas précisé les montants, mais il a déclaré que le NAN avait atteint son objectif d’un million de dollars : « Nous n’avons plus de créances. […] Nous serons en positif cette année. Les plus grosses dettes sont déjà réglées, et la soirée […] était notre deuxième collecte de l’année [lxxxi]. » Peut-on s’étonner que Sharpton et ses affidés se soient si peu exprimés sur la lutte pour les 15 dollars de l’heure ?
La lutte pour l’égalité des moyens éducatifs a aussi pris de l’ampleur ces dernières années et pourrait constituer un autre point de convergence. Le mouvement pour la justice éducative s’est concentré sur trois problèmes qui touchent massivement les élèves noirs : la privatisation des écoles publiques, le « pipeline école-prison » et les examens éliminatoires dans les écoles publiques. Il y a un lien évident entre la privatisation de l’école et les politiques de tolérance zéro qui mettent les élèves noirs en situation de délinquance. Les écoles sous contrat – gérées par le privé, financées par le public – ont mis en place des approches disciplinaires dont le mot d’ordre est « pas d’excuses » et qui fonctionnent selon le principe suivant :
Les enseignants exigent des élèves l’application rigoureuse d’une série d’exigences comportementales. Les infractions mineures – ne pas lever la main, avoir la chemise qui dépasse ou rêvasser – donnent lieu à une escalade de sanctions : mauvais points, perte de « privilèges »10, colles, exclusions. La théorie policière qui a abouti au stop-and-frisk a désormais investi les politiques éducatives [lxxxii].
Ces politiques de tolérance zéro ont rapidement démultiplié les exclusions temporaires et définitives, devenues les principaux outils disciplinaires des écoles publiques et sous contrat. Le taux d’élèves noirs soumis à des mesures d’exclusions temporaires est passé de 6 % dans les années 1970 à 15 % aujourd’hui. L’expulsion n’est qu’un aspect de cette approche, qui s’accompagne d’une présence accrue de la police dans les établissements ; elle a pour effet de criminaliser des bêtises qui se réglaient auparavant dans le bureau du proviseur. Les élèves noirs sont les premières victimes du tournant disciplinaire de l’enseignement public. Le jour où des centaines de lycéens de Seattle ont quitté symboliquement les cours pour protester contre le non-lieu de Darren Wilson à Ferguson, Jesse Hagopian, enseignant, a fait le lien entre Black Lives Matter et l’enseignement public :
Ces élèves ont évidemment été émus par l’injustice de Ferguson, mais […] ils n’ont pas besoin de traverser le pays pour affronter la férocité du racisme. Les écoles publiques de Seattle sont sous le coup d’une enquête fédérale du département de l’Éducation : leur taux d’exclusion des élèves noirs est quatre fois supérieur à celui des blancs pour les mêmes infractions [lxxxiii].
De la même manière que l’argent des entreprises décourage les organisations historiques des droits civiques de s’impliquer dans les luttes pour augmenter le salaire minimum, elle inhibe leur volonté de réagir face aux réformes visant à marchandiser et à privatiser l’école. À elle seule, la Fondation Gates a versé plusieurs millions à la NAACP et à l’Urban League [lxxxiv] – alors que le milliardaire Bill Gates a pour projet de transformer l’éducation par la promotion des écoles sous contrat, et que sa fondation est devenue un avant-poste de l’offensive contre les syndicats d’enseignants et pour la diffusion des tests standardisés.
Dans les deux cas – les luttes de travailleurs pauvres et la résistance à la privatisation de l’enseignement et à ses conséquences –, le mouvement Black Lives Matter, lui, est bien placé pour créer et approfondir des liens avec les milieux syndicaux. Travailleuses et travailleurs noirs continuent de se syndiquer plus souvent que les blancs. La raison est simple : les noirs syndiqués bénéficient de salaires et d’avantages sociaux largement supérieurs à ceux des non syndiqués. Par ailleurs, les salariés noirs sont souvent concentrés dans les secteurs qui sont dans le collimateur de l’État – administrations fédérales, d’États et locales ; ils sont souvent employés par les municipalités, notamment dans les écoles. Pendant l’hiver 2015, des militants BLM de tout le pays ont organisé des blocages d’autoroutes, de transports publics, de magasins, de cafétérias. Si le mouvement s’alliait avec les syndicats, il pourrait s’appuyer sur la capacité des travailleurs à bloquer la production, les services et le fonctionnement des entreprises pour exiger des réformes concrètes face au système policier. Certains ont ouvert la voie. Le 1er mai 2015, des dizaines de milliers de militantes et de militants ont défilé dans tout le pays sous la bannière de BLM ; à Oakland (Californie), la section locale de l’International Longshore and Warehouse Union, syndicat de dockers et de manutentionnaires, a appelé à un arrêt de travail qui a interrompu la circulation de dizaines de millions de dollars de marchandises en bloquant le chargement des cargos. C’était la première fois qu’un grand syndicat lançait un arrêt de travail en solidarité avec le mouvement BLM. « Les ouvriers sont ceux qui peuvent réellement bloquer le pays », déclare, dans son communiqué, la coordination à l’origine de l’action. « Si les ouvriers refusent de travailler, les produits ne sont pas fabriqués et l’argent ne change pas de mains. Le seul moyen pour que cet État nous prenne au sérieux est d’interrompre son commerce et de le frapper au portefeuille. Quand on en appelle à son humanité, il ne se passe rien. Sinon, le génocide noir par la police se serait arrêté il y a des décennies [lxxxv]. »
Ce type d’élargissement du mouvement fait par ailleurs mentir l’idée d’une division générationnelle. Le fait de se coordonner avec des travailleuses et des travailleurs noirs, notamment des enseignants et des syndicalistes, permet de brasser les classes d’âges et démontre que les Afro-Américains de toutes les générations ont intérêt à une victoire du mouvement.
Le décloisonnement du mouvement dépend aussi de sa capacité à nouer des solidarités avec d’autres groupes opprimés. Les Afro-Américains ont toujours été en première ligne face aux aspects les plus répressifs du capitalisme états-unien. Mais cela ne signifie pas qu’ils soient les seuls à vouloir en finir avec sa brutalité. Cette société est structurée par l’oppression des peuples indigènes, des immigrés et plus généralement des non-blancs. C’est bien là ce qui permet d’éclairer les ressorts profonds de cette énigme qui veut que les 1 % peuvent dominer une société dont la grande majorité a tout intérêt à détruire l’ordre existant. Si l’on s’en tient à une arithmétique de base, il n’est pas réaliste de penser que 12 ou 13 % de la population – la part des Afro-Américains – puissent transformer radicalement l’ordre social des États-Unis.
L’enjeu du mouvement sera de transformer le mot d’ordre de « liberté » en revendications audibles qui, en permettant à ses membres d’être mieux entraînés et coordonnés, les rendront capables de lutter pour aller plus loin. Le mouvement doit aussi avoir des pistes concrètes pour nouer et approfondir des solidarités entre dominés. Cela implique de construire des réseaux et des alliances avec les Hispaniques face aux attaques contre les droits des immigrés, d’être en lien avec les Arabes et les musulmans en lutte contre l’islamophobie et de se coordonner avec les collectifs indigènes qui revendiquent leur droit à l’autodétermination à l’intérieur des États-Unis – pour ne citer que quelques exemples.
Mais construire des solidarités entre communautés opprimées n’a rien d’évident. Par exemple, quand trois musulmans, Deah Barakat, Razan Abu‑Salha et Yusor Abu‑Salha, ont été tués par balles par un blanc à Chapel Hill (Caroline du Nord), l’utilisation par quelques militants du hashtag #BLM a suscité une levée de boucliers. Certains y ont vu une « récupération » du mouvement noir :
Il ne s’agit en aucun cas de sous-estimer ou de minimiser les injustices que les autres minorités subissent chaque jour dans ce pays ; en fait, c’est l’inverse. Chaque communauté doit pouvoir développer une réflexion critique sur son statut en Amérique, sur ses propres enjeux, ses propres expériences et dans ses termes à elle. Bien sûr que les musulmans sont en ligne de mire dans le système américain. Personne ne le met en doute. Mais le fait de se servir du hashtag de BLM revient à mettre sur le même plan des luttes qui, même si elles ont l’air de se ressembler, sont profondément différentes [lxxxvi].
S’il faut effectivement respecter le travail politique réalisé par le mouvement contre les violences policières, il serait dommage de présenter l’oppression noire et le racisme anti-noirs comme des phénomènes tellement spécifiques qu’ils deviennent inaccessibles à la compréhension et, potentiellement, à la solidarité d’autres groupes opprimés.
En essayant de démontrer à tout prix la singularité des oppressions vécues par chaque groupe, on passe à côté de ce qui nous relie à travers l’oppression – et de l’importance d’utiliser ces liens pour former des solidarités, au lieu de nous complaire dans notre propre marginalité. L’État diabolise ses ennemis pour justifier le traitement qu’il leur inflige : guerre permanente, internement, torture, emprisonnement de masse et abus policiers. Il y a une boucle de rétroaction raciste par laquelle les politiques intérieures et extérieures s’alimentent et se renforcent mutuellement. La politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient rejaillit à l’intérieur du pays. L’instrumentalisation cynique de l’islamophobie pour légitimer la poursuite des interventions dans les pays arabes et musulmans a nécessairement des effets sur les musulmans qui vivent aux États-Unis. Et l’extension permanente du système policier, justifiée par la « guerre contre la terreur », devient le moyen d’une répression accrue à l’intérieur du pays – qui touche avant tout, bien sûr, les Afro-Américains et les Hispaniques des régions frontalières.
À la fin des années 1990, un mouvement s’était constitué pour lutter contre le profilage racial des automobilistes noirs. D’importantes actions collectives en justice menées dans le Maryland, le New Jersey, la Pennsylvanie et la Floride ont mis en lumière l’ampleur de la suspicion et du harcèlement subis par les conducteurs afro-américains sur les autoroutes. Le New Jersey est devenu le foyer de ces luttes quand, lors d’un contrôle de routine au printemps 1998, un policier a tiré sur une camionnette de jeunes Afro-Américains. Al Sharpton a conduit une manifestation de plusieurs centaines de personnes et un cortège de 500 véhicules sur l’Interstate 95. La même année, l’ACLU lançait une procédure collective au nom de plusieurs automobilistes noirs ayant subi des contrôles discriminatoires sur cette même autoroute. L’année suivante, en 1999, une vague de manifestations et de désobéissance civique exigeait l’inculpation des policiers impliqués dans le meurtre d’Amadou Diallo en février. C’est dans ce contexte qu’en mars 1999, la gouverneure républicaine du New Jersey, Christine Todd Whitman, a fini par révoquer le directeur de la police de l’État qui avait justifié le profilage en déclarant que le trafic de cannabis et de cocaïne « est surtout le fait des minorités » [lxxxvii].
Mais cette dynamique a été brusquement interrompue après les attentats du 11-Septembre. Le gouvernement s’est empressé de commuer cette tragédie en appel à l’unité nationale en prévision de nouvelles guerres, en Afghanistan puis en Irak. Au lendemain des attentats, les agents fédéraux ont justifié le profilage racial par la nécessité de traquer des terroristes musulmans et arabes. Désormais soustraite aux enquêtes fédérales et aux poursuites, cette pratique est devenue une arme légitime et plébiscitée dans la « guerre contre la terreur ». En 1999, 59 % des États-Uniens pensaient que la police avait recours au profilage racial, et 81 % d’entre eux le condamnaient [lxxxviii]. Quelques mois avant le 11-Septembre, George W. Bush lui-même déclarait lors d’une session plénière du Congrès : « Le profilage racial est condamnable et nous le ferons disparaître en Amérique [lxxxix]. » Mais dès le 30 septembre 2001, 60 % de la population noire se déclarait favorable au profilage racial des Arabes, contre 45 % du reste de la population [xc]. Non seulement le mouvement contre le racisme a été englouti sous une vague de chauvinisme et d’islamophobie, mais le point de mire de la lutte antiraciste, le profilage racial, a été hissé au rang d’outil indispensable à la sécurité du pays.
Dès lors que le mouvement reprend à son compte des divisions activement encouragées par l’État, c’est l’ensemble des luttes antiracistes qui s’en trouvent affaiblies. Cela ne veut pas dire qu’il faudrait escamoter les différences qui existent réellement entre les divers groupes, mais cela implique en revanche de comprendre que les situations d’oppression se rejoignent et se chevauchent, et de réaliser qu’on a beaucoup à gagner en s’unissant et beaucoup à perdre en restant chacun dans son coin.
Les manifestations ont le pouvoir de faire connaître toutes ces situations de domination et de les relier au système policier ; elles peuvent mobiliser les gens ; elles peuvent obliger des personnalités publiques à dénoncer ces situations. Manifester peut changer beaucoup de choses, mais cela ne suffit pas à mettre fin aux abus de la police et au contexte qui sert à les justifier. Le mouvement contre les violences policières, s’il n’en est qu’aux prémisses, a transformé la manière dont les États-Uniens perçoivent et interprètent l’action de la police. En une année, d’une côte à l’autre des États-Unis, des personnes noires ont lutté pour dénoncer l’État policier qui s’est installé dans les villes, avec des avant-postes en banlieue. Le pays a été forcé de regarder en face l’ampleur du mensonge de la société « post-raciale » ou « indifférente à la race ». En 2015, 83 % des États-Uniens considèrent que le racisme « pose toujours problème », soit 7 % de plus qu’en 2014. 61 % des blancs et 82 % des noirs s’accordent sur la « nécessité de débattre du racisme dans la société américaine [xci] ». Dans le même intervalle, le nombre de blancs qui considèrent les homicides de la police comme des « incidents isolés » est passé de 58 % à 36 % [xcii]. Au cours du seul mois de juillet 2015, la police a tué 124 personnes, un chiffre étonnant, largement supérieur à la moyenne [xciii]. Dès la mi-août, on dénombrait 54 victimes de plus. Le jour anniversaire de la mort de Mike Brown (9 août 2015), la police de Ferguson tire sur un adolescent noir, qui est grièvement blessé. À New York – où une mobilisation énergique luttait déjà contre les violences policières depuis des années, avant de réapparaître sous la forme d’un mouvement national –, le maire libéral Bill de Blasio s’est engagé à recruter un millier de policiers supplémentaires. Cette décision a surpris, étant donné qu’il avait surfé sur le succès de la campagne contre le stop-and-frisk pour se faire élire en 2013. Une fois encore, cela illustre la résilience de la police en tant qu’institution et la réticence des élus à l’empêcher de nuire.
Le mouvement est confronté à de nombreux défis, mais il a aussi montré qu’il était là pour durer. Cela tient moins au génie organisationnel de ses militants et de ses militantes qu’à la profonde colère de toutes les personnes noires ordinaires qui ont été passées à tabac, emprisonnées, humiliées et insultées, tout en se voyant expliquer dans le même temps qu’elles étaient responsables de leur sort.
La capacité des simples citoyens afro-américains à faire vivre le mouvement a été illustrée en juin 2015 à McKinney (Texas), où la police est intervenue violemment contre plusieurs jeunes noirs pendant une fête privée autour d’une piscine – et où Dajeria Becton, 15 ans, a été violentée par un agent. Il y a quelques années, on aurait à peine prêté attention à une telle affaire. Mais quelques jours après cet épisode, des centaines de manifestants noirs et blancs remplissaient les rues et bloquaient la circulation du petit quartier résidentiel où la jeune fille avait été agressée en chantant « Nous voulons nous baigner » et « Si on ne peut pas nager, vous ne pouvez pas conduire ! » Ce devait être une scène impressionnante – et pour plusieurs raisons. Les riverains blancs de cette banlieue aisée qui soutenaient la police ne pouvaient rien faire ; ils avaient été réduits à l’impuissance.
Cette action a manifestement intimidé les services de police qui ont obligé l’agent le plus brutal, l’assaillant de Dajeria Becton, à démissionner. Mais surtout, pour ces enfants noirs qui avaient été agressés et tenus en joue avec une arme, pour leurs parents, le fait de voir des centaines de personnes descendre dans la rue pour dire que leurs vies comptent a dû compenser une partie du traumatisme. Le fait de voir des centaines de blancs solidaires a dû leur donner l’espoir que tous ne sont pas racistes et que certains sont même prêts à venir se battre à leurs côtés. Cette manifestation a peut-être aussi légitimé leur droit à résister, à lutter contre le racisme et sa violence, et réaffirmé qu’ils avaient eu raison de protester au moment des faits.
Entre les premières explosions à Ferguson et aujourd’hui, le mouvement Black Lives Matter a réveillé la fierté et la combativité d’une génération que cet État a cherché à tuer, à emprisonner ou simplement à faire disparaître de la société. Le pouvoir de la révolte a été vérifié. Pour augmenter sa capacité à changer les choses, pour qu’elle puisse entamer le système policier, pour résister à ses adversaires et aux tentatives d’infiltrer, de détourner et de détruire ce qui a été construit, il faut à présent renforcer l’organisation et la coordination afin de passer de la révolte au mouvement.
[i]En 1931, dans cette petite ville du nord de l’Alabama, neuf adolescents noirs furent jugés et condamnés, au cours d’un procès monté de toutes pièces, pour le viol de deux femmes blanches. À l’issue d’une bataille politique, certaines condamnations furent cassées par la Cour suprême dans les années qui suivirent. Trois furent également graciés… en 2013, et à titre posthume. [ndt]
[ii]Acronyme de People United to Save Humanity. Organisation fondée par Jesse Jackson en 1972, elle fusionne en 1996 avec la Rainbow Coalition – également fondée par Jackson – et devient Rainbow/Push. [nde]
[i]Cassandra Johnson, citée par Michelle Dean, « “Black Women Unnamed” : How Tanisha Anderson’s Bad Day Turned into Her Last », The Guardian, 5 juin 2015.
[ii]John H. Richardson, « Michael Brown Sr. and the Agony of the Black Father in America », Esquire, 5 janvier 2015.
[iii]Kristin Braswell, « #FergusonFridays : Not All of the Black Freedom Fighters Are Men : An Interview with Black Women on the Front Line in Ferguson », The Feminist Wire, 3 octobre 2014.
[iv]Charles P. Pierce, « The Body in the Street », Esquire, 2 août 2014.
[v]Mark Follman, « Michael Brown’s Mom Laid Flowers Where He Was Shot – and Police Crushed Them », Mother Jones, 27 août 2014.
[vi]John H. Richardson, « Michael Brown Sr. », art. cit.
[vii]Amnesty International USA, « On the Streets of America : Human Rights Abuses in Ferguson », 24 octobre 2014.
[viii]Dan Burns et Megan Davies, « In Riot-Hit Ferguson, Traffic Fines Boost Tension and Budget », Reuters, 19 août 2014.
[ix]Anna Brand and Amanda Sakuma, « 11 Alarming Findings in the Report on Ferguson Police », MSNBC, 4 mars 2015.
[x]Jon Schuppe, « U.S. Finds Pattern of Biased Policing in Ferguson », NBC News, 3 mars 2015.
[xi]Nathan Robinson, « The Shocking Finding from the DOJ’s Ferguson Report That Nobody Has Noticed », Huffington Post, 13 mars 2015.
[xii]Joel Anderson, « Ferguson’s Angry Young Men », BuzzFeed, 22 août 2014.
[xiii]Johnetta Elzie, « When I Close My Eyes at Night, I See People Running from Tear Gas », Ebony, septembre 2014.
[xiv]Joel Anderson, « Ferguson’s Angry Young Men », art. cit.
[xv]Jon Swaine, « Ohio Walmart Video Reveals Moments Before Officer Killed John Crawford », The Guardian, 24 septembre 2014.
[xvi]Josh Harkinson, « 4 Unarmed Black Men Have Been Killed by Police in the Last Month », Mother Jones, 13 août 2014.
[xvii]Darnell L. Moore, « Two Years Later, Black Lives Matter Faces Critiques, but It Won’t Be Stopped », Mic, 10 août 2015.
[xviii]Associated Press, « Five Arrested in Ferguson after Protests Break Out over Burned Memorial », The Guardian, 12 août 2015.
[xix]Trymaine Lee, « Why Vonderrit Myers Matters », MSNBC, 18 octobre 2014.
[xx][Sans nom], « Ferguson October: Thousands March in St. Louis for Police Reform and Arrest of Officer Darren Wilson », Democracy Now !, 13 octobre 2014.
[xxi]Donna Murch, « Historicizing Ferguson », New Politics, vol. XV-3, no 59, été 2015. Disponible sur Newpol.org.
[xxii]Lilly Fowler, « Al Sharpton Arrives in St. Louis, Seeking Justice for Michael Brown », Saint Louis Post-Dispatch, 12 août 2014.
[xxiii]« Rev. Sharpton Preaches Truth and Action at Michael Brown, Jr. Funeral », Daily Kos, 25 août 2014.
[xxiv]Joel Anderson, « Ferguson’s Angry Young Men », art. cit.
[xxv]Erica Ritz, « Jesse Jackson Cornered by Angry Ferguson Protesters : “When You Going to Stop Selling Us Out ?” », Blaze, 22 août 2014.
[xxvi]Kristin Braswell, « #FergusonFridays », art. cit.
[xxvii]Matt Pearce, « “Ferguson October” Rally Highlights Divide among St. Louis Activists, Los Angeles Times, 12 octobre 2014.
[xxviii]Kristin Braswell, « #FergusonFridays », art. cit.
[xxix]Ella Baker, « Bigger Than a Hamburger », Southern Patriot, 18 juin 1960. Disponible sur Historyisaweapon.com/defcon1/bakerbigger.
[xxx]Britni Danielle, « “Say Her Name” Turns Spotlight on Black Women and Girls Killed by Police », Take Part, 22 mai 2015.
[xxxi]Amanda Sakuma, « Women Hold the Front-Lines of Ferguson », MSNBC, 12 octobre 2014.
[xxxii]Kristin Braswell, « #FergusonFridays », art. cit.
[xxxiii]Stephen Bronars, « Half of Ferguson’s Young African-American Men Are Missing », Forbes, 18 mars 2015.
[xxxiv]David Leonhardt, Kevin Quealy et Justin Wolfers, « 1.5 Million Missing Black Men », New York Times, 20 avril 2015.
[xxxv]Kristin Braswell, « #FergusonFridays », art. cit.
[xxxvi]Katherine Mirani, « Nurturing Black Youth Activism », Chicago Reporter, 6 octobre 2014.
[xxxvii]Alicia Garza, « A Herstory of the #BlackLivesMatter Movement », Feminist Wire, 7 octobre 2014.
[xxxviii]« Transcript : Obama’s Remarks on Ferguson Grand Jury Decision », Washington Post, 24 novembre 2014.
[xxxix]M. David and Jackson Marciana, « Tanisha Anderson Was Literally Praying for Help as Cops Held Her Down and Killed Her », Counter Current News, 28 février 2015.
[xl]Fredrick Harris, « Will Ferguson Be a Moment or a Movement ? », Washington Post, 22 août 2014.
[xli]Ferguson Action, « Breaking : Ferguson Activists Meet with President Obama to Demand an End to Police Brutality Nationwide », communiqué de presse, 1er décembre 2014.
[xlii]Tanya Somanader, « President Obama Delivers a Statement on the Grand Jury Decision in the Death of Eric Garner », communiqué de presse de la Maison-Blanche, 3 décembre 2014.
[xliii]Kirsten West Savali, « The Fierce Urgency of Now : Why Young Protesters Bum-Rushed the Mic », Root, 14 décembre 2014.
[xliv]Darryl Fears, « Thousands Join Al Sharpton in “Justice for All” March in D.C.,” Washington Post, 13 décembre 2014.
[xlv]Al Sharpton, « It’s Been a Long Time Coming, But Permanent Change Is Within Our Grasp », Huffington Post, 15 décembre 2014.
[xlvi]Azi Paybarah, « Amid Tensions, Sharpton Lashes Out at Younger Activists », Politico, 31 janvier 2015.
[xlvii]Marcia Chatelain, « #BlackLivesMatter : An Online Roundtable with Alicia Garza, Dante Barry, and Darsheel Kaur », Dissent, 19 janvier 2015.
[xlviii]Azi Paybarah, « Amid Tensions, Sharpton Lashes Out at Younger Activists », art. cit.
[xlix]Ferguson Action, « About This Movement », communiqué de presse, 15 décembre 2014.
[l]Tim Mak, « Capitol Hill’s Black Staffers Walk Out to Do “Hands Up, Don’t Shoot !” », Daily Beast, 10 décembre 2014.
[li]Nicole Mulvaney, « Princeton University Students Stage Walkout in Protest of Garner, Ferguson Grand Jury Decisions », NJ.com, 4 décembre 2014.
[lii]White Coats 4 Black Lives, « About », [sans date], consulté en juillet 2017. Disponible sur www.whitecoats4blacklives.org/about.
[liii]Malaika Fraley et Gary Peterson, « Bay Area Public Defenders Rally for “Black Lives Matter” », San Jose Mercury News, 18 décembre 2014.
[liv]Marcia Chatelain, « #BlackLivesMatter : An Online Roundtable », art. cit.
[lv]Jill Colvin, « Hillary Clinton Denounces Torture, Says Black Lives Matter », Huffington Post, 16 décembre 2014.
[lvi]Nia-Malika Henderson, « “Black Respectability” Politics Are Increasingly Absent from Obama’s Rhetoric », Washington Post, 3 décembre 2014.
[lvii]Noah Berlatsky, « Hashtag Activism Isn’t a Cop-Out », The Atlantic, 7 janvier 2015.
[lviii]Ibid.
[lix]Barbara Ransby, « Ella Baker’s Radical Democratic Vision », Jacobin, 18 juin 2015.
[lx]Danny Katch, « #BlackLivesMatter Looks to the Future », Socialist Worker, 4 février 2015.
[lxi]Darnell L. Moore, « Two Years Later », art.cit.
[lxii]Hill-Snowdon Foundation, « How to Fund #BlackLivesMatter », Hill-Snowdon Foundation, 9 juin 2015.
[lxiii]Ryan Schlegel, « Why Foundations Should Support July’s Movement for Black Lives Convening », National Committee for Responsive Philanthropy, 9 juin 2015.
[lxiv]Aldon D. Morris, The Origins of the Civil Rights Movement, New York, Simon & Schuster, 1986, p. 234-235.
[lxv]Ibid., p. 235.
[lxvi]Tanzina Vega, « How to Fund Black Lives Matter », CNN, 5 juin 2015.
[lxvii]Incite ! Women of Color Against Violence, The Revolution Will Not Be Funded : Beyond the Non-Profit Industrial Complex, Cambridge (Mass.), South End Press, 2007.
[lxviii]Arundhati Roy, Capitalism : A Ghost Story, Chicago, Haymarket Books, 2014, p. 26.
[lxix]Megan Francis, « Do Foundations Co-Opt Civil Rights Organizations ? », HistPhil, 17 août 2015.
[lxx]Cory Shaffer, « Cleveland Group Seeks Arrests of Officers Involved in Tamir Rice Shooting »,” Cleveland.com, 9 juin 2015.
[lxxi]John Kopp, « Hundreds in Philly Rally against Police Violence », Philly Voice, 30 avril 2015.
[lxxii]Jasmine Aguilera et Claire Z. Cardona Jasmine Aguilera, « Marches against Police Brutality, for Immigration Reform Take to Downtown Dallas Streets », Dallas Morning News, 1er mai 2015.
[lxxiii]Ferguson Action, « Demands », [sans date]. Disponible sur Fergusonaction.com.
[lxxiv]Hands Up United, « Hands Up », [sans date]. Disponible sur Handsupunited.org.
[lxxv]Black Lives Matter, « Demands », [sans date]. Disponible sur Blacklivesmatter.com.
[lxxvi]James Forman, The Making of Black Revolutionaries : A Personal Account, New York, Macmillan, 1972, p. 395-96.
[lxxvii]Annie-Rose Strasser, « The Majority of Fast Food Workers Are Not Teenagers, Report Finds », Think Progress, 8 août 2013.
[lxxviii]BYP 100, « Racial Justice Is Economic Justice », [sans date]. Disponible sur Byp100.org/ff15signup/.
[lxxix]Gary Kopycinski, « Black Youth Project 100 (BYP100) Declares #BlackWorkMatters at Protests in Chicago, New Orleans & New York City », E-News Park Forest, 16 avril 2015.
[lxxx]Peter Waldman, « NAACP’s FedEx and Wal-Mart Gifts Followed Discrimination Claims », Bloomberg Business Week, 8 mai 2014.
[lxxxi]Annie Karni, « Rev. Al Sharpton Gets $1M in Birthday Gifts for His Nonprofit », New York Daily News, 3 octobre 2014.
[lxxxii]Owen Davis, « Punitive Schooling », Jacobin, 17 octobre 2014.
[lxxxiii]Jesse Hagopian, « “Why Are They Doing This to Me ?” : Students Confront Ferguson and Walkout Against Racism », Common Dreams, 30 novembre 2014.
[lxxxiv]Valerie Strauss, « Just Whose Rights Do These Civil Rights Groups Think They Are Protecting ? », Washington Post, 9 mai 2015.
[lxxxv]Alessandro Tinonga, « Black Lives Matter on the Docks », Socialist Worker, 30 avril 2015.
[lxxxvi]Sabah, « Stop Using #MuslimLivesMatter », Muslim Girl, 12 février 2015.
[lxxxvii]Robert D. McFadden, « Whitman Dismisses State Police Chief for Race Remarks », New York Times, 1er mars 1999.
[lxxxviii]Frank Newport, « Racial Profiling Is Seen as Widespread, Particularly Among Young Black Men », Gallup, 9 décembre 1999.
[lxxxix]Dan Zeidman, « One Step Closer to Ending Racial Profiling », American Civil Liberties Union, 7 octobre 2011.
[xc]Sasha Polakow-Suransky, « When the Profiled Become Profilers », African America, 24 novembre 2002.
[xci]Ariel Edwards-Levy, « Americans Say Now Is the Right Time to Discuss Racism, Gun Control », Huffington Post, 22 juin 2015.
[xcii]Terrell Jermaine Starr, « New Study : More White People See Systemic Problems in Policing after Freddie Gray, but Racial Gulf Remains », AlterNet, 5 mai 2015.
[xciii]Base de données en ligne actualisée depuis le 1er juin 2015 : « The Counted : People Killed by Police in the United States in 2015 », site du Guardian, consulté en juillet 2017. [Disponible sur TheGuardian.com.]
Illustration : Jewel Samad/AFP/Getty Images.
références
| ⇧1 | En référence à la pratique des Freedom Rides (« voyages de la liberté ») initiée en 1961 par des militants des droits civiques qui montaient à bord des bus inter-États du Sud des États-Unis pour vérifier l’application du jugement de la Cour suprême de 1960 interdisant la ségrégation dans les transports en commun (nde). |
|---|---|
| ⇧2 | Traduisible par « De quel côté êtes-vous ? », ce morceau a été composé en 1931 par la militante et chanteuse folk Florence Reece en soutien aux mineurs du comté de Harlan (Kentucky). Durant toutes les années 1930, dans ce qui fut désigné sous le nom de « guerre de Harlan County », les mineurs et leurs syndicats s’opposèrent à leurs employeurs dans une série de grèves très dures au cours desquelles plusieurs mineurs et délégués syndicaux furent abattus par la Garde nationale, des troupes fédérales ou des milices patronales. (nde) |
| ⇧3 | Précisons que le coup de feu de Marissa Alexander n’a pas blessé son conjoint : il ne l’a même pas atteint. |
| ⇧4 | En 1931, dans cette petite ville du nord de l’Alabama, neuf adolescents noirs furent jugés et condamnés, au cours d’un procès monté de toutes pièces, pour le viol de deux femmes blanches. À l’issue d’une bataille politique, certaines condamnations furent cassées par la Cour suprême dans les années qui suivirent. Trois furent également graciés… en 2013, et à titre posthume. |
| ⇧5 | La Bart, acronyme de « Bay Area Rapid Transit », est la société de transport de la baie de San Francisco. C’est dans l’une de ses stations qu’Oscar Grant, 23 ans, a été tué d’une balle dans le dos par un de ses agents de sécurité à l’aube du 1er janvier 2009 |
| ⇧6 | Variante du sit-in dans laquelle les manifestants s’allongent au sol en simulant la mort. |
| ⇧7 | Les avocats commis d’office (public defenders) forment un groupe distinct dans la corporation des avocats aux États-Unis, car ce sont des employés à plein temps des gouvernements des États ou du gouvernement fédéral. |
| ⇧8 | « Historique » parce qu’elle fut notamment le lieu d’un célèbre discours de Martin Luther King, dans lequel le pasteur s’élevait contre la guerre du Vietnam. |
| ⇧9 | Le titre de cette section fait référence à « The Revolution Will Not Be Televised », célèbre morceau de slam de Gil Scott-Heron issu de l’album de 1970 A New Black Poet – Small Talk at 125th and Lenox. |
| ⇧10 | Accès au matériel informatique, à certaines salles de récréation ou de sport, à une place de parking… Aux États-Unis, il n’est pas rare que le ramassage scolaire, par exemple, soit considéré comme un « privilège » (et non un droit) qui peut être perdu en cas de violation du règlement. |