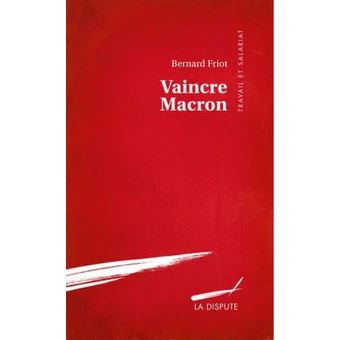
Nous publions une série d’articles sur le dernier livre de Bernard Friot, Vaincre Macron (La Dispute, 2017), auxquels l’auteur répondra ensuite. C’est d’abord Jean-Marie Harribey, ancien co-président d’Attac et auteur de plusieurs articles pour Contretemps, qui propose une lecture critique du livre.
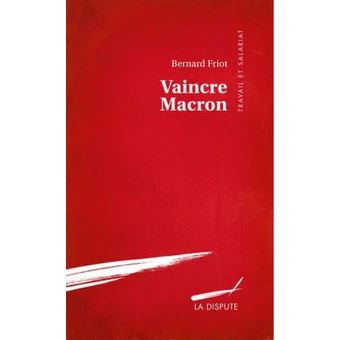
Le sociologue Bernard Friot laboure sans relâche un terrain depuis les années 1990 : celui de l’histoire des institutions sociales créées en Europe pendant le XXe siècle, et, notamment en France, le régime général de la Sécurité sociale après la Seconde Guerre mondiale. Il a déjà une dizaine de livres à son actif, dans lesquels il déconstruit l’histoire officielle de la protection sociale et la reconstruit autour d’une idée maîtresse : les institutions nées de la lutte des classes menée par les travailleurs préfigurent ce que pourrait être une reprise de leur offensive contre les réformes des néolibéraux, qui sont des réformes contre le travail. Une offensive cette fois-ci victorieuse contre « la réforme », au lieu des défaites à répétition, subies parce que trop de monde, trop de syndicats, trop de partis, trop d’associations se sont trompés, selon lui, de combat, en s’attaquant à la répartition de la valeur plutôt qu’à la production de celle-ci. Tel est le manifeste en quelque sorte que vient de publier Bernard Friot : Vaincre Macron (La Dispute, 2017)[1].
Par son activité de chercheur et sa pratique sociale engagée, Bernard Friot a acquis une grande notoriété et son influence s’étend bien au-delà des noyaux militants. Avec conviction et pédagogie, il expose ses thèses qui séduisent par leur côté iconoclaste dans un paysage social et politique sans boussole. Puisque l’auteur se place explicitement dans une perspective anthropologique générale, sa contribution théorique doit être examinée au-delà même de la contingence Macron, car, au final, elle se fixe pour objectif de construire une stratégie tournée vers l’émancipation humaine. On résume ci-après la problématique de Bernard Friot (1), avant de voir quelles questions pose sa conception du travail et du salaire (2), puis l’option qu’il adopte de mêler projet normatif et analyse positive (3).
Ce nouveau livre n’est pas une répétition des précédents. Bien sûr, l’auteur rappelle les éléments fondamentaux de sa thèse, étayée depuis son ouvrage fondateur Puissances du salariat[2], mais il y ajoute un peaufinage du projet « communiste » qu’il entend refonder. Son livre est structuré en trois chapitres. Le premier présente la « révolution communiste du travail » que fut l’invention du régime général de la Sécurité sociale en 1946. Ce régime est « révolutionnaire : il constitue un salariat unifié, il ôte l’initiative à la classe capitaliste, il permet à la classe ouvrière de se construire en gérant une part notable de la valeur (le tiers de la masse salariale dès 1946), afin de l’affecter à une autre pratique du travail. Tout cela sans employeurs, sans actionnaires et sans prêteurs, qu’il s’agisse de la production des soignants, de celle des parents ou de celle des retraités. » (p. 21)[3].
À l’époque, « la CGT se bat sur trois fronts : l’unicité d’un taux de cotisation interprofessionnel, la nature de la cotisation, le refus de la fiscalisation » (p. 26). La cotisation est du salaire et non pas un revenu différé. Plusieurs points sont à noter sur lesquels on reviendra dans la discussion : Bernard Friot indique que la CGT veut « imposer la cotisation contre l’impôt, gage de la collecte d’une part suffisante de la valeur ajoutée » (p. 28). Et surtout, le contrat de travail et le salaire n’expriment pas les termes de la subordination au capital mais sont, au contraire, des institutions qui furent imposées à celui-ci (p. 33 à 35). Dès lors, selon Bernard Friot, il faut analyser, « les prémices d’une production communiste à grande échelle » (p. 42), constituées par le salaire à la qualification à vie et la copropriété d’usage de l’outil de travail.
Le deuxième chapitre analyse la « réforme » comme une contre-révolution incomprise par ses opposants, à savoir tous les mouvements sociaux sans distinction, parce qu’ils se situent au niveau de la répartition des revenus qui n’est que « seconde » (p. 55) dans la « réforme ». En effet, celle-ci « vise à conforter le pouvoir de la bourgeoisie sur la production dans ses deux dimensions décisives : le régime de propriété, en restaurant la propriété lucrative et le crédit ; et le statut du producteur, en instituant des droits capitalistes à revenu et à carrière à la place des droits communistes de salaire à vie en cours de conquête. » (p. 55-56). Le côté le plus pernicieux de la « réforme » est peut-être de promouvoir des droits de la personne détachés de sa qualification à être productrice de valeur, pour n’être plus que des droits liés à sa « performance marchande » (p. 65). Concrètement, la « réforme » organise l’érection d’un « premier pilier » forfaitaire de la protection sociale, déclaré non contributif et fiscalisé au nom de l’universalité, tandis que des comptes personnels dépendants du marché complèteront le forfait.
Le troisième chapitre est consacré à montrer que le « déjà là communiste » doit et peut être poursuivi et généralisé : « restaurer notre appareil productif sur des bases faisant sens d’un point de vue anthropologique, territorial et écologique » (p. 85). Bernard Friot donne quatre directions à ce projet : un nouvel horizon pour le travail, des droits de souveraineté sur la valeur, la démocratie centrée sur le travail, l’extension du modèle du régime général de la Sécurité sociale à toute l’économie. Ainsi, on peut envisager un nouveau modèle productif bâti selon trois axes : le salaire à vie dès l’âge de 18 ans ; la copropriété d’usage de l’outil de travail permise par la création d’une caisse de salaires et d’une caisse d’investissement, alimentées par la cotisation sociale restaurée et une cotisation économique créée ; la gestion par les travailleurs des entreprises et de ces caisses.
Engagé avec Bernard Friot depuis près d’une vingtaine d’années à l’occasion de la publication de livres ou de séminaires, le débat se poursuit sur des points délicats de la théorie critique du capitalisme, qui ne font consensus nulle part. Sans répéter les éléments déjà débattus à plusieurs reprises, soulignons ici ceux qui permettraient d’avancer un peu plus dans l’éclaircissement des controverses.[4]
Le point théorique nodal, et dont tout le reste découle ensuite, est celui de la valeur, à la fois dans la définition de ce concept et dans le périmètre de son champ d’application. En partant du constat que la conception marxiste traditionnelle de la valeur ne permet pas de rendre compte d’une transformation majeure opérée par les luttes sociales, il s’agit de théoriser le fait qu’un large pan du travail a été soustrait de l’obligation de valoriser le capital et accomplit des tâches de production de services non marchands, mais évalués monétairement, de santé, d’éducation, etc. Ce travail est donc productif de valeur, mais pas pour le capital. Jusque-là, nous partageons grosso modo le même refus de se laisser enfermer dans la définition de la valeur restreinte à celle qui est destinée au capital.[5] S’ouvrent ensuite de nombreuses discussions.
La première discussion est née à propos de la conception des pensions de retraite. Bernard Friot considère que les retraités produisent la valeur qu’ils reçoivent sous forme de pension. Il récuse la notion de transfert social des travailleurs actifs vers les retraités, ainsi que celle de solidarité intergénérationnelle (p. 74), dont on caractérise habituellement le système de retraite dit par répartition, et que l’anthropologie considère comme l’un des fondements des sociétés, au-delà même de la question des retraites. Il applique le même raisonnement aux parents et aux chômeurs qui « travaillent ».
Plusieurs problèmes logiques se posent alors. Bernard Friot écrit : « la pension [est] la contrepartie de la valeur que les retraités sont en train de produire » (p. 75). Si c’est le cas, à quoi servent les cotisations vieillesse payées par les salariés ? Ne pourrait-on pas les supprimer ? Bernard Friot réfute l’objection en faisant un parallèle avec les impôts servant à payer les fonctionnaires sans contredire l’idée que ces derniers produisent. Or, cette réponse ne résout pas la question posée : si on supprimait les cotisations vieillesse, les retraités pourraient-ils vivre de leur activité libre qui, par définition, n’a pas de demande en face d’elle, ni privée, ni publique ? La réponse est non, tandis que l’éventuelle privatisation de l’éducation publique ou des soins publics ne ferait pas disparaître ces besoins et la demande ; il s’ensuit que, contrairement à des retraités privés de pension, les anciens fonctionnaires pourraient, bien que dans des conditions sans doute dégradées, continuer de vivre de leur travail. Aussi, logiquement, peut-on dire que « la conquête de la pension comme salaire à vie initie le changement de ce qui est considéré comme travail productif de valeur. Pour avoir un salaire, ce qui signifie que l’on produit de la valeur économique, il n’est plus nécessaire, à partir d’un certain âge, de passer par le marché du travail ou par celui des produits, et donc de se soumettre à des marchés sur lesquels le travailleur n’a pas de prise. » (p. 50, souligné par moi ; aussi p. 70) ? En aucune manière, cette affirmation n’est une preuve logique ; on peut même douter, pour la problématique de Bernard Friot, que le changement sémantique ait le moindre effet performatif.[6]
Bien que Bernard Friot affirme maintenir la distinction entre valeur d’usage et valeur (p. 93), le fait de considérer que toute activité libre produit de la valeur, et pas seulement de la valeur d’usage, dissout cette distinction irréductible depuis Aristote jusqu’à Marx, en passant par l’économie politique de Smith et Ricardo. Simultanément, il dilue les frontières du travail puisque tout est travail productif de valeur. Pour y parvenir, Bernard Friot reprend chez Marx le couple conceptuel de travail concret/travail abstrait, mais lui en modifie le sens. C’est son droit, mais le changement permet-il une avancée ? Il y a chez Marx une correspondance entre les distinctions qu’il opère à propos de la valeur et celles concernant le travail. D’un côté, la valeur d’usage est une condition de la valeur en tant que fraction du travail socialement validé monétairement, laquelle apparaît dans l’échange par le biais d’une proportion, la valeur d’échange qui, en tendance, est mesurée par l’équivalent monétaire de la quantité de travail nécessaire en moyenne dans la société considérée, une fois satisfaite l’exigence d’un taux moyen de profit pour le capital. De l’autre côté, le marché rend les travaux concrets indistincts, débarrassés de toutes leurs caractéristiques particulières ; c’est-à-dire que la vente de la marchandise valide un travail, en faisant abstraction de ses particularités dans la production de telle ou telle valeur d’usage.
Comment ces concepts sont-ils ensuite utilisés ? Bernard Friot a raison de dire que c’est la validation sociale qui fait d’une activité un travail productif ou non de valeur, « une convention décidée par les rapports sociaux » (p. 37). Mais qu’est-ce que la validation sociale ? Peut-on admettre que le travail soit rendu abstrait par une décision a priori des capitalistes s’arrogeant le « monopole de la valeur » ou ayant une « pratique capitaliste de la valeur » (p. 39, 45), parce que ce sont eux « qui décident ce qui, dans l’activité, a de la valeur et est donc du travail » (p. 38-39) et que « les seules personnes qui décident de la valeur sont les propriétaires lucratifs de l’outil de travail, qu’ils soient prêteurs, propriétaires directs ou actionnaires » (p. 101) ? Que la frontière séparant le champ de valorisation du capital de celui qui ne l’est pas soit la sanction d’un rapport de classes est indéniable, mais comment comprendre la métaphore de Marx du « saut périlleux de la marchandise »[7] ? Hélas pour les capitalistes, ils doivent passer l’épreuve du marché pour récupérer leur capital agrandi de la plus-value. C’est donc le marché qui est l’institution validant le travail effectué pour produire de la valeur pour le capital ; la validation n’est pas le fruit d’une décision de classe prise dans un laboratoire secret du capital, sauf à tomber dans le piège du fétichisme. Marx parlait de la valeur passant d’une forme à une autre comme un « sujet automate »[8]. Il n’y a donc pas une pré-décision de ce qui transformera un travail concret en un travail abstrait, que Bernard Friot définit comme « la part de l’activité considérée comme produisant non seulement des valeurs d’usage, mais aussi de la valeur économique » (p. 36, souligné par moi). La lutte des classes intervient en amont et en aval de la validation marchande. En amont, comme dit plus faut, pour tracer la frontière entre ce qui sera production de plus-value pour le capital et ce qui sera production de services non marchands pour la collectivité. En aval, pour le partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits. Curieusement, Bernard Friot n’attache pas d’importance à l’institution marché ni au moment où se réalise l’abstraction du travail, le fameux « saut périlleux ». Or, la validation par le marché qui rend abstrait le travail est consubstantielle aux rapports marchands liés à la division du travail, laquelle dépasse historiquement et logiquement les rapports spécifiquement capitalistes. Le capitalisme implique le travail abstrait, mais la réciproque n’est pas vraie.
Au sujet de la nature du capitalisme, certains passages sont énigmatiques. D’un côté, Bernard Friot sépare la contradiction lutte de classes de sa base économique : « [Le terme de néolibéralisme] recouvre des interprétations différentes, mais leur dénominateur commun est l’absence de lutte de classes. Le capitalisme serait un « système » qui certes bouge pour se reproduire, d’où sa périodisation, mais, ses déplacements relèveraient d’une cause interne : épuisement du fordisme, baisse du taux de profit, caractère mortifère du fétichisme de la valeur, pour reprendre quelques-unes des explications avancées pour définir le néolibéralisme. » (p. 11). En récusant le concept de fétichisme de la valeur qu’il qualifie de « lecture hors-sol de Marx » (p. 90), il se prive de ce qui permit à Marx de se détacher le mieux d’une vison naturaliste de l’économie et de la société. De plus, ne court-il pas le risque de verser dans une interprétation économiciste restrictive de la situation actuelle en diagnostiquant que « [les] graves dérives de notre vie publique sont à voir avec l’épuisement anthropologique dû à l’absence de souveraineté sur la valeur » (p. 104) ?[9]
Un problème de comptabilité nationale un peu technique doit également être abordé. Le produit intérieur brut (PIB) comporte deux parts : le produit marchand (pour environ les trois quarts) et le produit non marchand, ce dernier étant mesuré (en net) uniquement par les salaires des travailleurs employés par les administrations publiques puisque celles-ci ne font pas de profits. Une fois déduits les amortissements du capital installé, le produit intérieur net est équivalent au revenu national net[10]. Si l’on se situe au niveau de la répartition primaire avant prélèvements d’impôts, l’ensemble des revenus primaires (ceux issus de la sphère marchande comme ceux issus de la sphère non marchande) contient les sommes qui seront ensuite prélevées par le fisc. Si l’on suit Bernard Friot, puisque selon lui les retraités, les parents et les chômeurs produisent, la valeur qu’ils produisent devrait être ajoutée à celle déjà comptabilisée au niveau primaire. Comme ce n’est pas ce que font les comptables nationaux, à juste raison, comment Bernard Friot interprète-t-il cela ? « Bien sûr, la monnaie de la pension vient de la sphère marchande, comme l’impôt qui paie les fonctionnaires, mais elle représente la reconnaissance sociale de la valeur non marchande produite par les retraités. » (p. 50).[11] Cette affirmation résume le différend théorique discuté : on ne peut pas considérer que les fonctionnaires sont productifs et, en même temps, que ce qu’ils ont produit est inclus dans la valeur de la production marchande. Bernard Friot répond à cette objection qu’il faut distinguer les flux de valeur (les fonctionnaires et les retraités étant une source de celle-ci) et les flux de monnaie (seuls issus de la sphère marchande). Mais c’est une nouvelle aporie puisqu’il n’y a pas de valeur qui ne soit monétaire.[12] Plus simplement, la thèse de Bernard Friot oublie que les fonctionnaires paient eux aussi des impôts et des cotisations sociales. Lorsque j’achète une automobile, je paie son prix qui inclut les salaires des travailleurs et les cotisations, les profits et les amortissements du capital, et la TVA ; à ce stade, on peut dire que les revenus versés par les entreprises capitalistes seront soumis ultérieurement aux impôts directs, mais ils ne recouvrent pas les impôts qui seront prélevés sur les salaires versés par les administrations publiques, pas plus que les cotisations sociales versées au régime général de la Sécurité sociale par les entreprises privées n’incluent les cotisations sociales des fonctionnaires. On ne peut pas à la fois soutenir que les fonctionnaires sont productifs de la valeur qu’ils perçoivent comme salaires et que leur « retenue pour pension est un pur jeu d’écriture » (p. 48), comme une sorte de fiction. Il faut choisir entre les deux interprétations.
En bref, il y a une ambiguïté – voire une confusion – très fréquente dans le débat public au sujet de la redistribution et que la thèse de Bernard Friot ne permet pas de lever : les soignants dans les hôpitaux et les enseignants ne sont pas rémunérés au titre de la redistribution, leur salaire est bien de nature primaire, c’est-à-dire engendré par leur travail ; en revanche, la prestation reçue par les malades ou bien le service rendu aux élèves et étudiants relèvent, eux, du registre de la redistribution.
Au-delà des problèmes logiques soulevés par la thèse de Bernard Friot, une réflexion méthodologique est nécessaire. On ne portera pas ici de jugement sur le projet normatif de Bernard Friot qui veut reconstruire une légitimité au communisme. Cet objectif peut être entendu. On se demandera seulement si l’auteur trace une frontière entre le normatif et le positif ou si, au contraire, il va de l’un à l’autre sans retenue.
Pourquoi Bernard Friot fustige-t-il avec autant de vigueur les mouvements sociaux qui se préoccupent du partage de la valeur ajoutée, au risque de rendre impossible toute stratégie de convergence des luttes ? Personne ne trouve grâce à ses yeux. Tous sont coupables de méconnaître le salaire socialisé à travers la cotisation sociale. Si Bernard Friot est l’un des premiers à avoir affirmé avec force et à juste raison le caractère socialisé de la cotisation servant à payer les retraites, et qu’en aucun cas il ne s’agit d’un revenu différé, il n’est pas aussi isolé qu’il le prétend. Aucun des principaux acteurs ayant mené en première ligne la bataille contre les réformes des retraites ne fait référence à un revenu différé et tous considèrent la cotisation comme la partie du salaire qui est socialisée[13]. Aucun n’a jamais assimilé la solidarité intergénérationnelle à un revenu différé, comme le croit Bernard Friot (p. 74). Et surtout, en dépit de sa critique, Bernard Friot est bien obligé de reconnaître que la valeur ajoutée est répartie, « se partage » (p. 69) ; ainsi, il approuve le combat mené par la CGT en 1946 : « sur le troisième front de la lutte des classes, il s’agit pour la CGT d’imposer la cotisation contre l’impôt, gage d’une collecte d’une part suffisante de la valeur ajoutée » (p. 28).[14] Après s’être opposé longtemps à l’élargissement de l’assiette des cotisations à la valeur ajoutée, Bernard Friot promeut aujourd’hui la chose (p. 107). On peut même se demander s’il n’oscille pas entre deux positions contraires incompatibles : 1) les travailleurs de la sphère non marchande produisent et 2) « le régime général de la Sécurité sociale est géré par les travailleurs eux-mêmes qui s’approprient par la cotisation une part suffisante de la valeur [sous-entendu, déjà produite ailleurs que dans la sphère du soin par exemple, JMH] pour l’affecter à une production sans capital [posture des marxistes traditionnels et même des libéraux ! JMH] » (p. 52, souligné par moi, voir aussi p. 117).
En filigrane, sous la cotisation magnifiée par Bernard Friot et l’impôt qu’il déconsidère en comparaison de la première, quel sens faut-il donner à l’universalité des droits ? L’éducation est-elle moins socialisée parce qu’elle est payée collectivement par l’impôt et non par la cotisation ?
Très étonnante aussi est la juxtaposition à quelques lignes d’intervalle de : 1) « dès lors que le salaire ne baisse pas, toute hausse de la cotisation est une ponction non pas sur le travail, mais sur le profit, et donc une excellente chose pour réduire le poids de la propriété lucrative dans la production. Pour que cette ponction soit réelle, encore faut-il que le salaire net augmente aussi vite que la valeur ajoutée et que le taux de cotisation augmente, ou qu’à taux de cotisation inchangé, la part du salaire net dans la valeur ajoutée augmente – et donc mécaniquement celle de la cotisation. » (p. 69) ; et 2) « si la mobilisation en faveur du salaire est menée en termes de meilleure répartition entre capital et travail (« prendre l’argent là où il est », « les patrons se gavent », « retrouvons les 10 points de PIB qui ont été perdus pour le travail dans les années 1980″), il y a fort à craindre qu’elle échoue, comme c’est le cas depuis des décennies. » (p. 69). Là encore, ces deux affirmations sont contradictoires.
Bernard Friot n’a pas de mots assez durs contre le « partage du travail, thématique aussi familière que désastreuse » (p. 87), ou bien « mot d’ordre inadmissible » (p. 15). « Travailler moins pour travailler tous, écrit-il, est un mot d’ordre réactionnaire » (p. 88). Et pourquoi ? Parce que ce mot d’ordre « naturalise la pratique capitaliste du travail et sa réduction aux seules activités valorisant le capital » (p. 88, aussi p. 70). Pour Bernard Friot, partage de la valeur et partage du travail sont pour ainsi dire les deux faces de ce qu’il appelle une « belle lisse poire » (p. 32). Que dire alors des luttes ouvrières arrachant peu à peu une réduction de leur temps de travail depuis l’aube du capitalisme industriel ? Si la formule de Bernard Friot avait une quelconque réalité, on se demande bien pourquoi les patronats, ont, de tous temps, fait violemment obstacle à toute forme de RTT, qu’elle soit à la journée, à la semaine, à l’année ou sur la vie active. La classe bourgeoise a fort bien compris que réduire le temps de travail impliquait une nouvelle répartition de la valeur ajoutée.
Bernard Friot insiste pour voir la pension comme une continuité du salaire (p. 41, 48). Qu’il faille assurer une continuité du salaire à la pension est une chose qui entre dans un projet normatif de progrès social, voire communiste pourquoi pas. Mais cela ne vaut pas preuve qu’il y ait en même temps continuité de production du salarié au pensionné. Autrement dit, créer un droit attaché à la personne ne signifie pas que cette personne produit le moyen de satisfaire ce droit. C’est le même argument que celui qu’on peut opposer aux partisans du revenu d’existence, qui, eux aussi, font l’amalgame entre un droit qu’ils pensent légitime et la source de sa satisfaction.[15]
Bernard Friot ne réécrit-il pas l’histoire pour la mettre au service de son projet politique ? Est-on bien sûr qu’Ambroise Croizat, lorsqu’il crée le droit à la prise en charge collective de la santé par le régime général de la Sécurité sociale, ait voulu instituer en même temps un autre mode de production de valeur, comme l’écrit Bernard Friot : « [les révolutionnaires de 1946] socialisent une part importante de la valeur dans un régime unique qu’ils gèrent eux-mêmes pour produire une autre valeur que la valeur capitaliste » (p. 117) ? Si on lit le discours de Croizat à l’Assemblée nationale le 8 août 1946, il n’est nullement question de production de valeur mais, très explicitement, de protéger les travailleurs de l’insécurité.[16] Il faut alors comprendre le « déjà là » exprimé par Bernard Friot comme des prémices d’une potentialité – ce qu’il reconnaît – plus qu’une réalité advenue.
Bernard Friot critique fortement le principe de la contributivité de la protection sociale, renforcé par chacune des réformes. Il lui oppose l’exemple de la pension des fonctionnaires qui assure selon lui la « continuité du salaire à vie ». Mais, en réalité, la pension des fonctionnaires, représentant jusqu’à présent 75 % du dernier salaire, est elle aussi de nature largement contributive, puisque les cotisations vieillesse sont un pourcentage du salaire. Derrière ladite continuité du salaire, il y a donc la continuité, au moins partielle, de la contributivité. De surcroît, la loi de 1946 assoit la pension des salariés du privé sur la cotisation qui est fonction du salaire, loin du mythe du Croizat inventant un nouveau mode de production.
On sait que Marx a présenté deux explications du niveau de salaire : sur le long terme, le salaire est défini par le niveau des besoins à satisfaire pour reconstituer la force de travail dans la société considérée ; dans l’immédiat, il dépend du rapport de force entre les travailleurs et les capitalistes, qui fixe la frontière entre salaire et plus-value. La cohérence entre ces deux aspects exige de ne pas faire du salaire un prix économique au sens étroit du terme, ni de la force de travail une marchandise comme les autres. Bernard Friot modifie le contenu des concepts de force de travail et de salaire. Pour lui, le salaire comme prix du panier de biens propres à satisfaire les besoins du travailleur est la vision de la classe capitaliste, tandis que la dimension socio-politique du salaire est le fait de la classe ouvrière révolutionnaire. On a là un exemple de retournement des concepts de Marx. Répétons-le, rien n’interdit d’effectuer un tel retournement s’il est utile à la compréhension de la réalité. Mais, ici, ne constitue-t-il pas davantage une façon de justifier ce qui est posé comme hypothèse de départ, à savoir que le salaire à la qualification est « l’invention décisive du changement du mode de production » (p. 38), parce que « ce n’est pas pour qu’il puisse satisfaire des besoins et continuer à produire des valeurs d’usage que le travailleur est rémunéré : le salaire à la qualification fait du poste de travail, inclus dans une grille de qualifications, le support d’un salaire qui reconnaît non pas des besoins, mais la contribution à la production, et qui s’impose à des employeurs qui, en permanence, tenteront de s’y dérober. » (p. 39). Sans parler de l’ambiguïté de l’opposition déclarée par Bernard Friot entre certification et qualification[17], celle-ci étant régulièrement graduée par des vérifications s’apparentant à des diplômes, deux tests peuvent être déployés pour contrôler la pertinence de la thèse du salaire à vie à la qualification. Puisque, selon lui, l’attribution du premier niveau de qualification doit avoir lieu le jour du 18e anniversaire, avant même que le premier acte productif ait été accompli par le jeune, la thèse s’écroule car cette attribution relève bien d’un projet strictement et exclusivement normatif. Et, puisque la personne âgée en retraite, diminuée progressivement sur les plans physique et intellectuel, continue de percevoir jusqu’à sa mort sa pension, le lien de celle-ci avec les prétendues production et qualification de la personne est rompu.
En conclusion, le mérite de Bernard Friot est double. Il nous oblige d’abord à revisiter méticuleusement des catégories socio-économiques que l’idéologie dominante a recouvert d’un voile mystificateur et que le discours progressiste délaisse trop souvent pour ce qui est de leur fondement : ainsi du travail, de la valeur, du salaire et de la protection sociale. Ensuite, Bernard Friot entreprend de reconstruire un projet communiste sans avoir peur ni du mot, ni de son histoire désastreuse au XXe siècle, notamment en redonnant à la critique de la propriété sa vigueur et sa radicalité d’antan. En ce sens, il contribue à faire émerger de nouveau un horizon d’émancipation. Cela dit, la direction donnée à sa recherche théorique rencontre plus d’obstacles logiques et méthodologiques que de fenêtres ouvertes. Se réclamant de Marx, il renverse pourtant plusieurs de ses concepts fondamentaux. Ce qui n’est pas a priori interdit, la théorie de Marx n’étant pas taboue. Mais la curiosité éveillée et la séduction opérée par le message de Bernard Friot ne tiennent-elles pas davantage au désarroi intellectuel général dans la société qu’à la cohérence de sa problématique ?
[1] On pourra aussi lire le résumé qu’il en présente dans « En finir avec les luttes défensives », Le Monde diplomatique, novembre 2017, ou de manière encore plus synthétique dans la table ronde de L’Humanité, « Faut-il repenser le modèle de protection sociale de 1945 ? », 13-14-15 octobre 2017.
[2] B. Friot, Puissances du salariat, Emploi et protection sociale à la française, La Dispute, 1998, Nouvelle édition augmentée, La Dispute, 2012. Voir aussi L’enjeu des retraites, La Dispute, 2010 ; L’enjeu du salaire, La Dispute, 2012 ; Émanciper le travail, Entretiens avec Patrick Zech, La Dispute, 2014.
[3] Un peu plus loin, le chômeur est également déclaré « travailleur productif » (p. 60). Il écrit aussi, ce qui exclut que les malades appartiennent à la catégorie de productifs : « Si mon salaire, par la cotisation maladie qu’il contient, me permet d’accéder à des soins, ma cotisation n’est pas l’entretien d’un improductif, c’est la reconnaissance de la valeur qu’il crée et à laquelle j’accède non par un prix, mais par une cotisation. » (p. 20).
[4] Parmi les étapes de la discussion avec B. Friot, voir notamment : J.-M. Harribey, « Ce n’est pas le salaire qui paie la cotisation sociale, c’est le salarié. Nuance ! », 1er juin 2003, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/retraites/retraites20.pdf. S. Treillet, « Du salaire socialisé au salaire continué, Ruptures et continuités, Contretemps, n° 7 », 3e trimestre 2010. J.-M. Harribey, « Les retraités créent-ils la valeur monétaire qu’ils perçoivent ? », Revue française de socio-économie, n° 6, second semestre 2010, p. 149-156, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/retraites/debat-friot.pdf. B. Friot, « Travailler, est-ce avoir un emploi ou une qualification personnelle ? L’activité des retraités est-elle « utile » ou est-ce « du travail » ? Débat avec Jean-Marie Harribey », Revue française de socio-économie, n° 6, second semestre 2010, p. 157-166. J.-M. Harribey, « Du travail et du salaire en temps de crise, À propos du livre de Bernard Friot, « L’enjeu du salaire », Contretemps, avril 2012, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/retraites/enjeu-salaire.pdf. P. Khalfa, « Des théorisations fragiles aux implications politiques hasardeuses, À propos des thèses de Bernard Friot », Les Possibles, n° 11, Automne 2016, https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-11-automne-2016/dossier-le-travail-en-question-s/article/des-theorisations-fragiles-aux-implications-politiques-hasardeuses. B. Friot, « 1945 change le salaire, et donc le travail », Les Possibles, n° 11, Automne 2016,
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-11-automne-2016/dossier-le-travail-en-question-s/article/1946-change-le-salaire-et-donc-le-travail. J.-M. Harribey, « Travail collectif, valeur et revenu : l’impossible dissociation », Les Possibles, n° 11, Automne 2016, https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-11-automne-2016/dossier-le-travail-en-question-s/article/travail-collectif-valeur-et-revenu-l-impossible-dissociation.
[5] Voir la discussion qui est consultable sur mon site, http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/valeur/index-valeur.html, et que j’ai synthétisée dans J.-M. Harribey, La richesse, la valeur et l’inestimable, Fondements d’une critique sociologique de l’économie capitaliste, Les Liens qui libèrent, 2013. Voir aussi le « Dossier : extension du domaine de la valeur », Contretemps, 5 juin 2017, https://www.contretemps.eu/dossier-valeur-capitalisme.
[6] Souvent Bernard Friot attribue sans l’expliciter un effet performatif au discours. Par exemple, il explique que le discours sur l’allongement de la durée de cotisation vieillesse et autres réformes préconisées depuis le Livre blanc Rocard de 1991 font passer du salaire socialisé au revenu différé (p. 63). L’allongement de la durée de cotisation entraîne certes une baisse des pensions mais ne change pas en soi la nature de la pension, pas plus que ne le ferait la modification du taux de cotisation, sauf à considérer que le caractère socialisé du salaire et de la pension tient à la proportionnalité de l’une par rapport à l’autre et non pas à la mutualisation des cotisations rassemblées pour verser dans l’instant des pensions. Bernard Friot réintroduit lui-même la contributivité individuelle qu’il chasse par ailleurs.
[7] K. Marx, Le Capital, Livre I, Œuvres, Gallimard, La Pléiade, 1965, tome I, p. 645.
[8] En allemand, Marx dit « automatisches Subjekt », mal traduit par « substance automatique » dans K. Marx, Le Capital, Livre I, op. cit., p. 700.
[9] Je laisse de côté ici, parce cela demanderait un développement de questions que j’aborde ailleurs (voir La richesse, la valeur et l’inestimable, op. cit.), la question de l’association par Bernard Friot de la préoccupation écologique à sa théorie du salaire à vie, tout en affirmant que le travail est « inépuisable » (p. 88-89) : sans matière ?…
[10] Bernard Friot réserve le terme de revenu aux seuls revenus de la propriété, alors que la convention admise partout (et qui n’est pas issue de la classe capitaliste) est de faire de revenu un terme général recouvrant toutes les formes de salaires, de profits et de transferts monétaires.
[11] Pour la discussion sur la création monétaire dans le système de Bernard Friot, je renvoie à J.-M. Harribey, « Que dit le Réseau Salariat ? », 21 février 2017, http://blogs.alternatives-economiques.fr/harribey/2017/02/21/que-dit-le-reseau-salariat.
[12] Au sein du Réseau Salariat qui entoure Bernard Friot s’est répandue l’idée que les salariés du secteur non marchand produisent de la « valeur économique » mais pas de « valeur ajoutée ». La contradiction est alors manifeste lorsqu’on déclare 1) que ce que font les salariés du secteur non marchand est inclus dans ce que font ceux du secteur marchand, et 2) que les salariés du secteur non marchand ajoutent de la valeur économique. On nous dit avec raison que le PIB a deux composantes, le PIB marchand et le PIB non marchand qui s’ajoute au précédent ; qu’est-ce donc que ce PIB non marchand qui n’est pas de la valeur ajoutée mais qui s’ajoute ? Voir J.-M. Harribey, « Que dit le Réseau Salariat ? », op. cit.
[13] On pourra se reporter aux différents livres publiés sous l’égide de la Fondation Copernic et d’Attac, Les retraites au péril du libéralisme Syllepse, 1999, 2000, 2002 (avec la participation de B. Friot) ; Retraites : l’heure de vérité, Syllepse, 2010 ; Retraites : l’alternative cachée, Syllepse, 2013. Dans les confédérations syndicales, seule FO se réfère encore au revenu différé.
[14] La sociologue Christine Jakse, membre du Réseau Salariat, enfonce le clou en déclarant dans « L’avenir du travail passe-t-il par l’emploi ? Entretien croisé entre Christine Jakse et Denis Durand », 21 décembre 2016, http://www.reseau-salariat.info/aa7d1ec2ff83333f0240d128a42e7a77?lang=fr : « Revendiquer une baisse du temps d’emploi légitime le marché du travail ; revendiquer le déplacement du curseur entre salaire et profit légitime le régime capitaliste. » Déplacer le curseur serait-il une bonne chose quand c’est Bernard Friot qui le demande, et ce serait mal quand ce sont les opposants à la « réforme » qui le réclament ?…
[15] Voir M. Alaluf et D. Zamora (dir.), Contre l’allocation universelle, Lux Éditeur, 2016 ; Les Économistes atterrés et la Fondation Copernic (coord. J.-M. Harribey et C. Marty), Faut-il un revenu universel ?, Les Éditions de l’Atelier, 2017.
[16] Comité d’histoire de la Sécurité sociale, Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale, « 40 ans de Sécurité sociale », Bulletin de liaison 14, janvier 1986, p. 94, http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/bhss14-2.pdf : « Nul ne saurait ignorer que l’un des facteurs essentiels du problème social en France, comme dans presque tous les pays du monde, se trouve dans ce complexe d’infériorité que crée chez le travailleur le sentiment de son insécurité, l’incertitude du lendemain qui pèse sur tous ceux qui vivent de leur travail. Le problème qui se pose aujourd’hui aux hommes qui veulent apporter une solution durable au problème social est de faire disparaître cette insécurité. Il est de garantir à tous les éléments de la population qu’en toute circonstance ils jouiront de revenus suffisants pour assurer leur subsistance familiale. C’est ainsi seulement, en libérant les travailleurs de l’obsession permanente de la misère, qu’on permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités, leur personnalité, dans toute la mesure compatible avec le régime social en vigueur. » On se demande d’ailleurs comment les dirigeants communistes des organisations de l’époque (PCF et CGT) pouvaient inventer une nouvelle conception de la valeur, tellement le dogme traditionnel du travail productif collé à la production capitaliste matérielle était prégnant. Par ailleurs, on lit très explicitement dans ce discours que Croizat ne s’oppose pas aux ordonnances de 1945, comme l’affirme Bernard Friot, mais au contraire, veut s’inscrire dans leur continuité et les parachever.
[17] Sur ce point voir P. Khalfa, op. cit.