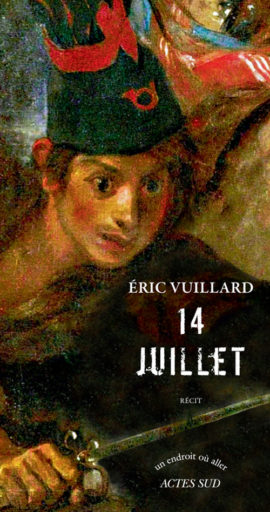
Éric Vuillard, 14 juillet, Marseille, Actes Sud, 2016, 208 p.
Avec l’aimable autorisation de l’auteur et des éditions Actes sud.
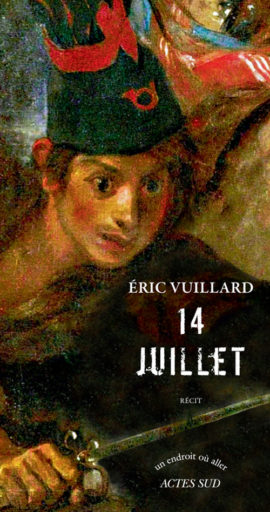
La rue Saint-Antoine éventre la Bastille. On dirait qu’un immense bélier s’apprête à la forcer. De toutes parts, la ville abonde, ruisselle. On se cache des coups de feu ; il y a des gens derrière chaque porte de la rue des Remparts, sous tous les arbres de la grande allée de l’Arsenal, derrière chaque tas de bois de la rue des Marais. La Bastille est enveloppée par l’humanité. Mais ce ne sont pas les hordes débonnaires qui vont au champ de foire et s’en reviennent ; c’est une multitude armée de piques, de broches, de sabres rouillés, de haches, de vieux canifs, de mauvais fusils, de pilums et de tournevis. Les armes étincellent, dans un brouhaha extravagant, confusion de voix et de cris.
L’assaut commença de partout et de nulle part, il se fit aussi bien coup de fusil que de caillasse. Les cris jouèrent leur rôle. Les jurons jouèrent leur rôle. Ce fut une grande guerre de gestes et de mots. Lafoulemouvante, expressive, lançait des pierres et de vieux chapeaux. Ça faisait un horrible tintamarre, jurements. Les soldats, l’ordre qu’ils représentaient, étaient traités de tous les noms : cul-crottés, savates de tripières, pots d’urine, bouches-à-bec, louffes- à-merde, boutanches-à-merde, et toutes les choses-à-merde, et toutes les couleurs-à- merde, merdes rouges, merdes bleues, merdes jaunilles. Et cela fusait avec gouaille. Quand soudain, un nouveau coup de feu partit du haut des tours. Comme le matin, on courut se mettre à l’abri, les visages étaient en sueur. Un homme se traînait par terre au milieu de la cour. Il s’appuya un instant sur le coude et gémit. Derrière les portes, sous les porches, la foule se mit à pousser un râle sourd. Ce bourdonnement montait vers les murailles ; il semblait venir des rues abandonnées, des places vides. Le blessé gisait immobile, avec de longs cheveux noirs. Le soleil ajoutait à l’impression de désolation. Et puis le marmonnement devint intelligible. La foule scandait d’une voix grave : “Assassins ! Assassins !” Les gens ressortirent lentement de sous les auvents, d’un peu partout ; de petits groupes se détachaient de l’ombre, et criaient de plus en plus fort : “Assassins !” La parole ne laisse pas de trace, mais elle fait des ravages dans les cœurs. On se souvient toute une vie d’un mot, d’une phrase qui nous a touchés. À l’intérieur de la forteresse, les soldats reculèrent en une oscillation insensible. Ils éprouvèrent une impression terrible de solitude. Les murailles humides, noires, n’étaient plus une protection ; elles les enfermaient.
À partir de ce moment, on ne comprend plus rien. Les lieux vacillent, le temps meurt. Tout se précipite. Un jeune épicier observe qu’il serait aisé d’atteindre le chemin de ronde, au sommet du mur de la contrescarpe. Ce chemin faisait le tour du fossé ; de là, on pourrait sauter dans la Cour du Gouvernement. Jean-Armand Pannetier, c’est son nom, laissera une petite relation de sa journée, et retombera aussitôt dans le néant. Mais à ce moment, le mardi 14, il est l’étincelle qui met le feu aux poudres. Comme il est de grande taille, il se plante contre la muraille et fait la courte échelle. Le charron Tournay monte le premier. Il porte un gilet bleu. Il a vingt ans. Huit à dix autres le suivent. Ils enjambent une échoppe qui sert de remise à un débitant de tabac. La foule les apostrophe, on rigole, on les encourage. Il y a un raffut inouï. Tournay grimpe sur le toit du corps de garde. Des copains le hèlent, le vent fait bouffer son gilet.
Je désire, j’imagine, qu’à cet instant, le charron Louis Tournay ait été lui-même, seulement lui-même, vraiment, dans son intimité la plus parfaite, profonde, là, aux yeux de tous. Ce fut pour un court instant. Quelques pas de danse sur un toit de tuiles. Une série de déboulés, la tête libre, haute, puis un chapelet de battements, de piqués, de pirouettes même. Ou plutôt, non, ce furent des pas très lents, de petites glissades, des pas de chat. Soudain, Tournay, sous le grand ciel, dans le jour gris et bleu, oublie tout. Le temps meurt un instant en lui. Il vacille près d’une cheminée. Les gens craignent qu’il tombe. Oh ! Il s’accroupit sur la pente intérieure du toit, les tuiles lui brûlent les mains ; on ne le voit plus. Il est seul. La Cour du Gouvernement est vide, face à lui. Il est alors juste une ombre, une silhouette. Les soldats sur les tours le regardent. Il saute dans la cour.
Là, il est encore plus seul. Il accomplit un devoir étrange. Personne ne sait de quoi la liberté est faite, de quelle façon l’égalité s’obtient. Louis Tournay, le charron, le jeune homme de vingt ans, est passé de l’autre côté de la vie. Il n’est pourtant rien qu’un petit morceau de foule tombé là, tout seul, dans la Cour du Gouvernement. La cour est large, horriblement. Tournay frissonne. Qu’est-ce que je fais là ? se dit-il. Il fait quelques pas sur les gravillons. Peut-être que malgré le bruit, il entend crisser la plante de ses pieds sur le sol des rois. À sa droite, il y a l’Hôtel du Gouvernement qui a été abandonné par les soldats de la forteresse. Les bâtiments sont déserts. On dirait qu’ils sont vides depuis toujours. En face, c’est l’avenue de la grande cour, le passage qui conduit au dernier pont- levis ; ce petit couloir mène de l’Ancien Régime vers autre chose. Une fois parcouru l’isthme, une fois franchie cette fine bande de pierre au bout de laquelle se trouve la porte cadenassée de la citadelle, on ne voit qu’un trou noir.