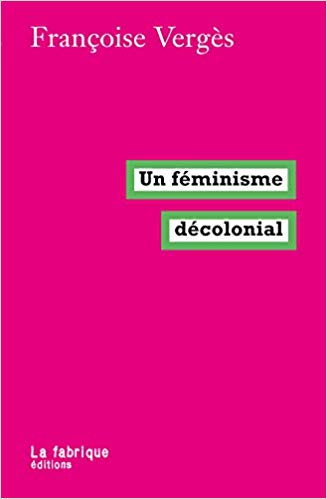
Françoise Vergès, Un féminisme décolonial, Paris, La Fabrique, 2019.
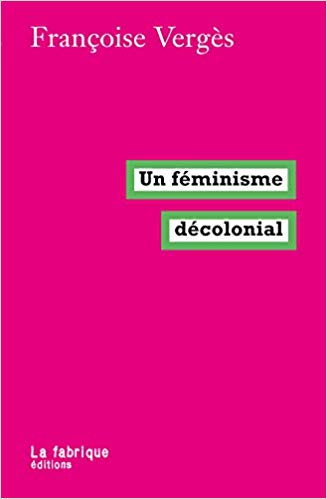
Un ouvrage qui pose la question de quelle stratégie pour quel mouvement féministe est le bienvenu dans le contexte qui est le nôtre depuis le début des années 2010, celui d’un renouveau féministe dont l’épicentre est à n’en pas douter l’Amérique latine[1], mais qui commence à se développer en France. En témoignent à la fois le succès du 24 novembre de cette année, journée internationale contre les violences sexistes, avec 50 000 personnes dans la rue selon les organisatrices, et à la fois l’importance de l’implication remarquée des femmes à l’avant-poste du mouvement des Gilets Jaunes[2]. À ce titre, l’ouvrage de Françoise Vergès prolonge en quelque sorte la réflexion amorcée dans Pour un féminisme de la totalité[3], qu’elle cite d’ailleurs à plusieurs reprises. C’est un excellent signe pour la vitalité du mouvement féministe que les questions stratégiques commencent à ré-émerger car c’est le bon moment pour les poser.
Dans le même temps, l’ouvrage de Françoise Vergès s’inscrit dans une autre temporalité et un autre enjeu, cette fois-ci internes au champ féministe, et pourrait-on dire également interne au champ universitaire, et en ce sens il semble alors redoubler avec un décalage notable de plusieurs dizaines d’années le geste initié par bell hooks en 1984 dans De la marge au centre. Théorie féministe[4] : relire la théorie féministe à l’aune d’une perspective qu’on qualifierait aujourd’hui d’intersectionnelle. Ce décalage est sans nul doute lié au long aveuglement français sur la question de la « race » qui peine encore à émerger aujourd’hui dans le champ académique, notamment en sociologie, en histoire et en sciences politiques, et qui est dû à une multitude de facteurs sur lesquels nous ne reviendrons pas ici, mais qui a touché également en partie le féminisme.
Dans son ouvrage, Françoise Vergès réussit à tenir les deux bouts qui ont pu être présentés ou vécus comme irréconciliables : le féminisme et l’antiracisme. Elle s’adresse tout autant aux féministes (blanc·he·s et racisé·e·s) qu’aux racisé·e·s qui, à cause de l’instrumentalisation du féminisme à des fins racistes et impérialistes, ne se reconnaissent plus/pas dans ce terme. Elle dresse ainsi une histoire sans concession de l’aveuglement sur les questions antiracistes et anti-impérialistes, voire de la complicité avec le gouvernement français, d’une partie du féminisme tout au cours de son histoire moderne, de la Révolution Française à nos jours. À ce titre, ce qu’on a appelé les « affaires du voile » ont constitué un tournant majeur ces dernières années. Le féminisme doit prendre à bras le corps, comme l’ensemble de la France, son passé colonial et son présent raciste et néo-colonial.
Pourtant Françoise Vergès l’affirme : le féminisme a encore un sens. Ainsi, « les féministes décoloniales ne choisissent pas d’ignorer l’existence de la violence systémique contre les femmes ni le retour de structures oppressives dans les États issus de la décolonisation. » (p. 102). Mais pour cela il est nécessaire de penser les différents statuts au sein de la catégorie de « femmes » et de cesser de l’appréhender comme un tout unifié. Les antagonismes de race et de classe existent au sein du sujet politique et de la catégorie analytique des « femmes ». Il ne s’agit pas pour autant de « découper » les oppressions en autant de tranches, même si cela est certainement nécessaire pour le temps de l’analyse, mais dans un contexte politique, il s’agit de les penser dans leurs rapports dynamiques les unes aux autres. Ainsi, Françoise Vergès défend une « analyse multidimensionnelle de l’oppression » (p.34) ou encore un « féminisme de la totalité » (p. 34) qui pense ensemble et non pas isolément les différents rapports d’oppression.
Cette position amène en outre à dépasser la question des simples identités individuelles pour poser celle des structures qui maintiennent ces dominations, et des stratégies qu’il faut leur opposer. C’est pourquoi Françoise Vergès inscrit la lutte contre le « capitalisme racial » (p. 32), et nous ajouterions patriarcal, au centre de son projet. La compréhension à un niveau systémique des dominations induit une remise en question radicale de l’État, de sa politique, et de ses institutions, comme la police et la justice. Elle le synthétise de la façon suivante : « Je partage l’importance donnée à l’État et j’adhère à un féminisme qui pense ensemble patriarcat, État et capital, justice reproductive, justice environnementale et critique de l’industrie pharmaceutique, droit des migrant·e·s, des réfugié·e·s, et fin du féminicide, lutte contre l’Anthropocène-Capitalocène racial et criminalisation de la solidarité. » (p. 34).
D’un point de vue stratégique, Françoise Vergès affirme la centralité du travail dans nos sociétés, et en particulier du travail reproductif. Le travail reproductif est l’ensemble des tâches, rémunérées ou non, ayant lieu au sein de la famille ou hors de ce cadre, qui permettent la reproduction de la force de travail, quotidienne ou intergénérationnelle, ou dit autrement la reproduction des travailleur·se·s. Le livre s’ouvre ainsi sur la grève de 2017 des travailleur·se·s d’ONET, sous-traitant du ménage de la SNCF, grève victorieuse et qui était composée majoritairement des femmes racisées. Il se clôt sur la question fondamentale : « qui nettoie le monde ? » (p. 119). Or, on constate à la fois que le travail reproductif est de plus en plus externalisé et confié aux femmes racisées, particulièrement exploitées dans ce cadre, mais aussi que c’est un secteur de lutte dynamique et victorieux (on peut citer également l’exemple des grèves victorieuses des salariées d’Holiday Inn).
Mais ce constat ne peut faire l’économie d’un autre : qu’en grande partie les femmes racisées précaires payent le plein prix de l’émancipation du travail reproductif d’une partie des femmes blanches des classes moyennes et supérieures. La centralité stratégique du travail reproductif conduit donc à la centralité stratégique des femmes racisées. À l’échelle internationale, ce sont également les femmes racisées qui sont à l’avant-poste des luttes contre les politiques néo-libérales : par exemple en Argentine avec la lutte contre les violences sexistes mais aussi les luttes des femmes indigènes pour la terre, ou au Brésil contre le gouvernement Bolsonaro, dans un contexte de répression exacerbée avec les féminicides, notamment des figures du mouvement, comme Marielle Franco.
Tout cela dresse les contours d’un certain féminisme, que Françoise Vergès nomme « féminisme décolonial ». Il s’oppose au « féminisme blanc », au « fémonationalisme » et au « fémo-impérialisme ». Le « fémonationalisme » est un concept que Sara R. Farris développe dans son ouvrage In the Name of Women’s Rights. The rise of femonationalism publié en 2017[5]. Il s’agit de la convergence de trois acteurs, les politiques néolibérales, les nationalistes, et une partie des féministes, dans la création d’une figure repoussoir de l’Islam, du monde musulman, et plus globalement de l’ensemble des hommes racisés comme étant par nature sexistes, homophobes, etc. Le « fémo-impérialisme » est un concept que Françoise Vergès a créé à partir de celui de Sara R. Farris et nous semble particulièrement pertinent, en permettant de distinguer tout en liant l’instrumentalisation du féminisme à des fins racistes sur le territoire directement français (fémonationalisme) et l’instrumentalisation du féminisme pour justifier les guerres impérialistes (fémo-impérialisme). Cette nécessaire démarcation est la bienvenue dans un moment de renouveau du féminisme et de risque de récupération exacerbée. Le mouvement féministe doit connaître son histoire et doit faire le bilan des différentes stratégies qu’il a mises en place au cours du temps. Un féminisme décolonial peut être un pas dans ce sens.
Néanmoins, comme je l’ai signalé, cet ouvrage est inscrit dans une double temporalité et un double enjeu. D’un côté, c’est ce qui fait sa force, de l’autre, c’est ce qui fait en partie sa limite. À mon sens, il demeure trop prisonnier d’enjeux internes au champ féministe et universitaire. Vue l’urgence de la situation actuelle, avec une polarisation politique exacerbée, entre d’un côté la montée partout dans le monde de gouvernements d’extrême-droite, donc l’extrême danger dans lequel nous nous trouvons, et de l’autre un renouveau des luttes, non seulement du mouvement social avec les Gilets Jaunes, mais aussi du féminisme et en particulier des féministes racisées, la question ne devrait pas être, comme elle l’a été tout au long des années 2000 et 2010 en France, de dresser deux pôles antagonistes au sein du féminisme. La question devrait être pleinement stratégique (et dans une certaine mesure, Françoise Vergès la pose comme telle). Car, moins que de différents féminismes, il faudrait parler de différentes stratégies féministes, ou plutôt il faudrait dire que ce sont différentes stratégies qui définissent différents féminismes, ce qui permettrait d’éviter d’essentialiser les féminismes autour de caractéristiques sociales.
Comment comprendre qu’une partie des féministes aient participé à l’entreprise fémonationaliste et fémo-impérialiste ? Une réponse possible est qu’il y a une dimension raciste et impérialiste inhérente au féminisme européen qui s’est construit comme un féminisme Blanc. Une autre réponse possible est que comme tout mouvement social révolutionnaire, il a été coopté et intégré dans les institutions. Ce n’est pas nouveau, le mouvement ouvrier connaît cette petite musique par cœur. La différence est que le mouvement féministe est plus récent et que la cooptation est en partie nouvelle pour nous. D’ailleurs, Françoise Vergès le dit elle-même de façon particulièrement juste : « Nous ne devons pas sous-estimer la rapidité avec laquelle le capital se montre capable d’absorber des notions pour en faire des slogans vidés de leur contenu : pourquoi le capital ne serait-il pas capable d’incorporer l’idée de décolonisation, de décolonialité ? Le capital est colonisateur, la colonie lui est consubstantielle. » (p.27).
Que quelles que soient les époques, il y aient eu des femmes et des féministes racistes et colonialistes, c’est indéniable. Mais de la même façon qu’il y a eu des féministes racisées dans tous les mouvements féministes, et que nombre de féministes blanches sont devenues féministes grâce aux luttes anti-impérialistes et antiracistes. Ainsi, pour reprendre l’exemple des années 1970, les féministes luttes de classe que j’ai été amenée à interroger dans le cadre d’un projet d’archivage du féminisme lutte de classe avec Elsa Boulet témoignaient toutes que leurs premiers engagements ont été contre la guerre du Vietnam et contre la guerre d’Algérie, un engagement anti-impérialiste, et que c’est de là que sont venus dans un second temps leurs engagements anticapitalistes puis féministes.
Les principales théoriciennes françaises du féminisme de la deuxième vague, Christine Delphy comme Colette Guillaumin, ont élaboré tout leur féminisme en lien avec les luttes antiracistes et en lien avec une réflexion autour de la notion de « race » : Christine Delphy a défendu la non-mixité suite aux expériences qu’elle avait pu voir aux États-Unis des luttes pour les droits civiques des Afro-Américain·e·s, Colette Guillaumin a d’abord travaillé sur la notion de la race, et n’est venue que dans un deuxième temps à la notion de genre, en soulignant des similitudes, comme la naturalisation de la domination. On ne peut pas faire comme si ces données historiques n’existaient pas. Quand Françoise Vergès dit que « au XIXème siècle, la plupart des féministes, à quelques rares exceptions comme Louise Michel ou Flora Tristan, soutiennent l’empire colonial » (p. 48), de qui s’agit-il ? Que recouvre « la plupart des féministes » ? Le féminisme au XIXème siècle est encore consubstantiel au mouvement ouvrier. S’il s’agit d’un féminisme de la bourgeoisie capitaliste, qui a intérêt au maintien et à la perpétuation des dominations sociales, cela n’a rien d’étonnant.
Ce qui pose profondément problème, c’est quand le racisme, l’impérialisme et le colonialisme deviennent partie intégrante d’une stratégie féministe. Mais ce n’est pas le cas de l’ensemble des stratégies féministes et de l’ensemble des féminismes en Europe. C’est le cas d’une stratégie, la stratégie réformiste, en particulier quand elle devient féminisme d’État. Avec le fémonationalisme et le fémo-impérialisme, il y a une logique d’État qui s’est manifestée du côté du féminisme d’État, ce qui est cohérent. Néanmoins, cela n’a pas empêché que toute une partie du féminisme institutionnel[6] ait été leurrée par le féminisme d’État et l’ait soutenu et suivi, comme le décrit bien et à juste titre Françoise Vergès. Mais c’est là que l’on peut bien parler d’instrumentalisation, au sens où une partie des féministes se sont retrouvées véritablement instrumentalisées par le féminisme d’État, dans une logique qui pré-existe d’ailleurs à cette montée du fémonationalisme, puisqu’il y a eu et il y a toujours des interactions fortes entre féminisme institutionnel et féminisme d’État. Une question demeure : pourquoi le féminisme? Comme l’ont montré Sara R. Farris et Françoise Vergès, renforcer le fémonationalisme revient à renforcer les stéréotypes de genre sur les femmes racisées, immigrées et migrantes, et donc renforcer leur rôle de pilier central du travail reproductif, un travail centralement nécessaire au système capitaliste, raciste et patriarcal dans lequel nous vivons.
Pour conclure, Françoise Vergès a commencé à poser la question la plus urgente dans ce contexte de l’émergence d’une quatrième vague du féminisme, la question stratégique[7]. Même si elle n’aime pas la notion de « vague », la métaphore a le mérite de poser un mot sur le phénomène actuel, et qui ne prend pas les formes classiques d’autres « irruptions sociales » centrées sur un événement précis, même s’il peut être dilué dans le temps, le plus souvent dans un contexte local ou national. De fait les vagues féministes ont eu en commun d’arriver sur des périodes de temps diluées sur plusieurs années voire dizaines d’années, et de façon simultanée à une échelle internationale[8]. Il faut continuer les débats stratégiques entre nous car la quatrième vague du féminisme est en train d’arriver en France. Entre temps, Françoise Vergès a posé un jalon important, dont le mouvement féministe ne peut faire l’économie s’il veut être victorieux : la nécessité d’une stratégie féministe décoloniale.
[1] Voir les articles publiés sur Contretemps du collectif Ni Une Menos, « Comment s’est tissé l’appel à la Grève Internationale de Femmes ? », 7 mars 2017, celui de Carolina Olmedo et Luis Thiellemann Luis, « Chili. Un féminisme venant du Sud », 27 juin 2018, ou encore celui de Dora Barrancos, Dolores Fenoy, Fanny Gallot et Bettina Ghio, « Au-delà du rejet de la loi pour la légalisation de l’avortement en Argentine : une quatrième vague féministe ? », 23 août 2018.
[2] Voir Fanny Gallot, « Les femmes dans le mouvement des gilets jaunes : révolte de classe, transgression de genre », Contretemps, 17 décembre 2018.
[3] Félix Boggio Éwanjé-Épée, Stella Magliani-Belkacem, Morgane Merteuil, Frédéric Monferrand (dir), Pour un féminisme de la totalité, Paris, Editions Amsterdam, 2017.
[4] bell hooks, De la marge au centre. Théorie féministes, Paris, Editions Cambourakis, 2017.
[5] Sara R. Farris, In the Name of Women’s Rights. The rise of femonationalism, Durham and London, Duke University Press, 2017. Voir sur Contretemps : Sara R. Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme », 17 juillet 2013, et « Au nom des droits des femmes ? Fémonationalisme et néolibéralisme », 22 novembre 2017.
[6] A mon avis, il faut distinguer entre féminisme institutionnel et féminisme d’État. Les féministes institutionnelles ont une reconnaissance institutionnelle et sont en dialogue avec l’État, mais n’en font pas partie et entretiennent une existence organisationnelle autonome. Les féministes d’État développent une politique d’amélioration du statut des femmes au sein même de l’État, de ses administrations, de ses institutions, de son gouvernement. Elles sont intégrées à l’État, et c’est pourquoi leurs intérêts sont intimement liés.
[7] Je me propose moi-même d’apporter ma contribution, plus importante qu’ici, aux débats stratégiques au sein du champ féministe dans un ouvrage qui paraîtra à la rentrée 2019 aux Éditions Amsterdam.
[8] Voir Abigail Bakan, « Marxisme et féminisme, une dissonance épistémologique », traduction de l’anglais par Félix Boggio Éwanjé-Épée et Stella Magliani-Belkacem sur Période, Revue d’études socialistes 8 (2), Automne 2012.