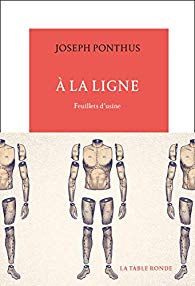
Joseph Ponthus, À la ligne. Feuillets d’usine, Éditions La Table Ronde, 2019, 18 euros.
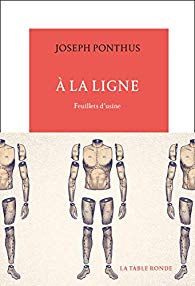
La France compte une longue tradition de récits sur les mondes du travail. On retient d’abord les témoignages d’étudiants-devenus-ouvriers dans les années qui suivent mai 68. Ce sont ceux d’établis à l’usine pour « contribuer à la résistance, aux luttes, à la révolution » comme le dit Robert Linhart[1]. Appréciés par leur style et leurs descriptions des luttes auxquelles ils ont contribué, ces récits pêchent aussi par misérabilisme, laissant peu de place à la sociabilité au travail, aux moments où l’étau de la domination se desserre, voire aux formes d’acceptation de la domination. On retient ensuite les écrits de journalistes qui, le temps d’un reportage, revêtent le bleu de travail afin de témoigner de la « souffrance sociale » de certaines populations. C’est le cas de Satoshi Kamata dans Toyota, l’usine du désespoir[2] au Japon, de Günter Wallraff dans Tête de turc[3] en Allemagne ou de Florence Aubenas dans Le Quai de Ouistreham[4].
Pourtant, tout en voulant rendre visible les mondes du travail, ces écrits ont paradoxalement contribué à éclipser une production littéraire proprement ouvrière, c’est-à-dire celle de travailleurs qui écrivent sur leurs propres conditions de travail. Aujourd’hui, les écrits ouvriers qui ont accédé au statut d’oeuvres littéraires se comptent sur le doigt d’une main : c’est le cas de Travaux de Georges Navel[5], ou encore de Grain de sable sous le capot de Marcel Durand[6], moins pour ses qualités littéraires que pour ses descriptions « de l’intérieur » de l’ambiance de travail à Peugeot-Sochaux.
Outre l’ouvrage désormais classique de Michel Ragon consacré à l’Histoire de la littérature prolétarienne de langue française[7], la « littérature prolétarienne » a peu suscité l’attention d’universitaires, bien que cela commence à changer ces dernières années. Dans Le corps à l’ouvrage, le sociologue Thierry Pillon analyse le corps ouvrier au travail en mobilisant une multitude de témoignages et de récits autobiographiques[8]. Éliane Le Port a soutenu en 2017 une thèse sur le témoignage ouvrier depuis 1945[9], en même temps que l’historien Xavier Vigna a consacré L’Espoir et l’effroi à l’étude du « flot gigantesque d’écrits » sur le monde ouvrier[10]. Enfin, Corinne Grenouillet consacre le premier travail universitaire à la nouvelle littérature sur le travail[11], tandis que le numéro de janvier 2019 de Les Mondes du travail consacre un dossier à « Écrire à propos du travail », coordonné par Marc Loriol.
De la même manière, la « littérature prolétarienne » connaît un nouveau souffle depuis une trentaine d’années suite à la publication de Sortie d’usine de François Bon en 1982[12]. Chaque publication d’un roman ou d’un témoignage éclaire sous un nouveau jour la condition ouvrière en France. Et pour cause : en parlant de leur travail, ces auteurs témoignent aussi des transformations du travail et du salariat. Les récits de luttes dans les grandes concentrations ouvrières, tel le témoignage d’Henri Rollin sur la répression patronale dans Militant chez Simca-Chrysler[13], laissent place aux récits sur l’expérience de la précarité, tel Daniel Martinez dans Carnets d’un intérimaire[14]. Il est difficile de recenser tous les roman ou témoignages de salarié.e.s sur le monde du travail : souvent publiés dans des petites maisons d’édition, ils passent sous le radar des médias et restent inconnus du grand public (par exemple, le livre de Daniel Martinez n’a connu que quelques recensions dans des médias et des revues de gauche).
Trop documentée, la condition ouvrière n’intéresserait donc plus personne, si ce n’est pour revenir rituellement sur les vieux topoï de l’ « ouvrier sans usine » (et sans parti et sans syndicat) ? Certains récits sont pourtant au cœur de l’actualité comme L’usine des cadavres de Silien Larios, récit célinien sur le travail et les désillusions politiques d’un ouvrier de l’usine PSA à Aulnay-Sous-Bois[15], publié seulement quelques mois après la fin du conflit de plusieurs mois des ouvriers contre la fermeture. Quelques livres sont néanmoins l’exception. Sans devenir des best-sellers, ils circulent dans les réseaux militants — peut-être parce leurs auteurs s’inscrivent dans ces mêmes réseaux —, comme ceux de Jean Pierre Levaray (Tranches de chagrin[16], Putain d’usine[17], ou Je vous écris de l’usine[18], compilation de ses chroniques parues dans Le Monde libertaire).
Alors que les membres du courant de la littérature prolétarienne des années 1920-1930 autour d’Henry Poulaille se déchiraient sur la définition de ce qu’est un « auteur prolétarien » (doit-il être fils de paysans ou d’ouvriers ? doit-il occuper un emploi ouvrier ? doit-il écrire sur le monde ouvrier ? doit-il écrire dans un style réaliste et non formaliste ?), la « littérature prolétarienne » contemporaine se pose peu les questions de son appellation d’origine et d’une éventuelle unité de style. En effet, Jean Pierre Levaray ou François Bon seraient rejetés par Henry Poulaille dans la petite bourgeoisie, s’agissant de techniciens dans l’industrie chimique et métallurgique, et non pas d’ouvriers spécialisés sur une ligne de montage. Aussi, si l’autodidaxie était de rigueur parmi les premiers écrivains prolétariens, les « dominés aux études longues »[19] sont légion aujourd’hui parmi les classes populaires, ce qui contribue à diversifier les profils des écrivains.
À la ligne. Feuillets d’usine de Joseph Ponthus correspond à ce nouveau type d’écrits sur les mondes du travail. Comme il l’affirme dès les premières lignes, l’auteur n’est pas allé à l’usine « pour faire un reportage/encore moins pour faire la révolution/l’usine c’est pour les sous » (p. 11). Ponthus n’a pourtant pas toujours connu l’usine, loin de là. Avant, il a fait une classe préparatoire, des études et il a travaillé pendant une dizaine d’années en tant qu’éducateur spécialisé en région parisienne. C’est l’absence de postes dans son métier d’origine et l’expérience du chômage qui le poussent à trouver des missions d’intérim dans l’industrie agro-alimentaire en Bretagne, où il a déménagé en suivant sa compagne. Ce décalage d’expériences produit un livre singulier, qui ressemble tantôt à une description ethnographique du travail — les gestes, les cadences, les lieux, le rapport avec les collègues et les chefs, etc. — tantôt à un long poème d’où ressort une « paradoxale beauté » (p. 12).
Les usines de l’industrie agro-alimentaire où travaille Ponthus font partie de ces univers sur lesquels on connaît peu ou rien. Les seules images qui en sortent d’habitude sont celles prises à la dérobée par des associations des droits des animaux : celles-ci dénoncent la maltraitance animale et des salariés « complices », sans se demander si ce n’est pas l’organisation du travail et donc les organisateurs du travail qui en seraient les premiers responsables. Quelques travaux en sociologie ont pourtant commencé à jeter de la lumière sur le travail dans ces usines : à partir d’une enquête par observation participante dans un abattoir, Sévérin Muller décrit les tensions entre les injonctions à la productivité et les impératifs de santé publique[20], tandis que Sylvie Célérier décrit l’activité des tâcherons, ce travail que personne ne veut faire, ou ne peut plus faire, en raison des cycles de travail de trois secondes par carcasse de volaille (pendant sept heures) qui provoquent des tendinites du poignet, des bras et de l’épaule[21]. Avec À la ligne, Joseph Ponthus complète ce tableau en nous donnant le point de vue précieux d’un ouvrier intérimaire du secteur.
Un des aspects les plus étonnants du livre de Joseph Ponthus est son style. Loin de la prose de Le pain quotidien, des Damnés de la terre de Poulaille ou d’autres romans sur la condition ouvrière, Ponthus écrit des phrases courtes, parfois d’un seul mot, sans ponctuation, ce qui donne l’impression au lecteur de suivre la cadence de auteur à son poste de travail : « J’écris comme je travaille/À la chaîne/À la ligne » (p. 15). En effet, les auteurs qui écrivent aujourd’hui sur les mondes du travail n’hésitent pas à expérimenter au niveau du style, abandonnant le réalisme social. Ainsi, L’usine des cadavres de Silien Larios a recours à un style inspiré de Céline pour décrire l’univers sombre d’une usine automobile et des groupuscules trotskistes et religieux qui pullulent à l’intérieur.
La fragmentation des paragraphes correspond aussi à celle des chapitres. Le livre est divisé en soixante-six « feuillets », où l’auteur décrit différents aspects de ses expériences d’intérimaire dans deux usines de l’agro-alimentaire, l’une de production et de transformation de poisson et de fruits de mer et l’autre un abattoir. Une telle diversité d’expériences donne un tableau d’ensemble de la vie à l’usine. On y trouve par exemple la division de la main-d’œuvre entre les ouvriers du dépotage, du mareyage ou de la cuisson :
« Les dépoteurs/C’est un peu comme les ouvriers du livre de la CGT/Seuls/Un peu planqués/Avec des avantages considérables/Par rapport au reste des ouvriers de l’usine » (p. 28).
L’auteur décrit aussi le racisme et l’homophobie au travail, de même que les conditions de travail et ses effets (la fatigue, les douleurs musculaires, l’adaptation difficile au travail de nuit) :
« J’ai mal à mes muscles/J’ai mal de cette heure de pause où je devrais être/mais où je ne suis pas/En fumant ma clope chez moi » (p. 53). Ou encore les accidents si fréquents qu’ils deviennent une réalité banale de l’usine : « Un doigt coupé/La greffe n’a pas pris/Voilà pour la nouvelle du jour » (p. 212).
Mais Ponthus ne se satisfait pas d’une vision misérabiliste de l’usine, propre aux récits d’établis qui réduisent l’usine à un univers de domination totale sur les corps et les esprits. Il décrit aussi les blagues entre collègues et les chants au travail qui le rendent supportable :
« À l’usine on chante/Putain qu’on chante/On fredonne dans sa tête/On hurle à tue-tête couvert par le bruit des machines/ (…) Et ça aide à tenir le coup/Penser à autre chose/Aux paroles oubliées/Et à se mettre en joie » (p. 190).
Des formes d’appropriation du travail sont aussi possibles, comme le vol de fruits de mer, déclinaison de la « perruque » dans l’agro-alimentaire, cette appropriation pour soi du travail ouvrier décrite principalement pour les usines de la métallurgie :
« Pour l’instant c’est du détournement/Artisanal/ Deux langoustes par-ci/Une pince de crabe par-là/Mais à partir de maintenant/On va passer dans le sérieux » (p. 107).
Les « feuillets » de Ponthus ont la particularité de laisser une large place au hors-travail à travers le récit de ses rapports avec sa compagne, sa mère ou son chien pok pok. Il rappelle, comme le font d’autres témoignages sur le travail ouvrier, que l’on ne ressent pas tant la fatigue pendant le travail qu’après, une fois rentré à la maison ou les week-ends. L’usine envahit toute l’existence : on porte l’usine chez soi, dans ses odeurs de poisson ou de viande, et on porte aussi l’usine chez soi y compris dans ses rêves (ou plutôt dans ses cauchemars) :
« Pas une sieste pas une nuit sans ces mauvais/rêves de carcasses/de bêtes mortes/ (…) Parfois je hurle/Toutes les nuits je sais que je vais emporter/l’abattoir dans mes mauvais rêves » (p. 137).
L’usine affecte le rapport aux autres. Le stress provoqué par les week-ends écourtés par un samedi travaillé ou par le réveil tôt le lundi provoque des tensions à la maison : « Le vendredi après-midi/À la maison ce devrait être la fête/Mais jamais/Je suis irritable/Le mot est faible/Irascible » (p. 183). L’ouvrage ne serait qu’une simple évocation de l’usine si son auteur ne parlait pas aussi de sa colère et de sa révolte. Révolte pourtant impossible dans les faits pour un intérimaire qui ne peut pas quitter son travail pour quelques jours pour aller affronter les gendarmes à Notre-Dame des Landes :
« Et moi/petit intérimaire/petit anarchiste de godille/Je choisis le boulot/J’ai pas les sous suffisants pour partir une/semaine à même pas deux heures de bagnole » (p. 248).
Au-delà des spécificités du travail dans l’agro-alimentaire, l’usine de Ponthus n’est, en quelque sorte, qu’une usine parmi d’autres : on pourrait tout aussi bien fabriquer des poissons que du papier toilette ou des voitures. C’est ainsi que son livre rejoint la longue tradition de récits sur le monde du travail. Cependant, alors que la révolte des gilets jaunes aurait pu attirer de nouveau l’attention sur l’usine, c’est la centralité du rond-point qui l’a emporté. Les usines restent des univers plus ou moins clandestins où les sociologues et les journalistes ont de plus en plus de mal à y accéder. Et pourtant, tout vient de là : il faut bien que des hommes et des femmes produisent jour et nuit, souvent les samedis et les dimanches, tout ce qui est consommé. Il faut bien que quelqu’un « fabrique » du poisson, des bulots, des crabes ou de la viande de bœuf pour que les autres vivent. Heureusement aussi que quelqu’un est là pour décrire ces lieux, y compris avec de la poésie.
[1] Robert Linhart, L’Établi, Minuit, 1981, p. 60.
[2] Satoshi Kamata, Toyota, l’usine du désespoir, Démopolis, 2008.
[3] Günter Wallraff, Tête de turc, La Découverte, 1986.
[4] Florence Aubenas, Le Quai de Ouistreham, Éditions de l’Olivier, 2010.
[5] Georges Navel, Travaux, Folio, 1979.
[6] Marcel Durand, Grain de sable sous le capot. Résistance & contre-culture ouvrière : les chaînes de montage de Peugeot (1972-2003), Agone, 2006.
[7] Michel Ragon, Histoire de la littérature prolétarienne en France, Albin Michel, 1974.
[8] Thierry Pillon, Le corps à l’ouvrage, Stock, 2012.
[9] Éliane Le Port, 2017, Écrire sa vie, devenir auteur. Le témoignage ouvrier depuis 1945, Thèse de doctorat, Université dÉvry-Val-d’Essonne.
[10] Xavier Vigna, L’Espoir et l’effroi. Luttes d’écritures et luttes de classes en France au XXe siècle, La Découverte, 2017.
[11] Corinne Grenouillet, Usines en textes, écritures au travail. Témoigner du travail au tournant du XXIe siècle, Garnier, 2015.
[12] François Bon, Sortie d’usine, Minuit, 1982.
[13] Henri Rollin, Militant chez Simca-Chrysler, Éditions Sociales, 1977.
[14] Daniel Martinez, Carnets d’un intérimaire, Agone, 2003.
[15] Silien Larios, L’usine des cadavres ou la fin d’une usine automobile du nord de Paris, Éditions Libertaires, 2013.
[16] Jean Pierre Levaray, Tranches de chagrin, Éditions de l’Insomniaque, 2006.
[17] Jean Pierre Levaray, Putain d’usine, Agone, 2005.
[18] Jean Pierre Levaray, Je vous écris de l’usine, Éditions Libertalia, 2016.
[19] Olivier Schwartz, La notion de « classes populaires », habilitation à diriger des recherches, université de Saint-Quentin en Yvelines, 1998.
[20] Sévérin Muller, À l’abattoir. Travail et relations professionnelles face au risque sanitaire, MSH, 2008.
[21] Sylvie Célérier, « Des travailleurs suspects. Tâcherons dans les abattoirs de volaille », Communications, n° 89, 2011, p. 41-55.