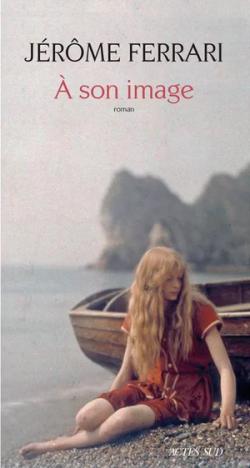
À propos de : Jérôme Ferrari, À son image, Actes Sud, 2019, 222 p, 19 euros.
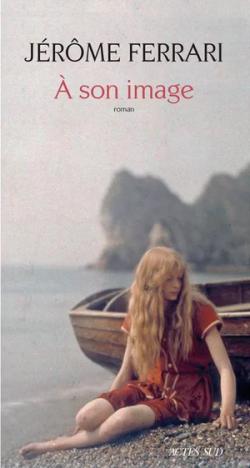
La littérature contemporaine est souvent taxée de nombrilisme. Tournée vers son auteur, son autrice ou sur elle-même plutôt que vers son lectorat, elle aurait remplacé les évènements du monde par les micro-évènements d’un « je » de plus en plus restreint à un petit milieu. Cette critique n’est pas dénuée de toute pertinence. Cependant, les écrits contemporains sont pluriels. Loin des récits autocentrés ou cyniques qui se complaisent dans une lucidité sans débouchés nous voudrions, dans cette chronique, mettre en valeur d’autres littératures : celles qui ne renoncent pas à dire le monde, ses luttes, ses échecs et ses espoirs.
***
Dès les premières pages, l’héroïne, Antonia, meurt. À peine l’avons-nous vue prendre sans conviction des photographies de mariage, retrouver un ancien légionnaire, Dragan, qu’elle meurt sur les routes de Corse, alors qu’elle retournait voir sa famille. La photographie et la mort : les deux thèmes principaux d’À son image, que nous allons retrouver dans chacun des douze chapitres, sont brutalement exposés.
Unis par les moments rituels du thrène, chaque chapitre commence par la légende d’une image ; chaque chapitre parle de violence, celle de mouvements indépendantistes corses, de la prison, de la guerre. Antonia prend forme à travers les douze moments de la messe, célébrée par son parrain (celui-là même qui lui avait offert un appareil photo et encouragé sa vocation) et à travers douze photographies jamais représentées dans le livre, mais minutieusement décrites, qu’il s’agisse de photographies fictives (celles d’Antonia) ou de photographies réelles (de photographes célèbres).
Cette structure croisée qui mêle les voix et les regards des proches d’Antonia et les histoires, intimes et célèbres, de ces photographies, pose sans cesse la question de la représentation. Antonia « en quête de profondeur » cherche à se rapprocher de l’image qui a du sens, celle qui changera le monde. Mais l’impression de tricher ne la lâche pas, que ce soit lorsqu’elle essaie de sublimer son quotidien ou qu’elle se plie aux exigences de son journal local qui lui réclame systématiquement les photos les plus banales possibles, ou encore qu’elle se retrouve à couvrir les actions et prises de parole de ces mouvements indépendantistes qui, trop proches de son quotidien, lui paraissent désespérément superficiels à côté de la chute du mur de Berlin ou de la guerre en Irak.
La guerre en ex-Yougoslavie ne fera que perdre davantage la jeune femme, qui ne développera aucune des images prises là-bas et se contentera, à son retour, de faire des photos « inoffensives et insignifiantes qu’il n’importe ni de cacher ni de montrer ». « Il y a tant de façons de se montrer obscène », écrit-elle à son parrain.
Ce risque permanent de l’obscénité d’une représentation inutile taraude Antonia, mais aussi toutes les figures de célèbres photographes évoqués dans le livre : Kevin Carter, auteur de la célèbre image « La fillette et le vautour » accusé d’être lui-même un prédateur pire que le vautour prêt à se jeter sur l’enfant famélique, Gaston Chéreau, qui couvrit la guerre italo-turque à Tripoli en 1911 et photographia les victimes des jugements des tribunaux militaires italiens, et bien d’autres encore. C’est la même angoisse qui tenaille le parrain d’Antonia lorsqu’il doit célébrer la messe funèbre et ne sait pas s’il peut trouver les mots pour évoquer sa filleule chérie, celle qui ne croyait plus en Dieu après avoir vu les horreurs de la guerre.
À son image. Le texte joue sur le double sens du titre : l’intertexte biblique (comment Dieu peut-il avoir fait l’être humain à son image, quand cet être humain est capable des pires atrocités ?) résonne comme un écho tragique des interrogations d’Antonia, celle qui cherche désespérément un sens mais redoute tout aussi désespérément de « produire une image mensongère, suggérant une profondeur saturée d’un sens qui, en fait, n’existe pas ».
Alors, roman du désespoir, de l’inutilité de la représentation ? Non, car si le texte ne prétend pas dire comment éviter l’obscénité de la représentation, il ne renonce pas à la représentation. Et il suggère même qu’Antonia a tort quand elle voit toujours le sens ailleurs, quand elle regrette d’être née « au mauvais endroit et au mauvais moment », lorsqu’elle ne sait pas discerner le sens historique, l’intérêt humain, le mystère des déchirements des mouvements nationalistes corses.
Le texte de Jérôme Ferrari est ambitieux. Mais la hauteur des sujets abordés (le sens de la vie, de la mort, de l’engagement politique, la question du mal) qui ont fait la réputation d’écrivain-philosophe de l’auteur (qui est par ailleurs professeur de philosophie) ne devient jamais exagérément emphatique. À son image conserve une simplicité et une pudeur qui dessinent le beau personnage d’Antonia, celle qui ne cesse de lutter pour sa liberté, de femme, de photographe, d’être humain.
Alors que Le Sermon sur la chute de Rome (œuvre pour laquelle Ferrari a reçu le prix Goncourt) racontait l’histoire de la déréliction de l’être humain, À son image, malgré sa brutalité, malgré son exigence, a quelque chose d’une réconciliation. Antonia ne verra jamais sa dernière photographie, mais l’image, décrite dans le texte, demeure.