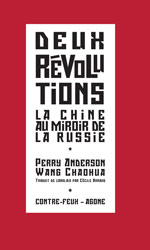
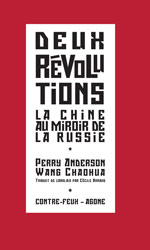
Perry Anderson et Wang Chaohau, Deux révolutions. La Chine au miroir de la Russie, Marseille, Agone, « Contre-feux », 208 pages.
Au moment de franchir le seuil des réformes, l’URSS semblait présenter des conditions matérielles et culturelles bien plus favorables que la Chine. Son produit intérieur brut (PIB) était quatre ou cinq fois supérieur. Sa base industrielle, beaucoup plus large, employait proportionnellement deux fois plus de main-d’œuvre. Elle était mieux pourvue en ressources naturelles (combustibles fossiles, minerais précieux, terre) et beaucoup plus urbanisée. Sa population, mieux nourrie, disposait d’un apport calorique moyen moitié plus important que la population chinoise. Ses infrastructures étaient beaucoup plus développées. Enfin, l’enseignement y était de bien meilleure qualité : l’alphabétisation était complète, le nombre d’étudiants vingt fois supérieur en données relatives, et le pays possédait un large vivier de scientifiques bien formés.
Cependant, la « période de stagnation » avait progressivement neutralisé et, à certains égards, détruit ces atouts. Pendant vingt ans, aucun changement politique n’était venu troubler la surface morte de la vie soviétique. La planification centrale, portée à un extrême caricatural – fixant le prix de 60 000 produits – étouffa l’innovation et favorisa toutes sortes d’aberrations. La productivité du travail stagnait ; les ratios capital-production se dégradaient ; les équipements obsolètes n’étaient pas remplacés ; le pays passa à côté des nouvelles technologies de l’information. Et pendant que les performances économiques déclinaient, la pression de la course à l’armement s’intensifiait. Enfermé dans une rivalité stratégique avec les États-Unis, une société beaucoup plus riche et plus avancée, le pouvoir soviétique consacra une part écrasante du PIB aux dépenses militaires, sans que cela profite, ou à peine, au reste de l’économie, et sans parvenir à rester au niveau de l’arsenal américain. Les protectorats établis en Europe de l’Est et en Afghanistan, nécessitant subventions et forces expéditionnaires, représentaient un fardeau supplémentaire.
Pour l’URSS, la guerre froide ne fut pas seulement une impasse diplomatique, elle figea aussi les ressorts de la croissance. Quand l’heure de la réforme finit par arriver, le plus grand déficit dans ce système bloqué n’était pourtant pas économique mais politique. Depuis la Révolution, quatre générations s’étaient succédé dans le parti au pouvoir. L’esprit insurrectionnel du bolchévisme s’était éteint depuis longtemps. Le dynamisme brutal de la sturmovshchina dans l’industrie et la guerre appartenait au passé1. Même le souvenir de Khrouchtchev et de ses tentatives tapageuses autant que brèves de combiner les deux s’était effacé. La masse apathique du PCUS, c’est-à-dire la nomenklatura soviétique proprement dite, était constituée pour l’essentiel de fonctionnaires médiocres, incapables d’imagination ou d’initiatives. Seule l’émergence de Gorbatchev à sa tête laisse à penser qu’elle n’était pas complètement catatonique. Une fois installé au poste de secrétaire général, il se débarrassa sans attendre de la couche supérieure des permanents de l’ère brejnévienne, consolidant son pouvoir au sein du Parti avec une majorité choisie par lui au Politburo. Puis il proclama ses deux mots d’ordre : « glasnost » et « perestroïka » – la nécessité d’une plus grande ouverture de la vie publique et une transformation des institutions du pays.
La première, qui vit un grand assouplissement de la censure, fut accueillie par une vague d’enthousiasme dans la société, et des énergies longtemps réprimées se libérèrent sous forme de discussions, de prises de position et de débats iconoclastes. La seconde suscita davantage de perplexité. Que signifiait, en pratique, la perestroïka – un terme utilisé une fois, brièvement, par Lénine ? Il devint vite manifeste que Gorbatchev, courageux dans ses intentions, n’avait que des idées vagues : bien qu’il soit moralement éloigné du PCUS de Brejnev dans lequel il avait fait sa carrière, il en restait intellectuellement très dépendant et n’avait qu’une vision floue des réformes qu’il envisageait. La plupart de ceux qu’il avait nommés au sommet du Parti avaient encore moins d’idées, et nombre d’entre eux ne tardèrent pas à lui résister. Afin de contourner leur opposition, il chercha de plus en plus auprès d’un groupe alternatif une légitimation et une direction à suivre.
L’intelligentsia russe était depuis longtemps coupée du pouvoir. La brillante culture d’avant-garde formée par ceux qui n’étaient pas partis en exil après la Révolution avait été enterrée par Staline. Les espoirs soulevés par le « dégel », après la mort de ce dernier, avaient vite été réduits à néant, avant même la chute de Khrouchtchev, par le caractère fruste et philistin du nouveau régime. Au milieu des années 1980, le communisme, sous n’importe quelle forme, était honni par tous les courants de cette strate historiquement influente de la société russe. Les slavophiles autant que les Occidentaux, ses deux pôles traditionnels, se rejoignaient dans le rejet de l’ordre soviétique. Les premiers, et ce, malgré la célébrité de Soljenitsyne, étaient résiduels ; les seconds, hégémoniques. Libéraux, convaincus de la supériorité de l’Occident et aspirant à en faire partie, ils donnèrent bientôt le ton dans l’entourage de Gorbatchev, lui fournissant plus d’idées et d’objectifs précis qu’il n’en avait développés lui-même. Pour eux, une vraie réforme ne pouvait vouloir dire que deux choses étroitement liées : l’introduction de la démocratie, avec des élections libres, et la mise en œuvre d’une économie de marché, basée sur la propriété privée des moyens de production.
En tant que secrétaire général du PCUS, Gorbatchev n’était pas en position de reprendre à son compte ce second objectif – même s’il l’avait voulu, ce qui n’était pas le cas. Mais il endossa le premier, sous réserve que les formes de la démocratisation lui permettent de renforcer son propre pouvoir. Il comptait s’appuyer sur la consultation du peuple pour se libérer de la dépendance vis-à-vis d’un parti dont il se méfiait de plus en plus, tout comme ce dernier se méfiait de lui. La réforme politique, visant à instaurer une démocratie représentative pour la première fois dans l’histoire russe, devint la priorité. La réforme économique, signification originelle de la perestroïka, fut ajournée. Tel était l’ordre de bataille préconisé par l’intelligentsia libérale, qui devait briser le monopole communiste sur le pouvoir avant de s’attaquer aux fondements de l’économie planifiée. Pour Gorbatchev, cependant, ce programme possédait un autre attrait. Démanteler la censure et autoriser des élections libres était en effet relativement facile : il s’agissait essentiellement de lever des interdictions. La réorganisation de l’économie allait être beaucoup plus compliquée – une tâche gigantesque en comparaison. Il opta pour le chemin le moins ardu.
Puisque la démocratie à l’occidentale devait être adoptée à l’intérieur, pourquoi la combattre à l’étranger ? Mettre un terme à la guerre froide pouvait lui gagner non seulement les applaudissements d’une intelligentsia qui, désormais bien implantée dans les médias, était devenue la principale faiseuse d’opinions dans la société, mais aussi de réels bénéfices économiques, en réduisant le poids des dépenses militaires. Plus encore, le prestige international d’un dirigeant s’affichant dans les meilleurs termes avec ses homologues occidentaux, en particulier avec le président des États-Unis, et apportant la paix et la concorde aux nations du monde, ne pouvait que rehausser son image dans le pays. À partir de 1987, Gorbatchev se consacra de plus en plus à ses voyages et causeries à l’étranger, devenant la coqueluche des opinions occidentales. Manifestement grisé par sa propre image sur la scène internationale, il avait de moins en moins de temps à perdre avec la tâche ingrate de contrôler l’économie intérieure.
Après l’échec de maladroits projets visant à promouvoir des coopératives, divers expédients incohérents furent envisagés pour introduire une plus grande autonomie des entreprises, sans résultats ou presque, au moment où une crise sociale massive frappait l’URSS, conséquence directe de la priorité donnée à la réanimation politique plutôt qu’économique du pays. La croissance était quasiment nulle quand Gorbatchev arriva au pouvoir, et le prix du pétrole, dont dépendaient les rentrées en devises, commençait déjà à baisser, créant une tension sur le budget, qui s’intensifia à mesure que les revenus pétroliers continuaient de décroître. Ce qui aurait créé une situation difficile en toutes circonstances déboucha sur une chute libre catastrophique à cause de la marginalisation du PCUS opérée par Gorbatchev dans sa quête de consécration populaire. L’économie planifiée reposait en effet sur la capacité du Parti à faire en sorte que les entreprises effectuent les livraisons exigées par le centre. Or, une fois le Parti dépouillé du pouvoir effectif, sans substitut cohérent, les dirigeants d’entreprises cessèrent simplement de fournir à l’État leur production aux prix prescrits, préférant les vendre au prix qu’ils pouvaient à qui ils pouvaient. D’où un effondrement du mécanisme central d’affectation qui maintenait l’intégrité du système. On se rapprochait de plus en plus du point de rupture des échanges économiques, tout particulièrement dans le commerce entre les républiques soviétiques.
Alors que l’économie s’enfonçait dans le chaos, l’État avait de plus en plus de mal à collecter l’impôt auprès des entreprises et des républiques, et recourut à l’impression de monnaie pour couvrir les subventions alimentaires et les dépenses sociales. À la spirale inflationniste s’ajouta une aggravation du déficit de la balance des paiements – au moment où le gouvernement tentait de lutter contre l’impopularité avec des importations de biens de consommation – et une dette extérieure galopante, qui doubla presque en cinq ans. En 1989, l’État soviétique frôlait la faillite. Pis encore, il était au bord de la désintégration – pour la même raison.
Une fois que Gorbatchev eut retiré du système le pivot qu’était le Parti, se positionnant comme unique dirigeant en dehors et au-dessus de lui, plus rien ne maintenait les républiques ensemble2. Sans le corset du PCUS, l’URSS manquait de ligaments reliant les différentes parties de l’Union. Immergé jusqu’à la fin dans son rôle de fossoyeur de la guerre froide et de libérateur de l’Europe de l’Est, Gorbatchev se révéla plus aveugle encore à la question nationale dans son propre pays qu’à sa dramatique situation économique. Lorsque ce qui restait du vieux régime se révolta contre lui en 1991 et l’entraîna dans sa chute, l’URSS se désintégra sur-le-champ.
Quand, sept ans avant le PCUS, le PCC s’engagea sur la voie des réformes, la Chine était un pays beaucoup plus pauvre et arriéré que ne l’était la Russie3On trouvera les comparaisons pertinentes dans l’ouvrage incontournable de Peter Nolan, China’s Rise, Russia’s Fall : Politics, Economics and Planning in the Transition from Stalinism (Palgrave, 1995, p. 110-159), qui contient aussi l’une des analyses critiques de la perestroïka les plus percutantes et à ce jour des meilleures (p. 230-301). En comparaison, on lira les réflexions teintées de regret sur son échec à « déclencher une révolution capitaliste » dans Minxin Pei, From Reform to Revolution : The Demise of Communism in China and the Soviet Union (Harvard UP, Cambridge, MA, 1994, p. 118-142).[/fn]. Autour de 1980, le PIB par habitant de la RPC était quatorze fois inférieur à celui de l’URSS. Plus de 70 % de sa main-d’œuvre travaillait dans l’agriculture, contre 14 % en Union soviétique. Presque un tiers des Chinois ne savaient toujours pas lire et écrire. Les universités y étaient beaucoup moins nombreuses même qu’en Inde. On peut affirmer qu’aucun observateur, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, n’aurait pu prédire que, trente ans plus tard, la situation des deux sociétés serait inversée. Pourtant, dès le début, la Chine était exempte de certains handicaps dont souffrait la Russie soviétique : une série d’avantages négatifs qui lui fit profiter de conditions initiales (économiques, sociales et politiques) paradoxalement plus favorables.
Sur le plan économique, elle n’avait pas tant d’équipements obsolètes, non que le capital fixe y fût plus avancé qu’en URSS, mais simplement en raison d’une moindre industrialisation. Certes, ce qui allait devenir la rust belt chinoise n’était pas négligeable – comme se le rappelle quiconque a vu la trilogie de Wang Bing, À l’Ouest des rails, peut-être le plus grand documentaire de tous les temps, sur le sort du district industriel de Shenyang et de ses ouvriers. Mais, en termes relatifs, elle était plus petite que celle de l’URSS. Il y avait moins d’usines bonnes pour la casse. De manière plus significative encore, la planification chinoise avait toujours été plus souple que son pendant soviétique. Mao avait tôt admis l’impossibilité d’imposer des directives omniprésentes comme celles du Gosplan à une économie beaucoup moins articulée, possédant des traditions régionales beaucoup plus ancrées et des infrastructures beaucoup moins développées. Dès l’origine, les autorités provinciales et municipales disposèrent d’une autonomie bien plus grande que dans le système soviétique à n’importe quel moment de son histoire. La Révolution culturelle affaiblit encore davantage, et délibérément, les pouvoirs du centre, laissant aux gouvernements locaux une plus grande marge d’initiative. De sorte que les objectifs de production pour l’industrie étaient assez modestes, et la pression pour les remplir n’était pas écrasante. D’où un système beaucoup plus décentralisé, dans lequel le nombre de produits encadrés dont les prix étaient fixés par Pékin ne dépassa jamais six cents, soit un centième de la pléthore soviétique4. Ce cadre institutionnel moins contraignant permettait davantage de flexibilité et des changements plus en douceur.
D’un point de vue social, la Chine disposait aussi d’un avantage énorme et décisif par rapport à l’URSS. Sa paysannerie n’avait rien d’une classe apathique, triste vestige de ce qu’elle avait autrefois été. Ni éreintée ni hostile, elle était au contraire pleine d’une énergie qui ne demandait qu’à se libérer, comme le prouvèrent les événements. Historiquement, elle n’avait jamais eu d’institutions collectives comparables aux communautés traditionnelles du mir russe. La société rurale, depuis longtemps fragmentée dans le Nord et atomisée par la révolte des Taiping au Sud, put se rétablir après le Grand Bond en avant grâce à des siècles de réflexes marchands derrière elle. Non seulement la paysannerie chinoise n’avait pas subi de profonde aliénation, mais elle constituait l’écrasante majorité de la population du pays et formait la principale base de la nation. Son plus proche équivalent en URSS aurait été la classe ouvrière, qui ne représentait pourtant pas une partie aussi importante de la société. Mais si, à l’orée des années 1980, les ouvriers soviétiques n’étaient pas aussi démoralisés que les kolkhozniki, ils constituaient une force sociale complètement désabusée, profondément cynique à l’égard du régime, habituée aux emplois inutiles et à la faible productivité. Tout ceci en réaction contre le grand écart entre le rôle symbolique de la classe ouvrière en tant que classe dominante dans l’État et sa position réelle dans la hiérarchie des privilèges. En Chine, où après le Grand Bond en avant la population rurale avait été interdite d’entrée dans les villes, et où elle n’avait jamais eu droit aux avantages sociaux dont profitaient les ouvriers des zones urbaines, les inégalités réelles entre ville et campagne étaient plus grandes qu’en Union soviétique. Mais l’idéologie dominante n’avait jamais affirmé aux paysans qu’ils étaient à l’avant-garde dans la construction du socialisme. Il n’y avait pas un tel gouffre entre la théorie et la réalité, et moins de temps écoulé entre l’espoir originel et l’expérience ultérieure. Malgré tout ce qui lui avait été infligé, et aussi accordé, la campagne demeurait une réserve pour le parti au pouvoir.
Sur le plan international, la situation de la Chine populaire lui donnait une plus grande liberté d’action. Elle n’avait pas la charge d’une zone satellite, coûteuse en soldats et en aides financières. Elle n’était pas en position de rivaliser avec les superpuissances dans la course aux missiles et n’essaya même pas. Libre de ces entraves, elle entretenait par ailleurs des relations totalement différentes avec les États-Unis. Après une décennie d’extrême tension avec l’URSS, allant jusqu’à des affrontements frontaliers, Mao avait privilégié une entente avec les États-Unis pendant la Révolution culturelle. La visite de Nixon, toute spectaculaire qu’elle fût, ne fut guère plus qu’une simple ouverture diplomatique du vivant du dirigeant chinois. Mais du moins la Chine put-elle profiter d’un environnement extérieur plus favorable quand vint le tournant des réformes. Au lieu d’une hostilité calculée, cette amitié circonspecte suffisait pour qu’au moindre signe d’ouverture vers le marché les quartiers généraux du capital mondial et leurs diverses filiales régionales soient prêts à offrir leurs services. Pour la première fois dans son histoire moderne, le pays ne connaissait ni aliénation de la paysannerie ni menace impérialiste directe de l’étranger.
Enfin, contrairement à l’URSS, la RPC ne courait aucun danger de désintégration. Elle n’était pas composée de quinze républiques distinctes. Plus homogène sur le plan ethnique que la plupart des États-nations, elle avait dû faire face à des nationalités rebelles (tibétaine et ouïgoure) à l’intérieur de ses frontières, ce que n’avait pas fait l’URSS depuis un demi-siècle, mais leur poids dans la population globale était minime comparé à la somme des peuples qui allaient faire éclater l’URSS dix ans plus tard. La priorité de la RPC n’était pas de garder le contrôle sur ces régions mais bien de récupérer Taïwan, où le Kuomintang avait bâti une forteresse insulaire sous protection américaine, qui se revendiquait encore comme la véritable République de Chine et connaissait désormais un fort développement économique. Le Parti s’inquiétait beaucoup moins de risques de dissolution que de problèmes de reconquête.
Nos contenus sont sous licence Creative Commons, libres de diffusion, et Copyleft. Toute parution peut donc être librement reprise et partagée à des fins non commerciales, à la condition de ne pas la modifier et de mentionner auteur·e(s) et URL d’origine activée.
références
| ⇧1 | Littéralement « production par assauts », la « sturmovshchina », propre à l’ère stalinienne, était caractérisée par des objectifs perpétuellement changeants, toujours plus élevés et extravagants. [nde] |
|---|---|
| ⇧2 | À propos du démantèlement du Parti, lire Stephen Kotkin, Armageddon Averted : The Soviet Collapse 1970-2000, Oxford UP, Oxford, 2001, p. 76-81 ; sur le chaos monétaire, l’expansion du troc et l’intensification du vol des biens publics lors de l’échec de la perestroïka, David Woodruff, Money Unmade : Barter and the Fate of Russian Capitalism, Cornell UP, Ithaca, 1999, p. 56-78, et Andrew Barnes, Owning Russia : The Struggle over Factories, Farms and Power, Cornell UP, Ithaca, 2006, p. 43-67. |
| ⇧3 | On trouvera les comparaisons pertinentes dans l’ouvrage incontournable de Peter Nolan, China’s Rise, Russia’s Fall : Politics, Economics and Planning in the Transition from Stalinism (Palgrave, 1995, p. 110-159), qui contient aussi l’une des analyses critiques de la perestroïka les plus percutantes et à ce jour des meilleures (p. 230-301). En comparaison, on lira les réflexions teintées de regret sur son échec à « déclencher une révolution capitaliste » dans Minxin Pei, From Reform to Revolution : The Demise of Communism in China and the Soviet Union (Harvard UP, Cambridge, MA, 1994, p. 118-142). |
| ⇧4 | Barry Naughton, Growing out of the Plan : Chinese Economic Reform, 1978-1993, Cambridge UP, Cambridge, 1995, p. 41-42. |