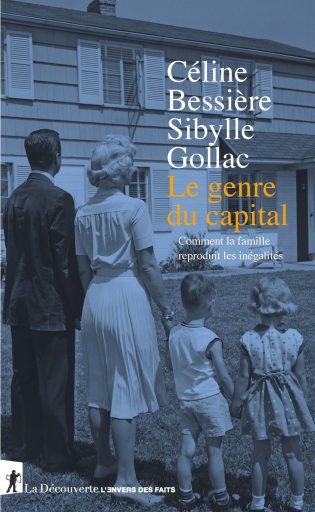
Céline Bessière et Sibylle Gollac, Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités, Paris, La Découverte, collection « L’envers des faits », 2020, 21 euros.
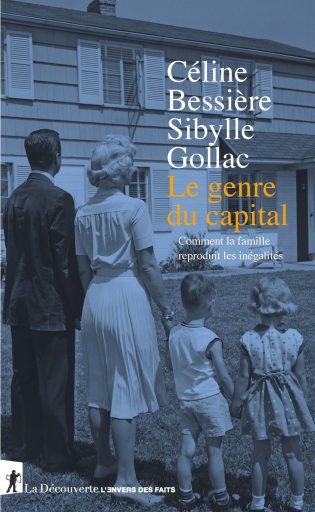
Sociologues et assumant une approche féministe, Céline Bessière et Sibylle Gollac « étudient depuis 20 ans [les] arrangements économiques dans des familles ordinaires de la France contemporaine, depuis les plus modestes jusqu’aux plus fortunés. » Dans Le genre du capital, publié aux éditions La Découverte, elles reviennent sur la manière dont la société de classe se reproduit grâce à l’appropriation masculine du capital.
Pour cela, elles s’appuient sur des monographies de famille, l’exploitation de données statistiques issues des enquêtes patrimoine de l’INSEE ainsi que sur des matériaux recueillis auprès d’avocat·e·s, de notaires mais aussi dans les tribunaux à l’occasion de l’enquête collective qui a donné lieu à l’ouvrage Au tribunal des couples[1].
***
Elle s’appelle Ingrid. Son nom, répandu en Normandie, signifie le vassal d’un seigneur lui-même vassal : Levavasseur. Ingrid est née en 1987 dans l’Eure, non loin des boucles de la Seine. Avec ses trois frères et sœurs, elle a été élevée par sa mère, une femme de ménage devenue par la suite auxiliaire de vie. Un père violent et alcoolique, régulièrement pris en charge par l’Armée du salut, aux abonnés absents. À seize ans, Ingrid quitte le foyer maternel, sans diplôme. Elle enchaîne des petits boulots de serveuse, caissière, opératrice de téléphonie, et se marie. Deux enfants naissent. Un an après la naissance du second, elle divorce. Ingrid a alors vingt- quatre ans. Tout en étant sapeur-pompier dans un centre de secours la nuit, elle suit une formation d’aide-soignante. Ingrid occupe cet emploi, d’abord comme contractuelle de la fonction publique puis dans une clinique privée à Rouen. Elle a renoncé à devenir infirmière, car elle n’avait pas les moyens de payer la formation. En 2018, elle gagne 1 250 euros par mois, touche 95 euros d’allocations logement et 200 euros de pension alimentaire, en tout, pour ses deux enfants âgés de huit et treize ans dont elle a la garde. Elle vit dans une petite maison en location à Pont-de-l’Arche et doit mettre ses enfants à la garderie pour aller travailler à Rouen, à vingt kilomètres de là. Ses vacances se résument à trois jours par an en camping au Mont-Saint-Michel, elle a du mal à acheter des baskets à ses enfants et à remplir le frigo chaque mois. Ingrid a supprimé toutes les dépenses pour elle-même : pas de coiffeur, pas de sport, pas de resto. De toute façon, elle n’a guère de temps, seulement un week-end sur deux, quand ses enfants sont chez leur père.
Ingrid Levavasseur est devenue à l’automne 2018 une figure nationale du mouvement des Gilets jaunes. Avec sa chevelure rousse immédiatement reconnaissable et ses traits à la Botticelli, elle a donné un visage dans les médias à ce que les données statistiques décrivaient depuis longtemps : la pauvreté des femmes qui sont à la tête de familles monoparentales. Ingrid Levavasseur en fait même une cause politique, puisque au printemps 2019 elle annonce la création d’un réseau d’accueil, proposant logement, garde d’enfants et activités pour les femmes élevant seules leur progéniture.
Le mouvement des Gilets jaunes a mis sur le devant de la scène des inconnues de classes populaires qu’on ne voyait jamais dans les médias auparavant. La présence de nombreuses femmes est remarquée, que ce soit sur les ronds- points ou dans les manifestations. Nombre d’entre elles sont séparées, élèvent seules leurs enfants et connaissent des fins de mois difficiles. Devant les micros, elles parlent des pensions alimentaires impayées, des longues démarches imposées par les caisses d’allocations familiales pour percevoir des aides sociales limitées. Elles racontent comment elles jonglent avec les factures au jour le jour, en plaçant les besoins de leurs enfants avant les leurs. D’autres sont en couple, tiennent les comptes, sont en charge des courses et des factures. Elles parlent du chômage, du temps partiel, de ce que signifie faire des heures à droite et à gauche pour un salaire réduit. D’autres encore ont quitté le salariat pour devenir autoentrepreneuses, sans que les revenus soient au rendez-vous. Enfin, il y a des femmes retraitées, parfois veuves, qui touchent de maigres pensions, insuffisantes pour vivre. Dans les classes populaires, les problèmes d’argent sont des problèmes de femmes.
Elle s’appelle MacKenzie. Elle est née en 1970 à San Francisco, en Californie, dans une famille fortunée : un père gestionnaire de patrimoine et une mère au foyer. Elle est diplômée de l’université de Princeton où elle a suivi les cours de littérature de Toni Morrison en vue de devenir romancière. Au début des années 1990, elle travaille dans le fonds d’investissement D. E. Shaw & Co à New York, un « job alimentaire » pour pouvoir écrire, explique-t-elle. Elle y rencontre son futur mari, Jeff Bezos un informaticien de formation, lui aussi diplômé de Princeton, devenu vice-président senior du hedge fund. C’est lui qui l’a embauchée, et il occupe le bureau qui jouxte le sien. En 1993, ils se marient, elle a vingt-trois ans, et lui trente. L’année suivante, le couple déménage sur la côte Ouest, dans une petite maison louée dans la banlieue de Seattle. C’est au cours du voyage en voiture coast-to‑coast, alors que MacKenzie est au volant et Jeff sur le siège passager, que le business plan d’une nouvelle entreprise, qui consiste à vendre des livres par correspondance sur Internet, est mis sur le papier. L’entreprise est créée l’année suivante par son mari, sous le nom d’Amazon. Dans les débuts de l’entreprise, MacKenzie est très impliquée : elle assure la comptabilité, participe aux premières embauches et décisions stratégiques, et met la main à la pâte en envoyant les premiers colis par UPS. « J’ai travaillé avec lui et beaucoup d’autres dans le garage reconverti, dans l’entrepôt en sous-sol, dans les bureaux à l’odeur de barbecue ou dans les centres de distribution en ébullition avant Noël », déclare-t-elle quelques années plus tard, quand l’entreprise est devenue le groupe numéro un mondial de la vente en ligne. En 1999 naît le premier enfant du couple, qui sera suivi de trois autres. MacKenzie et Jeff déménagent dans une maison d’une valeur de 10 millions de dollars. MacKenzie s’éloigne de l’entreprise. Elle met aussi entre parenthèses son ambition de romancière, pour s’occuper des quatre enfants. Elle dit qu’elle aurait pu recourir à des nounous mais qu’elle préfère s’occuper des enfants elle-même, allant jusqu’à faire l’école à la maison à certaines périodes. C’est en 2005 que paraît son premier roman sur lequel elle a travaillé en pointillé pendant dix ans ; un second suit en 2013. MacKenzie reçoit un accueil critique favorable, mais les ventes restent modestes, quelques milliers de copies seulement (des libraires refusent de vendre le livre, parce que l’entreprise dirigée par son époux les affaiblit considérablement). Après vingt-cinq ans de mariage, le 9 janvier 2019, MacKenzie et Jeff Bezos annoncent leur divorce sur Twitter par un message commun : « Nous voulons faire connaître aux gens ce changement dans nos vies. […] Nous avons décidé de divorcer et de poursuivre nos vies comme amis […]. Nous avons eu une vie tellement belle ensemble, comme couple marié, et nous envisageons encore un futur merveilleux, en tant que parents, amis, partenaires dans des entreprises ou dans nos projets, et en tant qu’individus en quête d’aventures. » Ce message qui met en scène un divorce apaisé et réussi n’est pas destiné à leurs proches, mais plutôt aux marchés financiers, investisseurs et actionnaires. C’est l’avenir de la plus grande fortune mondiale qui est en jeu : un patrimoine commun estimé à plus de 130 milliards de dollars, qui comprend notamment une grosse part du capital d’Amazon (16 % des actions). Dans l’État de Washington, où le couple réside et a fait fortune, le droit du divorce stipule que tous les biens acquis pendant la durée du mariage doivent être divisés en deux parts égales. C’est le même principe que celui du régime matrimonial légal qui s’applique par défaut en France, la « communauté de biens réduite aux acquêts ». Des centaines d’articles de journaux, partout dans le monde, s’inquiètent du devenir de la fortune des Bezos, en grande partie constituée d’entreprises : Amazon, mais aussi la société spatiale Blue Origin ou encore le quotidien The Washington Post. 8 % des parts d’Amazon risquent de tomber entre les mains d’une femme, faisant peut-être perdre le contrôle de l’entreprise à Jeff Bezos, et toute la finance mondiale tremble. Trois mois plus tard, les détails du divorce sont révélés par le couple, à nouveau sur Twitter. « Je suis reconnaissante d’avoir terminé le processus de divorce avec Jeff, en se soutenant l’un et l’autre, et avec la gentillesse de tous […]. Heureuse de lui donner tous mes intérêts dans The Washington Post et Blue Origin, ainsi que 75 % des actions d’Amazon et mes droits de vote, pour soutenir son action, ainsi que celle des équipes de ces formidables entreprises », écrit MacKenzie. Jeff Bezos reste donc le premier actionnaire d’Amazon et en conserve le contrôle. Il est toujours l’homme le plus riche du monde. Chez les riches, a fortiori les ultra- riches, le capital reste une affaire d’hommes.
Un océan et des milliards de devises séparent les vies d’Ingrid Levavasseur et de MacKenzie Bezos. Le patrimoine de la première se limite sans doute à sa voiture, peut-être un peu d’économies, sans doute guère plus de quelques milliers d’euros. MacKenzie Bezos sort de son divorce avec plus de 35 milliards de dollars. Comme l’a révélé au grand public l’ouvrage de Thomas Piketty Le Capital au XXIe siècle, l’inégalité patrimoniale est une caractéristique centrale du capitalisme contemporain. Beaucoup plus prononcée que l’inégalité des revenus, elle décrit mieux que cette dernière le gouffre croissant entre le monde de MacKenzie Bezos et celui d’Ingrid Levavasseur. D’après le World Inequality Report de 2018, parmi l’ensemble des habitant·es de l’Europe, des États-Unis et de la Chine, les 1 % les plus riches détiennent un tiers du patrimoine total, les 10 % les plus riches disposent de 70 % du patrimoine total, tandis que la moitié la plus pauvre de la population n’en possède que 2 %.
Au XXIe siècle, le capital économique familial est redevenu central dans la construction du statut social des individus. Ce capital économique est de plus en plus crucial pour se loger et accéder à la propriété immobilière, dans un contexte où cette dernière s’est répandue tout en demeurant socialement distinctive (notamment en fonction de l’adresse). Alors que la société salariale s’effrite, les appuis économiques familiaux peuvent aussi s’avérer déterminants pour se mettre à son compte, maintenir son activité économique, accéder au crédit ou obtenir des revenus complémentaires du patrimoine.
L’accumulation de capital scolaire dépend aussi de plus en plus de la mobilisation par la famille d’un capital économique, et les conditions matérielles de vie influencent dès le plus jeune âge la réussite scolaire. L’absence de richesse familiale contraint fortement les destinées scolaires et sociales des personnes diplômées.
En d’autres termes, la précarité économique dans laquelle vit Ingrid Levavasseur a des effets sur le devenir scolaire de ses enfants et réduit leurs chances de réussite sociale. Si par bonheur sa fille et son fils excellent à l’école et obtiennent un emploi avec un bon salaire, il leur faudra encore du temps pour commencer à accumuler du patrimoine : épargner après s’être éventuellement endettés pour leurs études, accéder à la propriété, peut-être se mettre à leur compte. Entre-temps, les enfants de MacKenzie Bezos auront vraisemblablement accédé aux meilleures écoles et universités. Ses trois fils et sa fille n’auront jamais à emprunter pour se loger, se lancer dans les affaires et faire de bons placements, quand bien même ils et elle auraient eu du mal à faire leurs preuves à l’université. Le mouvement des Gilets jaunes, tout comme la constitution d’un groupe d’« ultra-riches », rappelle l’importance du rôle du capital économique dans la structuration de notre société de classes. Mais, si pauvreté et richesse naissent des rapports de production, comme nous l’a appris Marx, elles ne se constituent pas uniquement dans la sphère marchande : c’est aussi dans la famille, dans les rapports de production domestique, que se jouent l’accumulation et la transmission des richesses, et donc le maintien des frontières entre les classes sociales. Christine Delphy a bien montré comment, dans les années 1960, le patrimoine familial s’est accumulé et transmis grâce à l’exploitation du travail gratuit des femmes, dont les droits sur ce patrimoine étaient extrêmement réduits : la hiérarchie sociale se reproduit aux dépens des femmes. Qu’en est-il aujourd’hui dans une société majoritairement salariée, dans laquelle les droits des époux et des épouses, et plus généralement des hommes et des femmes, se sont peu à peu égalisés ?
Tout oppose les destinées d’Ingrid Levavasseur et de MacKenzie Bezos. Et, pourtant, il y a quelques points communs entre les existences de ces deux femmes. Dans leur couple, elles se sont retrouvées en première ligne pour la prise en charge des enfants et la bonne tenue de l’économie domestique. Ainsi, elles ont dû faire des sacrifices sur le plan professionnel, en renonçant ou en remettant à plus tard des projets qui leur tenaient à cœur. Leur vie professionnelle est une succession hachée d’activités, davantage qu’une carrière construite. Toutes deux ont affronté l’épreuve d’un divorce, accompagnées par des professionnel·les du droit qui leur ont prodigué des conseils juridiques (au moins un·e avocat·e en ce qui concerne Ingrid, sans doute plusieurs pour MacKenzie). Pour ces femmes, la séparation conjugale a entraîné un appauvrissement par rapport à leur situation antérieure. La pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant perçue par Ingrid Levavasseur est loin de couvrir la moitié du coût de l’entretien et de l’éducation des enfants. Qui pourrait loger, nourrir, habiller, soigner et couvrir l’ensemble des frais d’un enfant avec 100 euros par mois en France aujourd’hui ? Quant à MacKenzie Bezos, propriétaire selon la loi de la moitié d’un patrimoine conjugal colossal, elle a dû renoncer au moment de son divorce à une partie de sa fortune au profit de son ex-mari.
Aux deux extrémités de l’échelle sociale, la situation de ces deux femmes soulève des questions fondamentales. Pourquoi les femmes sont-elles en première ligne pour affronter les problèmes d’argent dans les classes populaires, tandis qu’au fur et à mesure que l’on grimpe dans la hiérarchie sociale, le pouvoir économique est accaparé par les hommes ? Historiquement, des discriminations juridiques ont empêché les femmes d’accumuler de la richesse, partout dans le monde. Dans les sociétés occidentales, l’égalité en matière de droit du travail, de droit de la famille et de droit de propriété est une conquête des XIXe et XXe siècles qui paraît désormais acquise. Pourtant, en dépit de ce droit formellement égalitaire, les hommes continuent à accumuler davantage de richesses que les femmes.
À celles et ceux qui pensent que cette inégalité économique s’explique par le fait que les femmes gagnent moins que les hommes parce qu’elles travailleraient moins, il est utile de rappeler que les femmes ont toujours travaillé autant, voire plus que les hommes.
Ce qui caractérise le travail féminin depuis plus de deux siècles, dans de nombreux secteurs (à commencer par l’agriculture, mais aussi l’artisanat, le commerce ou l’industrie), c’est avant tout son invisibilisation et son absence de reconnaissance juridique et financière15. Le travail domestique, accompli principalement par les femmes dans le cadre familial, est l’archétype du travail gratuit et non reconnu en tant que tel. La production domestique n’est pas comptée dans les grands agrégats statistiques de la comptabilité nationale. La richesse nationale ne recense que les activités donnant lieu à la production de biens et de services destinés à l’échange marchand, ou fournis par les administrations publiques. On considère qu’une assistante maternelle qui s’occupe d’un enfant contribue à la richesse nationale, mais pas une mère qui réalise la même activité. Si la production domestique était comptabilisée, le produit intérieur brut (PIB) de la France aurait été en 2010 de 33 % supérieur, celui du Royaume-Uni de 63 % supérieur, celui de l’Allemagne de 43 % supérieur ; en 2014, celui des États-Unis aurait été de 23 % supérieur. Cette production domestique invisible et gratuite est largement assurée par les femmes. En France, en 2010, dans les couples avec enfants, les femmes travaillent en moyenne chaque semaine 54 heures, qui comprennent 34 heures de travail domestique non rémunéré et 20 heures d’activités professionnelles. Dans ces mêmes ménages, les hommes travaillent 51 heures, soit trois heures de moins par semaine : ils consacrent en moyenne 18 heures à des activités domestiques gratuites et 33 heures à leurs activités professionnelles. Au final, les femmes travaillent davantage mais sont beaucoup moins payées.
Ces données, établies par l’INSEE à partir de relevés d’activité des hommes et des femmes, ne rendent pas compte de l’émiettement du temps de travail des femmes, domestique mais aussi professionnel, interrompu en permanence parce qu’elles restent disponibles pour autrui. Les femmes portent en continu une charge mentale domestique, y compris pendant leurs heures de travail rémunéré[2]. Ce sont elles que les crèches et les écoles appellent en premier quand les enfants sont malades. Elles réalisent aussi souvent plusieurs tâches à la fois (faire le ménage tout en surveillant les enfants), qu’elles interrompent à tout instant en cas de besoin. Les activités des hommes, que ce soit leur travail professionnel ou domestique (bricolage, réparations, jardinage, voire cuisine), sont mieux délimitées dans le temps et dans l’espace. Dans les années 1980, François de Singly montre à partir de données statistiques que la disponibilité permanente des femmes pour les tâches domestiques freine leur carrière et bénéficie à celle de leur conjoint.
L’inégalité salariale est ainsi un condensé d’un grand nombre d’inégalités cumulées dans la famille et sur le marché du travail salarié, en haut comme en bas de la hiérarchie professionnelle. Les femmes sont concentrées dans des secteurs d’activité moins rémunérateurs, les professions de l’éducation, du soin et de l’aide à la personne notamment (l’emploi d’aide-soignante d’Ingrid Levavasseur est typique). Du fait de leurs charges de famille, elles occupent plus souvent des emplois à temps et à salaire partiels ; elles ont des carrières moins rapides et butent dans bon nombre de secteurs sur un plafond de verre qui les empêche d’occuper les positions les plus rémunératrices.
Aujourd’hui, les sociétés occidentales semblent avoir pris en charge la question de l’égalité de salaire entre hommes et femmes à coups de lois sur l’égalité professionnelle. Hélas, quand bien même les femmes seraient payées à travail égal salaire égal, tout ne serait pas résolu. Il existe une inégalité économique entre femmes et hommes qui sort des radars de la plupart des statistiques et des politiques et qui, pourtant, structure et condense le destin socio-économique des individus et se transmet d’une génération à l’autre.
Pour la mesurer, il faut s’intéresser non plus seulement aux revenus, mais aussi aux patrimoines. Au niveau individuel, ce qui est désigné par les termes de patrimoine, de richesse ou de capital (trois synonymes dans la littérature économique contemporaine) est tout ce que possède une personne à un moment donné : en pratique, cela peut être des terres, des biens immobiliers, des actifs financiers ou encore des entreprises. Le patrimoine est constitué d’actifs économiques dont l’acquisition permet de conserver de la valeur (autrement dit d’accumuler) et dont la réalisation (c’est-à-dire la vente) peut assurer des liquidités dans le futur[3]. Le patrimoine d’un individu n’est bien sûr pas indépendant de ses revenus, qui lui permettent d’épargner ou encore d’acquérir une partie des biens qui constituent son patrimoine (acheter une voiture ou un appartement) ; mais il dépend aussi des richesses qui se produisent, s’échangent et se transmettent dans le cadre familial, sans passer par le marché.
L’exploration de l’inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes a reçu récemment davantage d’attention. Les quelques analyses statistiques disponibles montrent que, partout dans le monde aujourd’hui, les hommes possèdent davantage de richesses que les femmes. Ce n’est pas étonnant a priori, au vu des inégalités de revenu selon le sexe. Cela montre cependant, pour un pays comme la France, que des mécanismes juridiques comme la « communauté de biens réduite aux acquêts », censés assurer une répartition égale des fruits de l’investissement des conjointes dans le mariage, ont leurs limites : la conjugalité hétérosexuelle n’assure pas un partage équitable des bénéfices de la spécialisation des hommes dans la carrière professionnelle et des femmes dans la production domestique. Surtout, selon les données statistiques les plus récentes, cet écart de richesse entre les hommes et les femmes s’accroît régulièrement en France : il est passé de 9 % en 1998 à 16 % en 201525. Beaucoup moins médiatisé que l’augmentation des inégalités de patrimoine entre ménages, l’accroissement des inégalités de richesse entre femmes et hommes n’en est pas moins impressionnant, et semble bel et bien l’accompagner. Mais l’inégalité patrimoniale entre les femmes et les hommes continue à être peu documentée, du fait de problèmes de mesure importants qui s’expliquent par une unité d’analyse inadaptée.
Comment estimer des patrimoines individuels d’hommes et de femmes quand les biens sont la propriété de plusieurs personnes à la fois (typiquement un couple) et que les enquêtes sont réalisées à l’échelle du ménage, qui rassemble les personnes qui vivent sous le même toit ? Du fait des difficultés d’accès aux données individuelles, la variable sexe est absente de l’ouvrage de 950 pages de Thomas Piketty, Le Capital au XXI siècle. En matière d’inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes, il est pourtant indispensable de s’appuyer sur des données statistiques claires. Mais ce n’est pas suffisant. Pour saisir pleinement l’inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes, il faut aussi entrer dans le vif des relations familiales. […]
Certaines classes sociales s’accaparent les richesses et les conservent en leur sein d’une génération à l’autre, tandis que d’autres en sont durablement privées. Dans le même temps, les femmes accumulent moins de richesses que les hommes. En matière de capital, on ne peut pas comprendre séparément les inégalités de classe et les inégalités de genre. Des travaux menés dans d’autres contextes nationaux, notamment aux États-Unis, ont aussi documenté la dimension raciale des inégalités de richesse. Nous verrons que l’âge et la génération sont également constitutives de ces inégalités. Notre travail s’inscrit ainsi dans une perspective intersectionnelle, qui articule, sans les hiérarchiser, plusieurs rapports de domination. En explorant les arrangements économiques familiaux, nous étudions les lieux concrets où se jouent indissociablement ces différentes dynamiques inégalitaires. Porter le regard sur les lieux et les moments de l’accumulation et de la distribution des richesses familiales suppose de rompre avec le sens commun, qui considère la famille comme un havre de paix affective dans un monde capitaliste brutal et cynique. Au contraire, il faut reconnaître que la famille est une institution économique à part entière : une instance de production, de circulation, de contrôle et d’évaluation des richesses. Nous le montrons dans le chapitre 1, qui nous situe dans la littérature scientifique sur la famille et les inégalités. Dans le deuxième chapitre, nous décrivons, à partir de monographies de familles et d’une exploitation des données statistiques, comment les mécanismes de production, de circulation, de contrôle et d’évaluation de la richesse sont pris dans des stratégies familiales de reproduction, qui visent à assurer le maintien ou l’amélioration du statut du groupe familial. Nous montrons que ces stratégies sont défavorables à l’accumulation patrimoniale des femmes.
Nous entrons ensuite dans les cabinets des professions libérales du droit, c’est-à-dire dans les lieux discrets où les arrangements économiques familiaux sont formalisés dans un langage juridique et, de ce fait, officialisés. Selon les milieux sociaux, les personnes apparentées, hommes et femmes, sont amenées à rencontrer (ou non) différent·es professionnel·les du droit qui vont plus ou moins les accompagner et leur permettre de jouer avec le droit de la famille et de la propriété. L’activité des notaires et des avocat·es renforce les inégalités économiques entre les classes sociales en favorisant le maintien et la transmission de la richesse des familles les plus aisées. Dans le même temps, elle contribue à dissimuler, entériner et légitimer l’inégalité patrimoniale entre les hommes et les femmes (chapitre 3). Les partages successoraux et les liquidations du patrimoine conjugal sont des moments de comptabilités formalisées. En apparence neutres et techniques, ces comptabilités intègrent en fait des normes genrées qui favorisent les hommes de la bourgeoisie économique. Ces comptabilités sexistes ne résultent pas nécessairement d’une volonté explicite ou consciente des professionnel·les du droit de déposséder les femmes, mais elles contribuent, en pratique, à creuser les inégalités de genre, selon des modalités différenciées selon les milieux sociaux (chapitre 4). Cette construction familiale des inégalités économiques est, au nom de la paix des familles, très peu contestée, et il est coûteux pour les femmes de la renverser. D’autant plus que, selon l’ampleur de la richesse familiale, les arrangements patrimoniaux au moment des séparations et des successions constituent aussi de petits ou de grands arrangements avec le fisc. L’évitement de l’impôt est un puissant ferment de la cohésion familiale, souvent au détriment des moins fortunés de ses membres, en particulier des femmes (chapitre 5).
Nous montrons ensuite qu’au moment des ruptures des couples (qu’ils soient mariés ou non), la justice ne parvient pas à renverser ces mécanismes sexistes. Parce que les outils juridiques de compensation des conséquences économiques des séparations et les procédures prévues pour encadrer les ruptures d’union s’avèrent en pratique inégalitaires ; mais aussi parce que les juges, notamment les magistrates, les appliquent selon une vision plus ou moins sexiste, inconsciente et incorporée de la contribution des hommes et des femmes à la richesse familiale (chapitre 6). Dans les familles où il n’y a pas de richesse à partager, mais des contraintes budgétaires à gérer, la situation économique des hommes et des femmes, des pères et des mères, à l’issue des séparations, se joue au croisement de différentes institutions publiques : le tribunal, mais aussi les caisses d’allocations familiales et les différents guichets de l’aide sociale. Non seulement les femmes assurent le travail de prise en charge quotidienne des enfants, mais ce sont aussi elles qui doivent effectuer toutes les démarches administratives pour obtenir l’argent qui les fera vivre. Face aux administrations, elles sont mises en position de demandeuses, sous la dépendance financière de l’État social ou de leur conjoint (chapitre 7).
Garder des enfants, les nourrir, les aider à faire leurs devoirs, organiser leurs loisirs extrascolaires. Faire le ménage, tenir un intérieur, décorer son logement. Avoir toujours de quoi servir un apéritif ou un café, organiser des repas de famille et des dîners entre ami·es, orchestrer des mondanités. Tenir la caisse de la boutique pour dépanner, se porter caution solidaire, grâce à son statut de petite fonctionnaire, pour un prêt pour la constitution du capital d’une entreprise, organiser des dîners pour les client·es de son mari qu’on a suivi en expatriation… Autant de pratiques féminines, bourgeoises ou plus populaires, qui contribuent à l’enrichissement des familles, ne serait-ce qu’en libérant les hommes d’obligations qui les freineraient dans leur carrière. Autant de pratiques qui mobilisent avant tout du temps mais aussi des compétences et des ressources variées, culturelles notamment. Au moment des héritages et des séparations, ces contributions des femmes à l’enrichissement des familles, qui prennent le plus souvent la forme d’un travail gratuit, sont pourtant largement invisibilisées, niées, au mieux discutées, mais sans effet. Si, avec Pierre Bourdieu, on entend par capital un ensemble de ressources accumulées dont on peut tirer des profits sociaux, le constat que dresse ce livre est alors le suivant : tandis que le travail féminin participe activement à la production et à la reproduction de la richesse des familles, le capital au XXIe siècle reste résolument masculin.
[1] Le Collectif Onze, Au tribunal des couples. Enquête sur des affaires familiales, Paris, Odile Jacob, 2013.
[2] La « charge mentale » désigne, dans la sphère domestique comme professionnelle, le poids psychologique lié à une tâche : il faut non seulement accomplir la tâche, mais penser à la faire, quand et comment la faire. Il s’agit par exemple, alors qu’on est au travail, de penser à ce qu’on va faire à manger le soir, aux courses qu’il reste à faire et au temps qu’on va pouvoir consacrer à la cuisine entre la sortie de l’école, l’accompagnement des enfants à leurs activités extrascolaires, l’aide aux devoirs, etc.
[3] Nous nous appuyons ici sur la définition de Thomas Piketty dans Le Capital au XXIe siècle, op. cit., p. 82-89. Contrairement aux définitions marxistes classiques, Piketty ne réserve pas la notion de capital aux éléments de patrimoine directement utilisés dans le processus de production ou dont les propriétaires attendent un rendement. Il inclut dans sa définition du capital les terres et les ressources naturelles sur lesquelles il est possible d’exercer un droit de propriété, le patrimoine comme réserve de valeur (par exemple, l’or) ou à usage de jouissance (par exemple, l’immobilier d’habitation). Sa définition du capital est donc un synonyme des définitions contemporaines de la science économique du patrimoine et de la richesse.