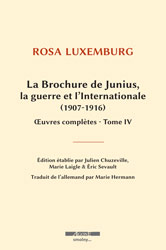
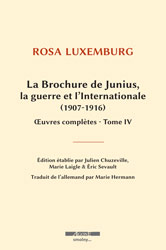
VIII
Malgré la dictature militaire et la censure de la presse, malgré la défaillance de la social-démocratie, malgré la guerre fratricide, la lutte des classes s’extirpe de la Paix sociale par une force élémentaire, et la solidarité internationale des ouvriers s’élève au dessus des brumes sanglantes des champs de bataille. Il ne s’agit pas ici des tentatives dérisoires pour galvaniser artificiellement la vieille Internationale, ou des promesses solennelles renouvelées de-ci, de-là de faire à nouveau cause commune tout de suite après la guerre. Non, c’est maintenant, pendant la guerre et de la guerre que renaît avec une force et une violence toutes nouvelles, le fait que les prolétaires de tous les pays partagent un seul et même intérêt. La guerre mondiale réfute elle-même l’illusion qu’elle a créée.
Victoire ou défaite ! Tel est le mot d’ordre lancé par le militarisme régnant en maître dans chacun des pays belligérants et qu’ont repris, comme en écho, les dirigeants de la social-démocratie. Encore maintenant, il n’est question que de victoire ou de défaite sur le champ de bataille pour les prolétaires d’Allemagne comme de France, d’Angleterre comme de Russie, tout aussi bien que pour les classes dominantes de ces pays. Dès que les canons tonnent, le prolétariat ne devrait plus s’intéresser qu’à la victoire de son pays et donc à la défaite des autres. Voyons donc ce qu’une victoire peut rapporter au prolétariat.
D’après la version officielle reprise à l’identique par les leaders de la social-démocratie, la victoire signifie pour l’Allemagne la perspective d’un essor économique illimité et sans obstacle, mais la défaite, celle d’une ruine économique. Cette conception s’appuie grosso modo sur le schéma de la guerre de 1870. Or, la prospérité capitaliste qui lui succéda en Allemagne n’était pas une conséquence de la guerre, mais plutôt de l’unification politique, même si ce n’était que sous la forme rabougrie de l’Empire allemand créé par Bismarck. L’essor économique découla de l’unification politique malgré la guerre et les multiples obstacles réactionnaires apparus à sa suite. L’effet spécifique de la guerre victorieuse fut de consolider la monarchie militaire en Allemagne et le régime des junkers prussiens, alors que la défaite de la France avait contribué à liquider l’Empire et à instaurer la République. Mais il en va aujourd’hui autrement dans tous les États impliqués. Aujourd’hui, la guerre ne fonctionne plus comme un procédé dynamique susceptible de procurer au jeune capitalisme naissant les conditions politiques indispensables à son épanouissement « national ». Tout au plus la guerre possède-t-elle ce caractère en Serbie, et uniquement si on la considère isolément. Réduite à son sens historique objectif, la guerre mondiale actuelle est, d’un point de vue général, une lutte de concurrence d’un capitalisme déjà parvenu à pleine maturité, pour la domination mondiale et pour l’exploitation des dernières zones du monde restées non capitalistes. Il en résulte un caractère totalement différent de la guerre elle-même et de ses effets. Le stade avancé du développement économique de la production capitaliste se manifeste aussi bien dans le niveau extraordinairement élevé de la technique, c’est-à-dire de la puissance de destruction des engins de guerre, que dans son niveau à peu près identique dans tous les pays belligérants. L’organisation internationale de l’industrie de mort se reflète actuellement dans l’équilibre des forces militaires qui se rétablit sans cesse à travers les fluctuations partielles des plateaux de la balance, repoussant toujours plus une décision générale. L’indécision des opérations militaires entraîne de son côté l’envoi continuel au feu de nouvelles réserves ponctionnées sur les masses de la population des pays belligérants ou des pays restés neutres jusque-là. Partout, la guerre trouve matière en abondance pour alimenter convoitises et contradictions impérialistes, elle en crée elle-même de nouvelles et se répand ainsi comme un feu de brousse. Mais au fur et à mesure que des masses colossales et des pays sont entraînés de tous côtés dans la guerre, la durée de celle-ci se prolonge. Il résulte de tout cet ensemble de faits qu’avant même qu’intervienne une décision militaire, dans le sens d’une victoire ou d’une défaite, la guerre produit un phénomène que les guerres précédentes des temps modernes n’ont pas connu : la ruine économique de tous les pays belligérants mais aussi, dans une mesure toujours plus grande, celle des pays qui ne sont pas formellement impliqués. Chaque mois de guerre qui passe confirme et renforce ce résultat et repousse ainsi à plus de dix ans les fruits attendus d’une victoire militaire. En fin de compte, ni la victoire ni la défaite ne peuvent rien changer à ce phénomène. Il rend au contraire tout à fait douteuse une décision purement militaire. Il est de plus en plus vraisemblable que la guerre s’achèvera finalement par l’épuisement extrême de tous les adversaires. Dans ces circonstances, une Allemagne victorieuse – même si les fauteurs de guerre impérialistes devaient réussir à conduire le massacre de masse jusqu’à l’élimination complète de tous leurs adversaires, si ce rêve téméraire devait jamais se réaliser – ne remporterait qu’une victoire à la Pyrrhus. Ses trophées seraient l’annexion de quelques territoires à la population décimée et réduite à la mendicité et, sous son propre toit, le spectre ricanant de la ruine, qui se montrera dès qu’auront disparu les trompe-l’œil d’une économie financière soutenue par les emprunts de guerre, ainsi que les villages Potemkine du « bien-être inébranlable du peuple » maintenus en activité par les livraisons de guerre. Il est clair pour le plus superficiel des observateurs que même le plus victorieux des États ne peut espérer réparer, si peu que ce soit, les dégâts subis pendant la guerre avec les indemnités de guerre. En guise de compensation et pour compléter sa « victoire », l’Allemagne assisterait à la ruine peut-être encore plus grande du camp opposé et vaincu, de la France et de l’Angleterre, c’est-à-dire des pays auxquels l’Allemagne est la plus étroitement liée du point de vue économique, son propre redressement économique étant largement dépendant de la prospérité de ces pays. C’est dans ce cadre qu’après la guerre – une guerre « victorieuse », bien entendu – il faudra au peuple allemand couvrir après coup l’avance sur les frais de guerre que les représentants patriotes du peuple ont « approuvés », c’est-à-dire prendre sur ses épaules une charge incommensurable d’impôts ainsi que le poids d’une réaction militaire renforcée. Voilà quel sera le seul fruit durable et tangible de sa « victoire ».
Si l’on cherche maintenant à se représenter les plus terribles conséquences d’une défaite, on constate qu’à l’exception des annexions impérialistes, elles ressemblent trait pour trait à l’ensemble des conséquences qui résulteraient inéluctablement d’une victoire : les effets de la guerre elle-même sont aujourd’hui si profondément marqués et si étendus que son issue militaire ne peut y changer grand-chose.
Pourtant, imaginons un instant que l’État victorieux entende néanmoins se décharger du plus gros de la ruine et en accabler son adversaire vaincu, et qu’il étrangle le développement économique de celui-ci par des obstacles de toutes sortes. La classe ouvrière allemande peut-elle progresser avec succès dans son combat syndical après la guerre si l’action syndicale des ouvriers français, anglais, belges et italiens est entravée par une régression économique ? Jusqu’en 1870, le mouvement ouvrier marchait encore isolément dans chaque pays. En fait, ses décisions ne touchaient que de rares villes. C’est sur le pavé de Paris que les batailles du prolétariat furent livrées et tranchées. Mais le mouvement ouvrier actuel, sa lutte économique quotidienne et laborieuse, son organisation de masse, sont fondés sur la coopération de tous les pays qui connaissent la production capitaliste. S’il est vrai que la cause ouvrière ne peut prospérer que sur la base d’une vie économique saine et vigoureuse, alors cela ne vaut pas seulement pour l’Allemagne, mais aussi pour la France, l’Angleterre, la Belgique, la Russie et l’Italie. Et si le mouvement ouvrier stagne dans tous les États capitalistes d’Europe, s’il existe partout des salaires bas, des syndicats faibles et peu de résistance de la part des exploités, alors il est impossible que le mouvement syndical soit florissant en Allemagne. De ce point de vue, le dommage est en fin de compte exactement le même pour la lutte économique du prolétariat, si le capitalisme allemand se renforce aux dépens du capitalisme français ou si le capitalisme anglais se renforce aux dépens du capitalisme allemand.
Mais tournons-nous vers les conséquences politiques de la guerre. Ici, la distinction devrait être plus facile que dans le domaine économique. Depuis toujours, les sympathies et les prises de position des socialistes sont allées à celui des camps belligérants qui se faisait le champion du progrès historique contre la réaction. Quel camp représente le progrès dans la guerre mondiale actuelle, et quel camp la réaction ? Il est clair que cette question ne peut être tranchée d’après des attributs extérieurs des États belligérants, tels que « démocratie » ou « absolutisme », mais uniquement d’après les tendances objectives de la position adoptée par chaque camp dans la politique mondiale. Avant de pouvoir juger ce qu’une victoire allemande peut apporter au prolétariat allemand, nous devrions envisager les conséquences qu’elle aurait sur la configuration d’ensemble des relations politiques en Europe. Une victoire nette de l’Allemagne entraînerait comme conséquence immédiate l’annexion de la Belgique, et probablement aussi de quelques morceaux de territoires à l’Est et à l’Ouest ainsi que d’une partie des colonies françaises. Elle permettrait en même temps la sauvegarde de la monarchie des Habsbourg, qui s’enrichirait de nouveaux territoires, et enfin la conservation de l’« intégrité » fictive de la Turquie sous protectorat allemand, c’est-à-dire la transformation simultanée de l’Asie mineure et de la Mésopotamie en provinces allemandes, sous cette forme ou une autre. La conséquence suivante serait l’hégémonie militaire et économique effective de l’Allemagne en Europe. S’il faut s’attendre à ce qu’une victoire nette de l’Allemagne produise tous ces résultats, ce n’est pas parce qu’ils correspondent aux souhaits des braillards impérialistes dans la guerre actuelle, mais parce qu’ils sont les conséquences inévitables de la position adoptée par l’Allemagne dans la politique mondiale, ainsi que des oppositions avec l’Angleterre, la France et la Russie dans lesquelles l’Allemagne s’est précipitée et qui, dans le cours de la guerre, se sont développées bien au-delà de leurs dimensions d’origine. Il suffit cependant de se représenter ces résultats pour comprendre qu’en aucun cas ils ne pourraient déboucher sur un équilibre stable de la politique mondiale. Quand bien même la guerre signifierait la ruine pour tous les pays impliqués, et plus encore peut-être pour les vaincus, les préparatifs en vue d’une nouvelle guerre mondiale commenceront à se faire sous la direction de l’Angleterre dès le lendemain de la conclusion de la paix, pour secouer le joug du militarisme prusso-allemand qui pèserait sur l’Europe et le Proche-Orient. Une victoire de l’Allemagne ne serait donc qu’un prélude à une deuxième guerre mondiale qui surviendrait peu après et, de ce fait, ne serait que le départ d’une nouvelle et fébrile course aux armements ainsi que du déchaînement de la réaction la plus noire dans tous les pays, mais en premier lieu en Allemagne même. D’un autre côté, la victoire de l’Angleterre et de la France conduirait très vraisemblablement, pour l’Allemagne, à la perte d’une partie au moins de ses colonies et du territoire du Reich et, à coup sûr, à la faillite de la position de l’impérialisme allemand dans la politique mondiale. Et cela signifie le démembrement de l’Autriche-Hongrie et la liquidation totale de la Turquie. Si archi-réactionnaires que soient maintenant ces deux États et quand bien même leur chute correspondrait en tout point aux exigences d’une évolution progressiste, cette désintégration de la monarchie des Habsbourg comme de la Turquie ne pourrait aboutir à rien d’autre, dans le cadre concret actuel de la politique mondiale, qu’au marchandage de leurs territoires et de leurs peuples entre la Russie, l’Angleterre, la France et l’Italie. Cette redistribution géographique de grande envergure et ce réajustement des forces dans les Balkans et autour de la Méditerranée se prolongerait inévitablement en Asie par la liquidation de la Perse et par un nouveau démantèlement de la Chine. De sorte que l’antagonisme anglo-russe comme l’antagonisme anglo-japonais passeraient au premier plan de la politique mondiale, ce qui, aussitôt après la liquidation de la guerre mondiale actuelle, pourrait entraîner une nouvelle guerre mondiale dont l’enjeu serait éventuellement Constantinople, ou qui ferait en tout cas de cette guerre une perspective ultérieure inévitable. Avec cette option aussi, la victoire conduirait donc à une nouvelle et fébrile course aux armements dans tous les États – avec, bien entendu, l’Allemagne en tête – et par là, préparerait une ère de domination incontestée du militarisme et de la réaction dans toute l’Europe avec, à terme, une nouvelle guerre mondiale.
Si, dans la guerre actuelle, la politique prolétarienne doit prendre position pour l’un ou l’autre des deux camps du point de vue du progrès et de la démocratie, elle est, somme toute, piégée entre Charybde et Scylla dès lors que l’on considère globalement la politique mondiale et ses perspectives futures. Et la question « victoire ou défaite » revient dans ces conditions pour la classe ouvrière européenne à un choix désespéré entre deux raclées, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Ce n’est donc qu’un funeste aveuglement si les socialistes français présument qu’en écrasant l’Allemagne par les armes, ils vont frapper le militarisme ou même l’impérialisme en plein cœur, et frayer la voie à la démocratie pacifique dans le monde. Peu importe à qui va la victoire ou la défaite dans cette guerre, l’impérialisme, et le militarisme à son service, y trouveront largement leur compte, sauf dans un seul cas : si, par son intervention révolutionnaire, le prolétariat international barre ce compte.
C’est pourquoi la plus importante leçon que la politique du prolétariat puisse retirer de la guerre actuelle, c’est la certitude inébranlable que ni en Allemagne ou en France, ni en Angleterre ou en Russie, le prolétariat ne peut se faire sans critique l’écho du mot d’ordre Victoire ou défaite. Ce mot d’ordre n’a de sens véritable que pour l’impérialisme et, pour chaque grand État, équivaut à la question : renforcement ou perte de sa puissance dans la politique mondiale, de ses annexions, de ses colonies, de sa prédominance militaire. Pour le prolétariat européen dans son ensemble, la victoire ou la défaite de chacun des camps belligérants est maintenant tout aussi funeste de son point de vue de classe. C’est précisément la guerre en tant que telle, et quelle que soit son issue militaire, qui représente pour le prolétariat européen la plus grande défaite imaginable. Seules l’éradication de la guerre et l’obtention aussi rapide que possible d’une paix imposée par la lutte internationale du prolétariat peuvent apporter une véritable victoire à la cause prolétarienne. Et c’est uniquement cette victoire qui permettra de réellement sauver la Belgique et la démocratie en Europe.
Dans la guerre actuelle, le prolétariat conscient ne peut identifier sa propre cause à aucun des deux camps militaires. S’ensuit-il que la politique du prolétariat exige aujourd’hui le maintien du statu quo ? Que nous n’ayons d’autre programme d’action que le vœu de tout voir rester comme par le passé, comme avant la guerre ? Mais l’état de choses existant n’a jamais été notre idéal, ni une expression de l’autodétermination des peuples. Qui plus est, on ne peut certainement plus sauvegarder l’état de choses antérieur – il n’existe plus –, même si subsistent les anciennes frontières entre les États. avant d’avoir formellement épuisé toutes ses conséquences, la guerre a déjà amené un changement si considérable dans les rapports de forces et dans l’évaluation des forces antagonistes, dans les alliances et les oppositions politiques, elle a si radicalement modifié les relations des États entre eux et des classes à l’intérieur de la société, elle a anéanti tant de vieilles illusions et de vieilles puissances, créé tant de nouveaux besoins et de nouvelles tâches, que le retour à la vieille Europe telle qu’elle existait avant le 4 août 1914 est tout aussi exclu qu’un retour à des conditions pré-révolutionnaires, fût-ce après une révolution défaite. D’ailleurs, la politique du prolétariat ne connaît jamais de « marche arrière », elle ne peut aller que de l’avant, elle doit toujours dépasser ce qui existe ou qui vient d’être nouvellement créé. C’est en ce sens seulement que le prolétariat est capable d’opposer sa propre politique aux deux camps de la guerre impérialiste mondiale.
Mais cette politique ne saurait consister en ceci que les partis social-démocrates, chacun pour soi ou en commun, élaborent des projets à qui-mieux-mieux dans des conférences internationales, et concoctent des recettes pour la diplomatie bourgeoise sur la manière dont elle devrait conclure la paix pour permettre à l’avenir une évolution pacifique et démocratique. Toutes les revendications qui aboutissent par exemple à un « désarmement » total ou partiel, à l’abolition de la diplomatie secrète, au démantèlement de tous les grands États en minuscules États nationaux et toute cette sorte de choses, sont toutes sans exception totalement utopiques aussi longtemps que la classe capitaliste tiendra les rênes en main. Et celle-ci peut d’autant moins, dans le cours impérialiste actuel, renoncer si peu que ce soit au militarisme, à la diplomatie secrète, au grand État multinational centralisé, que les postulats en question aboutissent en fait, si l’on veut être conséquent, à cette simple « exigence » : l’abolition de l’État de classes capitaliste. Ce n’est pas avec des conseils utopiques et des projets qui permettraient d’adoucir, de dompter ou de modérer l’impérialisme au moyen de réformes partielles dans le cadre de l’État bourgeois que la politique du prolétariat peut reconquérir la place qui lui revient. Le problème réel que la guerre mondiale a posé aux partis socialistes, et de la solution duquel dépendent les destinées futures du mouvement ouvrier, c’est celui de la capacité d’action des masses prolétariennes dans la lutte contre l’impérialisme. Ce qui manque au prolétariat international, ce ne sont pas des postulats, des programmes, des mots d’ordre, mais plutôt des actions, une résistance efficace, la capacité d’attaquer l’impérialisme au moment opportun, précisément en temps de guerre, et de mettre en pratique le vieux mot d’ordre « guerre à la guerre ». C’est ici Rhodes, c’est ici qu’il faut sauter1, c’est ici que se situe le nœud gordien de la politique du prolétariat et de son avenir.
références
| ⇧1 | Allusion à une locution latine attribuée à Ésope : « Hic Rhodus, hic saltus [C’est ici Rhodes, saute ici] », reprise – et incorrectement traduite – par Marx, à la suite de Hegel, dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Le sens est clair : c’est le moment de faire ses preuves. |
|---|