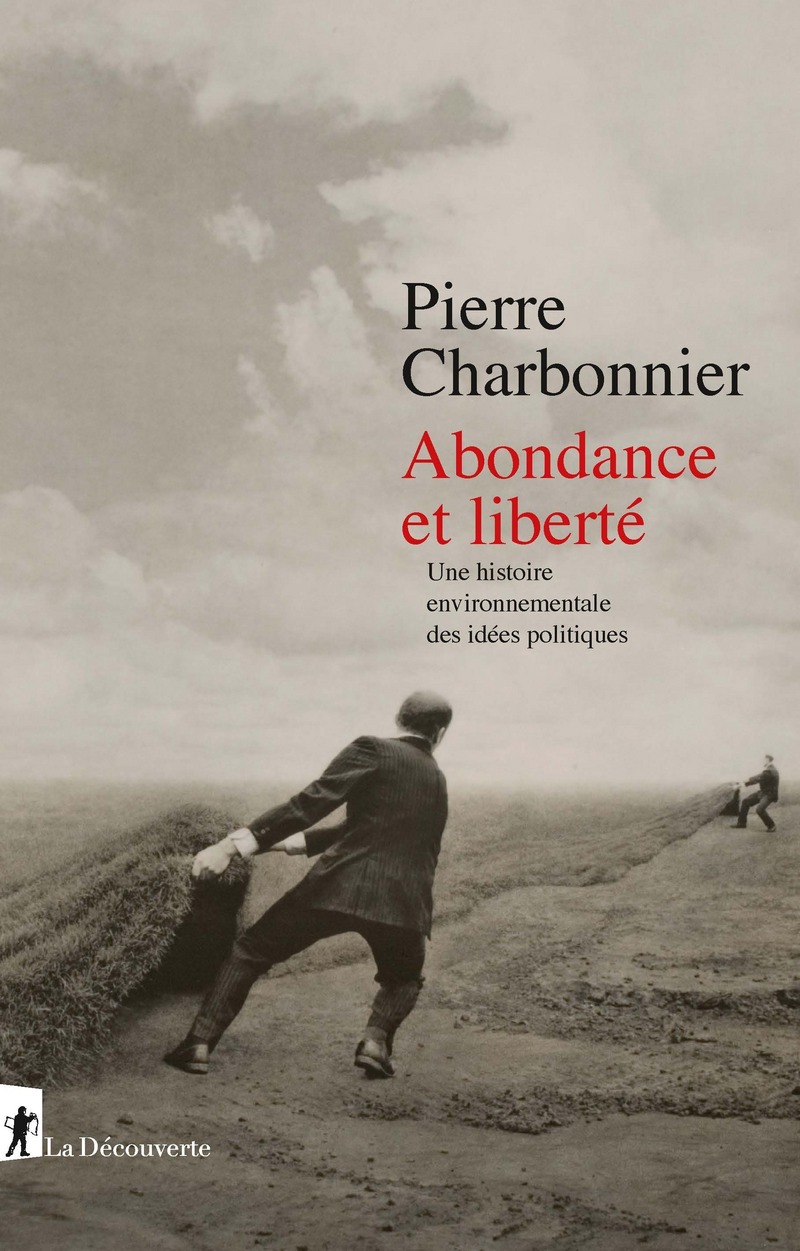
À propos de : Pierre Charbonnier, Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques, Paris, La Découverte, 2020, 464 p.
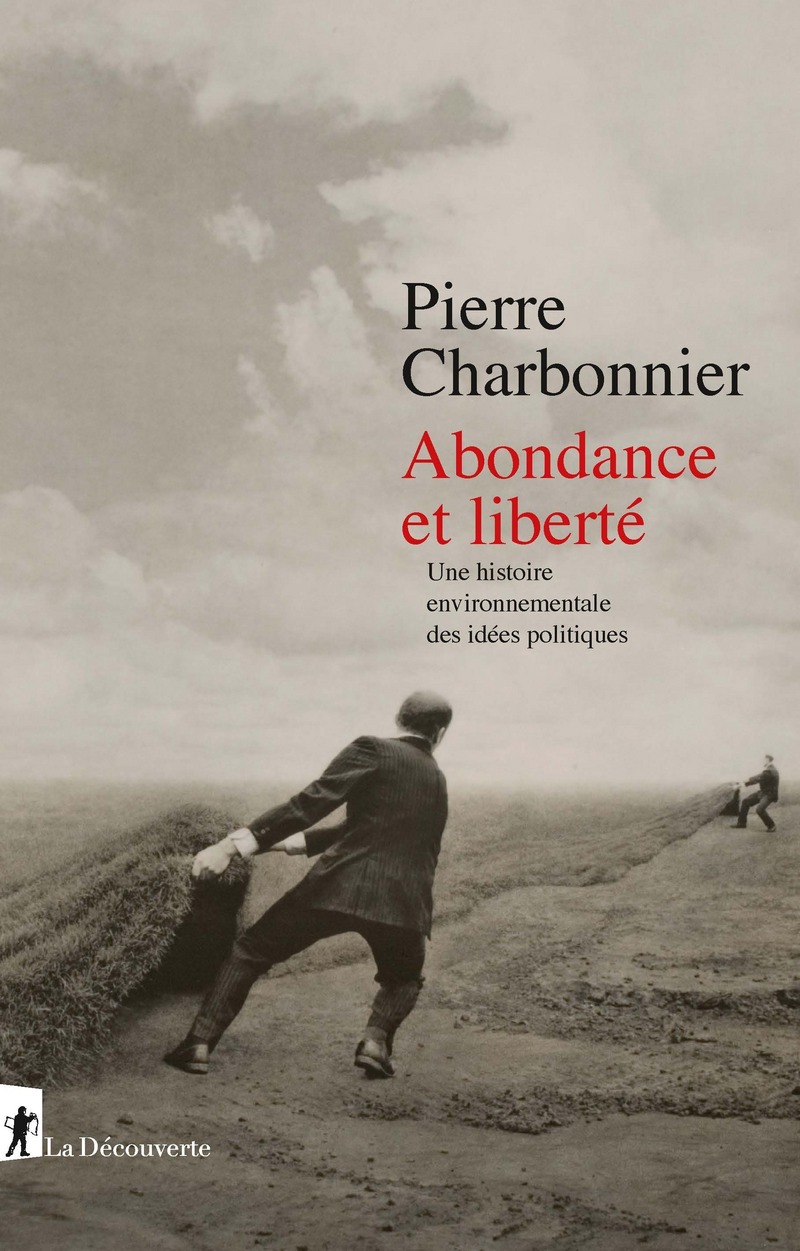
« La construction juridique et technique d’une société de croissance a imprégné et orienté le sens que nous donnons à la liberté ». Depuis le début de la modernité, « abondance et liberté ont marché main dans la main, la seconde étant considérée comme la capacité à se soustraire aux aléas de la fortune et du manque qui humilient l’être humain ». Or, cette alliance est en train de se défaire sous les coups de boutoir du basculement climatique. Par conséquent, soit nous renonçons à la liberté pour respecter les contraintes climatiques ; soit nous dynamitons l’avenir en jouissant sans entraves des derniers instants d’autonomie qui nous restent. Nous sommes « au fond d’une impasse écologique et politique ». Une « écologie autoritaire » n’étant pas plus acceptable qu’une « liberté sans lendemains », la conclusion, pour Pierre Charbonnier, s’impose : « l’impératif théorique et politique du présent consiste à réinventer la liberté à l’âge de la crise climatique, c’est-à-dire dans l’anthropocène ». Telle est l’ambition de l’ouvrage qu’il publie aux éditions La Découverte.
Réinventer la liberté pour quoi faire ? Pour « retrouver une conformité entre nos modes d’organisation et le substrat physique et vivant du monde ». Le binôme abondance-liberté nous a entraînés au-delà des limites écologiques. Or, pour Pierre Charbonnier, il est illusoire de penser que « la mégamachine économique se plierait docilement aux contraintes naturelles ». « Laisser se déployer la même société, la même organisation politique, seulement débarrassée de ses abus productivistes » n’est pas une solution : « sortir des forçages écologiques et décarboner l’économie implique une redéfinition totale de ce qu’est la société, un réarrangement des rapports de domination et d’exploitation et une requalification des attentes de justice. En d’autres termes, c’est l’organisation démocratique et les aspirations qui la soutiennent qu’il s’agit de décarboner – et pas seulement l’économie. Accéder à la ‘prospérité sans croissance’, pour reprendre le titre d’un ouvrage célèbre 1, ne procède pas d’une solution technologique mais d’une mutation politique dont les équivalents sont à rechercher du côté des grandes révolutions techniques et juridiques qui ont fondé la modernité et servi de laboratoire à nos idéaux partagés. »
« La mégamachine économique ne se pliera pas docilement aux contraintes naturelles » : nous rejoignons Pierre Charbonnier sur ce point. Mais alors, pourquoi l’auteur se contente-t-il de questionner la « construction juridique et technique » de la « mégamachine » ? Pourquoi nous propose-t-il seulement une « mutation politique » plutôt qu’une mutation économique ; une « révolution technique et juridique » plutôt qu’une révolution sociale ? Pour sortir de l’impasse, suffirait-il de se référer aux grands penseurs qui, à l’instar de Copernic, « ont fondé la modernité » ? Il y a certes grande urgence à une révolution copernicienne mettant la nature au centre plutôt qu’Homo sapiens, qui n’en est qu’un produit. Mais, pour « réinventer la liberté », n’avons-nous aucun « équivalent », aucune source d’inspiration, aucune leçon à rechercher du côté de la Commune de Paris, de la Révolution russe, de la Révolution cubaine ? Abondance et liberté ne répond pas à ces questions. Cet angle mort sera au centre de notre discussion de l’ouvrage.
Pierre Charbonnier entend contribuer à politiser la question écologique en évitant à la fois « l’enthousiasme angélique » face à l’amélioration de certains indicateurs économiques et humains, d’une part, et, d’autre part, « la prophétie de la fin », autrement dit « le millénarisme de l’effondrement qui met un terme à toute ambition politique en assurant qu’après l’abondance ne vient que la survie, l’adaptation, ou la rédemption ». Pour l’auteur, la polarisation entre ces « deux interprétations caricaturales » nous empêche de « saisir le problème auquel on doit faire face : il se trouve en effet qu’il est possible, pour certains du moins, de vivre mieux dans un monde qui se dégrade ». C’est le cas de centaines de millions d’humains dans le Sud global, en Chine et dans les autres pays « émergents », qui accèdent à ce qu’on appelle la « classe moyenne ». Dès lors, « la contradiction qui se présente à nous n’est pas une affaire de perception, ni même d’opinion, elle se situe dans la réalité elle-même, et plus exactement dans une réalité sociale différenciée ». Pour l’auteur, c’est dans l’interstice entre ces deux dimensions […] que se situe la « politisation adéquate de l’écologie ». « Il ne s’agit pas d’affirmer qu’une liberté infinie dans un monde fini est impossible, mais que celle-ci ne se gagne que dans une relation socialisatrice et durable avec le monde matériel ». La mise en perspective d’une alternative civilisationnelle permettant une « relation socialisatrice et durable avec le monde matériel » est en effet indispensable à la « politisation de l’écologie ». Encore faut-il préciser les contours de cette alternative, et, pour cela, mettre à nu et extirper non seulement les racines « techniques et juridiques de la société de croissance » mais aussi ses racines socio-économiques. En dépit de ses indéniables qualités (une approche originale embrassant de très nombreux auteurs, une attention particulière pour les sciences et les technologies, un regard très critique sur le bilan de l’écologie politique, notamment), Abondance et liberté ne le fait pas.
L’ouvrage commence par une longue enquête philosophique et historique mettant à jour « la double exception » de l’Occident, par laquelle la modernité s’est définie et continue de se définir aujourd’hui : exception par rapport aux choses naturelles, en s’instituant comme choses réflexives, fondées à dominer la nature ; et exception historique par rapport au monde, en s’instituant comme peuple autonome, fondé à dominer les autres. La « double exception » implique donc un double découplage, une double extériorisation : de la société par rapport à la nature, et de l’Occident par rapport à la majorité de l’humanité. « À la clé, écrit Charbonnier, on ne trouve rien d’autre que la mise en adéquation de la liberté et de l’abondance : l’assemblage des terres coloniales comme ressources a fourni un appui matériel décisif pour une liberté conçue sous la forme d’un éloignement [par rapport à la nature], voire d’une élimination des freins et des contingences qui pèsent sur l’idéal d’autonomie [de liberté], mais aussi comme l’exorcisme de notre propre prémodernité ».
La question se pose de savoir ce qui est à l’origine de cette exception moderne. Pierre Charbonnier s’y attache mais sa réponse est, selon nous, trop partielle. En effet, sa focale exclusive sur la prédation coloniale escamote l’autre facteur historique clé qui a mis en branle « la société de croissance » : la lente dissolution du féodalisme en Occident, en particulier le mouvement des enclosures. En effet, ce que l’auteur appelle « l’assemblage des terres en ressources » – autrement dit leur accaparement par l’expropriation des producteurs/trices direct.e.s – n’est pas une exclusivité coloniale. Il a été imposé en Europe également par des possédant.e.s qui ont eu recours pour cela à la plus extrême violence. Les populations rurales d’Europe, à commencer par celles d’Angleterre, ont été coupées du sol, privées de leurs communs. La plongée de ces dépossédé.e.s dans la misère n’était nullement due aux « aléas (sic) de la fortune et du manque », pour elleux, « abondance et liberté » ne marchaient pas « main dans la main ». Ce n’est pas pour accéder à celle-ci qu’iels ont été enchaîné.e.s à la frénésie d’accumulation capitaliste, mais parce que vendre leur force de travail était devenu leur seul espoir de survie. Quant aux expropriateurs/trices qui ont ainsi « assemblé les terres en ressources », ils et elles n’avaient pas pour but abstrait « l’abondance » de la société en général mais la réalisation de la plus-value contenue dans les marchandises que la concurrence les poussait à produire en quantités sans cesse croissantes, en épuisant le travail et la nature. Ainsi, avant même sa généralisation à toute la société, le capital en tant que rapport social portait en lui le double germe d’un développement « hors-sol » et d’une inégalité sociale de plus en plus vertigineuse. L’arrachement des producteurs/trices à la terre nourricière est au principe du développement exponentiel qui en est résulté. Sans cet « extrême déchirement » (Marx) originel, les richesses pillées aux colonies n’auraient pas pu se métamorphoser systématiquement en capital, de sorte que « l’abondance et la liberté » n’auraient pas pris la forme historique dont Charbonnier dénonce la dynamique mortifère. Paradoxe : alors que sa démarche est matérialiste, le fait d’ignorer cet aspect de l’accumulation primitive du capital pousse l’auteur à suggérer qu’un imaginaire extractiviste et productiviste est la cause ultime des destructions de la nature.
L’histoire politique des idées environnementales cherche dans le passé les premières formes de la pensée écologiste d’aujourd’hui. Cette méthode semble, à juste titre, trop restrictive à Pierre Charbonnier. Il choisit d’écrire plutôt une histoire environnementale des idées politiques, « où la centralité des relations entre nature et société fonctionne comme un analyseur pour (potentiellement) l’ensemble des idées ». La démarche est intéressante, entre autres parce qu’elle amène l’auteur à donner une place significative aux dispositifs techniques et aux savoirs écologiques dans l’histoire environnementale des sociétés, donc aussi à souligner le rôle des techniciens, des scientifiques et des ingénieurs dans la conception des forces productives matérielles nécessaires à la transition. Son enquête conduit l’auteur à distinguer trois phases : celle de la modernité préindustrielle, ancrée dans la terre ; celle qui va de la Révolution industrielle à l’après-guerre, ancrée dans les combustibles fossiles ; et celle de la crise écologique globale, résultat des deux autres. Le découpage est pertinent mais la description des phases est biaisée par l’appréhension sélective des origines de la « société de croissance ». Du coup est oubliée une série de carrefours historiques qui auraient pu orienter le développement vers d’autres possibles, ainsi que certains auteurs – de droite ou de gauche – qui ne cadrent pas avec l’idée que, « depuis le début de la modernité, abondance et liberté ont marché main dans la main ».
Dans la première phase, Charbonnier ne voit que la mise en place des concepts de souveraineté et de propriété qui se confondent avec la prise en charge de la nature et se combinent avec l’idée de progrès pour dessiner une nouvelle rationalité politique justifiant la conquête des empires coloniaux. Les enclosures et l’émergence du « capitalisme agraire » lui échappent, Malthus n’est qu’effleuré 2. La seconde phase est celle de l’extraction intensive et de l’émergence de la question sociale. L’auteur n’y voit que l’inscription du mouvement ouvrier dans « l’intensification productive » européocentrée, la tentative sociale-démocrate d’établir « un juste équilibre entre […] la croissance et la répartition de ses bénéfices ». Il ignore le mouvement des Luddites ainsi que l’émergence ultérieure de la révolution sociale, et l’œuvre de William Morris ne retient pas son attention. Pour Charbonnier, cette deuxième phase mène en droite ligne à « la grande accélération », à « l’éclipse de la nature » et à l’anthropocène qui marque « la fin des certitudes ». Dans l’intervalle, il n’a remarqué ni l’ébauche prometteuse d’une convergence possible entre l’écologie et les soviets 3, ni l’étranglement de ceux-ci par la contre-révolution stalinienne, ni la collectivisation forcée des campagnes, ni la tentative de mise en coupe réglée des zapovedniki, ni les délires du lyssenkisme et la lucidité prémonitoire de Walter Benjamin. Du coup, sans traverser aucun carrefour historique, l’auteur débouche sur la phase d’aujourd’hui, où la recherche de la croissance/abondance se retourne contre la quête de l’émancipation/liberté, de sorte que deux voies sont ouvertes : « soit le projet d’autonomie reste arrimé au rêve d’abondance, auquel cas il sombrera dans le grand mouvement réactionnaire et autoritaire auquel nous assistons déjà, soit il s’en affranchit en prenant la forme d’une autonomie postcroissance, c’est-à-dire d’une autonomie-intégration d’un nouveau genre. »
Dans cette recension, on se concentrera principalement sur les deux derniers chapitres de l’ouvrage, où l’auteur explicite sa vision de « l’autonomie-intégration d’un nouveau genre » et ébauche la stratégie susceptible d’y conduire. L’objectif général consiste à identifier « un assemblage entre théorie politique et savoirs écologiques qui garantisse la refondation d’un sujet politique critique sur la base d’une réponse aux nouvelles affordances de la terre 4 ». Pour Charbonnier, l’écologie politique de la génération précédente n’est pas parvenue à relever ce défi, et elle en paie le prix. Le collapse et la résilience, en effet, ne sont que des « stratégies désespérées » : « d’un côté le naturalisme, voire le darwinisme renouvelé des prophètes de l’apocalypse […], de l’autre la responsabilité individuelle intégrée à un marché qui, bien loin d’être contenu, étend son emprise à de nouvelles sphères. Population et individu, soit les coordonnées de l’économie politique classique, sont précipités dans des aventures d’un nouveau genre sans que leur substance ne soit véritablement questionnée ». Face à ce « couple révélateur des espoirs déçus » de l’écologie politique, Pierre Charbonnier propose de s’inspirer de « l’interprétation polanyienne du socialisme » pour « reconstituer la promesse démocratique à l’âge du changement climatique ».
Pour en finir avec la « double exception de la modernité » basée sur « la confiscation de l’émancipation par la croissance », le philosophe plaide alors pour ce qu’il appelle la « symétrisation ». « Symétriser, écrit-il, c’est d’un même coup démonter les procédures par lesquelles un sujet constitue son autorité sur des objets, sa position d‘exception à leur égard, et amorcer de nouveaux arrangements, de nouvelles compositions possibles sur base de l’abolition de l’ancien régime intellectuel où un sujet exerce une autorité incontestable sur des objets vassalisés ». Puisque la modernité a construit un monde asymétrique centré sur « le mâle, l’Occident et la société », symétriser consistera donc à « décentrer le regard » pour « rendre à la femme, au monde colonisé et à la nature leur rôle d’acteurs historiques à part entière ». Charbonnier recommande donc de s’appuyer sur « les luttes féministes, postcoloniales et écologistes » qui constituent, selon lui, « les principaux espaces où se poursuivent les mouvements d’émancipation ». Le « principe de symétrie » serait ainsi « l’opérateur principal de la reconfiguration des savoirs politiques alimentée par la remise en cause du patriarcat, des empires coloniaux et des certitudes industrialistes ». Mettre fin à la double exception signifiera alors conjointement « montrer comment l’autonomie des uns s’est articulée à l’hétéronomie des autres » et « comment la charge écologique de l’amélioration moderne a été passée sous silence ».
On ne contestera pas l’importance émancipatrice majeure des luttes féministes, postcoloniales et écologistes. La question est plutôt : pourquoi en rester là ? En effet, « le monde asymétrique de la modernité » s’est construit aussi autour de la ville et de la figure de l’entrepreneur, par opposition respectivement à la campagne et à la classe ouvrière. Le silence de Pierre Charbonnier par rapport à ces deux binômes est cohérent avec sa vision tronquée des origines de la « double exception » et éclaire crûment les conséquences de celle-ci. L’auteur pense-t-il que paysan.ne.s et salarié.e.s ont été suffisamment reconnu.e.s dans « leur rôle d’acteurs/trices historiques à part entière »? Estime-t-il comme suffisamment démontrée la manière dont l’autonomie des employeurs « s’est articulée à l’hétéronomie » des employé.e.s ? Ne pense-t-il pas que la résistance des paysan.ne.s contre l’agrobusiness destructeur fait partie « des principaux espaces où se poursuivent les mouvements d’émancipation sociale et de protection de la nature » ? En admettant qu’il faille « rendre à la nature son rôle d’acteur historique à part entière » (cette affirmation mériterait débat), il est clair que la « symétrisation » proposée fait plus que « recentrer le regard » : elle le détourne des conflits de classe. Pour le dire plus simplement : en symétrisant « la nature » face à « la société », Charbonnier occulte les rapports asymétriques de domination propres au capitalisme. Il fourre en effet dans un même sac opaque Jeff Bezos et les employé.e.s d’Amazon (qui ont fait grève et manifesté pour le climat à l’appel de Greta Thunberg), ou Monsanto et les militant.e.s de Via Campesina (qui exigent la souveraineté alimentaire par une agroécologie bonne pour le climat). La sémantique est neuve, la méthode l’est moins.
Ayant posé à sa façon les principes de la « symétrisation » société/nature, Pierre Charbonnier constate que se pose ici un problème particulier. En effet, « la composition moderne des rapports entre humains et non-humains » s’est faite via l’autorité scientifique, dont l’auteur note avec justesse que « la dimension politique est révélée par la question climatique 5 ». L’autorité scientifique, en effet, n’est pas neutre, elle tend à protéger l’ordre existant. Mais pour l’auteur, du coup, la production marchande reste largement hors-champ, de sorte que « symétriser » la nature face à « la société » ne passe que par la critique de l’autorité scientifique. Charbonnier s’appuie ici sur la sociologie des sciences de Bruno Latour, qu’il considère comme incontournable mais dont il souligne cependant les limites en ces termes : « imaginer un espace démocratique incluant humains, machines, vivants » comme si ceux-ci étaient « capables de trouver en eux-mêmes la norme de leur organisation optimale » dans « des chaînes d’association sans principe organisateur fixe », ne permet pas d’expliquer pourquoi « les maîtres d’œuvre de la normativité technoscientifique » travaillent pour le marché plutôt que pour le bien commun. « Au nom d’une ontologie simplifiée, expurgée des partages et des hiérarchies modernistes, l’égalité des êtres trouve plutôt son aboutissement dans le cadre douillet, postidéologique, de réseaux globaux qui ne laissent en principe personne sur le bord du chemin ». Déplorant ce qu’il appelle le « cosmopolitisme néolibéral » de la sociologie des sciences, Charbonnier conclut toutefois sur un mode plus mineur en écrivant que « le type de composition du monde que cette symétrisation propose n’est pas tout à fait à la hauteur de l’opération qu’elle a fait subir à l’autorité scientifique ».
Quoique fort mesurée, la critique adressée à Latour est pertinente 6. Mais comment dépasser le « laissez-faire » de la sociologie des sciences ? Pierre Charbonnier propose trois médiations théoriques : l’historiographie subalterne et postcoloniale, l’histoire environnementale, et l’anthropologie de la nature. Tout en confirmant une focalisation trop exclusive sur le pillage extractiviste dans les colonies (qui laisse dans l’ombre le rôle de l’expropriation des paysan.ne.s européen.ne.s dans l’accumulation primitive), cette partie de l’ouvrage est riche de propositions stimulantes. Marchant dans les traces d’Immanuel Wallerstein, Samir Amin et Joan Martinez-Allier, Charbonnier évoque « le caractère organique du développement des uns et du ‘sous-développement’ des autres », structuré par « la division globale du travail et les flux de matières depuis les régions essentiellement extractives vers les régions essentiellement consommatrices ». Passant à l’anthropologie de la nature, il note que « les collectifs animistes rendent manifeste le lien indissociable entre rapports sociaux et rapports écologiques », ce qui fait d’eux des « porte-parole dans la remise en cause de la double exception : qu’il existe des collectifs sans nature (comme il existe des sociétés sans État) montre que l’identification collective à des êtres non humains peut être un facteur de solidarité, d’intégration ». Cependant, il ne croit pas à la possibilité « perspectiviste » de transplanter l’animisme dans les sociétés modernes : « nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre les siècles nécessaires à une éventuelle conversion à l’animisme pour répondre à l’impératif écologique, car le temps nous est compté », écrit-il. Nous le rejoignons sur ce point, mais divergeons sur l’alternative. En effet, comme on va le voir, l’angle mort de son analyse amène Charbonnier à s’élever d’abord dans les nuées abstraites d’une dénonciation anhistorique de « la production » pour atterrir ensuite sur le terrain concret d’un capitalisme vert-rose d’inspiration sociale-démocrate.
La plupart des théoriciens de l’écologie politique jettent le bébé du socialisme avec l’eau sale du pacte croissanciste. Pierre Charbonnier, lui, puise une inspiration dans les luttes ouvrières pour l’autoprotection, la justice et l’émancipation. Mais guère plus qu’une inspiration, car la question sociale et la question écologique, pour lui, ne sont pas les deux faces d’une même médaille, ce sont – nuance ! – « deux étapes d’un même conflit inhérent à notre histoire ». Deux étapes successives, donc. La question sociale, le socialisme, appartiennent au passé. L’auteur en retient « l’émergence d’un sujet critique exigeant », qui a cherché à se connaître lui-même, a fait reculer le marché et imposé de la sorte, « en partie, un rééquilibrage démocratique ». « Faute d’avoir pris en compte la dimension territoriale, ou terrienne, de la coexistence sociale », le socialisme « a abandonné aux forces conservatrices, nationalistes, puis fascistes, la protection de ces liens non moins politiques que les autres, et non moins ciblés par le marché ». Une autre question s’impose aujourd’hui : la question écologique. Elle « incarne la poursuite d’un idéal politique » tout en nécessitant « la réinvention de l’ambition démocratique hors du socle de l’abondance ». Si, de la catastrophe écologique, ne devait émerger « aucun contre-pouvoir dont la force serait au moins égale à celle qui a alimenté le socialisme, alors, pour le dire simplement, nous perdons au change ». Dès lors, « le meilleur hommage que l’on puisse rendre au socialisme consiste à actualiser le socle conceptuel et historique sur lequel le projet d’autonomie peut se reconstituer ». On retrouve ici la vision linéaire de l’histoire évoquée plus haut, à propos des trois phases de la modernité. Elle conduit Charbonnier à faire du dernier stade (le stade écologiste de la pensée politique), la vérité de la période antérieure et son dépassement. Plutôt que de penser que les problèmes sont différents, l’auteur semble penser que la fin de l’histoire moderne (écologisme) éclaire son commencement (socialisme) et lui donne sens. Or, ce schéma est étonnamment téléologique…
Pierre Charbonnier ne nie pas la légitimité de la tentative écosocialiste, ou écomarxiste, c’est-à-dire antiproductiviste, basée notamment sur la théorie du métabolisme humanité-nature et de sa rupture, exposée dans Le Capital. Il considère cependant qu’une interprétation « accélérationniste », c’est-à-dire productiviste, de l’œuvre de Marx est tout aussi fondée, et qu’elle peut s’appuyer – par exemple – sur un passage célèbre des Grundrisse où est en effet exaltée la capacité du productivisme capitaliste de faire de l’homme social « une création aussi universelle et totale que possible 7 ». Pour Charbonnier, par conséquent, « ce n’est pas un hasard si les interprétations actuelles de la pensée de Marx sont clivées [entre ces deux tendances] : l’une et l’autre héritent malgré elles de l’effet d’irréversibilité de la relation productive, qui a chez Marx la valeur d’un cadre ontologique indépassable. Qu’il faille l’encourager pour en actualiser tout le potentiel ou la freiner pour préserver le socle écologique de la relation sociale, c’est toujours cette relation de production qui détermine la conception d’un horizon postcapitaliste ». Selon nous, l’auteur a raison de pointer les tensions au sein de l’œuvre de Marx, et certaines interprétations écologiques de celle-ci sont en réalité des reconstructions a posteriori 8. En revanche, le fait d’imputer ces tensions au « schème de la production » est discutable. Pour Charbonnier, les antiproductivistes, marxistes ou non, ne mettent en cause que « l’intensification des prélèvements non rendus à la nature par l‘économie moderne ». C’est « un geste théorique incomplet, qui (demande) simplement le maintien d’une même relation, simplement au ralenti ». Sortir de « la double exception moderne » commanderait donc d’aller au-delà, de contester « le mode de relation productionniste, aux lointaines sources techniques et théologiques ». Selon nous, cette proposition de dépassement de l’antiproductivisme par « l’antiproductionnisme » esquive la spécificité de la destruction écologique capitaliste, ne résout rien et débouche sur des impasses.
Impasse anthropologique d’abord : Homo sapiens est une espèce sociale qui produit et reproduit son existence collective par le truchement d’une activité consciente – le « travail » – incluant la transformation des richesses naturelles à l’aide d’outils. Quels que soient ses formes et son niveau de développement, cette activité entraîne inévitablement une transformation spécifique de « la nature » – y compris une transformation des humains qui font partie de cette nature (tout en étant, par nature pour ainsi dire, à la fois dans et hors de celle-ci)9. La production sociale de l’existence a pour corollaire le développement (chaque génération se hisse sur les épaules de la précédente). Par conséquent, le plaidoyer de Charbonnier pour « sortir de la production » n’a pas plus de sens que celui de Serge Latouche pour « sortir du développement ». On peut retourner la question dans tous les sens, on n’échappe pas à cette réalité : production sociale et développement sont consubstantiels à notre espèce, de sorte que oui, d’une manière générale, « l’effet d’irréversibilité de la relation productive a la valeur d’un cadre ontologique indépassable ». A ce niveau de généralité transhistorique, la production sociale n’est pas, en soi, « un acte qui glorifie son opérateur au prix d’un surinvestissement de sa responsabilité dans la genèse des biens » et d’une sous-estimation, voire d’une invisibilisation de « la contribution des agents non humains ». L’idée moderne selon laquelle l’émancipation des humains serait synonyme d’indépendance absolue par rapport à une nature dominée, domestiquée, asservie, chosifiée n’est donc pas un invariant de notre espèce. C’est un produit de son évolution, un produit historique, lié à des formes historiques particulières de la production sociale – donc réversible – et pas à cette production en général. L’hypothèse « productionniste » ne fait qu’obscurcir cette vérité.
L’impasse « antiproductionniste » est donc aussi historique. En effet, le fétichisme de la marchandise et la frénésie d’accumulation n’ont commencé à imprégner toute la société qu’à partir du moment où le capital est sorti des sphères du commerce et de la protofinance pour s’emparer aussi de la sphère productive. Auparavant, ils y restaient circonscrits. Marx définit le capitalisme comme un système basé sur la (sur)production généralisée de marchandises, donc sur la concurrence, l’exploitation du travail abstrait et le remplacement du travail vivant par du travail mort. C’est parce que le fétichisme est intimement lié à cette sphère de la production (au sens strict) que la sphère de la reproduction sociale est minorée, voire carrément occultée, alors que son rôle est bien évidemment décisif à la production sociale de l’existence humaine (au sens large). Cette invisibilisation n’est d’ailleurs pas un phénomène purement idéologique, comme Charbonnier semble le penser : elle découle du fait que le capitalisme est issu des sociétés de classe qui lui préexistaient, dont il a prolongé les modes et les instruments de domination en les adaptant à ses propres intérêts. En particulier, le patriarcat a été repris et conformé aux impératifs spécifiques du capital, ce qui a impliqué la destruction des formes d’autonomie économique dont les femmes des milieux populaires jouissaient auparavant (pour ne pas parler de l’élimination des « sorcières » analysée par Sylvia Federici)10. Comme le disent les écoféministes : domination des femmes et domination de la nature participent d’un même mouvement… patriarcalo-capitaliste.
De fait, en même temps qu’il escamote le travail des femmes, le capitalisme escamote aussi l’apport décisif de la nature en tant que seule pourvoyeuse des richesses sans lesquelles il n’y aurait évidemment pas de production sociale. Or, cet escamotage ne s’est vraiment imposé à la pensée politique qu’avec la révolution industrielle. Avant celle-ci, les physiocrates voyaient encore dans l’agriculture la seule activité créatrice de valeur. Pierre Charbonnier a donc tort, pensons-nous, d’imaginer un « mode de relation productionniste aux lointaines sources techniques et théologiques », donc prémodernes. Le fait que les ultra-libéraux soutiennent l’idée absurde que l’épuisement des ressources ne sera jamais un problème parce que le capital pourra toujours s’y substituer est une aberration religieuse dans l’histoire moderne de la pensée, pas un produit des Lumières. Elle témoigne du fait que la négation du partenariat entre le travail humain et la nature (une négation qui a contaminé aussi le socialisme mais n’est en rien imputable à Marx)11 enfle en même temps que l’aliénation capitaliste gangrène la société.
« Nous n’avons jamais rien produit », proclame Pierre Charbonnier. Il est certes utile de « recentrer le regard » sur la pyramide de Kheops en soulignant la contribution de la géologie à son érection, mais les blocs de pierre ne se sont pas taillés ni assemblés tout seuls. En quoi « l’antiproductionnisme » serait-il « un geste théorique » plus complet que l’antiproductivisme « répandu chez les penseurs de l’alternative à la croissance » ? Contrairement à ce qu’affirme l’auteur, ce nouveau concept n’améliore en rien la compréhension des mécanismes de la destruction écologique. En effet, il est inexact de réduire le productivisme à l’accélération et à l’intensification quantitative des prélèvements dans l’environnement, comme Charbonnier le fait. L’illimitation du « produire pour produire » de la classe capitaliste – qui implique le « consommer pour consommer » des riches improductifs – se traduit par une tendance ininterrompue à accumuler du travail mort. Or, cette accumulation à son tour implique la chosification/marchandisation croissante du vivant, la parcellisation croissante du travail, la dégradation des travailleurs/euses au rang d’accessoires des machines, leur déshumanisation, la création artificielle de besoins et le gonflement du crédit. Le mouvement est qualitatif autant que quantitatif : le productivisme capitaliste bouleverse sans cesse non seulement les rapports des humains entre eux et à la nature, mais aussi la nature des humains et des non humains.
Loin de radicaliser la critique de la modernité, le concept de « productionnisme » nous en écarte plutôt. Il participe de cette tendance, fort en vogue dans les débats sur la crise écologique, et qui consiste à dire « il n’y a pas que le capitalisme ». En effet, il n’y a pas que le capitalisme. En effet, des dégradations environnementales ont précédé la production généralisée de marchandises. En effet et surtout, les tentatives pour sortir de l’économie de marché au siècle passé ont débouché sur des systèmes monstrueux, au moins aussi destructeurs que le capitalisme. Cependant, outre qu’il convient de se pencher sur chacune de ces réalités pour en analyser concrètement la genèse et les mécanismes, il est indiscutable que l’accumulation capitaliste marque un saut qualitatif gigantesque dans le dérèglement des mécanismes écologiques. C’est d’ailleurs ce que confirment les datations liées aux notions de « grande accélération » et d’anthropocène. Surtout dans l’actuel contexte d’urgence absolue, il importe en priorité de comprendre, d’expliquer et de dénoncer que le capitalisme nous enfonce dans la catastrophe. C’est la condition sine qua non pour sortir de la sidération et élaborer un programme à la hauteur des défis. Dès lors, aux tenant.e.s de la thèse « Il n’y a pas que le capitalisme », et au risque de paraître peu subtil, nous répondons simplement : d’accord, mais il y a surtout le capitalisme ; commençons par l’abattre, on y verra plus clair par la suite. Mais alors, bien souvent, on constate que c’est précisément cela que l’interlocuteur se refuse à faire.
Dans le travail de Pierre Charbonnier, l’hypothèse productionniste fonctionne en fait comme une fuite en avant face aux problèmes cachés dans l’angle mort évoqué au début de cet article. En posant que la question sociale n’est qu’une source d’inspiration puisée dans un passé révolu, l’auteur s’interdit lui-même de tracer un chemin concret vers la « réinvention de la liberté à l’âge de l’anthropocène », à laquelle il a pourtant raison d’appeler. Cette réinvention, en effet, ne sera digne de ce nom que si elle annule non seulement la prédation coloniale et le patriarcat mais aussi l’expropriation des producteurs/trices, qui s’est généralisée à l’échelle de la planète et qui est au principe de la fausse « liberté » libérale ainsi que de l’accumulation marchande. Plus exactement : l’abolition de la prédation coloniale, du patriarcat, de l’exploitation du travail et du pillage des ressources forment un tout indissociable. Il s’agit donc d’appréhender la question sociale telle qu’elle se pose aujourd’hui, c’est-à-dire en tant que question écosociale, pas de la mettre au musée. Pour ce faire, plutôt que de s’attacher à une « symétrisation » qui dissimule les antagonismes sociaux dans le sac de « la société », la pensée critique doit au contraire démontrer que la destruction écologique procède principalement de cette « liberté » d’exploiter qui est inévitablement raciste, machiste, patriarcale et coloniale. Travailler à l’élaboration d’une « théorie unitaire » du capitalisme (au sens de Lise Vogel)12, articulant ces différentes dimensions de la domination, nous semble décidément une voie plus féconde que l’exploration de « l’antiproductionnisme ».
« Où atterrir ? », comme dit Bruno Latour ? Telle est en effet la question. À la fin de son ouvrage, Pierre Charbonnier se démarque de celles et ceux qui croient possible, « en éliminant les désirs inauthentiques créés par le capitalisme technoscientifique pour s’autojustifier, (de) lever la lourde pierre posée sur la liberté humaine par les abus de la raison ». Et il enchaîne : « Annuler d’un même geste les deux grandes exploitations qui définissent l’âge industriel (constitue) évidemment un objectif louable. Mais le problème est que ce pari ne résiste pas à l’analyse : nous ne disposons en effet d’aucun concept qui ne soit véritablement étranger aux mécanismes de l’abondance. […] Ce qui fait écran à l’émergence d’une pensée politique ajustée à la crise climatique n’est donc pas seulement le capitalisme et ses excès [nous y voilà, DT]. C’est aussi en partie l’acception même de l’émancipation dont nous sommes les héritiers, qui s’est construite dans la matrice industrielle et productionniste et qui s’est traduite dans la mise en place de mécanismes protecteurs encore tributaires du règne de la croissance. L’obstacle est en nous […] plus que dans un spectre économique surplombant que l’on pourrait confortablement dénoncer de l’extérieur. L’État social, en dépit de ses immenses bénéfices, a par exemple contribué à consolider les objectifs de performance économique qui conditionnent son fonctionnement, et qui en retour provoquent une mise en concurrence des risques sociaux et des risques écologiques. La crise des Gilets jaunes, en France, en est l’illustration parfaite : taxer les carburants pour dissuader de leur utilisation entre en conflit avec le sens de la liberté de millions de personnes prises dans les infrastructures de la mobilité héritées des Trente Glorieuses. »
L’arbre se juge à ses fruits, dit-on. Il faudrait donc, au nom de « l’antiproductionnisme », taxer les carburants et, plus largement, « internaliser les externalités », voire moduler les allocations sociales en fonction de l’empreinte écologique ? Serait-ce la voie à suivre pour « réencastrer des processus acquisitifs et marchands dans l’écologie » ? Est-ce ainsi que les humains devraient « assumer une responsabilité singulière à l’égard de leur monde », participer à « l’autoprotection de la Terre » ? Est-ce en cela, enfin, que consisterait le « réarrangement des rapports de domination et d’exploitation » annoncé au début de l’ouvrage ? Pierre Charbonnier hésite, mais penche dans cette direction. D’une part, il dénonce à juste titre « le recodage par l’économie des alertes écologiques en une série de modifications marginales des règles marchandes » et déplore que « les instruments mis au point pour concevoir la régulation environnementale globale révèlent l’impuissance à changer de paradigme ». D’autre part, il impute cette impuissance au refus de « faire entrer (les processus naturels) dans la sphère de la valeur », salue le « développement d’une science économique qui valorise la dimension anté-productive de nombreuses régulations écologiques », et se réjouit que celle-ci « mette fin à l’incommensurabilité entre les interdépendances qui tiennent ensemble les éléments de la terre et les interdépendances qui tiennent ensemble les membres des sociétés ». Last but not least, l’auteur se réfère à Robert Constanza13, cet économiste qui plaide depuis des décennies pour donner un prix aux « services écologiques » tels que « le filtrage de l’eau par les sols, l’entretien de l’équilibre chimique de l’atmosphère par les forêts ou la pollinisation des plantes par les abeilles ». Pour Charbonnier, cette approche permet de « décaler notre regard sur les arrangements institutionnels qui assurent pour l’instant la cheapness des matières premières ». Au final, donc, la solution à la crise écologique passe bien par des mécanismes de marché permettant d’augmenter les prix des ressources, de sorte que l’impasse de « l’antiproductionnisme » se prolonge sur le plan politique, où elle rejoint celle du « capitalisme vert ».
Tout ça pour ça, est-on tenté de dire… On peut certes considérer que « faire entrer les processus naturels dans la sphère de la valeur » mettra fin à l’incommensurabilité entre les richesses créées par le travail humain et les richesses créées par la terre. Mais la production pour la valeur est précisément ce qui corrompt les rapports entre les humains, et entre les humains et (le reste de) la nature. Valoriser les « services écosystémiques » revient à tenter d’imposer à la nature aussi le dogme capitaliste qui ramène tout à la quantité de travail abstrait, raison pour laquelle cette loi détruit la nature et vide le travail de ses qualités. On ne peut pas souhaiter à la fois le recul de la sphère du marché et l’extension du système des prix aux ressources naturelles, c’est antagonique. Charbonnier perçoit bien que la force de travail est aussi une ressource naturelle, et il semble toucher juste en écrivant que « le sous-investissement dans les domaines de la santé, de l’éducation, des retraites, est l’équivalent social du non-paiement des externalités ». Pourtant, l’apparence est trompeuse. Ce sous-investissement, en effet, est la conséquence du fait que le néolibéralisme veut privatiser la santé, l’enseignement, les retraites (et la Sécu en général) pour offrir de nouveaux champs d’action à la quête du profit capitaliste. Autrement dit, le but du capital est d’étendre le marché aux sphères de la vie sociale d’où il avait été repoussé par le mouvement ouvrier. Vu sous cet angle, le sous-investissement dans les services sociaux n’est pas « l’équivalent social du non-paiement des externalités » mais l’équivalent social de la marchandisation de la nature, c’est-à-dire du paiement des externalités.
À travers ces développements, on touche du doigt les limites stratégiques de la « symétrisation » en tant que « rééquilibrage ». Pierre Charbonnier, on l’a vu, ne retient de la question sociale que sa déclinaison social-démocrate : construire un « contre-pouvoir » capable de limiter le marché. Son projet de « réarrangement des rapports d’exploitation et de domination » peut être qualifié de « social-démocratie verte ». L’internalisation des externalités y est donc à sa place. L’avenir dira si cette stratégie permettra l’émergence d’un « sujet collectif critique (échappant) à la définition traditionnelle de la société qui implique son opposition à la nature ». Il dira aussi si ce sujet nouveau « au profil sociologique nécessairement instable » (constitué selon le modèle du « peuple » de Laclau et Mouffe, dit Charbonnier), « difficilement comparable à une classe dominée », car défini par « la dimension spatiale des enjeux », sera en mesure de créer un « contre-pouvoir » analogue à celui de la social-démocratie historique. De toute manière, le philosophe ne s’engage pas outre mesure : quoique son travail ait pour point de départ l’extrême gravité de la menace climatique, il se garde bien d’aligner la « symétrisation » de la nature par rapport à « la société » sur les contraintes draconiennes nécessaires au respect de l’accord de Paris14. On ne saurait lui reprocher cette prudence : en effet, les chances d’arrêter la catastrophe climatique par les recettes de marché du capitalisme vert sont tout simplement inexistantes.
Cette absence de bouclage sur l’enjeu climatique n’est pas le seul paradoxe de l’ouvrage. En effet, alors qu’il pose le pillage colonial au principe de la modernité, Pierre Charbonnier ne se demande pas si sa perspective d’état social écologique (formé sur le modèle des États-providence européens) est extensive aux pays du Sud, aux anciennes colonies, aux nouvelles zones extractivistes. La social-démocratie verte a-t-elle le moindre avenir dans des pays soumis aux politiques impérialistes et néocolonialistes des pays du nord ? L’ouvrage ne pose pas cette question importante. Il ne suffit peut-être pas d’une méthode postcoloniale en histoire des idées pour résoudre le problème de l’impérialisme réel : il faut en plus une étude des structures (globales) du capitalisme.
Face à la terrible catastrophe écologique et sociale qui monte autour de nous, la nécessaire reconstruction d’un contre-pouvoir ne saurait être qu’une étape vers la prise du pouvoir. Quant à la réinvention de la liberté, elle ne saurait se satisfaire d’un « réarrangement des rapports de domination et d’exploitation »… en particulier en ce qui concerne les rapports Nord-Sud, qui restent fondés sur le pillage (néo) colonial. L’émancipation implique d’en finir avec toutes les dominations. Elle passe par l’abolition de l’exploitation capitaliste qui « épuise les deux seules sources de toute richesse – la Terre et le travailleur/la travailleuse » – parce qu’elle les a totalement séparées. En effet, « ce n’est pas l’unité des hommes vivants et actifs avec les conditions naturelles, inorganiques de leur métabolisme [Stoffwechsel] avec la nature ni, par conséquent, leur appropriation de la nature, qui demande à être expliquée ou qui est le résultat d’un procès historique, mais la séparation entre ces conditions inorganiques de l’existence humaine et cette existence active, séparation qui n’a été posée comme séparation totale que dans le rapport du travail salarié et du capital », comme l’écrivait Marx dans les Grundrisse. Selon nous, cette citation de Marx fournit, pour « réinventer la liberté », un point de départ plus adéquat et plus radical que « l’antiproductionnisme » comme objectif et la « symétrisation » comme méthode.
*
Je remercie pour leurs suggestions et leurs critiques Jérôme Bouvy, Paul Guilibert et Michael Löwy.
références
| ⇧1 | Allusion à Tim Jackson, Prospérité sans croissance, De Boeck-Etopia, 2010. |
|---|---|
| ⇧2 | Il est frappant que Charbonnier, dans son histoire environnementale des idées, ne se penche pas sur Malthus, penseur de l’abondance pour les nanti.e.s et adversaire de la liberté pour les exploité.e.s. Sur le « capitalisme agraire », voir Ellen Meiksins Wood, L’origine du capitalisme. Une étude approfondie, Lux, 2009. |
| ⇧3 | Douglas Weiner, Models Of Nature : Ecology, Conservation, and Cultural Revolution in Soviet Russia, University of Pittsburgh Press, 2000. |
| ⇧4 | Affordance : ensemble des caractéristiques d’un milieu ou d’un objet dont les humains peuvent se saisir pour réaliser leurs buts. |
| ⇧5 | Dans Trop tard pour être pessimistes. Écosocialisme ou effondrement (Textuel, 2020), j’ai attiré l’attention notamment sur cette citation très politique extraite du 5e rapport d’évaluation du GIEC : « Les modèles climatiques supposent des marchés qui fonctionnent pleinement et des comportements de marché concurrentiels ». |
| ⇧6 | Pour une critique substantielle de la pensée de Bruno Latour, lire R.H. Lossin, « Neoliberalism for Polite Company: Bruno Latour’s Pseudo-Materialist Coup », Salvage, juin 2020. |
| ⇧7 | Le capital devra « explorer toute la nature pour découvrir des objets de propriétés et d’usages nouveaux pour échanger, à l’échelle de l’univers, les produits de toutes les latitudes et de tous les pays, et soumettre les fruits de la nature à des traitements artificiels afin de leur donner des valeurs d’usage nouvelles » de « créer ainsi les conditions de développement de toutes les propriétés de l’homme social, d’un individu ayant le maximum de besoins, et donc riche des qualités les plus diverses, bref d’une création aussi universelle et totale que possible ». Karl Marx, Grundrisse, UGE 10-18,1973. |
| ⇧8 | Dans son ouvrage Karl Marx’s Ecosocialism. Capital, Nature and the Unfinished Critique of Political Economy (Monthly Review Press, 2017) Kohei Saito apporte, selon nous, une contribution décisive à l’appréhension de ces tensions en montrant comment l’analyse de la question des sols a conduit Marx à passer d’une vision « productiviste » à une vision « antiproductiviste » du développement humain. Son livre renforce la légitimité du marxisme antiproductiviste mais ne permet pas de faire de Marx un écosocialiste avant la lettre. |
| ⇧9 | Selon une expression d’Alain Prochiantz dans Singe toi-même, Odile Jacob, 2019. |
| ⇧10 | Sylvia Federici, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Entremonde, 2017. |
| ⇧11 | D’innombrables citations en attestent, notamment celle-ci: « Le travail est en premier lieu un processus auquel l’homme et la nature participent » (Le Capital, Livre 1). |
| ⇧12 | Lise Vogel, Marxism and the oppression of women. Toward a unitary theory, Brill, 2013. |
| ⇧13 | Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R. et al. « The value of the world’s ecosystem services and natural capital », Nature, 387, 1997, p. 253–260. |
| ⇧14 | Selon le rapport spécial 1,5°C du GIEC, les émissions mondiales nettes de CO2 doivent diminuer de 58% d’ici 2030 et de 100% d’ici 2050 pour avoir une chance sur deux de ne pas dépasser 1,5°C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle. Tenant compte des responsabilités historiques différenciées, les pays de l’UE devraient réduire leurs émissions de 65% environ. |