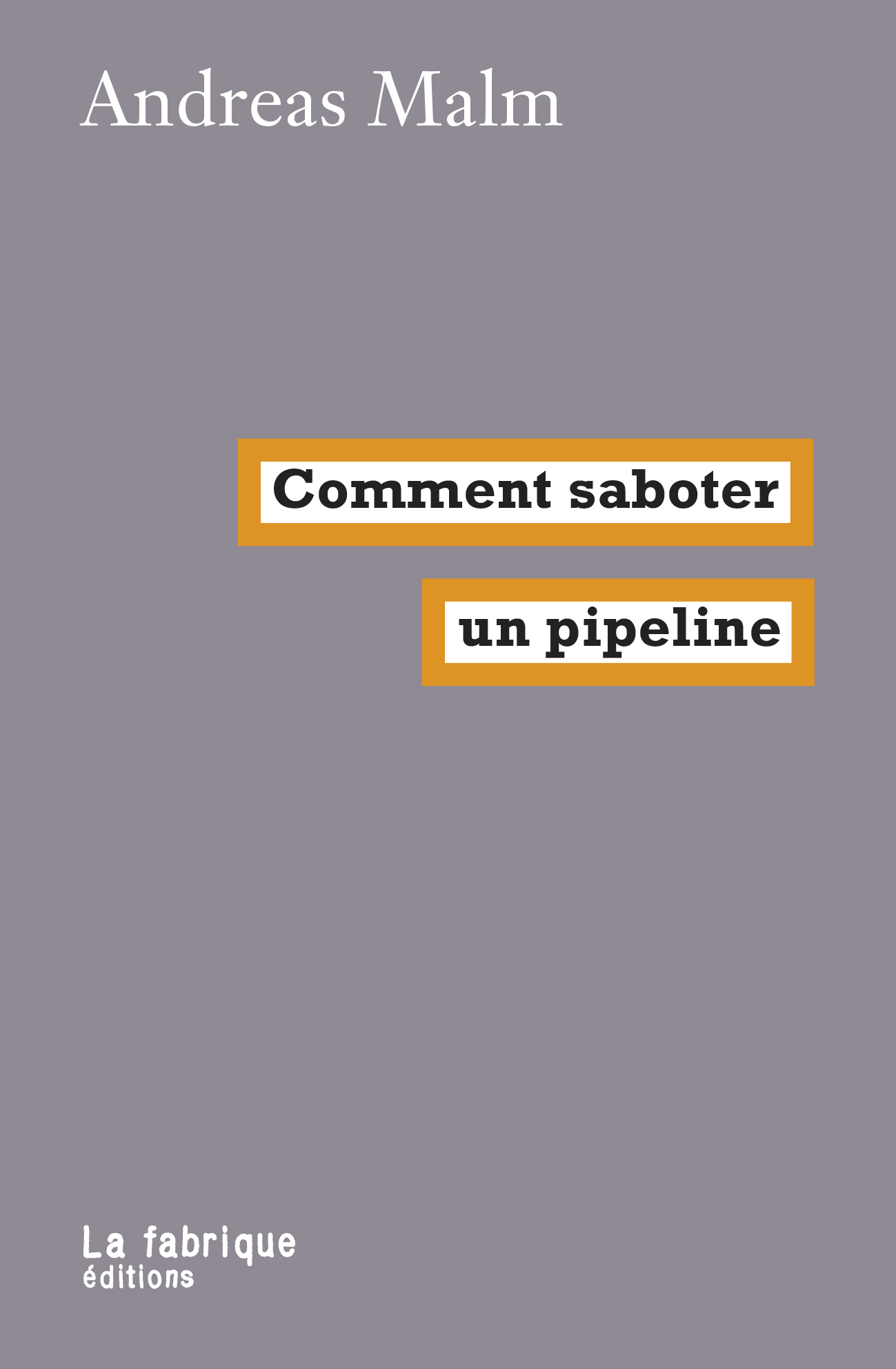
À propos des livres d’Andreas Malm, Comment saboter un pipeline (La Fabrique, 2020) et de Daniel Tanuro, Trop tard pour être pessimiste (Textuel, 2020).
***
Face aux changements climatiques, et plus généralement à l’accélération de la destruction des écosystèmes, l’écologie politique et les mouvements sociaux qui s’en réclament ont connu d’importants renouvellements ces dernières années, symbolisés par les immenses marches pour le climat, l’émergence de figures internationales, dont la plus charismatique demeure Greta Thunberg, ainsi que par une multitude d’écrits, de velléités théoriques, voire d’un nouveau vocabulaire, à l’instar de la « collapsologie ». De nombreux débats traversent cette floraison écologiste ; néanmoins, c’est souvent en creux que s’expriment des débats stratégiques, les mouvements écologistes étant relativement peu prolixes à ce sujet, hormis ceux qui, proches des partis verts, voient essentiellement dans la participation aux institutions et aux joutes électorales la seule voie crédible pour le changement.
De cette relative discrétion des questions stratégiques, qui n’est par ailleurs pas l’apanage des seuls mouvements écologistes, il ne faudrait pas déduire qu’aucune proposition ni aucun discours stratégique n’a émergé ces dernières années. Ne serait-ce que, dans le cas français, la lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes a donné lieu à un renouveau des questionnements stratégiques et le devenir de la ZAD est, de ce point de vue, un enjeu important.
L’intérêt de deux livres parus récemment est de remettre sur l’ouvrage les questions stratégiques qui traversent les mouvements écologistes et en particulier les mouvements pour le climat. Ils ont en outre comme point commun de se réclamer d’un marxisme écologiste, ou d’un écosocialisme plus ou moins affirmé. Le premier, Comment saboter un pipeline, a été écrit par Andreas Malm, géographe suédois et militant pour le climat ; le second, Trop tard pour être pessimistes !, par Daniel Tanuro, agronome, militant de la gauche radicale et des mouvements pour le climat en Belgique.
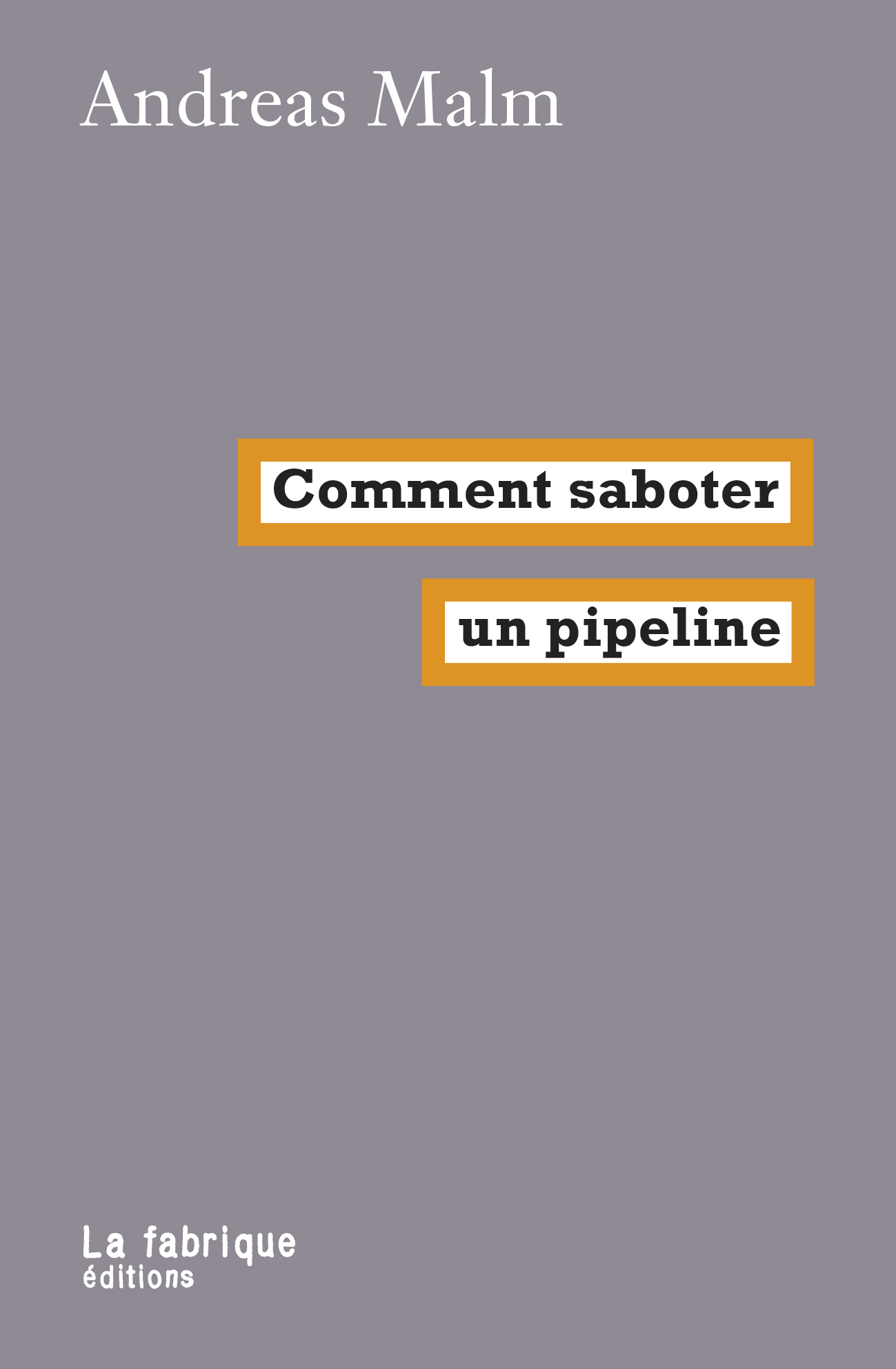
Andreas Malm ne propose pas à proprement parler de stratégie pour les mouvements pour le climat, mais s’interroge sur les limites des mobilisations récentes en les resituant dans une histoire plus ancienne et en essayant de débusquer les impasses de discours souvent perçus comme radicaux, car rompant avec l’inactivisme des ONG environnementalistes traditionnelles. Malm décrit la succession de vagues de ces mouvements depuis une quinzaine d’années. La première, entre 2006 et 2009 en Europe du Nord, a donné lieu à des occupations, des camps climat et bien sûr la mobilisation lors de la COP15 de Copenhague qui a marqué un tournant, négatif, dans les négociations internationales. La seconde, à partir de 2011 aux États-Unis, s’est caractérisée par la primauté donnée à la désobéissance civile, en particulier contre des projets de pipeline : sit-in devant la Maison Blanche, chaînes humaines, campagnes de désinvestissement des énergies fossiles, campement des nations sioux… La troisième vague, à partir de 2018, est celle de l’irruption de la jeunesse dans les marches climat, des Fridays for future, de la naissance du mouvement international Extinction Rebellion (XR) et des actions de blocage à Londres, Berlin, Paris et dans d’autres métropoles. La montée en puissance et la massification de ces mouvements rompent avec l’environnementalisme de bien des ONG institutionnalisées et ne nourrissent pas d’ambiguïtés quant à la dénonciation des responsables de la crise climatique et de l’incapacité des classes dominantes à apporter un début de solution aux dérèglements climatiques. Néanmoins, Malm s’interroge : alors que s’approfondit le mouvement et que chaque vague renforce la précédente, comment se fait-il que, malgré de petites victoires et de lourdes défaites, l’impératif de la non-violence soit toujours aussi puissant dans ces mouvements ? Voire que
« l’attachement à une non-violence absolue semble […] s’être renforcé d’une vague à l’autre, l’intériorisation de cette règle apparaissant universelle, la discipline remarquable » ?
Cette question traverse tout l’ouvrage et Malm revient sur les débats qui ont construit la non-violence comme enjeu majeur des mouvements climatiques, du moins dans les pays occidentaux. Il existe certes des raisons tactiques à la promotion de la non-violence : facilité à rejoindre les mouvements, sympathie médiatique, massification… Malm ne remet pas en cause ces vertus de la non-violence, mais il interpelle les activistes pour le climat : est-ce le seul moyen d’action ? Si les mouvements s’amplifient et que toujours rien ne change, ne sera-t-il pas temps de passer à d’autres pratiques ? Avant de répondre à ces questions, Malm fait un détour par les influences idéologiques permettant d’expliquer la prépondérance de la non-violence au sein des mouvements climatiques. Il mentionne par exemple le pacifisme moral de Bill McKibben, fondateur de l’association 350.org, ou le pacifisme stratégique de mouvements et de penseurs qui considèrent que la violence éloigne les mouvements sociaux de leurs objectifs. Ici, Malm cible surtout XR, dont le fondateur peut ainsi expliquer :
« la science sociale est formelle sur ce point : la violence n’optimise pas les chances d’issues progressistes victorieuses. De fait elle mène presque toujours au fascisme et à l’autoritarisme. La seule solution est donc la non-violence. »
Cette certitude tirée de la « science sociale » ne peut qu’étonner et mérite un certain nombre de rectifications auxquelles se livre Malm quant à la question de la violence dans les mouvements d’émancipation. Il remet ainsi en cause la lecture unilatérale, et parfois falsificatrice, de mouvements populaires du 20e siècle par XR, œuvre salutaire tant les discours militants peuvent être saturés de demi- ou de contre-vérités à ce sujet, visant à susciter des analogies entre les luttes du passé et les mouvements climatiques actuels, la « vérité historique » servant d’argument-massue. Parmi ces analogies, citons la lutte contre l’esclavage, les suffragettes, Gandhi, les mouvements pour les droits civiques aux États-Unis, la lutte contre l’apartheid, les mobilisations contre la poll tax sous Thatcher ou encore la chute de Milosevic ou de Moubarak. Le point commun de ces évènements serait, dans la lecture des fondateurs d’XR, leur non-violence. Or, rappelle Malm, non seulement cette version de l’histoire oublie une partie des protagonistes, par exemple les esclaves eux-mêmes dans la lutte contre l’esclavage, mais elle déforme également la vérité quant aux modes d’action utilisés. Ainsi, les suffragettes privilégiaient la destruction de biens ; les actions des militants pour les droits civiques étaient protégées par des armes et mettaient en œuvre, non sans tensions, une dialectique entre non-violence et violence ; l’ANC a créé en Afrique du Sud une organisation secrète dont le principal mode d’action était le sabotage, etc. Quant à Gandhi, figure tutélaire des mouvements se revendiquant de la non-violence, Malm ne manque pas de rappeler les fluctuations de sa vie politique, son exhortation aux Juifs d’Allemagne en 1938 à s’en tenir à la non-violence, et le fait que l’indépendance indienne ne peut être attribuée à la seule stratégie non-violente, l’Inde comme de nombreuses colonies ayant connu des luttes de décolonisation souvent très violentes.
Outre ces rappels bienvenus, Malm critique la façon dont la non-violence est devenue dans une large partie des mouvements pour le climat un fétiche sacré, qui empêche toute réflexion tactique et stratégique. Le « mélange de niaiserie et de falsification » qu’il décèle notamment chez XR fait que la non-violence ne peut jamais être réellement évaluée à l’aune de son efficacité ou de son inefficacité. Alors que les situations historiques évoquées sont sans commune mesure avec les enjeux posés par les changements climatiques, les analogies dans les discours écologistes deviennent non pas des outils pour saisir des situations politiques particulières mais des grigris permettant d’ériger la non-violence en valeur morale incontestable. L’histoire « aseptisée, dénuée de toute évaluation réaliste de ce qui s’est produit ou non » minimise les rapports de force, les intérêts en jeu, ne permet pas aux militant-e-s pour le climat d’être lucides face aux forces qu’il s’agit d’affronter. Au fond, on mesure là un des effets de la dévaluation des idéaux et perspectives révolutionnaires, qui laisse d’autant plus de place à l’idée qu’une succession de changements localisés pourrait conduire à un changement profond et ainsi « sauver le climat ».

Le dernier ouvrage de Daniel Tanuro couvre un spectre de questions bien plus larges que celui de Malm. Il revient de manière très éclairante et pédagogique sur la profondeur de la crise écologique en cours, sur les réponses capitalistes à cette crise, sur les biais des recherches scientifiques sur le climat et la conservation des espèces. Les deux derniers chapitres sont consacrés aux débats stratégiques qui traversent l’écologie politique. Tanuro commence par démontrer que la racine du problème climatique est le mode de production capitaliste et sa colonne vertébrale technique, le système énergétique basé sur l’exploitation des fossiles. L’écologie libérale, qui mêle recettes technologiques et exhortations morales, est donc une impasse, ce dont conviennent nombre de militants écologistes. Pour autant, dans la galaxie des propositions de l’écologie libérale, certaines sont mâtinées d’une dimension sociale, et font l’objet de débats dans les mouvements sociaux ; Tanuro prend ainsi l’exemple de la taxe carbone proposée par le célèbre climatologue James Hansen, soit une taxe à taux élevé progressant chaque année et dont le produit serait versé à tou-te-s sous forme d’un dividende identique, les plus pauvres pouvant ainsi augmenter leurs revenus en limitant leurs émissions de gaz à effet de serre, tandis que ceux qui polluent le plus paieraient des prix majorés supérieurs au dividende. Cette proposition tourne le dos à une régulation qui serait fondée sur des objectifs de réductions de gaz à effet de serre à atteindre ; de plus, les cas récents de forte augmentation des prix de l’énergie n’ont pas montré d’effets majeurs sur la baisse des consommations. Enfin, une telle proposition pose la question d’un prix mondial du carbone qui serait fixé par les pays riches, ce qui risque de se transformer en « coopération forcée » entre le Nord et le Sud, autrement dit une forme adoucie de néocolonialisme vert.
Tanuro prend également pour cible d’autres courants écologistes. Deux de ces courants d’idées méritent qu’on s’y arrête tant leur succès idéologique, sinon leur influence, est grande chez une partie des écologistes[1]. Le premier n’est pas à proprement parler un courant théorique structuré. Il s’appuie essentiellement sur une critique de la technique élaborée par Jacques Ellul dans Le système technicien paru en 1977. L’apport d’Ellul n’est pas négligeable dans la pensée écologique, notamment par sa remise en cause d’une supposée neutralité des techniques. Cependant le fait de renvoyer la critique non pas vers une organisation économique et un système de dominations sociales plurielles, mais plutôt vers « la Technique » (au singulier), affaiblit considérablement le propos et fait disparaître le rôle du capitalisme dans la domination sur la nature. Sans compter des aspects franchement conservateurs qui découlent de l’approche ellulienne de la technique, laquelle réfute l’exigence d’égalité absolue et est pour le moins ambiguë sur la pilule contraceptive et l’avortement, décrites comme des techniques (donc a priori suspectes) permettant d’augmenter l’irresponsabilité des individus, des femmes en l’occurrence ; on trouve aujourd’hui de tels accents réactionnaires chez certains mouvements anti-industrialistes hostiles par exemple à la PMA et l’analysant comme une mainmise de la technoscience sur la reproduction[2]. Le second courant idéologique est bien plus récent et son succès résonne autant comme un avertissement face à la profondeur de la crise écologique que comme l’impasse d’un certain catastrophisme. Les collapsologues[3] connaissent en effet un certain succès, leurs livres se vendent comme des petits pains. Pourtant leurs principaux écrits sont marqués d’une part par une faiblesse théorique, due notamment au fait qu’ils considèrent les phénomènes sociaux comme les phénomènes étudiés par les sciences dures, réglés donc par des lois naturelles face auxquelles il est inutile d’agir ; d’autre part par un fatalisme et une quasi-absence de propositions politiques, hormis le beau mot d’ordre de l’entraide, qui est cependant de faible portée face à nos adversaires ; et enfin par des propos qui flirtent parfois avec le néo-malthusianisme, voire des prévisions dignes de Mme Soleil[4]. On ne peut que déplorer l’écart entre le constat réalisé par les collapsologues, basé le plus souvent sur une compilation acritique de rapports scientifiques, et leur indigence politique. Dès lors qu’ils s’avèrent incapables d’identifier le problème, ils n’apportent pas le début d’une solution. « Pour eux, le véhicule qui va dans le mur est un monstre mécanique sans chauffeur. Il n’y a pas d’ennemi, pas d’adversaire, pas de classes sociales », et donc pas de politique, seulement une pseudo-« collapsosophie » permettant de « vivre l’effondrement plutôt que d’y survivre ». Si on peut observer avec Tanuro une diversité des approches collapsologues (libertaire, bouddhiste, survivaliste, régressive…), on ne peut que s’interroger sur les succès de librairies des principaux auteurs en la matière. Attrait des récits-catastrophes ? Illusion d’une radicalité du discours ? Effet de mode passager facilité par la personnalité de Pablo Servigne ? Confusionnisme ambiant et régression des idéaux d’émancipation ? Toujours est-il que ce succès pose question à la gauche écologiste, en particulier aux écosocialistes qui n’ont pas vraiment réussi jusque-là à faire vivre leurs idées et leurs propositions à une aussi large échelle.
C’est donc là tout l’intérêt des livres de Malm et de Tanuro que de contribuer aux débats stratégiques posés par les luttes écologistes, sans concession ni sectarisme. En effet, face au confusionnisme ambiant et au peu de perspectives de changement radical, on doit être à la fois exigeant et modeste, tant les enjeux posés par les changements climatiques sont immenses et ne peuvent se résoudre par des slogans du type « écosocialisme ou barbarie ». Malm ne délivre cependant pas une approche stratégique très développée. Il se centre sur deux enjeux complémentaires : l’usage de la violence et la question des alliances entre des mouvements sociaux de différentes natures. Remettant en cause les divers arguments en faveur de la non-violence (asymétrie des forces entre les activistes et les États, idée que ce ne serait jamais le bon moment pour la violence, risques de minoration des mouvements à cause de la violence et de perte du soutien populaire, caractère non démocratique de la violence…), il émet l’hypothèse d’une « augmentation tendancielle de la réceptivité » de la violence au fur et à mesure de l’avancée de la catastrophe climatique ; autrement dit :
« à six degrés d’augmentation, l’envie de faire sauter des pipelines pourrait bien être à peu près universelle dans ce qu’il restera d’humanité. »
Ce n’est donc pas la violence ou la non-violence en tant que telles, ou comme valeurs morales, qui intéressent Malm, mais bien leurs effets politiques, et donc la capacité des mouvements écologistes à amplifier l’acceptabilité des luttes radicales et de modes d’action déterminés. Dans le cas français, les exemples de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou les Gilets Jaunes semblent montrer qu’un certain usage de la violence ne fait pas s’évaporer le soutien aux mouvements. L’exercice d’équilibriste que doivent mettre en œuvre les militant-e-s doit donc, sans avoir peur d’être calomnié-e-s par certains, permettre de recueillir des soutiens tout en faisant augmenter le degré le niveau d’engagement. D’où sa proposition de « sabotage intelligent », nécessitant des choix pertinents quant aux cibles et au timing. Peut-être plus important que ces propositions sur le sabotage, Malm explicite la nécessaire complémentarité entre différentes franges des mouvements écologistes. L’unanimisme et le conformisme qui accompagnent les discours favorables à la non-violence doivent donc laisser place à des alliances et des complicités qui passeront nécessairement par des tensions, qu’il ne faut pas rejeter mais bien plutôt travailler pour avancer dans le sens d’une division du travail militant « où les radicaux et les modérés jouent des rôles très différents[5] ». Là encore, chaque situation doit être évaluée en fonction des effets possibles des actions respectives des uns et des autres, des dilemmes qui se posent au sein d’un mouvement qui doit se penser dans son unicité et sa diversité, notamment dans les épisodes de répression.
L’ambition stratégique de Tanuro est bien plus ample que celle de Malm et se fonde sur la définition d’une politique écosocialiste, dont il brosse à grands traits le projet de société :
« une société débarrassée de l’argent, de la propriété privée des moyens de production, des États, de leurs armées, de leurs polices et de leurs frontières. Une société dans laquelle le travail abstrait […] disparaît au profit de l’activité concrète, créatrice de valeurs d’usage, porteuse de sens, génératrice de reconnaissance sociale et de réalisation personnelle. Une société qui abolit la distinction entre travail manuel et intellectuel. Une société organisée en communautés autogérées, coordonnées de façon souple et démocratique par des délégué-e-s bénévoles et révocables. Une société qui a la maîtrise du temps, dans laquelle la pensée et les relations sociales – la coopération, le jeu, l’amour, le soin – sont la vraie richesse humaine. »
Autrement dit, une inspiration communiste antiproductiviste enrichie des apports des pensées écoféministes, décoloniales et autres, et non réductible à une écologie sociale pensée à une échelle locale, dans son versant municipaliste tel que le défendent des militant-e-s inspirés par Murray Bookchin, auteur libertaire récemment republié. Une des divergences majeures les militant-e-s qui se réclament aujourd’hui du municipalisme concerne la façon de coordonner les politiques à différents échelons et les formes de pouvoir politique, soit deux questions essentielles : l’État et la planification. Si le municipalisme connaît aujourd’hui un petit effet de mode, c’est qu’il semble se situer à un niveau d’appropriation démocratique accessible, à la possibilité d’un ancrage territorial de la politique, qu’il permet de limiter les phénomènes bureaucratiques et de domination politique. Certes. Cependant, il crée aussi des illusions sur les échelles du pouvoir, sur la capacité d’un territoire, fut-il émancipé du capitalisme, à renverser la table à un plus vaste niveau. Cette tendance à « miniaturiser » les luttes et l’échelle de la politique, selon l’expression de Barbara Stiegler[6], peut se comprendre au vu de l’immensité des défis et la nature des rapports de force actuels, cependant, le problème des changements climatiques ne peut être résolu à un niveau local, il appelle d’emblée des réponses de différentes dimensions. D’où pour Tanuro la nécessité de combiner conquête du pouvoir politique et planification qui se déclinerait à différentes échelles, prendrait appui sur « la conscientisation, la responsabilisation, l’auto-activité et le droit au contrôle de toustes », avec des élaborations produites « par les groupes sociaux, jusque dans les territoires, sur les lieux de vie et de travail. » L’ampleur de la tâche est immense, l’auteur le reconnaît, et exige de manier de concert plusieurs principes : centralisation et décentralisation, pouvoir politique populaire et lutte contre la bureaucratie, démocratie des savoirs et démocratie économique…
Sans prétendre dresser un tableau précis d’une telle planification, Tanuro précise trois priorités : démantèlement, socialisation et décentralisation des monopoles de l’énergie, de l’agrobusiness et de la finance ; suppression des productions inutiles et nuisibles ; encadrement strict des processus de production (efficience énergétique, durabilité, recyclage…), ainsi que huit principes généraux autour desquels penser un plan écosocialiste démocratique. On trouvera ici de précieux exemples et indications, tant concernant le travail, le soin, la protection sociale, que les modes de production, l’autogestion… Cependant l’auteur demeure peu disert sur la façon d’aboutir à cet « État aux mains des exploité-es et des opprimé-e-s » qu’il appelle de ses vœux et qui serait susceptible de mettre en branle le début d’une planification dont la visée devrait être rapidement mondiale. S’il s’agit là d’une question extrêmement complexe, et qui varie selon les situations politiques nationales, elle nécessiterait d’être réellement prise à bras-le-corps, au risque sinon que les propositions écosocialistes restent seulement un bon outil d’agitation et de pédagogie politiques, mais avec peu d’effets sur le réel. Or, la question des institutions, de l’État, de leur éventuelle conquête, fait autant partie du problème que de la solution[7]. Le débat est ancien et ne concerne pas seulement les réponses à apporter aux changements climatiques, cependant l’urgence qui fait qu’on ne peut pas attendre encore dix ans pour des changements substantiels peut conduire à des raccourcis de différentes natures. Il nous faut alors circuler entre diverses perspectives qui représentent autant d’écueils : celle d’un État néolibéral verdi qui couple écologie, croissancisme et privilèges accordés aux entreprises ; celle d’un État néo-keynésien écologisé qui confie aux experts et aux bureaucrates le soin de planifier la transition sans intervention populaire ; celle d’une autonomie ou d’une pensée des communs qui peut offrir des pistes quant à l’auto-institution de la société et aux processus autogestionnaires mais tend au final à contourner l’obstacle que constitue la question de l’État.
Tanuro traite une autre question souvent absente des débats écologistes centrés sur les institutions, celles de la caractérisation des groupes sociaux qui seraient les acteurs possibles de changements systémiques. Si le prolétariat comme groupe premier voire unique de la transformation sociale a depuis longtemps été remisé dans les poubelles de l’histoire, cet héritage du 20e siècle n’a pas vraiment laissé place à une lecture plus complexe des agents sociaux ; et c’est souvent en tant que citoyen-ne-s, tou-te-s concern-é-s au même titre, que nous sommes conviés à nous mobiliser pour le climat. Tanuro en appelle de son côté à des alliances entre groupes sociaux subalternes qui peuvent chacun à leur manière construire leur propre écologie, et il insiste sur l’enjeu stratégique du monde du travail et à son rôle dans la nécessaire transformation des processus productifs, soulignant les limites du syndicalisme quant à leur implication dans les luttes pour le climat mais également les évolutions positives récentes dans certains pays. Il précise que trois acteurs à l’échelle mondiale jouent un rôle majeur dans les luttes écologistes contemporaines : les paysans, les femmes et les jeunes.
Au final, le livre de Tanuro est un très bon outil pour les activistes, ceux et celles qui luttent pied à pied contre la catastrophe climatique, il énonce les fondements d’un projet émancipateur et antiproductiviste et constitue une excellente contribution aux débats stratégiques des mouvements écologistes. Mais en esquivant la question du champ politique, des initiatives à prendre à ce niveau, il laisse un certain nombre de questions en suspens, questions qui dépassent sans doute le cadre de cet ouvrage. Reste alors, et c’est à la fois la force du livre et sa limite, à manifester un volontarisme qui congédie le pessimisme :
« Aux écosocialistes de faire en sorte que le rouge et le vert se marient pour changer le monde. Il n’y a qu’une certitude : ʺCelui qui combat n’est pas sûr de gagner, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu (Bertold Brecht)ʺ. Il est trop tard pour être pessimistes. Il faut se battre. »
Nul doute qu’Andreas Malm serait d’accord avec une telle conclusion, lui dont l’ouvrage exprime aussi bien la nécessité radicale d’agir radicalement, mais qui dévoile en creux les difficultés à trouver les bonnes cibles et les moyens d’action pertinents qui se doivent d’être efficaces, populaires et permettre de dynamiser les combats présents et à venir. Ses propositions en matière de sabotage contre les infrastructures des énergies fossiles ne sont que partiellement convaincantes quant à leur possible efficacité. Elles ont le mérite de bousculer les débats qui traversent les mouvances écologistes, les principes de « consensus d’action » ou de non-violence, mais apparaissent assez décalées par rapport à la réalité des mouvements pour le climat, y compris ses franges radicales.
Malgré ces quelques limites, les livres de Tanuro et de Malm sont des outils politiques fort utiles, soulèvent nombre de questions essentielles qui mettent en lumière et cherchent à affronter un dilemme que Malm pointait dans un récent entretien à Contretemps, à savoir le fait que le mouvement climat « se fixe une tâche objectivement révolutionnaire – renverser le capital fossile, du moins, au minimum, séparer le capitalisme de la forme d’énergie qui lui a servi de substrat matériel universel depuis le début du XIXe siècle – à une époque où la politique révolutionnaire est passée de mode ». Problème majeur qui ne devrait échapper à aucun écologiste conséquent.
[1] Daniel Tanuro analyse également les limites des approches de la deep ecology, de l’écologie mystique et de celles qui évoquent une « valeur intrinsèque de la nature ». Il débat également avec ceux qui cherchent la solution dans une économie stationnaire (non croissanciste) et un « rétrécissement » et une « marginalisation » du capitalisme (Christian Arnsperger et Dominique Bourg). Il revient également de manière critique en fin d’ouvrage sur le Green New Deal porté par Alexandria Ocasio-Cortez et Bernie Sanders.
[2] C’est notamment le cas du collectif Pièces et Main d’œuvre, connu particulièrement au sein de la mouvance libertaire pour ses écrits contre la société industrielle et qui a produit ou diffusé des textes réactionnaires, sexistes et racistes. Voir à ce sujet : https://timult.poivron.org/08/timult-08-201409.pdf ; « PMA, homoparentalité, filiation : à propos de la pensée réactionnaire de quelques écologistes » publié sur http://grenoble.indymedia.org.
[3] Attention cependant à ne pas ranger derrière cette dénomination fourre-tout l’ensemble des militant-e-s qui s’interrogent sur la notion d’effondrement et peuvent l’utiliser politiquement de façon pertinente ; voir par exemple Renaud Duterme, De quoi l’effondrement est-il le nom ?: La fragmentation du monde, Editions Utopia, 2018, ou encore Luc Semal, Face à l’effondrement. Militer à l’ombre des catastrophes, PUF, 2019.
[4] Voir par exemple le calendrier des années à venir que fixait Yves Cochet en 2017. Depuis, il attend la fin du monde dans sa maison de campagne et ses quelques hectares de verdure…
[5] Herberts H. Haines, Black radicals and the civil rights mainstream, 1954-1970, University of Tennessee Press, 1988, cité par Malm.
[6] Barbara Stiegler, Du cap aux grèves. Récit d’une mobilisation. 17 novembre 2018 – 17 mars 2020, Verdier, 2020.
[7] « Face à la catastrophe : avec ou contre l’État ? », dossier de la revue Écologie & Politique, n° 53, 2016.