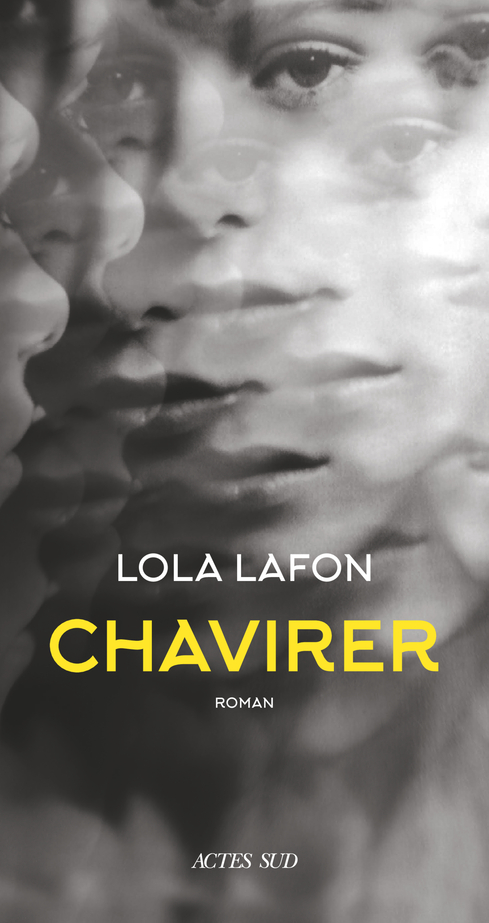
À propos de : Lola Lafon, Chavirer, Actes Sud, 2020.
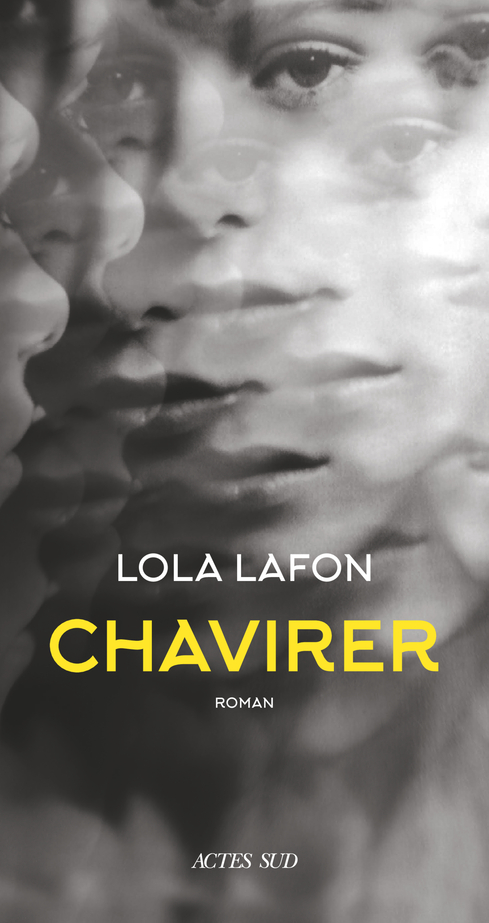
La littérature contemporaine est souvent taxée de nombrilisme. Tournée vers son auteur, son autrice ou sur elle-même plutôt que vers son lectorat, elle aurait remplacé les évènements du monde par les micro-évènements d’un « je » de plus en plus restreint à un petit milieu. Cette critique n’est pas dénuée de toute pertinence. Cependant, les écrits contemporains sont pluriels. Loin des récits autocentrés ou cyniques qui se complaisent dans une lucidité sans débouchés nous voudrions, dans cette chronique, mettre en valeur d’autres littératures : celles qui ne renoncent pas à dire le monde, ses luttes, ses échecs et ses espoirs.
***
« Ce n’est pas avec de bons sentiments qu’on fait de la bonne littérature ». Cette célèbre citation attribuée à Gide a trop souvent été inversée : il faudrait du cynisme cru, des déballages obscènes, des descriptions trashs pour faire littérature. Et nous pourrions penser, en lisant les premiers chapitres de Chavirer, qu’encore une fois, nous n’échapperons pas à l’abjection : l’histoire n’est-elle pas celle d’une adolescente de treize ans, Cléo, qui, croyant avoir des chances d’être sélectionnée par une prestigieuse fondation pour devenir danseuse, tombe dans un guet-apens sexuel et entraîne une multitude d’autres enfants avec elle ? Mais Lola Lafon ne cède à aucune facilité. Si elle exhibe la laideur cachée derrière les faux-semblants clinquants d’une société de consommation et de compétition, ce n’est pas pour se complaire dans le sordide, mais pour aller chercher une autre beauté, une beauté fragile, ténue, mais une beauté qui tient bon malgré tout.
Chavirer, un roman militant ? Un roman de « bons sentiments » ? C’est sans nul doute un roman qui affronte sans ciller les débats contemporains : le « moment me too » (« mitou », comme le dit une des protagonistes), ses déclinaisons en termes de genre, de classe et de race. C’est un roman qui aborde la question des violences sexuelles, mais aussi du racisme et de l’antisémitisme. Comment Lola Lafon arrive-t-elle alors à ne pas tomber dans un didactisme intersectionnel pesant ?
Tout d’abord par le choix de ses personnages, par le dessin subtil de la silhouette de Cléo. Cléo est une « incertaine », elle fait partie de celles « qui ne s’en sortent pas, ou laborieusement sans gloire ». Son déchirement nous tend le miroir de nos malaises : « ce n’est pas ce à quoi on nous oblige qui nous détruit, mais ce à quoi nous consentons qui nous ébrèche ; ces hontes minuscules, de consentir journellement à renforcer ce qu’on dénonce ».
Mais aussi grâce à son style. Le sujet de Chavirer, au-delà des violences, c’est, comme souvent dans l’œuvre de Lola Lafon[1], la lutte des corps féminins, ces corps qui souffrent, qui se souviennent, mais qui luttent, qui se déploient, qui se métamorphosent dans la danse. Or le style de Lola Lafon épouse magnifiquement ce sujet. Son écriture est à la fois très incarnée et extrêmement syncopée : elle joue sans cesse sur des effets de suggestions, d’ellipses, de ruptures. Ainsi, si la narration se déroule sur trois décennies, de 1979 à 2019, elle est morcelée, à l’image de l’identité de Cléo, dont le corps est offert « en pièces détachées » à ces adultes qui lui ont appris « la solitude des trahisons ».
Lola Lafon nous offre des trouées violentes, des visions fulgurantes, qui s’achèvent souvent avec discrétion et pudeur. Le très beau passage sur Yom Kippour, lorsque le père de Yonasz explique à Cléo que « [l]e pardon n’[est] pas l’oubli » que « pardonner [est] une décision, celle de renoncer à faire payer à l’autre [o]u à soi-même » reste suspendu : Lola Lafon n’épilogue pas sur la réaction de l’adolescente. La page se tourne.
Chavirer : le titre du livre saisit un moment, celui où on bascule, où l’on est sur le point de tomber, de se noyer peut-être. Mais où on ne tombe pas forcément, où on peut faire un bond, ce bond de danseuse qui permet à Cléo de franchir les grilles du Sacré-Cœur… où on peut être rattrapée par un geste, celui que Claude, l’habilleuse, ne fait pas en ne signant pas la pétition proposée par « ses filles » (les danseuses), où on peut être sauvée par une étreinte, celle que Lara ne donne pas, mais celle qui clôt finalement le roman.
Dans Chavirer, la beauté, si elle prend quelquefois les formes du tragique, n’a pas besoin d’être blasée ou désespérante. Elle sait se réinventer, traverser des « décors, des apparences, une vie de nuit et de recommencements ». C’est cette beauté qui apparaît dès les magnifiques premières pages du roman, qui scrutent les mécanismes de l’illusion scénique, lorsque les danseuses se produisent sur scène. Si « de loin, on n’en percevait rien », la narration nous amène au plus près, dans « les accrocs, les faux plis, les traces de cellulite, les cicatrices » de la mise en scène des corps. Mais de cette observation sans concessions, naît une nouvelle lumière, qui n’est plus celle de la fascination, mais de l’acuité. Lola Lafon nous démontre magistralement que la beauté peut être lucide, et nous l’en remercions.
*
Illustration : « Vol d’oiseau », Etienne-Jules Marey (chronophotographie sur plaque fixe).
[1] On peut citer tout particulièrement La Petite communiste qui ne souriait jamais (Actes Sud, 2014) qui met en scène un échange imaginaire avec la gymnaste Nadia Comăneci, mais aussi le poignant Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s’annonce (Flammarion, 2011).