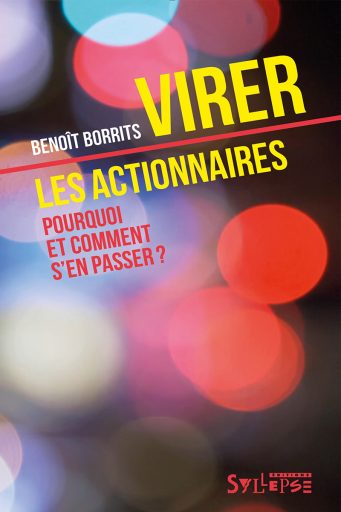
Benoît Borrits, Virer les actionnaires. Pourquoi et comment s’en passer ? Paris, Syllepse, 2020.
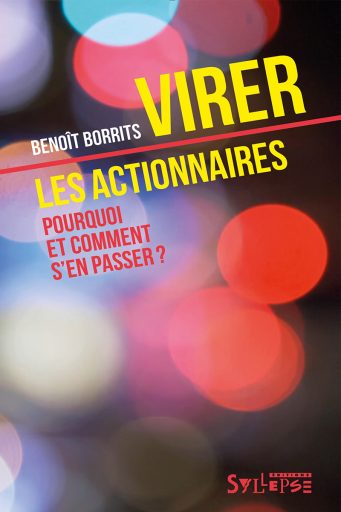
Le capitalisme triomphant des années 1990 a perdu de sa superbe. Après avoir promis monts et merveilles, il s’est mué en une machine infernale produisant de la régression sociale et des inégalités, incapable de faire face au changement climatique, et sécrétant une montée générale de l’autoritarisme en lieu et place de la démocratie promise.
Face à cela, les programmes de la gauche institutionnelle estiment qu’il faut repartager les richesses et orienter le capitalisme dans le sens de l’intérêt général. Si les profits des entreprises n’ont jamais été aussi imposants, ne pourrait-on pas les réduire pour faire place à plus de social et d’écologie, se demandent-ils ?
Mais ce n’est guère possible car la valeur de l’entreprise est spéculative et déterminée par les anticipations des dividendes. Si les profits sont moindres, les valorisations baisseront et les actionnaires cesseront d’investir même si l’entreprise gagne de l’argent.
Une politique sociale et écologique sérieuse doit donc exproprier les actionnaires pour laisser place à des entreprises autogérées par leurs salariés, les usagers et les citoyens.
Une nouvelle définition de la démocratie se dessine : une rencontre permanente entre des travailleurs et des usagers ou citoyens pour décider et réaliser ensemble.
Le livre se conclut sur l’amorce d’un programme de transformation qui conjugue des mesures sociales et écologiques avec une stratégie d’éviction des actionnaires. Ce programme, adapté à un pays de la zone euro, intègre divers scénarios liés à cette situation.
Afin de faciliter la compréhension des mécanismes économiques ou de compléter ses connaissances, le livre renvoie à des « tutoriels » en ligne (economie.org) où l’auteur décrypte le fonctionnement de la finance, de l’argent et la macroéconomie.
Outil pédagogique, le livre est articulé avec les apports aujourd’hui indispensables de l’apprentissage et de l’acquisition des connaissances en ligne.
L’ouvrage engage une réflexion sur le dépassement de la notion même de propriété des moyens de production et trace une voie de transition pour en sortir.
Nous avons vu au travers des trois chapitres précédents combien le système capitaliste est devenu fragile et source de désordres. Un système dont les décisions d’investissement sont soumises au bon vouloir des propriétaires des moyens de production, lesquelles décisions sont déterminées par une rentabilité exigée égale à l’addition du taux d’intérêt et d’une prime de risque définie par le marché.
Face à ce système, les gouvernements font tout leur possible pour réduire cette prime de risque en donnant le cadre juridique et social le plus favorable aux actionnaires, quitte à recourir à l’autoritarisme aux dépens de la démocratie. Ils en viennent à déployer des efforts financiers sans commune mesure avec les résultats, comme nous avons pu le voir avec les créations d’emplois résultantes du CICE ou pire, ces grands travaux inutiles qui bousillent notre planète à petit feu. De plus, un moteur essentiel des bénéfices des entreprises est un endettement collectif ou individuel d’une partie de la population au profit d’une minorité, endettement de plus en plus massif et donc insoutenable à terme. Il serait temps qu’enfin, les responsables politiques, et tout particulièrement ceux de gauche et de l’écologie politique, prennent en compte cette donne pour envisager la sortie du capitalisme.
La survie du capitalisme ne tient que parce qu’il y a des gouvernements qui font tout pour que les sociétés de capitaux puissent prospérer. Il nous faut désormais concevoir un gouvernement qui travaillera dans le sens inverse et préparera la transition. Ceci suppose de s’investir dans la politique institutionnelle avec un mouvement ou un parti qui se porte candidat au pouvoir et participe aux élections sur la base d’un programme de sortie du capitalisme.
On peut certes considérer que le jeu institutionnel est bloqué, qu’un tel parti n’aura jamais aucune chance et que, dans ces conditions, la seule chose raisonnablement sérieuse serait de préparer une insurrection, une grève générale qui mettrait à bas les institutions actuelles. Adopter une telle position revient à se perdre en conjectures. On peut certes entretenir l’agitation politique en vue d’une insurrection, il n’en reste pas moins vrai que celle-ci reste imprévisible et que rien ne serait pire qu’un déclenchement artificiel car il revient à déposséder celles et ceux au nom de qui cette insurrection a été initiée. Au-delà de cette remarque, une insurrection ne débouche pas automatiquement sur une meilleure société : elle peut certes être porteuse de progrès social et humain mais aussi déboucher sur des sociétés dictatoriales et régressives, comme le passé a su nous le montrer. Il est donc essentiel de préparer bien en amont le projet, qu’il soit largement discuté et intégré par une grande partie de la population, ce qui sera de toute façon essentiel en cas d’insurrection spontanée.
Autre cas de figure qu’il convient de ne pas écarter et dont la problématique est proche de celle de l’insurrection en termes de rupture : une crise majeure du capitalisme dont l’accumulation d’endettements sera sans doute la cause. Nous avons largement frôlé celle-ci en 2008 et les États ont alors été capables de l’enrayer en recourant à des déficits publics massifs. Le pourront-ils la prochaine fois, ce que l’économiste Nouriel Roubini questionne à juste titre[1] ? Il faut comprendre que toute crise de dette peut entraîner des effets en cascades qui remettent en cause d’autres créances et peut-être même la monnaie. Dans une telle hypothèse, il convient donc de savoir quelle société et quelle économie nous voulons construire sur ces ruines…
Dans tous les cas, insurrection comme crise majeure du capitalisme ou une conjonction des deux, le débat démocratique a toute sa place dès maintenant et la construction d’un parti ou mouvement postcapitaliste doit être entamée sans tarder. On objectera que des partis de gauche existent dont certains affichent une visée postcapitaliste. C’est une réalité historique. Est-ce que ces partis ont une réelle visée postcapitaliste ou s’agit-il seulement d’une posture ? Nous reviendrons sur cette question essentielle dans la conclusion. Disons simplement que leurs discours et leurs programmes sont, pour l’instant, assez différents de ce que nous allons maintenant exposer.
Nous avons vu au premier chapitre l’importance de la valorisation des entreprises déterminée par les espérances de dividendes futurs. Salaires et dividendes étant rivaux, toute hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée aura des effets sur la valorisation des entreprises. Comme nous l’avons dit précédemment, une baisse de valorisation des entreprises ne saurait nous émouvoir à ceci près qu’elle induira probablement une baisse des investissements de la part des propriétaires. Les laisser au pouvoir dans les entreprises ne peut que nous conduire à la défaite : il est donc nécessaire d’évincer les actionnaires si nous voulons que le progrès social apporté par la hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée ne soit pas mis en péril par une baisse soudaine et surtout incontrôlée de la production.
Comment les évincer ? Le plus simple serait que la constitution contienne des dispositifs qui autorisent l’éviction des actionnaires dès que l’urgence sociale se fait sentir[2]. Dans un livre récent[3], Emmanuel Dockès défendait l’interdiction de la propriété dominante comme une des caractéristiques du régime de la Misarchie, néologisme d’origine grecque signifiant « qui n’aime pas l’autorité ». La propriété dominante se définit comme une propriété dont nous n’avons pas l’usage. Interdire la propriété dominante rend impossible le fait d’être propriétaire d’une entreprise dans laquelle on ne travaille pas ou d’un logement que l’on loue à d’autres. Cette disposition s’inscrit dans la liste déjà importante des interdictions que l’on qualifiera d’émancipatrices, des interdictions qui défendent des droits humains fondamentaux. Ainsi, il est aujourd’hui impossible de posséder un esclave. Cela n’a pas toujours été le cas. Il s’agit certes d’une interdiction, mais qui permet que tous les humains soient potentiellement libres. De même, il est désormais interdit de discriminer selon le genre, la race présumée, la religion ou encore l’orientation sexuelle. Ces interdictions sont des facteurs de progrès et d’émancipation qui nous autorisent toutes et tous d’embrasser une religion ou de ne pas en avoir, d’aimer qui l’on veut et d’œuvrer à l’abolition du patriarcat. L’interdiction de la propriété dominante s’inscrit dans la même veine et constituera un progrès humain, car elle permettra à toutes et à tous de devenir citoyen·nes dans la vie économique en commençant par la sphère de l’entreprise. La proposition d’Emmanuel Dockès est donc un élément essentiel de cette société postcapitaliste.
Il n’en reste pas moins vrai que toute force politique qui arrive au pouvoir est immédiatement contrainte par le cadre constitutionnel existant qui reconnaît un droit de propriété dont on n’aurait pas l’usage. Ceci signifie qu’elle devra faire évoluer ce cadre conformément à ce qu’elle avait clairement exposé au préalable. Est-ce à dire qu’il faudra attendre cette évolution avant d’agir ? Certainement pas. Si les constitutions contemporaines interdisent les expropriations de propriétaires d’entreprises au motif qu’ils n’y travaillent pas, il n’en reste pas moins vrai que les gouvernements sont libres de pratiquer les politiques sociales qu’ils veulent en termes de droit du travail, de cotisations sociales et de fiscalité sur les entreprises. Sur ces trente dernières années, celles-ci ont été favorables aux sociétés de capitaux. Pourquoi ne seraient-elles pas demain défavorables ? Et si elles sont défavorables, les valorisations des sociétés s’effondreront. Elles s’effondreront d’autant plus que le marché sera convaincu que cette situation est faite pour durer, que la population ira à la révision constitutionnelle et abolira la propriété dominante.
Ceci ouvre une possibilité d’évolution rapide avant le changement constitutionnel. S’il n’y a pas de possibilité légale d’expropriation, les transactions sur les entreprises ne sont pas interdites et les actionnaires peuvent, dans le cadre de cette situation, être demandeurs d’une sortie. La base d’un accord est ici évidente. Comme nous l’avons expliqué au premier chapitre, une entreprise peut très bien avoir un patrimoine net significatif et ne rien valoir si le marché estime que celle-ci ne sera jamais capable de servir des dividendes. Ce patrimoine net peut donc être une base de négociation pour établir un prix. Pour nous, il correspond à une réalité, celle des actifs de l’entreprise non financés par de l’emprunt. Pour eux, c’est mieux que rien, un mieux qui ira en se rétrécissant d’année en année puisque désormais les entreprises feront des pertes. Donc pour eux, le plus tôt cette négociation aura lieu, meilleur sera le prix d’indemnisation.
Il est aussi possible qu’une partie des actionnaires n’accepteront pas ce qu’ils considèrent être un chantage. Nous verrons de grandes divisions s’opérer au sein de la classe des propriétaires, un peu comme les gouvernements actuels savent diviser la classe salariée lorsqu’ils placent les profits des entreprises comme paramètre intouchable de toute négociation : c’est alors toujours la faute de l’autre, « le fonctionnaire qui a des avantages exorbitants qu’on ne peut plus se permettre », « l’étranger qui vient dans notre pays pour bénéficier de nos régimes laxistes de subvention de la paresse », sans parler des dilemmes qui se posent tous les jours pour accepter les licenciements d’une partie des salarié·es d’une entreprise au nom de la sauvegarde de l’emploi des autres… Il est heureux que désormais nous soyons capables de renverser la situation afin que la peur change enfin de camp.
Si des actionnaires se font tirer l’oreille pour négocier et partir, il n’est pas non plus exclu que devant l’urgence de la situation – encore une fois, le pire est qu’ils restent au pouvoir et refusent de renouveler les investissements – les salarié·es d’une entreprise l’occupent, la fassent marcher contre la direction nommée par les actionnaires. Nous rentrons alors dans un processus quasi insurrectionnel. Ceci nous confirme qu’il est ridicule d’opposer processus électoral et mouvement insurrectionnel : l’un se nourrit de l’autre et vice versa. Ce mouvement sera d’autant plus solide que les salarié·es seront persuadés que leur gouvernement n’enverra pas la police pour mettre un terme à une occupation. Il est donc possible qu’en accord avec une banque qui aurait changé de direction, cette entreprise obtienne les financements nécessaires. Les actionnaires en appelleraient alors à la justice pour faire respecter le droit de propriété. Mais que vaut une « justice » si le gouvernement n’a pas l’intention d’envoyer la police contre les salarié·es ?
On le voit, il est inutile d’attendre l’évolution constitutionnelle pour avancer. Attendre serait même l’erreur fatale qui saperait les fondements d’une victoire électorale.
Nous venons d’envisager une indemnisation des actionnaires afin d’accélérer un processus de transition dans un cadre constitutionnel déterminé. A contrario, l’expropriation des actionnaires sans aucune indemnité est souvent présentée comme le nec plus ultra d’une politique révolutionnaire. Elle est parfois défendue comme objectif de très long terme par des personnes pour qui la sortie du capitalisme n’est pas vraiment la préoccupation immédiate : l’inconséquence est facile lorsqu’on fait de l’expropriation un horizon tellement lointain qu’il n’en est plus un objectif. La raison donnée à l’expropriation sans indemnité serait que le gros des fonds propres n’est pas le résultat d’une mise de fonds des actionnaires mais de l’accumulation successive des bénéfices qui ont été prélevés sur le dos des travailleur·euses. C’est parfaitement exact.
Afin de paraître plus attentifs aux petits épargnants, on entend parfois des propositions d’indemnisation limitées à un plafond maximum sur la base de ce que chaque actionnaire a mis. On exclurait aussi la partie accumulation qui résulte de l’exploitation des salarié·es. Tout ceci tient de la gageure. En effet, les propriétaires du moment sont rarement ceux qui ont mis de l’argent dans l’entreprise – création de l’entreprise ou augmentation de capital – mais des personnes qui ont racheté des actions à d’autres qui ne sont désormais plus actionnaires de l’entreprise. Les transactions se font sur la base d’une valeur qui anticipe les résultats futurs obtenus par l’exploitation des travailleur·euses. Allons-nous indemniser les actionnaires actuels à la hauteur de ce qu’ils ont acheté ? Nous risquerions alors d’indemniser fort cher, sur des valeurs spéculatives qui n’ont rien à voir avec la valorisation du moment. Pour compenser ces rachats à des prix excessifs, allons-nous rechercher les anciens actionnaires pour leur demander de rendre l’argent ? Sans compter que nombre de petits épargnants n’investissent pas directement en actions mais dans des fonds commun de placement, des fonds de pension et autres assurances-vies.
Ça devient très compliqué et apparaît peu réaliste. L’indemnisation des actionnaires autant que leur non-indemnisation est fondamentalement injuste. Mais cette injustice n’est pas la conséquence de cette éviction mais de la règle des marchés : on peut à tout moment perdre en détenant des actions et inversement gagner. L’éviction des actionnaires est un processus qui ne fait qu’arrêter ce jeu fondamentalement spéculatif et injuste.
Comme l’éviction des actionnaires se fera dans un contexte de faibles valorisations, la perspective de se faire indemniser sur tout ou partie d’une valeur comptable supérieure à la valeur de marché peut être le fondement d’une transition sans violence, dans laquelle les anciens actionnaires ne contesteront pas le nouveau pouvoir des salarié·es, d’autant que cette valeur comptable n’a de sens que si le fonctionnement de l’entreprise se poursuit.
Soyons clair. Nous ne défendons pas une indemnisation des anciens actionnaires pas plus que nous nous y opposons : ce sont les conditions concrètes dans lesquelles l’éviction des actionnaires aura lieu qui détermineront s’il y aura ou pas indemnisation. Il n’y aura indemnisation que si les deux parties y trouvent un intérêt mutuel. La présence de fonds de pension dans lesquels des salarié·es, parfois étrangers, ont investi est aussi un élément qui doit nous inciter à la plus grande prudence. Dans ce qui suivra, nous partirons donc de l’hypothèse qu’il y aura indemnisation, tout en soulignant régulièrement ce qui pourrait empêcher que ce soit le cas.
Cette hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée, qui n’est que l’exact contraire des politiques actuelles, nous ouvre un nouveau chemin d’appropriation sociale. Jusqu’à présent, l’appropriation sociale a principalement été pensée comme un changement de propriétaire dans les unités de production : la collectivité devait se substituer aux propriétaires privés. Tout le problème de cette approche est la difficulté de déterminer le juste périmètre de la collectivité. Les salarié·es de l’entreprise comme dans les Scop ou les coopératives de travail ? Ses usagers comme dans les coopératives de consommateurs ou bancaires ? L’État comme l’ont pensé pendant longtemps de nombreux socialistes ? Jamais une réponse satisfaisante n’a été apportée. Si la propriété collective s’applique à l’entreprise, alors celle-ci est trop petite et les relations marchandes prennent le dessus pour reconstituer à terme une propriété privée. Si la propriété collective s’applique à l’État, alors celle-ci tend à former une gigantesque bureaucratie qui exclut celles et ceux au nom de qui cette propriété a été établie. Quoi qu’il en soit et quelle que soit l’échelle, la propriété est toujours excluante, ce que les expériences passées nous ont largement démontré[4].
La hausse de la part des salaires dans la valeur ajoutée permet de penser une nouvelle approche de l’appropriation sociale. Si l’intégralité de la valeur ajoutée revient aux salarié.es, si les propriétaires ne touchent plus rien, quel peut donc être l’intérêt d’être actionnaire ? Aucun. Dans ces conditions, les travailleur·euses sont appelés à diriger l’entreprise, non en tant que nouveaux propriétaires mais en tant que titulaires de l’intégralité de la valeur ajoutée. Comment envisager concrètement ce dépassement de la propriété des moyens de production ?
Lorsque des salarié·es reprennent leur entreprise, ils/elles le font souvent sous le régime juridique de la coopérative de travail, rétablissant ainsi une relation propriétaire. Mais ils/elles utilisent une forme juridique qui limite dès le départ la propriété : les parts sociales ne se revalorisent pas, elles ne sont pas cessibles et les réserves sont impartageables. Dans les faits, c’est en qualité de salarié·es qu’ils/elles sont propriétaires de l’entreprise et non en tant qu’investisseurs extérieurs à l’entreprise. Il n’en reste pas moins vrai que cette forme est un entre-deux encore insatisfaisant et nous dépasserons cette propriété coopérative en évoluant vers une entreprise sans fonds propres – donc sans propriétaire – intégralement financée par un secteur financier socialisé[5].
Le fait que les travailleur·euses dirigent désormais l’entreprise en lieu et place d’un propriétaire a une incidence immédiate sur la gestion de celle-ci : elle ne se fera plus par les profits mais par la valeur ajoutée. Dans le modèle capitaliste, la conduite de l’entreprise est déterminée par le profit anticipé – qui correspond, aux impôts près, à la différence entre la valeur ajoutée et la masse salariale – qui doit être supérieur au rendement exigé par les actionnaires. Dans ce nouveau mode économique et social, les travailleur·euses ont un objectif, celui de maximiser la valeur ajoutée car il détermine l’intégralité de leur rémunération. Il s’agit donc d’un objectif plus souple que le seul profit et donc moins sujet aux défaillances d’entreprises : c’est sans doute ce qui explique que les Scop affichent des taux de résilience plus forts que les autres entreprises[6].
Avec l’éviction des actionnaires, les travailleur·ses bénéficient de la totalité de la valeur ajoutée qui correspond à la masse salariale bonifiée des anciens profits des propriétaires. C’est un avantage immense sauf qu’ils assument désormais le risque inhérent à l’entreprise au travers de leurs rémunérations et que celles-ci baisseront en cas de difficultés économiques. Or nous aspirons toutes et tous à une certaine forme de stabilité de nos rémunérations qui est difficilement compatible avec le régime marchand. La solution passe donc par la mutualisation des revenus à l’échelle d’un ou de plusieurs territoires, avec un ensemble de règles à définir par les travailleur·euses eux-mêmes. À une échelle microéconomique, c’est ce que fait déjà le groupe coopératif Mondragón avec sa grille de rémunération commune à l’ensemble de ses entreprises et ses mécanismes de solidarité inter-coopératives[7]. À une échelle macroéconomique, c’est ce que permet la péréquation du revenu disponible[8].
Son principe est simple : il s’agit d’extraire une partie de la production disponible réalisée par toutes les entreprises sur une période pour la redistribuer selon des critères non marchands. Dans une version basique, les revenus sont redistribués de façon uniforme avec une allocation unique par travailleur·euse en équivalent temps plein. Il est aussi possible de sophistiquer cette péréquation en modulant les allocations selon un système de grades ou de ne plus soumettre tout ou partie de ces allocations à la présence de la personne dans une entreprise, afin d’évoluer vers des revenus inconditionnels de type revenu universel[9] ou salaire à la qualification[10].
Le passage du pilotage de l’économie par le profit vers la valeur ajoutée nous permettra de sortir d’une société de croissance permanente. À partir du moment où la rémunération des salarié·es est donnée par des salaires fixes, il devient indispensable pour les actionnaires de réaliser une valeur ajoutée supérieure à la masse salariale pour que l’entreprise puisse fonctionner. À l’opposé, parce que les salarié·es réalisent la totalité de la valeur ajoutée, elles contestent ces profits en demandant à nouveau des hausses de salaires. Pour que ces hausses de salaires ne soient pas rattrapées par l’inflation et donc fictives, il faut donc qu’il y ait encore plus de production. Cette approche totalement productiviste s’explique par cette contradiction de la société de capitaux qui impose de réaliser un prélèvement en faveur des actionnaires sur une valeur ajoutée produite par les salarié·es. À partir du moment où les salarié·es dirigent l’entreprise, il n’y a plus de rivalité car ils sont titulaires de la totalité de la valeur ajoutée. Ils peuvent choisir de travailler plus pour améliorer leur rémunération ou, au contraire, considérer que cela n’en vaut pas la peine pour préférer disposer de plus de temps libre.
Une autre voie vers la stabilité des revenus des salarié·es est à rechercher dans l’intervention des usagers. L’histoire du mouvement coopératif nous a montré la supériorité numérique des coopératives d’usagers sur les coopératives de travail[11]. Une des raisons est la capacité de ces coopératives à réunir autour d’elles un « marché » préétabli d’usagers qui permet d’embaucher des salarié·es avec des rémunérations fixes.
On doit donc s’inspirer de ce fait pour que les salarié·es et les usagers travaillent de façon concertée plutôt que dans le cadre d’une relation marchande traditionnelle dans laquelle un client mécontent quitte l’entreprise pour la concurrence. C’est la raison pour laquelle nous défendons un droit de mobilisation des usagers leur permettant d’élire un conseil d’orientation qui travaillera de concert avec le conseil des travailleur·euses[12]. Cette disposition est bien sûr essentielle dans le cas d’entreprises en situation de monopole ou d’oligopole. Pour l’illustrer, nous allons prendre l’exemple de l’accès Internet sur fibre optique. Actuellement ce marché est détenu par un nombre limité d’opérateurs – quatre en France – dans lequel les usagers n’ont d’autre choix que de quitter leur fournisseur en cas d’insatisfaction pour un autre qui pratiquera des politiques assez similaires. L’élection d’un conseil d’orientation par les usagers leur permettra donc d’influencer directement les décisions des opérateurs et il est possible qu’ils imposeront une fusion de ceux-ci de façon à réaliser des économies d’échelle et une meilleure prise en compte de leurs besoins réels. De façon symétrique, les salarié·es seront peut-être aussi tenté·es par cette fusion qui leur permettra de se concentrer sur la qualité de service, tout en assurant une meilleure stabilité des rémunérations. Une façon démocratique et moderne de reconstituer nos anciens services publics marchands…
Cette intervention des usagers dans les unités de production nous permet d’aller encore plus loin et de remettre en cause notre vision de la séparation entre le politique et l’économie. Si dans la sphère marchande les salarié·es obtiennent le droit de diriger leur travail, pourquoi cette prérogative ne concernerait-elle pas aussi les travailleur·euses de l’État ? Ceci signifie clairement que l’on remet en cause la notion même d’État-patron, d’État propriétaire de ces services publics. Cela suppose de considérer les différents services publics de l’État comme étant des entités séparées : éducation, santé, politique extérieure-défense, justice-police, etc. Dans chacune de ces entités, nous aurons donc la rencontre de deux pouvoirs : celui des salarié·es de l’entité qui connaissent leurs métiers et sont les mieux à même d’avoir une opinion sur bien des sujets, et les citoyen·nes qui décident le financement de ces entités et sont aptes à définir les services qu’ils en attendent. Comme ces services sont subventionnés par des contributions fiscales, l’adhésion à ces communs ne se fait pas sur la base d’un achat mais par sa présence sur un territoire donné en qualité de contribuable : nous définirons donc ces structures comme étant des « communs géographiques ». Cet éclatement des anciens services publics en différentes entités permet d’obtenir une démocratie largement plus directe et active que notre régime actuel de démocratie représentative, dans laquelle on désigne des représentants sur des sujets divers et variés qui grosso modo feront un peu tout ce qu’ils voudront durant leur mandat. Dans le cas présent, les citoyen·nes exprimeront des choix sur chacun des sujets les concernant.
Cette approche fusionne l’économie et la démocratie : la rencontre entre des personnes qui produisent – les travailleur·euses – et des personnes qui allouent un budget sous forme d’impôts – des citoyen·nes – ou d’achats – des usager·ères. Toutes les unités de production seront donc dirigées par leurs travailleur·euses tout en étant sous le contrôle des usager·es et contribuables. Toutes les entreprises, quelles qu’elles soient, seront au service du public, constituant ainsi de nouveaux services publics démocratisés.
Nous n’irons pas plus loin dans les conséquences politiques d’une telle réorganisation qui appelle de nombreux développements, mais il est clair que cette évolution permet un dépassement de l’État tel qu’il est organisé aujourd’hui par une organisation dans laquelle de multiples communs à la fois politiques et économiques s’articuleront les uns avec les autres, et dans lesquels la démocratie s’exprimera par un dialogue permanent entre salarié·es et usager·es ou citoyen·nes, sachant que nous sommes les deux à la fois mais dans des positions différentes en fonction de l’activité dont on parle.
[1]Nouriel Roubini, « Les cinq ingrédients qui préparent la crise de 2020 », Les Échos, 4 octobre 2018.
[2]Selon Peter Ranis, Cooperatives Confront Capitalism, Challenging the Neoliberal Economy (Londres, Zed Books, 2016, p. 94), la constitution étasunienne comporterait déjà ce type de dispositif avec la notion d’Eminent Domain.
[3]Emmanuel Dockès, Voyage en Misarchie : essai pour tout reconstruire, Paris, Le Détour, 2017.
[4]Benoît Borrits, Au-delà de la propriété : pour une économie des communs, Paris, La Découverte, chap. 1 à 4.
[5]Ibid., p. 171.
[6]Benoît Borrits et Aurélien Singer, Travailler autrement : les coopératives, Paris, Le Détour, 2017, p. 7.
[7]Ibid., p. 58.
[8]Benoît Borrits, Coopératives contre capitalisme, Paris, Syllepse, 2015, p. 133 ; Borrits, Au-delà de la propriété…, op. cit., p. 148.
[9]Yannick Vanderborght et Philippe Van Parijs, L’Allocation universelle, Paris, La Découverte, 2005.
[10]Bernard Friot, L’Enjeu du salaire, Paris, La Dispute, 2012.
[11]Borrits et Singer, Travailler autrement : les coopératives, op. cit., p. 47.
[12]Borrits, Au-delà de la propriété…, op. cit., p. 196.