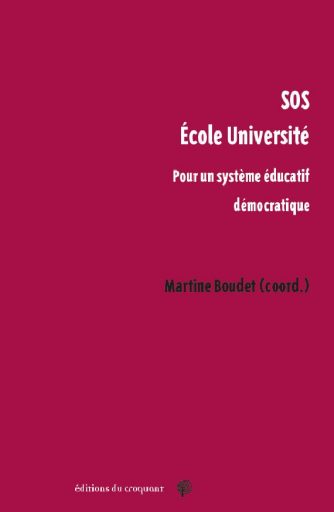
À propos de : Martine Boudet (dir.), SOS École Université. Pour un système éducatif démocratique, Éditions du Croquant (avec le soutien de l’Institut de recherches de la FSU), 2020.
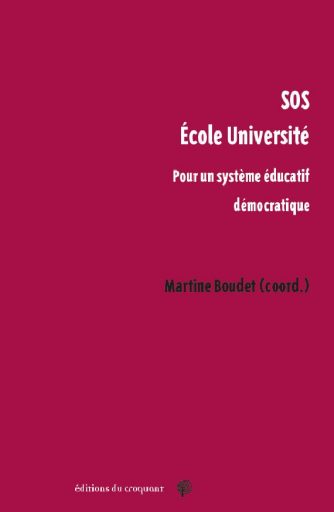
Quel système éducatif voulons-nous ? Pour quelle société ? Autant de questions qui se posent à nouveaux frais depuis l’épreuve subie par les élèves, les parents et les enseignants durant la période de confinement due à l’épidémie du COVID 19 et du fait notamment de la gestion désastreuse de la mal nommée « continuité pédagogique », avec la volonté du gouvernement Macron d’accélérer les transformations du système éducatif sous la houlette du ministre Blanquer, sans surprise maintenu à son poste pour la deuxième partie du quinquennat.
C’est dans ce contexte que l’ouvrage coordonné par Martine Boudet invite à résister à la politique mise en œuvre depuis plusieurs années par les gouvernements successifs, de Sarkozy à Macron en passant par Hollande, pour envisager la possibilité de refonder l’école, ce qui ne saurait nous laisser indifférents, tant il est vrai que la lutte pour une école réellement démocratique et émancipatrice n’est que la transposition de la lutte des classes sur le terrain éducatif, car tout projet éducatif résulte d’un projet de société.
L’organisation même de la succession des contributions est significative du projet : il se compose de trois parties regroupant chacune trois types d’analyse de la situation existante, regroupant au total quatorze articles qui sont avant tout un appel à la lucidité face aux mauvais coups qui s’accumulent. L’ensemble constitue un témoignage du fait que la résistance est possible face à la « culture de la violence instituée » instaurée par l’avalanche de réformes qui, « à défaut de légitimité, sont le plus souvent imposées par la force ».
D’entrée de jeu, Martine Boudet pointe l’enjeu dans son article introductif « Une décennie de dérive autoritaire de l’école et à l’université ». Constatant que « si des analyses critiques de la situation abondent, l’élaboration d’alternatives au système fait défaut », elle estime qu’« il est de la responsabilité du monde enseignant de contribuer à la reconstitution d’un intellectuel collectif à la hauteur des défis de la période […] face à l’hégémonie idéologique […] pour faire valoir d’autres modèles éducatifs ».
Le public de lecteurs potentiels est clairement ciblé. Mais quid des autres composantes de la société et notamment du monde du travail ? Qui, en définitive, est habilité à décider des formes et contenus du système éducatif ? Seulement les enseignants ? Qu’en est-il des autres catégories de personnels, des parents et des élèves eux-mêmes ? Leur inclusion à ce débat mènerait-elle à une configuration plus ou moins autogestionnaire ? Plus largement, faut-il y associer – sous quelles formes et dans quelles limites – les représentants du monde du travail (salariés, patronat…) ? Et donc, quelle place accorder aux politiques (élus) ? Ces questions auraient au moins mérité d’être posées.
Toujours est-il que pour répondre à cette injonction, encore faut-il comprendre à qui (à quoi ?) on a affaire, bien mesurer l’ampleur de la difficulté pour construire la/les réponse(s) pertinentes. C’est la fonction dévolue à la première partie de l’ouvrage, avec trois articles qui se complètent pour analyser les transformations de l’économie et du monde du travail sous le sceau du « néolibéralisme autoritaire » et du « capitalisme cognitif » qui caractérisent cette période.
Dans le premier article qui ouvre cette séquence, « Organiser le pessimisme », les membres du « groupe J. P. Vernant » analysent le « néolibéralisme identitaire » importé des États-Unis comme « un système remettant systématiquement en cause l’ensemble des systèmes de solidarité qui assuraient des formes de sécurité aux classes moyennes et populaires (école, santé, chômage, retraite ». Cette définition sera développée ensuite dans un autre article du même auteur (chapitre 3) qui note : « ce système postule que la mise en concurrence est le seul processus collectif qui puisse faire émerger de la Vérité… et qui garantit donc une efficience productive optimisée ».
C’est dans ce contexte que l’article suivant, signé par Emmanuel Brassat, « Transformations néolibérales du système d’éducation en France », décrit dans le détail un changement de paradigme dans l’éducation : en effet, dans le nouveau système éducatif en cours de (re)construction sous la houlette autoritaire du ministre Blanquer, « il ne s’agit plus tant d’enseigner des savoirs disciplinaires ou culturels en tant que tels, que des capacités à mettre en œuvre, qu’elles soient sociales, affectives, intellectuelles, morales, techniques ou culturelles » signale l’auteur. D’où les transformations néolibérales des institutions scolaires et leurs conséquences.
L’avalanche de réformes imposées depuis quelques années à l’école comme à l’université (autonomie des établissements, définition des diplômes et des formations, recrutement et formation des personnels éducatifs, critères de gouvernance, privatisation de pans entiers du système…), dont les finalités sont pour l’essentiel demeurées largement opaques aux yeux des personnels d’éducation, prend alors tout son sens. Par exemple, le nouveau système d’évaluation qui se met en place à marche forcée tend à mesurer qualitativement des attitudes, des capacités de conduites, plutôt que de sanctionner un niveau de résultats en fonction d’une assimilation abstraite de connaissances, ce qu’était l’ancienne notation.
D’où le décalage de plus en plus spectaculaire et mal supporté par un grand nombre d’enseignants qui restent attachés à la valeur culturelle et désintéressée de leur enseignement face à ce qui leur est présenté comme la mise en œuvre modernisatrice de pédagogies nouvelles soumises de fait aux normes de l’économie compétitive de marché. Ainsi, les diplômes, dans leur valeur et sens, ont été modifiés, la culture générale devenant moins prisée et accessible, c’est une définition bien plus professionnelle de leur finalité qui a déterminé leur évolution… Mais l’auteur ajoute, de manière incidente : «… hormis pour les filières d’élite sélectives dont l’aspect de formation générale pointue a continué de prévaloir sur l’utilité fonctionnelle ».
Cette remarque aurait mérité de plus amples développements : elle est en effet révélatrice d’une grande prudence de la part des concepteurs du nouveau système éducatif, qui continuent apparemment de se soucier du haut niveau de formation générale nécessaire pour les futures élites dirigeantes de l’économie et de la société et posent (involontairement ?) la question de la fonction de la culture générale dans les cursus des élèves. Tout ceci est rendu possible, car, note l’auteur, « l’entreprise, les organisations en général, sont devenues des lieux de production de savoir, par l’articulation de leurs activités et de l’informatisation… c’est ici que l’expression de capitalisme cognitif prend tout son sens.
Cet aspect du problème est ensuite développé dans un second article du groupe J.P.Vernant : « L’Université néolibérale et la théorie du capital humain », celui-ci étant défini comme « le portefeuille de compétences dont un individu (un agent économique) fait l’acquisition au cours de sa formation, de sorte à en tirer ultérieurement un revenu », devenant du coup outil de formation d’un « nouveau type de travailleur anthropologiquement subjectif : l’entrepreneur de soi-même », dont le modèle le plus abouti aujourd’hui est celui rattaché à un « capitalisme de plateforme » : l’uberisation.
Cette nouvelle organisation du travail demande un système de formation organisant une différenciation des parcours et des diplômes, ainsi que la mise en concurrence des individus et des établissements, créant ainsi « les outils de promotion d’un marché éducatif »[1]. Les lecteurs déjà familiers des analyses de C. Laval[2] ne seront pas surpris de ces analyses qui en constituent une actualisation fort utile, formant sans doute la partie la plus intéressante de l’ouvrage.
Sous le titre générique « Autoritarisme étatico-administratif et programmes revendicatifs », la deuxième partie comporte ensuite plusieurs articles signés principalement par des syndicalistes qui analysent les réformes du système éducatif concrètement à l’œuvre aujourd’hui, à commencer globalement par celles de « La fonction publique à l’épreuve du Macronisme » sous la plume d’Axel Trani. On y lira comment « Macron est en partie le continuateur des réformes engagées sous les précédents gouvernements », mais avec la brutalité et l’autoritarisme qui le caractérisent (que Naomi Klein désigne sous le vocable de « stratégie du choc »), tout en préparant de nouvelles réformes dont l’essentiel est de « déconstruire les garanties professionnelles des fonctionnaires » (fin des CAP, des CHS-CT, de la garantie de l’emploi, de la rémunération de carrière au profit du « mérite », etc.).
Les enseignants tout particulièrement se reconnaîtront dans les chapitres suivants, par exemple celui signé par P. Blanchet, qui montre comment a été mise en œuvre la politique d’asservissement de l’Université et de la Recherche Scientifique aux intérêts à court terme des entreprises privées depuis l’an 2000, ainsi que les véritables raisons de la mise en œuvre de « Parcoursup : un outil idéologique de sélection ». Le collectif FDE du Snesup-FSU apporte des éclaircissements instructifs concernant les péripéties des réformes successives de la formation des enseignants, tandis que Paul Devin montre bien comment la stratégie d’évaluation mise en œuvre par Blanquer en direction des personnels et des élèves relève d’un véritable détournement des principes statutaires envahis par la culture managériale du secteur privé.
Dans la même veine, Valerie Sipahimalani décortique « l’avalanche de réformes libérales opportunistes en cours dans les collèges et les lycées qui montre avant tout une absence de réflexion systémique sur fond idéologique libéral » et le double langage qui accompagne systématiquement chacune d’elles, censées « donner de la liberté aux acteurs de l’Éducation Nationale ».
On peut s’interroger sur l’appréciation portée par la syndicaliste à propos de cette politique : « des sujets peu ou mal traités par des technocrates éloignés des réalités du terrain et sans vision d’ensemble ». Cette appréciation nous semble en effet en totale contradiction avec les analyses de la première partie du livre. Rappelons en outre que Blanquer est un fervent adepte de l’Institut Montaigne (qui revendique clairement son parti pris libéral), ayant produit ces dernières années plusieurs études très cohérentes et documentées sur les nécessaires transformations du système éducatif susceptibles de contribuer à la transformation de la société conformément à l’idéologie néolibérale qui les anime[3]…
Enfin, la troisième partie comporte six articles visiblement destinés à redonner des perspectives aux luttes et à impulser les mobilisations nécessaires face au désastre en cours… À l’évidence, il s’agit de montrer – exemples concrets à l’appui – que la résistance à ces politiques peut être efficace pour peu que chaque bataille concrète soit porteuse « d’alternatives institutionnelles et programmatiques » qui les rendent crédibles. Ainsi, la série s’ouvre par le récit détaillé de la lutte menée… en 2008 (présidence Sarkozy, ministre de l’Éducation X. Darcos !) par les professeurs des écoles contre les nouveaux programmes édictés par le ministre.
Le récit de cette bataille, fait par son principal animateur de l’époque, A. Refalo, est intéressant à plus d’un titre. D’une part, concernant le mode d’action adopté, situé exclusivement sur le terrain de la désobéissance pédagogique aux nouvelles instructions ministérielles, jugées par les instituteurs ayant mené cette bataille difficile comme des prétextes à un « renforcement du caractère élitiste et ségrégatif de cette école ». Ce n’était, sur le plan réglementaire et statutaire, ni une grève, ni un service non fait, puisque ces enseignants continuaient à assurer leur service, mais en appliquant les programmes antérieurs, plus ouverts et moins contraignants, car, selon eux, plus axés sur l’éveil de l’enfant[4].
D’autre part, par la durée de l’action : plusieurs mois, impliquant des centaines d’enseignants à travers le pays. Enfin, parce que cette bataille fut victorieuse, assure A. Refalo, qui note en conclusion que « la plupart des dispositifs contre lesquels elle était menée ont été abandonnés en 2012 ». On ne discutera pas ici des acquis à plus long terme de cette lutte manifestement considérée comme exemplaire par l’auteur. Mais force est de constater que c’est la seule lutte « gagnante » décrite dans cet ouvrage, les autres articles de cette 3e partie étant essentiellement d’ordre revendicatif (voire programmatique), n’hésitant pas à mettre en avant les aspects corporatifs pouvant servir de détonateur et destinés à nourrir et sécuriser les velléités de lutte espérées dans le monde éducatif.
Des projets issus des collectifs « Sauvons la Recherche » ou « Sauvons l’Université », à celui de constituer une « Université Volante » (dont on peine à saisir la faisabilité), en passant par une analyse sommaire et injuste de l’éphémère « Université Autonome de Vincennes », jusqu’à l’exigence d’une « Université Inclusive » (entérinant au passage l’échec dramatique de la loi d’orientation de 2012, dite Loi Peillon »), émerge une sensation de fragmentation et d’impuissance.
On en apprendra du coup beaucoup plus sur les aspects contemporains de la perte de sens du métier des enseignants, des souffrances qu’elle entraîne, et des difficultés du monde universitaire à concevoir un véritable projet alternatif cohérent et mobilisateur dans la période actuelle. Finalement, les lecteurs bénéficieront avec cet ouvrage d’une sorte de bilan de la situation de l’école aujourd’hui, telle que l’envisage la gauche de transformation sociale, ce qui n’est pas rien !
[1] On ne peut s’empêcher, ici un rapprochement avec l’analyse de Rodrigo Arenas, co-président de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) dans une tribune libre publiée le 26 août 2020 par le journal Libération, qui parle d’une « accélération de la vente à la découpe de l’école publique ».
[2] On fait référence ici à la contribution de C. Laval intitulée « La réforme managériale et sécuritaire de l’école » dans l’ouvrage collectif L’appel des appels publié en 2009 aux Mille et une Nuits sous la direction de R. Gori, B. Cassin et C. Laval, analyse novatrice à l’époque dans le contexte éditorial français, développée ensuite dans un ouvrage de référence : La nouvelle école capitaliste, La découverte, Paris, 2011.
[3] J. M. Blanquer lui-même est par ailleurs l’auteur de deux ouvrages de référence : l’Ecole de demain (Odile Jacob 2016) et L’Ecole de la confiance (Odile Jacob 2018) dans lequel la cohérence du projet est explicite…
[4] Un ouvrage récent (à lire absolument), publié aux éditions La Dispute sous la direction de J.-P.Terrail : Pédagogies de l’exigence. Récits de pratiques enseignantes en milieux populaires se fixe un objectif politique proche de celui mené à l’époque par A. Refalo en se situant lui aussi sur le terrain des luttes motivées par une éthique professionnelle. Il s’agit de montrer des pratiques pédagogiques intellectuellement exigeantes pouvant conduire à la réussite scolaire d’élèves issus de milieux défavorisés plutôt que d’accepter de mettre en œuvre des conduites de contournement de la difficulté intellectuelle favorisées par l’idéologie dominante et l’institution, qui mènent le plus souvent à l’échec. Certes, les auteurs ne cherchent pas à créer des illusions : ils savent bien que c’est au politique, à l’État de décider d’une tout autre définition des missions de service public telles que celles de l’école aujourd’hui. Mais ce sont les enseignants – ceux que J.-P. Terrail désigne sous le terme « l’allié dans la place » – qui, ne se contentant pas de résister au néolibéralisme, explorent les voies d’une école démocratique, car, de toute façon ils sont et seront les acteurs incontournables de leur mise en œuvre. Et de fait, d’ores et déjà, le dépassement critique des pratiques de la doxa qu’ils mettent en pratique dessine les contours d’un déjà-là d’une autre école.