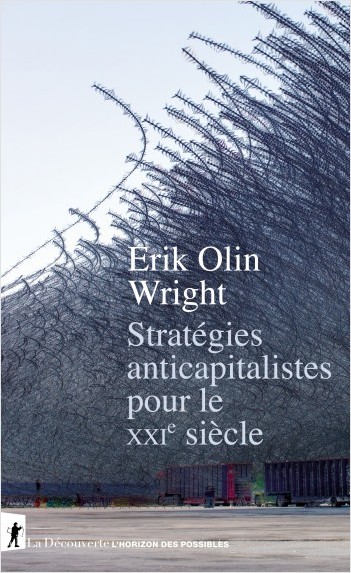
À propos de : Erik Olin Wright, Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2020.
Nous avons également publié la réponse d’Erik Olin Wright, malheureusement décédé depuis, à ce texte de Dylan Riley.
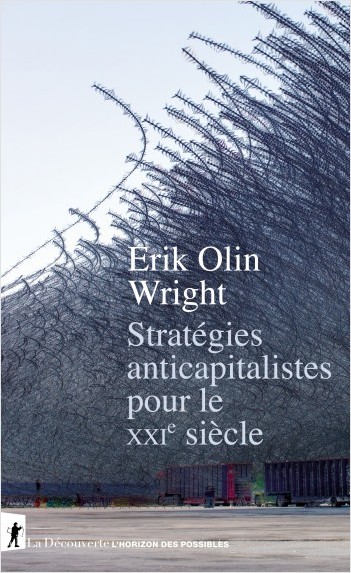
La gauche d’aujourd’hui peut se targuer de ses nombreux et fins analystes du capitalisme, de l’Etat, de la culture et de la géopolitique. Mais sa pensée stratégique reste terriblement sous-développée. Il y a deux explications évidentes à cela : le gouffre entre les injustices du capitalisme mondial et les catégories d’agents sociaux susceptibles à le transformer, et le scepticisme vis-à-vis d’un projet de politique radicale scientifiquement informée.
Quelle qu’en soit la raison, la gauche attend toujours une figure qui pourrait endosser de manière plausible le manteau de Gramsci, du premier Kautsky, de Lénine, Luxembourg ou Trotski. Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle d’Erik Olin Wright, résumé concis du message politique principal d’Utopies réelles (2010), se focalise justement sur les questions de stratégie socialiste qui sont au cœur de la tradition marxiste révolutionnaire. A ce titre au moins, sa position, courageuse et écrite de manière claire, mérite notre attention.
Le problème particulier abordé par Utopies réelles et Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle touche au développement d’une politique radicale dans un contexte où « aucune théorie sociale existante n’est suffisamment puissante pour ne serait-ce que commencer à construire … une représentation générale détaillée d’issues sociales possibles, d’avenirs possibles ». Ce défaut théorique crée « un gouffre entre les horizons temporels de la théorie scientifique et des luttes de transformation ».
Bien que les luttes de transformation aient besoin d’un horizon utopique, la théorie scientifique ne peut la fournir de manière convaincante. Il semble que, dans la perspective de Wright, la politique radicale soit condamnée à être non scientifique, alors que la science est condamnée à rester sans pertinence pour la politique radicale.
Afin de corriger ce problème, Wright vise à remplacer les théories sur la trajectoire historique par une science sociale émancipatrice en trois volets : diagnostic et critique des institutions sociales existantes, formulation d’arrangements alternatifs (« utopies réelles »), et stratégie pour la transformation. Comment s’articulent ces éléments, et à quel type de politique mènent-ils ?
La première partie du livre développe un diagnostic et une critique du capitalisme. Wright avance deux critères d’évaluation de tout ordre social : justice sociale et justice politique. Dans une société socialement juste, les gens ont un accès égal aux ressources matérielles et aux ressources intangibles comme la reconnaissance. Dans une société politiquement juste, les gens peuvent participer de façon significative aux décisions qui touchent à leur propre vie, et à leur vie dans la communauté au sens large.
Wright appelle la combinaison de ces deux critères « l’égalitarisme démocratique » – « la fondation normative générale pour le diagnostic et la critique des institutions existantes, et pour la recherche d’alternatives de transformation ».
Potentiellement, on pourrait utiliser ces critères pour évaluer un ordre social quel que soit l’angle sous lequel on l’aborde. Pourtant, le capitalisme est un mécanisme central empêchant la réalisation d’une justice sociale et politique ; il forme la cible de la critique de Wright.
Le capitalisme, affirme Wright, est un système de production et de distribution défini par son mécanisme principal de coordination économique (marchés), et par le rapport principal de classe (ouvriers et capitalistes). Les capitalistes font du profit en captant les fruits économiques produits par les ouvriers non propriétaires. Ils réalisent ce profit sur les marchés en concurrence avec d’autres capitalistes.
Puisque les entreprises sont en concurrence entre elles, les capitalistes doivent accumuler du profit et faire baisser les coûts en introduisant des technologies qui permettent des économies sur la main d’œuvre. Si elles ne le font pas, elles finissent par faire faillite. Dans le capitalisme, les relations entre les classes, et au sein de celles-ci poussent à l’accroissement de la productivité et engendre de la croissance économique.
La critique principale que fait Wright du capitalisme est que « ses rapports de classe perpétuent des formes éliminables de souffrance humaine », argument très courant dans la tradition marxiste. Tout en reconnaissant que le capitalisme est « une machine à croissance », Wright affirme que la richesse produite est mal distribuée. Bref, l’accès réel qu’ont la plupart des gens aux moyens d’épanouissement est radicalement différent de ce dont ils pourraient potentiellement bénéficier.
Marx affirmait que le capitalisme est un système injuste et, sur le long terme, condamné. Il pensait que la dynamique de la reproduction capitaliste tendait à créer des crises économiques de plus en plus sévères pour deux raisons.
Sur le court terme, les économies capitalistes rencontrent typiquement des problèmes de surproduction et de sous-consommation. Les décisions d’investissement étant faites de manière privée, l’activité économique est coordonnée par les marchés qui opèrent dans le dos des entreprises particulières. Puisqu’il n’y a pas d’agent social assurant un équilibre, il n’y a aucune raison a priori de penser que l’offre et la demande devraient se rencontrer. Et puisque les capitalistes ont intérêt à limiter les coûts du travail, ils tendent à faire baisser la demande. Ces deux mécanismes fonctionnent ensemble pour produire des cycles économiques.
Un processus plus fondamental agit parallèlement à ce mode cyclique. Sur le long terme, l’intensité capitalistique des entreprises tend à s’accroître car la concurrence impose des améliorations technologiques continuelles. De telles innovations réduisent la part de valeur apportée par le travail aux biens fabriqués, et donc la part de survaleur par rapport à la valeur globale. Autrement dit, le taux de profit tend à baisser.
Non seulement le capitalisme engendre des crises économiques de plus en plus aiguës, mais il engendre un agent pour qui son renversement est à la fois nécessaire et possible : le prolétariat. Dans la version marxienne classique, la taille de la population ouvrière s’accroît, alors que ses conditions de travail deviennent plus homogènes. Au fur et à mesure que le capitalisme s’affaiblit, et que ses adversaires se renforcent, une situation révolutionnaire se crée.
Wright développe quatre grandes critiques de cette version : l’une se concentre sur la théorie marxienne de la dynamique objective du capitalisme, deux autres, sur la théorie marxienne de la formation des classes, et une autre encore se focalise sur la notion de rupture ou de transformation révolutionnaire.
Marx, affirme Wright, prétend à tort que les crises capitalistes deviendront progressivement plus sévères. Pour Wright, il y a trois problèmes principaux avec cette affirmation. D’abord, Marx et les marxistes ultérieurs n’ont pas apprécié à quel point l’État peut contrebalancer le cycle économique. Deuxièmement, bien que « le taux de profit puisse être plus faible dans les stades ultérieurs du développement capitaliste qu’aux stades antérieurs, il ne semble pas qu’il existe la moindre tendance à long terme pour que ce taux continue à décliner au sein des économies capitalistes mûres ». Enfin, dans cette perspective, la théorie de la valeur-travail ne constitue pas de fondation cohérente pour expliquer la soi-disant baisse tendancielle du taux de profit.
La deuxième critique faite par Wright de la théorie marxienne du développement capitaliste concerne la prolétarisation. Wright fait remarquer que le développement capitaliste a augmenté le nombre de positions contradictoires dans l’écheveau des relations de classe ; certains peuvent ainsi avoir en même temps des intérêts en commun avec des capitalistes et d’autres avec des ouvriers.
L’auto-entrepreneuriat s’est accru (et non l’inverse) dans le capitalisme contemporain. La possession de titres boursier est devenue relativement répandue, d’où une implication d’une plus grande part de la population maintenant détentrice d’intérêts dans les rapports de production capitalistes. Davantage de ménages sont devenus transclasses, les hommes et les femmes occupant des positions différentes sur l’échelle des classes. Enfin, les inégalités de salaires et les différenciations d’emplois, en haut et en bas de la distribution des revenus, démentent l’idée de classes capitalistes et ouvrières homogènes.
En effet, la capacité de la classe ouvrière à agir collectivement a décliné (et non augmenté) dans le capitalisme contemporain. De plus, les ouvriers ont pu faire avancer leurs intérêts au sein des États capitalistes démocratiques de façon que Marx n’aurait pas pu imaginer. Selon Wright, ces arguments mettent sérieusement en doute la possibilité d’une classe ouvrière comme agent révolutionnaire.
La dernière critique de la théorie marxienne du développement capitaliste se focalise sur la vision que celle-ci a de la transition. La critique que fait Wright ici est plus hésitante, mais il semble que l’argument de base soit qu’une rupture révolutionnaire avec le capitalisme – ce qu’il appelle « briser le capitalisme » – est susceptible de finir en despotisme.
Comme il l’écrit :
« [I]l … se peut que les formes concentrées de pouvoir politique, de l’organisation et de la violence nécessaires à une rupture révolutionnaire réussie dans des institutions existantes soient elles-mêmes incompatibles avec les formes de pratique participative nécessaire à une expérimentation démocratique significative dans la construction de nouvelles institutions émancipatrices. »
À partir d’une critique de l’explication marxiste, Wright essaie de développer une stratégie distincte pour penser le socialisme. Tandis que l’explication marxiste s’appuie sur « une théorie déterministe concernant les propriétés principales de la trajectoire du capitalisme », Wright forge le concept de « possibilité structurelle ». Au lieu d’une « feuille de route », enracinée dans une théorie ostensiblement déterministe, Wright affirme que nous avons besoin d’une « boussole socialiste » qui « nous indique la direction où nous voulons aller, et un odomètre qui nous indique la distance parcourue depuis le point de départ ».
Il commence par faire la distinction entre trois formes du pouvoir (économique, politique, sociale) qui correspondent à trois domaines du pouvoir (l’économie, l’État, la société civile). Dans cette typologie, le capitalisme est un système où les moyens de production relèvent de la propriété privée et les décisions d’investissement sont déterminées par le pouvoir économique. L’Étatisme est un système économique où les moyens de production relèvent de la propriété de l’État, et l’allocation des ressources « est accomplie par l’exercice du pouvoir de l’État ».
Finalement, le socialisme est un système économique où « les moyens de production relèvent de la propriété sociale, et l’allocation et l’usage des ressources à des fins sociales différentes sont accomplis par ce qu’on pourrait appeler « le pouvoir social » ». Cette formulation rompt, selon Wright, avec « le socialisme centré sur l’État ». Comme il le dit, « le concept de socialisme proposé ici est fondé sur la distinction entre le pouvoir étatique et le pouvoir social, entre la propriété étatique et la propriété sociale ».
Wright identifie alors trois directions dans lesquelles le pouvoir social, « enraciné dans l’organisation volontaire au sein de la société civile », pourrait être prolongé pour régler « la production et la distribution de biens et de services ».
Le pouvoir social peut être utilisé directement pour prendre des décisions économiques. C’est ce qui se passe dans une économie socialiste pleinement développée. Alternativement, le pouvoir social peut être utilisé pour influencer l’État, qui devient alors un mécanisme pour la transmission du pouvoir social à l’économie. Finalement, le pouvoir social peut être utilisé pour influencer la façon dont le pouvoir économique est utilisé dans l’économie. C’est ce qui se passe, par exemple, quand les syndicats influencent les décisions d’investissement.
Dans ce cadre, le pouvoir d’agir social (social empowerment[1]) veut dire l’extension de la portée du pouvoir des associations sur l’une de ces voies : ou directement au travers du pouvoir d’Etat, ou au travers de l’économie.
Sur la base de cette discussion, Wright fait une série de propositions concrètes (utopies réelles) susceptibles d’augmenter le pouvoir social par rapport à l’État et à l’économie.
En ce qui concerne l’Etat, Wright distingue entre trois formes de démocratie : démocratie directe (référendums et réunions locales), démocratie représentative (gouvernement par des représentants élus), et démocratie associative (gouvernement par groupes organisés). Le pouvoir d’agir social vis-à-vis de l’État, selon la conception de Wright, implique l’approfondissement de chacune de ces dimensions.
Son exemple principal de démocratie directe est le budget participatif, tel qu’il a été pratiqué à Porto Alegre, Brasil. Il considère également deux propositions pour l’approfondissement de la démocratie représentative : des bons électoraux universels, et un gouvernement par tirage au sort. La dernière forme d’approfondissement démocratique examinée par Wright est l’extension de la démocratie associative. D’après ce modèle, des associations volontaires comme les syndicats ou les organisations communautaires pourraient prendre en charge certaines fonctions bureaucratiques comme la mise en œuvre des décisions législatives. Le modèle de base d’une démocratie associative approfondie est le néocorporatisme pratiqué Europe du nord.
Dans la perspective de Wright, chacune des trois stratégies pour l’approfondissement de la démocratie peuvent se comprendre comme voie vers la subordination de l’Etat à la société civile.
En ce qui concerne l’économie, Wright examine quatre extensions du pouvoir social : l’économie sociale, le revenu universel de base sans conditions, le capitalisme social, et l’économie coopérative de marché.
L’économie sociale fait référence à une façon de produire et de distribuer des biens à travers des contributions bénévoles. L’exemple clé ici est Wikipédia, caractérisé par quatre aspects : contributions volontaires et bénévoles, participation ouverte et égalitaire, interactions délibératives directes entre les contributeurs, et gouvernance démocratique.
La deuxième voie proposée par Wright pour le pouvoir d’agir social dans l’économie est le revenu universel de base sans conditions. L’idée ici est de fournir un revenu universel au-dessus du seuil de pauvreté qui remplace tous les programmes de droits conditionnels. Un tel mécanisme accroîtrait le pouvoir du travail (sur les plans organisationnel et économique), et stimulerait le développement de l’économie sociale et de l’économie coopérative.
La troisième voie est celle du capitalisme social. Il s’agit là d’une série de stratégies pour l’exercice direct du pouvoir social sur l’économie capitaliste. L’exemple clé ici est l’organisation syndicale dont l’expression la plus radicale est le fonds d’investissement des salariés, où les entreprises payent une part de leurs impôts sous la forme d’actions réservées aux salariés. Petit à petit, ce processus pourrait déplacer le contrôle sur les entreprises et sur les décisions d’investissement, des propriétaires privés, vers des entités collectives gérées par la classe ouvrière.
La quatrième voie est ce que Wright appelle « l’économie coopérative du marché ». Les coopératives sont des entreprises démocratiquement gérées qui opèrent dans un environnement marchand. L’exemple clé ici est l’entreprise Mondragon, fondée dans le nord de l’Espagne vers la fin des années 1950. Chacune des coopératives particulières dans la fédération Mondragon est gérée démocratiquement et insérée dans une structure organisationnelle plus grande qui peut déplacer des ouvriers et des ressources d’une entreprise à une autre.
Comment ces propositions s’articulent-elles ? Wright résume leur logique ainsi : « un revenu de base peut faciliter la formation des coopératives et des entreprises relevant de l’économie sociale ; des formes diverses de capitalisme social peuvent contribuer à l’expansion de l’économie coopérative du marché ; tout cela peut renforcer l’attrait pour de nouvelles formes de socialisme participatif. »
Bien entendu, l’établissement d’un socialisme participatif exige une théorie et une stratégie de transformation. La dernière section du livre de Wright tente de satisfaire cette exigence.
Comme il le reconnaît :
« Afin de faire avancer les idéaux égalitaires démocratiques, il faut radicalement prolonger et approfondir le pouvoir d’agir social au sein des structures économiques dans les sociétés capitalistes, mais toute amélioration significative dans ce sens menacera les intérêts d’acteurs puissants qui bénéficient le plus des structures capitalistes et qui peuvent se servir de leur pouvoir pour s’opposer à un tel mouvement. »
La théorie de la transformation est censée expliquer comment le socialisme comme pouvoir d’agir social est possible face à cette résistance.
Wright distingue entre deux types de stratégies de transformation : celles qui impliquent une rupture décisive, et celles qui « prévoient une trajectoire de métamorphose soutenue sans moment de discontinuité au niveau du système ». Ces stratégies évolutionnistes comprennent « la transformation interstitielle » qui mine progressivement le capitalisme de l’intérieur, et « la transformation symbiotique » qui génère un compromis de classe à somme positive entre ouvriers et capitalistes. Il est clair d’après le texte que Wright préfère cette dernière approche.
La stratégie de transformation symbiotique maintient que le pouvoir d’agir social a plus de chances de succès quand elle « aide à résoudre certains problèmes réels auxquels font face les capitalistes et autres élites ». Le noyau théorique de la stratégie est que, dans des conditions particulières, il existe un rapport à somme positive entre le pouvoir associatif des ouvriers et les intérêts des capitalistes.
À des niveaux très faibles du pouvoir associatif de la classe ouvrière, davantage de pouvoir de cette classe menace les intérêts capitalistes. À des niveaux élevés du pouvoir associatif de la classe ouvrière, davantage de pouvoir associatif menace aussi les intérêts capitalistes. Mais entre ces deux niveaux, le pouvoir associatif de la classe ouvrière peut avoir un effet positif sur les intérêts capitalistes, car dans un compromis de classe keynésien pleinement développé, le pouvoir associatif de la classe ouvrière mène à des niveaux élevés d’utilisation des capacités et à une forte demande pour des produits. Il est également utile pour discipliner la croissance des salaires.
Le problème fondamental avec cette stratégie est que l’on ne sait pas si elle présente une voie viable pour transcender le capitalisme. Comme l’échec du plan Meidner en Suède le suggère[2], au-delà d’un certain niveau, les extensions du pouvoir associatif de la classe ouvrière produisent un retour de bâton automatique de la classe capitaliste. Wright semble reconnaître cette limitation dans une conclusion hésitante et prudente :
« Ce qui nous reste, alors, c’est un menu de logiques stratégiques et un pronostic indéterminé pour le futur. Le point de vue pessimiste serait que cette condition constitue notre destin, vivre dans un monde où le capitalisme reste hégémonique : il serait peu probable que des ruptures systémiques pour une alternative égalitaire démocratique au capitalisme puissent même réunir un soutien populaire de masse au sein des démocraties capitalistes développées ; des transformations interstitielles seraient limitées à des espaces restreints ; et les stratégies symbiotiques, lorsqu’elles réussissent, renforceraient la capacité hégémonique du capitalisme. Le point de vue optimiste serait que nous ne savons pas quels défis au système et quelles possibilités de transformation existeront dans le futur. »
Le projet de Wright est mieux compris comme une forme de marxisme néo-tocquevillien. Les éléments de base de sa critique dérivent de Marx. Mais sa conception du socialisme, et sa vision politique, doivent beaucoup plus à Tocqueville ou à Durkheim (même si aucun de ces deux auteurs n’est explicitement mentionné). Cela est clair à la fois dans sa conception du socialisme comme « pouvoir d’agir social » et non comme mode de production, et dans la stratégie politique qu’il préfère, fondée non sur la lutte des classes, mais sur la coopération sociale générale.
Quelles sont les forces et les faiblesses de cette synthèse ? Le projet d’utopies réelles propose deux contributions clés : il offre une conceptualisation rafraîchissante et plutôt convaincante du socialisme, et il expose une vision de la politique radicale à mon avis correcte sur le fond.
Le premier apport de Wright est de proposer une conception du socialisme qui distingue celui-ci du legs de l’autoritarisme. Dans cette perspective, la finalité du projet socialiste est d’accroître le poids du « social » en déterminant l’allocation des ressources. La force de cette position est évidente. En mettant l’accent sur le pouvoir social, Wright rétablit le lien fort entre la tradition associative et le socialisme, lien brisé par le léninisme classique. Ce faisant, Wright redynamise la tradition socialiste pour l’ère postcommuniste. C’est une contribution valable.
Le deuxième point fort du livre de Wright est qu’il dresse une liste claire et convaincante de ce que devraient être les exigences fondamentales d’une politique radicale dans une société capitaliste avancée. En premier lieu parmi celles-ci se trouve le revenu universel de base que chacun recevra simplement en vertu de son statut de citoyen. Cela éliminerait la pauvreté, augmenterait le pouvoir de négociation des travailleurs, et donnerait aux gens la capacité à créer de façon expérimentale des entreprises dans l’économie coopérative. Comme exigence à moyen terme, la proposition de Wright semble très raisonnable.
Malgré ses points forts, cependant, le cadre de l’utopie réelle souffre d’un défaut majeur qui, venant de Wright, est hautement paradoxal[3] : il n’y a pas de concept adéquat de classe. Ce défaut mène à trois problèmes importants : une conceptualisation du socialisme radicalement incomplète ; une série de présuppositions irréalistes sur la nature du capitalisme contemporain ; et une tendance à considérer la démocratie sociale comme une stratégie viable pour une politique radicale.
Je commencerai avec cette compréhension du socialisme comme pouvoir d’agir social. Sans aborder la question de classe, le lien entre extension du contrôle social de l’économie et le socialisme reste peu clair. Pour Wright, « le pouvoir d’agir social de l’économie signifie une démocratie économique englobante à une vaste échelle » et que « « le socialisme » est le terme pour la subordination du pouvoir économique au pouvoir social ». A mon avis, que la subordination de l’économique au social mène à la « démocratie économique » dépend lourdement de ceux qui détiennent le pouvoir social et de ce qu’ils essaient de faire avec ce pouvoir.
Autrement dit, je ne crois pas que « le pouvoir de classe » corresponde de manière simple aux trois formes de pouvoir décrites par Wright : économique, politique, et sociale.
Les capitalistes et les propriétaires terriens en particulier ont historiquement utilisé le pouvoir social très efficacement. Il existe de nombreux exemples où les entreprises et les agro-industries coopèrent pour partager la technologie, contrôler la production et les prix, établir des relations à long terme avec les fournisseurs, faire pression sur les gouvernements dans la poursuite de leurs intérêts, et exclure les ouvriers jugés politiquement indésirables.
Il est donc important de souligner que la pertinence du pouvoir social pour le socialisme dépend de la classe qui détient ce pouvoir. Sans précision de la sorte, il n’y a pas de raison de supposer que l’extension du pouvoir social en elle-même puisse mener au socialisme, ou même pousser la société dans la direction de celui-ci. Tel quel, il y a peu de raisons de l’adopter comme projet normatif. Ce faisant, Wright reproduit l’une des principales faiblesses de la tradition tocquevillienne : l’acceptation non critique de la « société civile » sans précision adéquate quant à la façon dont le pouvoir de classe façonne sa valence politique.
Le concept de pouvoir d’agir social employé par Wright pose un problème supplémentaire. Le pouvoir associatif n’est pas nécessairement une source indépendante de pouvoir, mais peut être produit et conditionné par le pouvoir économique. Les capitalistes peuvent assez facilement convertir leurs ressources en pouvoir associatif.
Comme le remarque Wright, « la manière primaire dont l’économie sociale est financée est à travers des dons caritatifs ». Mais une part substantielle de ces dons provient des capitalistes, et peut même servir à reproduire ou à renforcer leur pouvoir de classe. Cela étant, le pouvoir d’agir social défini par Wright est potentiellement compatible avec le renforcement du pouvoir de classe capitaliste.
En dépit de ces problèmes, l’idée centrale chez Wright concernant le socialisme reste valide. Mais elle a besoin de davantage de précision. Pour Wright, ce qui semble présenter l’attrait principal du pouvoir social tient à la délibération. Discutant le concept de « gouvernance participative avec pouvoir d’agir » dans Utopies réelles, il affirme que la pouvoir d’agir social est importante parce qu’elle permet de rationaliser la prise de décision. Dans cette perspective, l’extension du pouvoir social n’est pas vraiment une valeur en elle-même, mais un moyen d’établir une société rationnelle – et je crois que le socialisme n’est rien s’il n’est pas une société rationnelle.
A partir des termes de Wright, on peut reformuler le socialisme ainsi, d’après la définition du sociologue Ivan Szelényi[4]: un système de redistribution rationnelle dans lequel l’allocation du surplus social se justifie par une rationalité substantive.
Alors que la rationalité substantive telle que le comprend Szelényi s’enracine dans la doctrine téléologique du marxisme-léninisme, la conception de Wright, cependant, se garantit par des procédures délibératives. Seules de telles procédures peuvent garantir des décisions substantivement rationalistes, en ce qu’elles sont le produit d’un dialogue soutenu par des arguments et des preuves.
Le socialisme, donc, est un système où l’allocation du surplus social est déterminée non dans le dos des acteurs sociaux, mais par des accords fondés sur des discussions publiques gouvernées par les règles du discours rationnel critique.
Alors qu’elle maintient l’idée d’un socialisme fondé sur la délibération, cette formulation aurait deux grands avantages sur celle avancée par Wright.
D’abord, elle précise que le socialisme exige non seulement l’extension du « pouvoir social », mais aussi l’élimination du pouvoir de classe. Les corps délibératifs ne fonctionnent comme prévu que lorsqu’il existe une homogénéité fondamentale parmi les participants, afin qu’un débat se déroule selon la raison, et non comme une confrontation entre intérêts préconstitués. Le socialisme en tant que « redistribution rationnelle » ne peut exister que lorsqu’il existe une homogénéité fondamentale d’intérêts de classe dans des corps délibératifs. L’extension du pouvoir social impliquerait l’extension de la délibération uniquement dans ces conditions.
Ensuite, cette caractérisation du socialisme nous donne une base beaucoup plus claire pour faire la connexion entre démocratie et socialisme. Il n’y a pas deux demandes ancrées dans des engagements normatifs fondamentaux : démocratie et socialisme. Plutôt, parce que la prise de décisions ne peut être rationalisée qu’au travers d’un processus de délibération, et que le socialisme est un système de redistribution rationnelle, celui-ci doit nécessairement inclure beaucoup d’institutions délibératives.
L’oubli chez Wright du concept de classe se voit aussi dans sa conception du capitalisme, et surtout dans son analyse de sa trajectoire probable. Il peut sembler surprenant d’élever des objections contre sa théorie de la trajectoire, car il nie explicitement qu’il y en a une. Un examen détaillé de son livre, cependant, révèle de forts présupposés sur le développement futur du capitalisme et sur le rapport entre le capitalisme et l’État.
Pour Wright, le capitalisme est « une machine à croissance ». Les capitalistes tendent à innover afin de réduire les coûts unitaires et d’augmenter leurs bénéfices, car ils doivent faire face aux pressions compétitives venant des autres capitalistes. S’ils ne réussissent pas à innover, leurs entreprises seront éliminées. C’est là une définition non controversée du capitalisme, un bon résumé de son histoire récente et moins récente. Ce qui est important, c’est que la position de Wright implique une croyance en le dynamisme économique continu du capitalisme.
L’idée que le capitalisme continuera à être un système économique hautement productif sous-tend aussi la critique que fait Wright de la transformation de rupture (« briser le capitalisme »). Entre autres raisons, Wright rejette la transformation de rupture en tant que stratégie politique, car elle ne peut éviter de nuire au bien-être matériel de la « personne médiane ». Enchâssée dans cet argument se trouve l’idée qu’en l’absence de transition au socialisme, le niveau de bien-être continuera à accroître. De l’avis de Wright, les économies capitalistes continueront à générer de la croissance économique substantielle dans un avenir prévisible, et cette croissance tendra à faire augmenter le bien-être matériel des masses.
Wright avance aussi une théorie forte sur la relation entre l’État et le capitalisme. Selon lui, l’une des raisons principales pour laquelle la théorie marxienne de la crise est fausse est due au fait d’une sous-estimation, chez Marx, de la capacité des États à neutraliser les cycles économiques.
En outre, à son avis, et les marxistes et les anarchistes radicaux n’ont pas compris l’autonomie relative de l’État par rapport aux intérêts capitalistes. Cela donne à l’État la capacité à intervenir dans les processus économiques, « au risque de la politisation continue de l’économie capitaliste ».
Ainsi, « il est peu probable qu’on atteindra un jour un équilibre stable et durable dans l’articulation entre le pouvoir d’État capitaliste et l’économie capitaliste ; dans la durée, des épisodes cycliques de régulation/dérégulation/ré-régulation sont plus probables comme trajectoire. » L’Etat continuera donc à agir dans le futur comme il l’a fait dans le passé, dérégulant et ré-régulant la production capitaliste périodiquement.
Une tendance à la croissance sur le long terme, et à un État suffisamment indépendant de la classe capitaliste pour contrebalancer le cycle économique, tout en politisant des questions économiques, voilà la vision de base proposée par Wright de « l’histoire de l’avenir du capitalisme ».
Il vaut la peine de se demander d’où vient cette vision. On pourrait affirmer que cette image du capitalisme projette une période hautement spécifique de l’histoire économique (le long boom de 1945 à 1975) dans un futur indéfini. Cette période, cependant, se caractérisait par un rapport de force entre classes qui était, lui aussi, hautement spécifique. La classe ouvrière était relativement forte dans ces années-là, ce qui a limité la production de survaleur absolue, tout en accroissant dramatiquement la productivité.
En outre, on pourrait suggérer que le pouvoir relatif du travail fût une autre raison majeure pour l’émergence d’un État relativement autonome. Si ces arguments sont justes, il faut se demander si le capitalisme du futur ressemblera au capitalisme du boom d’après-guerre.
On n’a pas besoin d’être millénariste pour douter que ce soit le cas (du moins aux États-Unis et en Europe). Pendant les trente dernières années, la performance économique du capitalisme ne correspond pas, même partiellement, à son triomphe idéologique.
L’infrastructure à base de combustibles fossiles établie dans la période d’après-guerre n’a pas été fondamentalement transformée. La « nouvelle économie » n’est toujours pas au rendez-vous. Qui se souvient encore que le Japon et l’Italie du Nord étaient censés avoir créé un nouveau modèle de croissance économique appelé « spécialisation flexible » ? Que reste-t-il de l’idée que les technologies de l’information ouvriraient une nouvelle frontière de productivité et de prospérité ? Quid de la biotechnologie, ou de l’économie verte ?
Le travail de Wright suggère une raison importante pour expliquer cette performance économique distinctement peu convaincante : la désintégration de la classe ouvrière comme acteur cohérent. Il vaut la peine de se rappeler que, pour Marx, la formation des classes ne fut jamais une simple rallonge sociologique à son analyse fondamentale du développement capitaliste. Au lieu de cela, la formation des classes et la lutte des classes jouaient un rôle clé dans sa description de la dynamique du système.
En plaçant des limites à l’extension et à l’intensification de la journée du travail, la formation des classes (en particulier, la syndicalisation), en plus de la concurrence, était au centre du passage de la survaleur absolue à la survaleur relative, et donc à la croissance économique. Si le pouvoir associatif de la classe ouvrière s’est nettement affaibli dans les dernières décennies, on pourra s’attendre à un impact négatif sur la croissance et sur la productivité.
Pour résumer, l’oubli chez Wright du concept de classe ne déforme pas seulement sa vision du socialisme – il brouille aussi sa vision du capitalisme. Pour lui, ce dernier est un système économique éternel, et non un système qui a son histoire propre, marquée par des changements soudains dans le rapport de forces entre classes. Concrètement, cela implique que Wright tend à projeter les conditions sociales du long boom d’après-guerre dans un futur indéterminé, sans tenir compte de leur étayage historique particulier.
Cette façon de comprendre le capitalisme a des conséquences politiques importantes. Ce qui frappe le plus dans cet oubli du concept de classe, c’est l’approche de la stratégie, ce qui est le vrai centre d’intérêt du livre.
Les instincts politiques de Wright sont manifestement assez radicaux, mais ses recommandations stratégiques sont cruellement insuffisantes. Le problème de base est que Wright ne nous dit rien sur ce qui reste la tâche centrale d’une stratégie viable pour faire gagner le socialisme : détruire le pouvoir économique et politique profondément enraciné de la classe capitaliste. Sans stratégie plausible pour au moins décisivement affaiblir le pouvoir des propriétaires privés des moyens de production, on ne voit pas comment un revenu de base généreux (ou toute autre proposition parmi ses utopies réelles) pourrait être mis en place.
Il est peut-être injuste de reprocher à Wright lui-même la faiblesse de ses recommandations stratégiques. Loin d’être un simple échec intellectuel, ces faiblesses sont manifestement à l’image de la donne politique existante. Mais ce n’est pas tout. L’idée de stratégie proposée par Wright souffre d’une orientation sociale-démocrate débilitante qui s’éloigne d’un engagement réel avec la tradition socialiste révolutionnaire.
Cela se voit le plus clairement dans le contraste entre ses discussions des transformations symbiotiques et de rupture de son livre précédent. La plus grande part du court chapitre sur les transformations de rupture est consacrée à une critique fondée sur la prémisse que celles-ci seraient peu susceptibles d’être dans l’intérêt matériel de la majorité de la population. En revanche, le long et bienveillant chapitre sur les transformations symbiotiques ne consacre qu’un seul paragraphe aux critiques de la social-démocratie.
Un tel déséquilibre surprend, car les transformations de rupture sont les seuls exemples de transition réussie vers des sociétés non capitalistes, pour autoritaires qu’elles eussent été. Par contraste, la social-démocratie et l’anarchisme sont, dans la perspective de passage au socialisme, de clairs exemples d’échecs.
Wright évite de reconnaître ce fait évident, en appréhendant la société, non en totalité articulée, mais en structure hybride combinant des éléments de socialisme, de capitalisme et d’étatisme. De ce point de vue, même les États-Unis peuvent être classés comme pays « partiellement socialiste ».
Wright a raison, bien entendu, de dire qu’il est difficile d’établir empiriquement les limites de la réforme. Mais il semble bien qu’une sérieuse attaque contre la propriété en soit une. Dans la période de l’entre deux guerres, les exemples de l’Italie et de l’Espagne sont des rappels sévères des limites ultimes aux réformes socialistes en régime parlementaire normal. Plus récemment, l’échec du plan Meidner (1976) visant à donner aux ouvriers une voix directe dans les décisions d’investissement a déclenché un retour de bâton de la classe capitaliste suédoise. À la lumière de ces exemples historiques, il semble peu probable qu’une société socialiste participative puisse s’établir sans stratégie de transformation qui inclut une rupture décisive (mais qui n’est pas restreinte à celle-ci).
Il faut se saisir de la tradition marxiste révolutionnaire et la prolonger, et non la rejeter. À cet égard, on observe que Stratégies anticapitalistes au XXIe siècle déforme l’un des messages centraux de cette ligne de pensée.
L’expression « briser le capitalisme » n’apparaît nulle part dans les œuvres de Gramsci, Lénine, Luxemburg ou Trotski. En effet, le terme leur eût semblé absurde, car ils furent déterminés à bâtir sur les réussites économiques substantielles du capitalisme. Ce que Lénine appelait de ses vœux, c’était de « briser l’Etat », expression qui met l’accent sur le rapport structurel entre l’Etat et les relations capitalistes de propriété. Le socialisme serait construit dans le cadre d’un nouvel ordre politique, résultat d’un processus plus étendu et moins ponctuel qu’une révolution politique en soi.
Étant donné l’histoire des mouvements socialistes dans les États capitalistes, la suppression par Wright du moment révolutionnaire (ou de son équivalent fonctionnel) ne convainc pas. L’inauguration du socialisme ne ressemblera pas à l’introduction externe d’une espèce invasive pour la simple raison que les économies capitalistes, à la différence des écosystèmes, sont soutenues par des institutions politiques spécifiquement conçues pour éliminer de telles espèces dès qu’elles commencent à menacer le système.
En effet, la stratégie qui consiste à éroder le capitalisme demande une rupture politique préalable – une confrontation décisive avec l’État capitaliste. Réaliser l’utopie réelle de Wright exige alors une approche relevant moins de la biologie et plus de la stratégie militaire.
*
Cet article a d’abord été publié en anglais par Jacobin.
Traduit par David Buxton.
[1] Aux États-Unis, empowerment réfère à l’octroi de (nouveaux) droits ou de davantage de pouvoir à des individus ou des groupes dans le cadre de luttes sociales, identitaires ou communautaires ; on peut citer à cet égard le mouvement des droits civiques des Noirs et le mouvement féministe. Le terme renvoie aussi aux activités de community organizing (Saul Alinsky) et de démocratie participative, notamment dans le domaine de la santé (droits des malades). Aucune des solutions diverses pour le traduire en français n’est pleinement satisfaisante ; j’ai suivi l’option des traducteurs d’Utopies réelles en rendant systématiquement social empowerment par « pouvoir d’agir social ».
[2] Le plan Meidner fut élaboré par deux économistes de la Confédération des syndicats suédois (LO), Gosta Rehn (1913-96) et Rudolf Meidner (1914-2005) en 1971, et adopté en 1976. Il imposait aux sociétés d’au moins 50 employés la distribution d’actions propres à destination de ceux-ci, à raison de 20% de leurs bénéfices annuels. Expression d’une stratégie classiquement sociale-démocrate, le plan a échoué dans l’immédiat pour des raisons politiques (défaite du parti social-démocrate suédois en 1976), mais la dérégulation néolibérale de l’économie mondiale à partir de la même époque a empêché toute reprise ultérieure conséquente. En 2017, un article dans la revue américaine Jacobin a suscité un regain d’intérêt pour ce projet comme stratégie socialiste. Voir : https://www.jacobinmag.com/2017/08/sweden-social-democracy-meidner-plan-capital
[3] La quasi-totalité des travaux universitaires considérables de Wright ont traité justement la question des classes sociales (non traduits en français).
[4] Ivan Szelenyi (1938-), sociologue hongro-américain, expulsé de Hongrie en 1974, ensuite professeur à l’université de Yale, spécialiste des inégalités urbaines et des problèmes structurels du capitalisme.