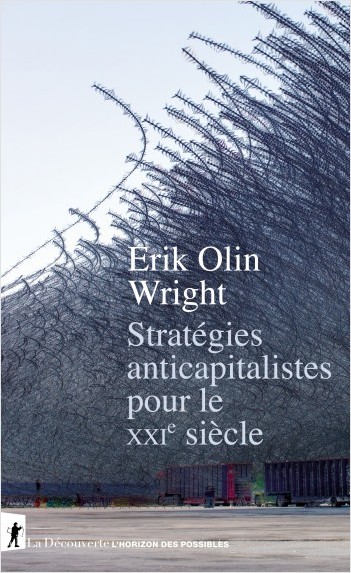
Contretemps a publié un article de Dylan Riley qui discutait les propositions stratégiques défendues par Erik Olin Wright dans ses derniers ouvrages, en particulier dans Utopies réelles et Stratégies anticapitalistes au XXIe siècle. Celui-ci, malheureusement décédé depuis, avait répondu en avril 2016 à son contradicteur, en affirmant qu’une rupture révolutionnaire n’est pas à l’horizon, mais que le capitalisme peut encore être vaincu.
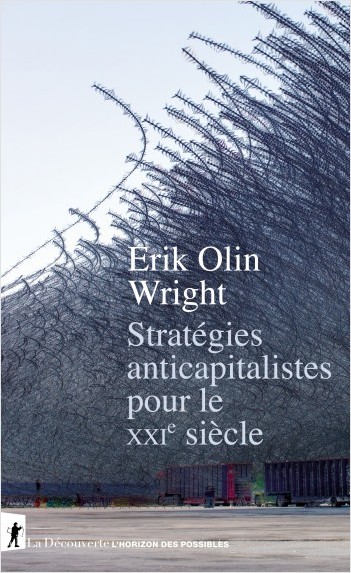
L’essai de Dylan Riley, « Quelle(s) stratégie(s) pour l’anticapitalisme ? »[1], soulève deux ensembles de critiques de mon livre Utopies réelles[2] (Envisioning Real Utopias) et de mon article paru dans la revue Jacobin « Comment être anticapitaliste aujourd’hui ? ».
La première concerne ma conception du socialisme comme alternative au capitalisme ; la seconde, mon approche des stratégies de transformation sociale nécessaires pour transcender le capitalisme.
Je pense que nous ne sommes pas, en fait, aussi éloignés dans notre compréhension du socialisme qu’il semble le penser, mais nous différons de manière fondamentale dans notre compréhension de la manière d’y parvenir.
Riley est très critique à l’égard de ma proposition de reformulation du concept de socialisme. Je décrirai d’abord brièvement mon argumentation, puis répondrai aux critiques de Riley.
Dans Utopies réelles, je soutiens qu’il existe trois types de pouvoir différents dans toutes les structures économiques : le pouvoir économique, basé sur le contrôle des ressources économiques ; le pouvoir de l’État, ancré dans le contrôle de l’élaboration et de la mise en œuvre des règles sur le territoire ; et le pouvoir social, que je définis comme un pouvoir ancré dans la capacité à mobiliser les gens pour des actions collectives volontaires et coopératives.
On peut alors distinguer différents types de structures économiques (ou modes de production) en fonction de celle de ces trois formes de pouvoir qui est la plus importante pour déterminer le contrôle du processus de production et l’extraction et l’utilisation du surplus social généré par la production.
Plus spécifiquement, le capitalisme peut être distingué en ces termes de deux alternatives post-capitalistes :
– Le Capitalisme est une structure économique dans laquelle les moyens de production appartiennent à des intérêts privés et où l’allocation et l’utilisation des ressources à des fins sociales se font par l’exercice du pouvoir économique. Les investissements et le contrôle de la production sont le résultat de l’exercice du pouvoir économique par les propriétaires du capital.
– L’Étatisme est une structure économique dans laquelle les moyens de production appartiennent à l’État et l’allocation et l’utilisation des ressources à des fins sociales sont réalisées par l’exercice du pouvoir de l’État. Les fonctionnaires de l’État contrôlent le processus d’investissement et la production par le biais d’une sorte de mécanisme administratif de l’État.
– Le Socialisme est une structure dans laquelle les moyens de production relèvent de la propriété sociale, et l’allocation et l’usage des ressources à des fins sociales différentes s’effectuent par l’exercice du « pouvoir social ».
En fait, cela équivaut à définir le socialisme comme une démocratie économique généralisée. La démocratie signifie « le pouvoir du peuple », mais cette expression ne signifie pas vraiment « le pouvoir par l’agrégation atomisée d’individus séparés au sein de société et pris comme des personnes isolées » ; elle signifie plutôt le pouvoir du peuple organisé collectivement en associations (partis, quartiers ou communautés d’intérêts, syndicats, etc.). Dans ce cas, le gouvernement de la société passe par l’exercice du pouvoir social.
Ces définitions du capitalisme, de l’étatisme et du socialisme sont des types idéaux. Dans le monde, les économies réelles sont des formes complexes de combinaison de ces rapports de pouvoir. Ce sont des écosystèmes de structures économiques qui varient en fonction de la manière dont ces différentes formes de pouvoir interagissent et se mélangent.
Appeler une économie « capitaliste » est donc un raccourci pour une expression plus lourde telle que « un écosystème économique combinant des rapports de force capitalistes, étatiques et socialistes au sein duquel les rapports capitalistes sont dominants ».
L’idée selon laquelle les économies sont des écosystèmes dominés par des rapports de production particuliers, peut être utilisée pour décrire n’importe quelle unité d’analyse – entreprises, secteurs, économies régionales, économies nationales et même l’économie mondiale. Ces rapports de forces s’interpénètrent également au sein des unités de production individuelles, de sorte que des entreprises peuvent être des hybrides opérant dans l’écosystème économique qui les entoure.
Là encore, face à une telle complexité, il est encore possible de qualifier une économie de « capitaliste » lorsque la forme de pouvoir propre au capitalisme – le pouvoir économique – est dominante dans le système économique global. Par exemple, dans toutes les économies capitalistes, le pouvoir d’État organise directement des formes importantes de production de biens et de services. L’économie reste cependant capitaliste dans la mesure où cet exercice du pouvoir de l’État dans l’économie est effectivement subordonné à l’exercice capitaliste du pouvoir économique.
l’État capitaliste comporte toutes sortes de mécanismes qui s’efforcent, avec plus ou moins de succès, de maintenir ce type de subordination. Par conséquence, si les économies capitalistes contiennent des formes de relations économiques étatiques, le système économique reste néanmoins capitaliste. Si ces mécanismes capitalistes de subordination du pouvoir étatique sont affaiblis par un processus quelconque, on peut alors dire que l’économie prend un caractère de plus en plus étatiste.
Avec cette compréhension des structures économiques, la possibilité du socialisme dépend de la possibilité d’élargir et d’approfondir la composante socialiste au sein de l’écosystème économique global et d’affaiblir les composantes capitaliste et étatique.
Cela signifierait que dans une économie socialiste, l’exercice du pouvoir économique et du pouvoir social serait effectivement subordonné au pouvoir social, c’est-à-dire que l’État et l’économie seraient tous deux démocratisés. C’est pourquoi le socialisme est l’équivalent d’une démocratisation radicale de la société.
Riley est d’accord avec l’idée que le socialisme implique une démocratisation radicale de l’économie et de l’État, mais il rejette ma formulation de cette idée en termes de pouvoir social au sein des économies capitalistes.
Il écrit :
« Les capitalistes et les propriétaires terriens en particulier ont historiquement utilisé le pouvoir social très efficacement. Il existe de nombreux exemples où les entreprises et les agro-industries coopèrent pour partager la technologie, contrôler la production et les prix, établir des relations à long terme avec les fournisseurs, faire pression sur les gouvernements dans la poursuite de leurs intérêts, et exclure les ouvriers jugés politiquement indésirables.
Il est donc important de souligner que la pertinence du pouvoir social pour le socialisme dépend de la classe qui détient ce pouvoir. Sans précision de la sorte, il n’y a pas de raison de supposer que l’extension du pouvoir social en elle-même puisse mener au socialisme, ou même pousser la société dans la direction de celui-ci. […]
Le concept de pouvoir d’agir social employé par Wright pose un problème supplémentaire. Le pouvoir associatif n’est pas nécessairement une source indépendante de pouvoir, mais peut être produit et conditionné par le pouvoir économique. Les capitalistes peuvent assez facilement convertir leurs ressources en pouvoir associatif. »
Les critiques de Riley reflètent ici une mauvaise compréhension de mon argument. Riley a tout à fait raison de dire que l’existence même du pouvoir social n’indique pas l’émergence de rapports socialistes. Lorsque l’association volontaire et l’action collective reflètent l’exercice du pouvoir de classe capitaliste, il s’agit d’une configuration capitaliste, comme dans les exemples cités par Riley d’entreprises coopérant pour divers objectifs.
Mais mon argument dans Utopies réelles n’est pas que le pouvoir social en tant que tel soit le critère du socialisme ; le critère est plutôt que le socialisme est basé sur la prééminence du pouvoir social dans la détermination de l’utilisation des ressources économiques et l’allocation du surplus.
Dire que le pouvoir social démocratique domine le pouvoir économique et le pouvoir de l’État signifie que la capacité d’action collective des travailleurs et des autres forces sociales populaires est la forme dominante de pouvoir dans l’économie. C’est une assertion sur les rapports de classe car elle décrit les relations de pouvoir au sein des rapports de production.
Si cela se produit au niveau du macro-système, nous pouvons appeler cette économie, socialiste. Lorsque cela se produit au sein d’organisations ou d’espaces économiques spécifiques, nous disons alors que ces organisations et espaces ont un caractère socialiste même s’ils existent au sein d’un système économique qui reste dominé par les rapports capitalistes.
Cette façon de comprendre la complexité des structures économiques a une base historique. La plupart des marxistes reconnaissent que des formes d’activité économique proto-capitalistes ont émergé au sein de sociétés encore féodales.
Le long et lent développement qui, au sein du féodalisme, a vu ces pratiques proto-capitalistes se muer en relations capitalistes, est au cœur de l’analyse de la transition du féodalisme au capitalisme en tant que formes dominantes d’organisation économique.
Le fait que l’émergence de rapports proto-capitalistes au sein du féodalisme a aidé les élites féodales à résoudre divers problèmes n’implique pas que ces nouveaux rapports n’étaient pas des précurseurs importants du capitalisme. Cela permet simplement d’expliquer certaines des conditions qui ont contribué à stabiliser ces nouveaux rapports et leur ont permis de s’enraciner et de se développer.
Ce qui est moins familier, c’est l’idée que des rapports de production socialistes peuvent émerger comme un trait saillant de la structure économique des économies capitalistes. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Où voit-on apparaître des rapports de production socialistes au sein du capitalisme ? En voici quelques exemples :
– Les coopératives ouvrières gérées par les travailleurs, dans lesquelles les moyens de production sont la propriété des travailleurs et la production est régie par des mécanismes démocratiques.
– L’économie sociale et solidaire dans laquelle la production est orientée vers la satisfaction des besoins et la gouvernance est organisée de manière démocratique ou quasi-démocratique.
– Les organismes fonciers solidaires [community land trusts[3]] dans lesquels des terrains sont soustraits au marché, leur utilisation établie par les conditions de l’organisme, lui-même régi par une sorte de conseil participatif communautaire.
– La production collaborative de valeurs d’usage en peer-to-peer, comme Wikipédia, ou le système d’exploitation Linux.
– La production de biens publics par l’État dans la mesure où l’État est démocratiquement subordonné au pouvoir social. Cela comprend un large éventail de biens et de services : services de soins – soins de santé, soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées ; équipements publics pour les événements et activités de quartier – maisons de quartier, parcs et installations de loisirs, théâtres, galeries d’art et musées ; éducation à tous les niveaux, y compris la formation continue, centres d’apprentissage tout au long de la vie et centres de remise à niveau des qualifications ; les infrastructures conventionnelles ainsi que toute une série de services publics.
Tous ces exemples, de différentes manières, incarnent certains aspects des rapports socialistes de production dans la mesure où les formes démocratiques de pouvoir social jouent un rôle important dans l’organisation des activités économiques. Mais bien sûr, ces exemples prennent aussi souvent une forme hybride dans laquelle les caractéristiques des relations capitalistes sont également présentes.
Les coopératives d’entreprises gérées par les travailleurs ont souvent des employés non-membres, par exemple. Les entreprises capitalistes peuvent payer certains de leurs employés pour participer à la production collaborative en peer-to-peer. Google paie certains de ses ingénieurs en logiciels pour contribuer au développement de Linux, même si Linux lui-même est un système de logiciels libres à code source ouvert qui fait partie du patrimoine créatif.
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire reçoivent parfois des subventions de fondations privées et de philanthropes dont les ressources proviennent d’investissements capitalistes. La fourniture de biens publics par l’État est souvent fortement influencée par le pouvoir capitaliste.
L’articulation des éléments capitalistes, étatistes et socialistes dans cet éventail complexe de formes sociales est désordonnée, ambiguë et contradictoire.
Néanmoins, les exemples ci-dessus constituent tous des formes d’organisation des activités économiques dans lesquelles le pouvoir social démocratique joue un certain rôle. Et dans la mesure où c’est le cas, nous pouvons les décrire comme des formes socialistes ou proto-socialistes au sein d’un système qui reste dominé par le capitalisme.
Riley rejette la stratégie qui consiste à « transformer les sociétés, qui sont des ensembles articulés, en structures hybrides combinant des éléments de socialisme, de capitalisme et d’étatisme. » Il ajoute avec mépris que « de ce point de vue, même les États-Unis peuvent être qualifiés de « partiellement socialistes » ».
Il a raison : je pense que les États-Unis sont « partiellement socialistes » précisément dans la mesure où ils contiennent déjà un ensemble significatif de formes économiques diverses qui auraient une place toute trouvée dans une économie socialiste.
La question est donc de savoir s’il est possible ou non de construire une stratégie pour le socialisme à partir d’une extension et d’un approfondissement de ces éléments socialistes au sein du capitalisme.
La vision générale des systèmes économiques exposée ci-dessus a des implications sur la façon dont nous envisageons la transformation sociale. En particulier, elle laisse entrevoir la possibilité d’alternatives à même de se développer à l’intérieur du monde tel qu’il est, et potentiellement, dans la durée, d’éroder la domination du capitalisme lui-même.
Dans mon précédent article dans la revue Jacobin, j’ai distingué quatre logiques stratégiques : briser, apprivoiser, fuir et éroder le capitalisme. Il n’est pas nécessaire ici d’entrer dans les détails de ces logiques. La stratégie de destruction correspond à l’idée classique de révolution. L’apprivoisement et l’érosion correspondent à peu près à l’idée de transformation au gré d’un processus plus graduel de réforme et de métamorphose.
Je rejette la plausibilité de la rupture et défends la possibilité de transformer le capitalisme par l’apprivoisement et l’érosion du capitalisme. Riley est très critique à l’égard de cette conclusion, soutenant qu’une rupture révolutionnaire est la condition nécessaire pour que ces stratégies plus progressives aient une chance réelle de fonctionner. Il écrit :
« Les instincts politiques de Wright sont manifestement assez radicaux, mais ses recommandations stratégiques sont cruellement insuffisantes. Le problème de base est que Wright ne nous dit rien sur ce qui reste la tâche centrale d’une stratégie viable pour faire gagner le socialisme : détruire le pouvoir économique et politique profondément enraciné de la classe capitaliste. Sans stratégie plausible pour au moins décisivement affaiblir le pouvoir des propriétaires privés des moyens de production, on ne voit pas comment un revenu de base généreux (ou toute autre proposition parmi ses utopies réelles) pourrait être mis en place. […]
En effet, la stratégie qui consiste à éroder le capitalisme demande une rupture politique préalable – une confrontation décisive avec l’État capitaliste. Réaliser l’utopie réelle de Wright exige alors une approche relevant moins de la biologie et plus de la stratégie militaire. »
Riley est particulièrement méprisant à l’égard de toute variété de social-démocratie, et donc très critique à l’égard de l’attention que je porte à l’exploration de la possibilité d’apprivoiser le capitalisme (décrite comme une « transformation symbiotique » dans mon livre).
« L’idée de stratégie proposée par Wright souffre d’une orientation sociale-démocrate débilitante qui s’éloigne d’un engagement réel avec la tradition socialiste révolutionnaire.
Cela se voit le plus clairement dans le contraste entre ses discussions des transformations symbiotiques et de rupture de son livre précédent. La plus grande part du court chapitre sur les transformations de rupture est consacrée à une critique fondée sur la prémisse que celles-ci seraient peu susceptibles d’être dans l’intérêt matériel de la majorité de la population. En revanche, le long et bienveillant chapitre sur les transformations symbiotiques ne consacre qu’un seul paragraphe aux critiques de la social-démocratie.
Un tel déséquilibre surprend, car les transformations de rupture sont les seuls exemples de transition réussie vers des sociétés non capitalistes, pour autoritaires qu’elles eussent été. Par contraste, la social-démocratie et l’anarchisme sont, dans la perspective de passage au socialisme, de clairs exemples d’échecs. »
Riley a certainement raison lorsqu’il affirme que les révolutions du XXe siècle « sont les seuls exemples de transitions de rupture réussies vers des sociétés non capitalistes », mais il ne s’agit guère d’une approbation des stratégies de rupture radicale, du moins si l’on admet que le résultat de ces tentatives a été un étatisme autoritaire plutôt qu’une alternative émancipatrice au capitalisme.
Mon argument n’a jamais été que les ruptures de transformation en tant que telles ne sont pas possibles, mais plutôt que les ruptures au niveau du système ne créent pas les conditions favorables à la construction du socialisme, compris comme une alternative démocratique, égalitaire et solidaire au capitalisme.
J’avance deux arguments principaux en faveur de l’invraisemblance des stratégies de rupture, en particulier dans les sociétés capitalistes complexes et avancées.
Premièrement, je soutiens que si un parti socialiste révolutionnaire prenait le pouvoir et lançait une rupture au niveau du système comme point de départ de la construction du socialisme, il en découlerait une longue transition au cours de laquelle le niveau de vie de la plupart des gens diminuerait considérablement. Même à supposer que la rupture se produise dans un contexte de déclin économique prolongé, les travailleurs en souffriraient considérablement.
Dans des conditions démocratiques (liberté d’expression et d’association avec des élections ouvertes et compétitives, etc.), il n’est pas plausible que la coalition politique pour la transition reste intacte pendant plusieurs cycles électoraux dans un contexte de profonde perturbation économique et de privation généralisée.
Il en résulterait, en cas d’élections, que le parti révolutionnaire en quête de rupture serait battu et que la transition serait inversée.
Deuxièmement, si, face à ces conditions, les socialistes refusaient d’abandonner le pouvoir et optaient pour une solution antidémocratique dans laquelle l’opposition serait réprimée, alors une transition hors du capitalisme pourrait être durable, mais la destination ne serait pas le socialisme tel qu’il est compris ici.
Étant donné le niveau de désordre social et de conflit qui serait déclenché dans ces conditions, la coercition exercée par un tel État ne consisterait pas simplement en des mesures d’urgence à court terme, mais serait institutionnalisée sous la forme d’un ample étatisme autoritaire.
Cela a certainement été le résultat de tentatives de ruptures anticapitalistes révolutionnaires au siècle dernier. La suggestion de Riley selon laquelle la « stratégie militaire » est la façon appropriée de penser la lutte pour transcender le capitalisme est une recette pour l’autodestruction des aspirations socialistes.
Mais qu’en est-il du jugement de Riley selon lequel « la social-démocratie et l’anarchisme sont, dans la perspective de la réalisation du socialisme, des exemples clairs d’échec » ? Il est certain que la social-démocratie du XXe siècle n’a jamais atteint le « socialisme » au sens de la création d’un système économique dans lequel des rapports socialistes étaient dominants.
En apprivoisant le capitalisme de manière à laisser une plus grande place aux rapports socialistes au sein des économies capitalistes, la social-démocratie a obtenu des succès significatifs pendant au moins un certain temps : la réduction spectaculaire des risques auxquels sont confrontés les travailleurs sur le marché du travail grâce à la démarchandisation partielle du travail, la fourniture d’un large éventail de biens et de services publics qui constituaient des composantes importantes du niveau de vie et amélioraient la qualité de vie, de modestes mesures de pouvoir d’agir social des travailleurs au sein des entreprises capitalistes par le biais des syndicats et des comités d’entreprise et d’autres mécanismes ainsi que la réalisation d’un faible niveau d’inégalité des revenus dans l’ensemble de l’économie.
Il est certain que le capitalisme est resté dominant ; tous ces développements se sont produits dans les limites imposées par le maintien du contrôle capitaliste sur l’investissement.
Mais cela ne signifie pas qu’ils ont été des échecs du point de vue socialiste : à son apogée, la social-démocratie d’Europe du Nord a présidé à un capitalisme moins capitaliste, un capitalisme avec un courant plus fort de socialisme (bien que toujours subordonné).
Le fait que cette évolution ait finalement été arrêtée et au moins partiellement inversée n’enlève rien à sa réussite.
Même si l’on accepte mon argument selon lequel les systèmes économiques capitalistes devraient être traités comme des écosystèmes hétérogènes dominés par le capitalisme plutôt que comme des ensembles, et que des organisations et des processus économiques socialistes peuvent exister au sein d’un système dominé par le capitalisme, il reste le problème soulevé par Dylan Riley selon lequel l’existence de l’État capitaliste garantit que de tels éléments ne pourraient jamais réellement agir comme des « espèces envahissantes » capables d’éroder la domination du capitalisme.
« L’avènement du socialisme ne ressemblera pas à l’introduction d’une espèce envahissante », écrit Riley, « pour la simple raison que les économies capitalistes, contrairement aux écosystèmes, sont soutenues par des institutions politiques qui sont spécifiquement conçues pour éliminer de telles espèces dès qu’elles commencent à menacer le système. »
L’intérêt central d’une rupture est donc de transformer l’État capitaliste de manière à en faire un instrument propre à faciliter la construction de relations économiques d’une nature différente.
Je ne suis pas d’accord avec cette vision. Bien que les structures de l’État capitaliste ne soient pas adaptées pour faciliter l’expansion des organisations socialistes, elles sont assaillies par suffisamment de contradictions internes pour ne pas nécessairement bloquer un tel développement.
Il existe en particulier une tension chronique dans les États capitalistes entre les impératifs de l’action de l’État à court terme pour stabiliser le capitalisme et les conséquences dynamiques à long terme de ces actions.
Ces incohérences temporelles peuvent devenir des contradictions dans lesquelles l’État capitaliste tolérerait, voire encouragerait des pratiques économiques ancrées dans le pouvoir social afin de résoudre des problèmes immédiats même si elles peuvent avoir des effets à long terme qui sapent la domination du capitalisme.
Les preuves historiques de cette possibilité se trouvent d’abord dans l’histoire du féodalisme, mais aussi dans l’expérience de la social-démocratie du XXe siècle. L’État féodal a facilité le capitalisme marchand même si, sur le long terme, la dynamique du capitalisme marchand a corrodé les rapports féodaux. Le capitalisme marchand permit de résoudre les problèmes immédiats de la classe dirigeante féodale, et c’est ce qui comptait.
Au milieu du XXe siècle, l’État capitaliste a également facilité la croissance d’un secteur public dynamique et la régulation publique du capitalisme avec l’aide de la social-démocratie. La social-démocratie a contribué à résoudre une série de problèmes au sein du capitalisme – elle a aidé à reproduire le capitalisme – tout en élargissant l’espace pour divers éléments socialistes dans l’écosystème économique.
Le fait que cet ensemble d’actions de l’État ait contribué à la stabilité du capitalisme du milieu du XXe siècle est parfois considéré comme une indication que ces politiques n’avaient rien d’anticapitaliste et qu’elles ne pouvaient en aucun cas être considérées comme corrosives pour le capitalisme.
C’est une erreur. Il est tout à fait possible qu’une forme d’intervention de l’État ait pour effet immédiat de résoudre les problèmes du capitalisme, voire de renforcer le capitalisme, et qu’elle mette néanmoins en route des dynamiques susceptibles d’éroder la domination du capitalisme.
En effet, c’est précisément cette propriété des initiatives sociales-démocrates qui a finalement conduit aux attaques, sous l’étendard du néolibéralisme, contre les empiétements de la social-démocratie sur le capitalisme. Les capitalistes en sont venus à considérer que l’expansion d’un État interventionniste devenait progressivement un frein à l’accumulation du capital.
Il est possible d’interpréter le succès puis le reflux de la social-démocratie comme la démonstration que des réformes au sein du capitalisme qui menacent le système ne sont pas durables. En fin de compte, l’État capitaliste remplit sa mission de protection du capitalisme en éliminant ces menaces.
L’autre interprétation est que la conclusion n’est pas aussi déterminée. Après tout, même après quatre décennies de néolibéralisme, de nombreuses réalisations de l’État-Providence restent en place.
La question qui se pose au XXIe siècle est donc de savoir si ce type de désarticulation temporelle est encore possible au sein de l’État capitaliste. Existe-t-il des interventions de l’État qui pourraient résoudre les problèmes urgents auxquels le capitalisme est confronté, mais qui, néanmoins, à long terme, pourraient élargir l’espace dans lequel des rapports économiques démocratiques et égalitaires pourraient se développer ?
Deux tendances laissent entrevoir des raisons d’être optimistes si l’on considère d’éventuelles initiatives étatiques qui pourraient favoriser l’érosion à long terme de la domination capitaliste
En premier lieu le réchauffement climatique qui risque de sonner le glas du néolibéralisme. Sans même prendre en compte la question de l’atténuation du changement climatique par une conversion à une production d’énergie non émettrice de carbone, les adaptations nécessaires au réchauffement climatique exigeront une expansion massive des biens publics fournis par l’État.
Le marché ne va tout simplement pas construire de digues pour protéger Manhattan. L’ampleur des ressources nécessaires à de telles interventions de l’État pourrait facilement atteindre les niveaux des grandes guerres du XXe siècle.
Même si les entreprises capitalistes tirent un jour d’énormes bénéfices de la production de ces biens publics et de ces infrastructures – tout comme elles tirent profit de la production militaire en temps de guerre – le financement de tels projets nécessitera des augmentations d’impôts substantielles et un effort idéologique pour réhabiliter le rôle de l’intervention de l’État dans la fourniture de biens publics.
Si ces processus se déroulent dans le cadre de la démocratie capitaliste, plus d’espace en sera disponible pour des interventions de l’État plus importantes et plus orientées vers les besoins sociaux.
La deuxième tendance à laquelle l’État capitaliste devra faire face est celle des effets à long terme sur l’emploi des changements technologiques de la révolution de l’information. Bien sûr, à chaque vague de changement technologique, on spécule sur la destruction d’emplois entrainant une marginalisation généralisée et un chômage structurel permanent, mais lors des vagues précédentes, la croissance économique finit par créer suffisamment d’emplois dans de nouveaux secteurs pour combler les déficits d’emploi.
Les formes d’automatisation de l’ère numérique, qui pénètrent maintenant profondément dans le secteur des services, y compris les secteurs des services professionnels, rendent beaucoup moins probable que la croissance économique future fournisse des possibilités d’emploi adéquates par le biais du marché capitaliste.
L’ampleur de ce problème est encore intensifiée par la mondialisation de la production capitaliste. Au cours du siècle, ces problèmes ne feront que s’aggraver et ne seront pas résolus par le fonctionnement spontané des forces du marché.
Il en résulte une précarité et une marginalisation croissantes d’une partie importante de la population. Même en dehors des considérations de justice sociale, cette évolution est susceptible d’engendrer une instabilité sociale et des conflits coûteux.
Ces deux tendances prises ensemble posent de nouveaux défis majeurs à l’État capitaliste : la nécessité d’une augmentation massive de la fourniture de biens publics pour faire face au changement climatique, et la nécessité de nouvelles politiques pour faire face à une large marginalisation économique causée par le changement technologique.
C’est dans ce contexte que les mobilisations et les luttes populaires ont une certaine chance de produire de nouvelles formes d’intervention de l’État qui pourraient soutenir l’expansion de formes d’activité économique plus démocratiques et égalitaires coexistant avec le capitalisme au sein de l’écosystème économique.
J’aimerais préciser mon propos en considérant le scénario suivant : la nécessité de faire face aux adaptations au changement climatique marque la fin du néolibéralisme et de ses contraintes idéologiques. L’État interventionniste se lance dans les grands projets de travaux publics nécessaires et joue également un rôle plus important dans la planification économique de la production d’énergie et des systèmes de transport afin d’accélérer la rupture avec l’énergie basée sur le carbone.
Dans ce contexte, l’éventail plus large des rôles de l’État revient à l’ordre du jour politique, en alliant notamment une compréhension plus large de la nécessité des biens publics et de la responsabilité de l’État en matière d’emploi face à la marginalisation et à l’inégalité économique croissantes. Mais le plein emploi par le biais du marché du travail capitaliste semble de plus en plus improbable.
Une approche pour répondre à ces défis est le Revenu de Base Inconditionnel (RBI), une proposition politique qui fait déjà l’objet d’un large débat public aujourd’hui.
Le concept est simple : chaque résident reçoit un revenu mensuel, sans conditions, suffisant pour vivre à un niveau de vie culturellement respectable, sans fioriture. Il est financé par l’impôt général et versé à chacun, quelle que soit sa situation économique.
Bien entendu, pour les personnes ayant un emploi bien rémunéré, les impôts augmenteraient plus que le RBI qu’elles reçoivent, de sorte que leur revenu net (salaires + RBI – impôts) diminuerait. Mais pour de nombreux contributeurs nets, l’existence d’une composante du revenu minimum vital dans leur revenu serait encore perçue comme un élément stabilisateur qui réduit les risques auxquels ils sont confrontés sur le marché du travail.
Un revenu de base peut concrétiser une intervention de l’État qui répond aux défis difficiles face à la diminution des possibilités d’emploi acceptables sur le marché capitaliste.
Du point de vue de la reproduction du capitalisme, le RBI accomplirait trois choses :
Premièrement, il atténuerait les pires effets de l’inégalité et de la pauvreté générés par la marginalisation, et contribuerait ainsi à la stabilité sociale.
Deuxièmement, il garantirait un modèle différent de travail générateur de revenus : la création d’emplois d’auto entrepreneurs pour générer des revenus disponibles pour les gens. Le RBI rendrait un large éventail d’emplois indépendants attrayants, même si les emplois d’auto-entrepreneurs ne dégagent pas suffisamment de revenus pour vivre. On peut imaginer, par exemple, que davantage de personnes seraient intéressées par le métier de petit agriculteur ou de jardinier si elles disposaient d’un RBI pour couvrir leur coût de vie de base.
Troisièmement, le RBI stabiliserait le marché de la consommation pour la production capitaliste. En tant que système de production, la production automatisée des entreprises capitalistes est intrinsèquement confrontée au problème du manque d’emploi global pour acheter les biens produits. Le RBI résoudrait une demande largement dispersée de biens de consommation de base.
Si un revenu de base inconditionnel est une solution attrayante aux problèmes auxquels le capitalisme est confronté, comment peut-il également contribuer à l’érosion du capitalisme ? Une caractéristique centrale du capitalisme est ce que Marx appelait la double séparation des travailleurs – séparation des moyens de production et des moyens de subsistance. Le revenu de base inconditionnel réunit les travailleurs avec les moyens de subsistance, même s’ils restent séparés des moyens de production.
Un revenu de base inconditionnel financé par l’impôt et fourni par l’État permettrait ainsi aux travailleurs de refuser l’emploi capitaliste et de choisir, à la place, de s’engager dans toutes sortes d’activités économiques non capitalistes, y compris celles provenant de l’économie sociale.
Les coopératives de travailleurs, par exemple, deviendraient beaucoup plus viables économiquement si les membres de la coopérative disposaient d’un revenu de base garanti indépendamment du succès commercial de la coopérative.
Le RBI contribuerait également à résoudre les problèmes du marché du crédit auxquels sont actuellement confrontées les coopératives de travailleurs en rendant les prêts de capitaux aux coopératives plus attractifs pour les banques : ces prêts deviendraient soudainement moins risqués puisque le flux de revenus généré par une coopérative n’aurait pas besoin de couvrir le niveau de vie de base de ses membres.
Le RBI garantirait une floraison de l’économie solidaire, des arts du spectacle non commerciaux, de l’activisme communautaire, et bien plus encore. Un revenu de base inconditionnel élargit ainsi l’espace pour des rapports économiques socialistes durables – dans le cadre du pouvoir d’agir social -.
Les mêmes développements technologiques qui créent le problème de la marginalisation peuvent aussi, ironiquement, contribuer à l’expansion et l’approfondissement d’activités économiques organisées de manière plus démocratique, égalitaire et solidaire.
L’une des conditions matérielles de la production qui contribue à ancrer le capitalisme est l’augmentation des économies d’échelle dans la production industrielle : lorsque les coûts unitaires de production de centaines de milliers de produits sont bien inférieurs à la production de quelques-uns seulement, il est difficile pour les petits producteurs d’être compétitifs sur le marché.
La caractéristique de l’ère industrielle du développement capitaliste est le retour massif à l’économie d’échelle. Les nouvelles technologies du XXIe siècle réduisent considérablement les économies d’échelle dans de nombreux secteurs, rendant la production à petite échelle et sur une base locale plus viable. Fondamentalement, la quantité de capital nécessaire pour acheter des moyens de production suffisants pour être compétitif sur le marché diminue dans un monde numérique.
Ceci, à son tour, est susceptible de rendre les entreprises d’économie solidaire et les coopératives de travailleurs associés plus viables, puisqu’elles opèrent plus efficacement à une échelle relativement petite sur des marchés locaux. Les changements à l’œuvre dans la production élargissent les possibilités de nouveaux rapports de production.
On peut envisager différentes politiques publiques, y compris au niveau local, susceptibles de stabiliser davantage un secteur non capitaliste dynamique. L’un des obstacles au développement de l’économie sociale est l’accès à l’espace physique : des terrains pour les jardins et les fermes communautaires, des ateliers pour la fabrication, des bureaux et des studios pour le design, des espaces de représentation pour les arts du spectacle, etc.
Les structures étatiques locales pourraient fournir ces espaces en tant qu’équipements publics afin d’encourager ces formes d’activité économique plus démocratiques et égalitaires.
Les fonds d’investissement fonciers communautaires pourraient soutenir l’agriculture urbaine. Les espaces de production publics ou subventionnés et les usines équipées d’imprimantes 3D et d’autres technologies de fabrication numérique pourraient soutenir la production matérielle. Les établissements d’enseignement pourraient également dispenser des formations spécifiques de gestion coopérative et de production sociale.
La combinaison d’un RBI accompagnant la sortie des gens du secteur capitaliste de l’économie, de nouvelles technologies au service de formes de production non capitalistes et d’un État local enclin à soutenir ces initiatives, signifie qu’avec le temps le secteur de l’économie sociale pourrait s’enraciner et connaître des développements imprévus.
Tout cela, il est important de le souligner, dans le cadre du capitalisme. Ces formes de production non capitalistes devraient inévitablement trouver des moyens de survivre au sein d’une économie capitaliste encore dominante. Il s’agirait donc d’avantager, d’une manière ou d’une autre, le secteur capitaliste.
De nombreux éléments du secteur non capitaliste seraient eux-mêmes produits par des entreprises capitalistes. Les producteurs du secteur non-capitaliste achèteraient une partie de leur consommation, peut-être la majorité, à des entreprises capitalistes. La production de biens publics par l’État impliquerait aussi souvent des contrats avec des entreprises capitalistes.
Même après la stabilisation de cette nouvelle configuration, l’État continuerait à superviser une économie au sein de laquelle le capitalisme resterait prédominant, et presque certainement dominant. Mais la domination du capitalisme serait réduite dans la mesure où il imposerait des contraintes beaucoup plus faibles sur la façon dont les gens gagnent leur vie. Cela ouvrirait de nouvelles possibilités aux luttes en cours pour élargir le champ du pouvoir social au sein de l’économie.
Il n’y a bien sûr rien d’inévitable dans cette trajectoire. Il n’y a en vérité aucune garantie qu’un revenu de base sera un jour institué et, même dans cette hypothèse, que le RBI serait accompagné d’initiatives de l’État afin de soutenir le développement de l’économie sociale.
Et il n’y a certainement aucune garantie qu’un revenu de base inconditionnel soit utilisé par ses bénéficiaires pour construire des structures économiques socialement autonomes.
Le RBI peut également être utilisé uniquement pour la consommation individuelle. Comme l’explique Philippe Van Parijs dans son livre Real Freedom For All (Oxford University Press, Oxford, 1995), le RBI redistribue la « vraie liberté » aux gens aussi bien pour les chercheurs de trésors ou les téléphages de canapé, qu’aux coopératives de travailleurs et à l’économie sociale.
Le spectre de ceux qui ne travaillent pas « exploitant » ceux qui travaillent est l’un des puissants arguments moraux contre le RBI. Ces assertions pourraient certainement bloquer les efforts politiques en faveur du RBI, ou du moins aboutir à l’ajout de conditions d’éligibilité qui constitueraient un frein au programme.
En outre, un revenu de base inconditionnel suffisamment généreux pour mettre en route une expansion dynamique des activités économiques non capitalistes serait coûteux, même s’il ne dépasse en aucun cas la capacité fiscale des États capitalistes. Il est donc probable que si un RBI devait être adopté, son montant serait inférieur à ce qui est nécessaire pour une vie dans des conditions acceptables. Cela compromettrait également le potentiel du RBI à avoir des effets anticapitalistes à long terme.
Pour ces raisons, les perspectives d’érosion du capitalisme par un revenu de base inconditionnel et d’autres interventions de l’État capitaliste, dépendent de manière significative de la mobilisation politique et des luttes pour l’État. Elles ne peuvent pas compter sur une prise de conscience éclairée des élites.
Si, comme le soutient Dylan Riley, la possibilité inscrite dans le caractère capitaliste de l’État, est limitée au point d’empêcher les actions de l’État ayant pour effet de favoriser la croissance de ce type de processus économique non-capitaliste, alors une telle mobilisation est condamnée par avance et les perspectives d’érosion du capitalisme sont lointaines.
Mais si des décalages entre la résolution des problèmes actuels et les conséquences futures sont possibles, et si les forces sociales populaires se mobilisent autour d’un programme de consolidation d’espaces économiques alternatifs, alors il est possible d’imaginer une expansion significative de l’activité économique construite autour de valeurs démocratiques, égalitaires et solidaires.
Cela pourrait constituer le fondement d’une trajectoire socialiste au-delà du capitalisme par le jeu de réformes venant d’en haut qui ouvriraient de nouveaux espaces pour le pouvoir social démocratique et d’initiatives venant d’en bas pour remplir ces espaces avec une nouvelle activité économique.
Bien sûr, je peux me tromper. Je suis un socialiste engagé et je veux développer une théorie de la société qui rende le socialisme possible. Il pourrait s’avérer que les systèmes économiques ne soient pas vraiment un écosystème dans lequel la domination du capitalisme puisse être érodée au fil du temps. Les contradictions internes de l’État capitaliste pourraient ne pas laisser d’ouvertures pour des réformes émancipatrices significatives. Une stratégie cohérente pour le socialisme pourrait donc ne pas être possible.
Nos connaissances actuelles sur le fonctionnement des systèmes sociaux est limitée. Face à l’ambiguïté et aux incertitudes sur l’avenir, il me semble néanmoins raisonnable de combiner l’objectif à long terme de dépassement du capitalisme avec les combats pour de nouveaux possibles, dans le cadre des contraintes du monde tel qu’il est. Une seule façon de tester la validité de cette proposition : s’efforcer de changer le monde.
*
Cet article a d’abord été publié en anglais par Jacobin.
Traduit par Christian Dubucq.
[1] Dylan Riley, « An Anticapitalism That Can Win », Jacobin, 07 janvier 2016.
[2] Utopies réelles, Paris, La Découverte, 2017.
[3] Formes d’organisations participatives apparues aux Etats-Unis dans les années 1970 et destinées à assurer une maîtrise du foncier et de l’immobilier pour répondre aux problèmes de logement rencontrés par les populations à faibles revenus, noires notamment, sur le marché privé [Ndt].