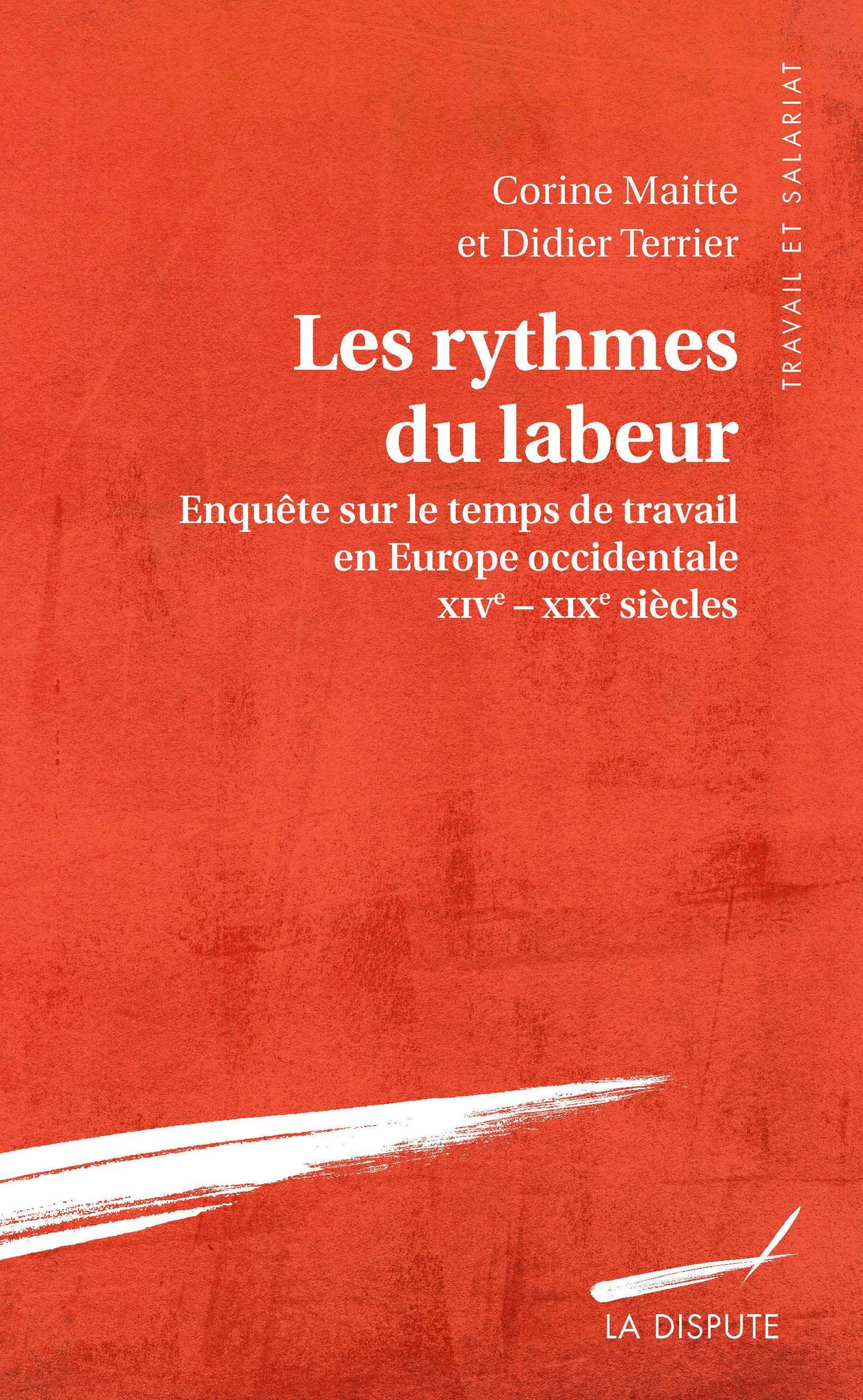
À propos de : Corinne Maitte et Didier Terrier, Les rythmes du labeur. Enquête sur le temps de travail en Europe occidentale XIVe-XIXe siècle, La Dispute, 2020, 432 p., 28 euros.
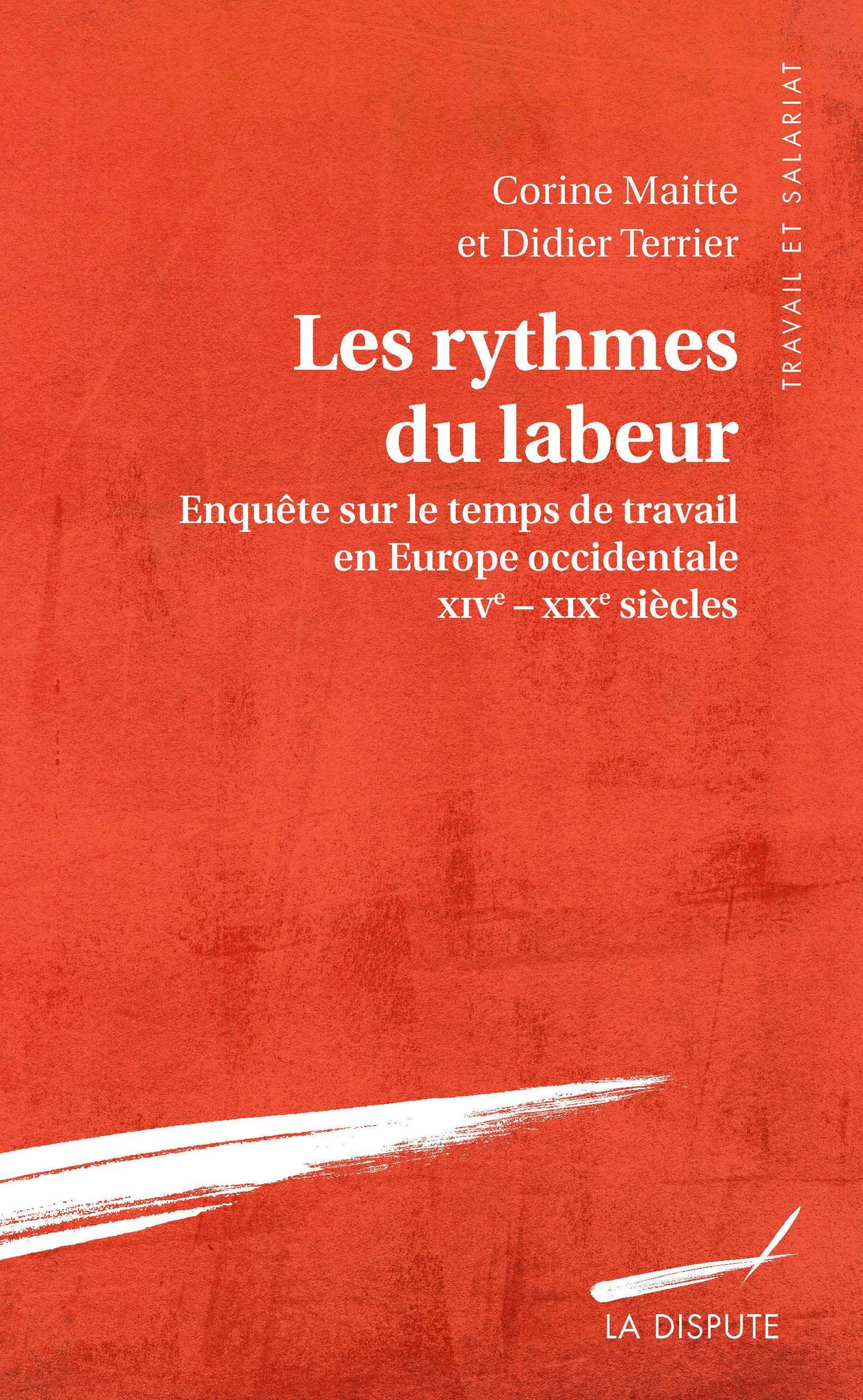
On doit à l’historien britannique Edward P. Thompson le consensus universitaire sur les évolutions du temps de travail en Europe occidentale. Selon lui, les transformations économiques des XVIIIe-XIXe siècles ont provoqué une révolution dans la manière d’appréhender le temps. Cette révolution aurait eu lieu en trois moments. Lors d’un premier moment, le travail est orienté par la tâche, interrompu par de nombreux jours fériés et fêtes populaires et le temps de travail est adossé au temps « naturel ». Lors d’un deuxième moment, suite à la révolution industrielle, le temps de travail devient de plus en plus long, à mesure qu’il s’intensifie et que les jours fériés et fêtes populaires sont supprimés. Puis, lors d’un troisième moment, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le temps de travail entame une lente réduction.
De nombreux auteurs ont prolongé par diverses moyens l’hypothèse de Thompson. Par exemple, Olivier Marchand et Claude Thélot ont tenté de fournir une vision d’ensemble de l’évolution du temps de travail en France. D’après les données qu’ils ont pu recueillir, le temps de travail se réduit de moitié entre les débuts du XIXe et le tournant du XXe siècle[1]. De la même manière, Michel Lallement parle d’un « tournant industriel »[2] dans l’histoire du temps de travail. Enfin, Jean-Yves Boulin et Laurent Lesnard attirent l’attention sur une progressive désacralisation du dimanche à l’aube de la société industrielle[3]. Si la plupart des auteurs apporte des spécifications et des clarifications, peu ont contesté le tableau d’ensemble. En ce sens, l’ouvrage de Corine Maitte et de Didier Terrier cherche à réfuter le consensus sur le temps de travail à partir d’une histoire qui commence au Moyen-âge et qui culmine à la fin du XIXe siècle.
Pour les auteurs, il faut donc « reprendre le dossier » de l’histoire du temps de travail. Pour cela, il faut commencer par la journée de travail, qui a longtemps été une unité de mesure pertinente pour penser le temps de travail. Selon l’hypothèse de Thompson, à l’époque pré-industrielle, le travail mesuré à la tâche domine et la journée est réglée selon la journée « naturelle ».
Pourtant, les auteurs remarquent que dès le Moyen Âge, on fait une distinction entre le « jour naturel » et le « jour artificiel ». On connaît des variations de la journée de travail selon les règlements corporatifs : on peut travailler 8 heures par jour ou 17 heures par jour selon le métier, même si de nombreux métiers se sont alignés sur la journée « naturelle » longue (avec un début du travail au lever du soleil et une fin du travail au coucher du soleil, donc à peu près 14 heures par jour). Cette durée semble très longue, pourtant les pauses pouvaient l’être aussi. Pendant les journées d’été, les ouvriers pouvaient bénéficier de plusieurs pauses d’une heure pendant la journée.
Enfin, des « heures supplémentaires » pouvaient exister au Moyen Âge, rarement rémunérées en tant que telles. Ainsi, on pouvait travailler des heures supplémentaires dans la draperie rouennaise au XVe siècle. On constate donc un aspect résolument moderne de la mesure du temps de travail, où « la journée peut être fractionnée en unités temporelles plus courtes dont la durée et la rémunération sont également des enjeux importants »[4].
On ne peut donc affirmer qu’avant la révolution industrielle prédomine un travail orienté par la tâche, et que le travailleur est par conséquent moins soumis à une discipline temporelle. Peut-on pour autant affirmer que l’organisation du temps de travail au XIXe siècle repose sur les très longues journées et sur la contrainte ? L’introduction des machines dans le procès de travail va considérablement modifier la donne, comme on verra plus loin. Pendant la seconde moitié du XIXe siècle en Europe se met en place un appareil législatif qui fixe une durée maximale du temps de travail. Pourtant, en matière de temps de travail, on ne peut que constater un décalage entre normes légales et durées effectives. Les auteurs montrent dans le cas de l’industrie textile du Nord une forte variation des horaires de travail au milieu du XIXe siècle. C’est-à-dire que les horaires annuels fixes officiels cachent des horaires effectifs variables dans divers secteurs d’activité.
Comment évaluer alors la durée de la journée de travail à l’époque pré-industrielle ? Travaille-t-on plus qu’aux siècles antérieurs, comme l’a longtemps affirmé le consensus historiographique ? Pour les auteurs, il est extrêmement difficile de répondre à une telle question, tant les horaires varient d’un secteur à un autre, voir même au sein d’un secteur à différents moments de l’année. De la même manière, les Maitte et Terrier constatent que le souci de ponctualité et la discipline temporelle, que Thompson associe à l’industrialisation, sont bien plus anciens. Ils s’ancrent dans les habitudes dans le temps long entre le XIVe et le XIXe siècle. On constate même dès le XIIIe siècle en Europe occidentale l’existence de cloches et de sonneries marquant le début et la fin du travail. Plus important, la mesure précise du temps de travail n’est pas seulement un enjeu crucial pour les employeurs, mais aussi pour les employés, qui cherchent à faire respecter les engagements des premiers. Toutefois, s’il existe très tôt des formes de discipline au travail, celles-ci peinent à s’imposer sur la main-d’œuvre.
Le consensus historiographique place la généralisation du travail de nuit entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Pourtant, on constate dès le XIIIe siècle l’existence du travail de nuit dans certaines corporations, notamment celles qui nécessitent un maintien de l’activité en continu. Par exemple, le « feu continu » dans la métallurgie contraint les ouvriers à travailler de jour comme de nuit. En revanche, ce que l’on voit apparaître à partir du XIXe siècle sont surtout des dénonciations des effets du travail de nuit, notamment dans les industries naissantes, telles que le textile.
Une dernière façon d’évaluer l’évolution du temps de travail entre l’époque pré-industrielle et l’époque industrielle est le nombre de jours fériés religieux. Selon l’hypothèse de Thompson et une partie importante de l’historiographie, le nombre de jours fériés se réduit avec l’âge industriel. Toujours selon le même schéma, les pays catholiques bénéficient davantage de jours fériés que les pays protestants. L’économie politique naissante plaide alors pour l’abolition de plusieurs jours fériés, au nom de la richesse des nations et au nom du rattrapage des pays protestants par des pays catholiques. Pourtant, selon les auteurs, il n’en est rien. L’idée que le protestantisme est une religion plus « industrieuse », en raison du moindre nombre de jours fériés, est un stéréotype qui ne peut être confirmée par les données : plusieurs jours fériés sont conservés de manière inégale dans des pays réformés, tandis que dans les pays catholiques on supprime les jours de fête selon les diocèses.
On peut noter une constante pendant toute la période étudiée : la tentative de discipliner ou de fidéliser la main-d’œuvre, que l’on soit un travailleur sans qualifications ou un travailleur qualifié. Le but des employeurs est de garantir la mise au travail des ouvriers ou de garantir la durée de l’engagement. Un des moyens employé est l’endettement : un ouvrier ne peut quitter son employeur sans avoir au préalable honoré ses dettes. À ceci s’ajoutent les règles qui limitent la mobilité des ouvriers tels que le livret ouvrier. On trouve aussi l’interdiction formelle de la Saint-Lundi, c’est-à-dire le fait de chômer volontairement le premier jour de la semaine. Ces mesures contraignantes persistent jusqu’au XXe siècle, allant contre l’idée que le XIXe siècle est le moment de l’émergence d’un marché du travail « libre » en Europe.
Ces différents efforts pour garantir le travail des ouvriers se conjuguent avec les efforts pour le rendre plus efficace. On rationalise l’espace et le temps afin de chasser les « temps morts », c’est-à-dire les temps passés « à ne rien faire ». Pour cela, on mesure et on quantifie le travail dès l’époque pré-industrielle, afin de définir ce qu’un ouvrier doit accomplir en une journée. La mécanisation du travail au XIXe siècle exacerbe ces tendances, car il s’agit de rentabiliser des investissements importants. Il ne s’agit plus seulement de travailler plus vite, mais de travailler de manière plus efficace. On cherche à économiser du travail et donc de la fatigue pour augmenter le temps de travail et la productivité :
« En un mot, plus la technique progresse et plus, paradoxalement, la machine humaine reste sollicitée à l’extrême limite de ses possibilités. Au cours des siècles antérieurs, les efforts des tondeurs, des verriers ou des métallurgistes sont là pour rappeler que ceci n’est pas nouveau. Mais il semble que la sollicitation de l’engagement plein et entier des ouvriers et des ouvrières dans le processus productif devienne la règle »[5].
Un âge pré-industriel où le temps de travail serait plus court, où il y aurait davantage de jours fériés, où le travail de nuit ou les horaires atypiques seraient exceptionnels, où le temps de travail ne serait pas mesuré par des unités précises, etc., est donc une reconstruction historique sans fondements. Les auteurs réussissent le pari d’une remise en cause de « l’idée simpliste d’une évolution linéaire de la forme et de la durée du travail »[6]. Pour eux, tout simplement, « il n’y a aucune évolution linéaire et générale » du temps de travail[7]. En ce qui concerne le travail de nuit, par exemple, « l’absence d’évolution est notable »[8] entre le XIXe siècle et les siècles précédents. Enfin, on peut lire dans la conclusion que « les mêmes objets de conflit apparaissent à des époques et dans des circonstances tout à fait différentes »[9].
Si l’ouvrage a pour mérite d’aller à l’encontre des conventions établies depuis longtemps dans l’histoire du temps de travail, on a aussi l’impression qu’il se perd dans des spécifications à l’infini. Les auteurs défendent une telle approche au nom du rejet des moyennes statistiques, dans la mesure où « le raisonnement par cas est le seul capable de saisir ce que pouvait être le rapport au temps et au travail des hommes et des femmes du passé »[10].
Cependant, on peut se demander si une telle approche ne constitue pas un obstacle tout aussi important à la connaissance de l’évolution des temps de travail. Un des apports de la sociologie et tout particulièrement de la sociologie du temps de travail est de ne s’en tenir ni aux moyennes statistiques, qui s’appuient sur un travailleur « moyen » inexistant, ni sur la multiplication d’études de cas qui empêchent toute généralisation. Ainsi, réfléchir en termes de normes temporelles a pu être une manière de sortir de la fausse alternative entre approche exclusivement quantitativiste et une accumulation d’études de cas. À ce sujet, Paul Bouffartigue avance l’idée que des normes temporelles se font concurrence et que certaines peuvent prendre le dessus sur d’autres au gré des transformations du capitalisme[11].
Un des principaux problèmes soulevés par le livre tient à la définition même de travail. Peut-on dire que le travail en tant que catégorie sociale homogène existe dans les sociétés pré-industrielles ? Comme le constatent les auteurs eux-mêmes, ce problème se pose tout particulièrement pour le travail non rémunéré. Comment mesurer le temps qu’un paysan passe à travailler « pour lui » dans son foyer ? Constitue-t-il du travail à proprement parler ? Comment mesurer le temps de travail des enfants, alors que ceux-ci ne reçoivent souvent aucune rémunération pour leur activité, ce qui souvent ne laisse aucune trace ? Peut-on comparer le travail (et donc le temps de travail) des artisans et la corvée royale ? Peut-on comparer le travail dans les villes avec le travail accompli dans des régions rurales, où le travail salarié est une activité ponctuelle, contrairement aux activités d’auto-subsistance ? Les auteurs sont conscients des difficultés pour mesurer et comparer différents travaux à l’époque pré-industrielle, notamment lorsqu’ils citent une série de cas d’individus poursuivis par la justice et pour qui le « travail » n’est qu’un à côté :
« Pour tous, le travail n’est qu’une façon parmi d’autres, sans doute pas la plus importante, d’essayer d’attraper le bout de l’année. Tout décompte du temps de travail devient alors parfaitement illusoire »[12].
La place qu’occupe le travail dans les sociétés pré-industrielles fait encore débat[13]. On peut se référer aux travaux de Dominique Méda, pour qui il faut attendre le XVIIIe siècle pour que l’on puisse parler de travail comme catégorie sociale homogène désignant une activité productrice de marchandises[14]. Elle rappelle que certaines sociétés pré-industrielles n’ont tout simplement pas de mot unique pour désigner les activités productives, c’est-à-dire l’ensemble d’activités visant à produire les moyens matériels d’existence. Tandis que pour d’autres, le travail désigne les activités non productives. S’il existe déjà une « théologie du travail » au Moyen Âge largement répandue[15], Méda rappelle qu’à cette époque il n’existe pas encore de définition homogène du travail.
À ce constat on peut ajouter, à la suite d’Andrea Komlosy, qu’on ne peut pas comprendre ce qu’est le travail dans les sociétés pré-industrielles sans se référer à la multitude de cadres sociaux dans lesquels il est exercé : le travail d’auto-subsistance, le travail collectif pour la communauté, le travail au service d’une autorité et, enfin, sous une forme minoritaire, le travail comme marchandise[16]. À cela, elle ajoute que différentes relations de travail déterminent également ce que l’on comprend comme travail ou non travail : travail indépendant/dépendant, travail libre/contraint, travail honnête/déshonorant, volontaire/forcé, rémunéré/non rémunéré, etc. Enfin, on peut ajouter qu’il est difficile de comprendre le travail du Moyen Âge à nos jours en le distinguant de la sphère domestique pendant toute la période pré-industrielle. En effet, cette séparation n’est devenue une réalité suite à la révolution industrielle que pour une minorité de la main-d’œuvre en Europe.
[1] Olivier Marchand et Claude Thélot, 1997, Le travail en France (1800-2000), Paris, Nathan.
[2] Michel Lallement, 2003, Temps, travail et modes de vie, PUF, p. 20.
[3] Jean-Yves Boulin et Laurent Lesnard, 2017, Les batailles du dimanche, PUF.
[4] Corinne Maitte et Didier Terrier, 2020, Les rythmes du labeur. Enquête sur le temps de travail en Europe occidentale XIVe-XIXe siècle, La Dispute, p. 62.
[5] Maitte et Terrier, op. cit., p. 342.
[6] Ibid., p. 387.
[7] Ibid., p. 66.
[8] Ibid., p. p. 161.
[9] Ibid.., p. p. 386.
[10] Ibid.., p. 390.
[11] Paul Bouffartigue (avec Jacques Bouteiller), 2012, Temps de travail et temps de vie, PUF.
[12] Maitte et Terrier, op. cit., p. 239.
[13] Jean-Philippe Deranty, « Cartographie critique des objections historicistes à la centralité du travail », Travailler, 2013, n° 30-2, p. 17-47.
[14] Dominique Méda, 2010, Le travail. Une valeur en voie de disparition ?, Flammarion.
[15] Idem.
[16] Andrea Komlosy, 2018, Work. The Last 1,000 Years, Verso.